Lavenir-De-Leurope-Est-Au-Sud.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1008-Novembre-2018-Financement.Pdf
www.cfcim.org 56e année Numéro 1008 15 novembre - 15 décembre 2018 Dispensé de timbrage autorisation n° 956 L’INVITÉ DE CONJONCTURE NOUREDDINE BENSOUDA Les nouveaux modes de financement Quelles alternatives pour les entreprises ? Forum d’Aff aires Inauguration de L’actualité des L’actualité vue par le Maroc-France à l’incubateur du Kluster Délégations Régionales Service économique de Laâyoune CFCIM de la CFCIM l’Ambassade de France Editorial Les nouveaux modes de financement. Quelles alternatives pour les entreprises ? Philippe-Edern KLEIN Président Rétablir la confiance pour mieux soutenir les entreprises Les entreprises marocaines, notamment les TPE et PME, sont confrontées à des difficultés chroniques de financement, que ce soit pour soutenir leur développement ou tout simplement pour assurer leur cycle d’exploitation. Ce fi nancement est en eff et indispensable pour les aider à passer chaque étape clé de leur évolution. Si toutes les entreprises n’ont pas forcément accès aux prêts bancaires ou aux marchés fi nanciers du fait de leur manque d’antériorité ou en raison du risque qu’elles représentent, elles disposent aujourd’hui de nouvelles alternatives telles que le crowdfunding, la fi nance participative ou encore les business angels. Ces nouveaux dispositifs, dotés progressivement d’un cadre juridique, sont amenés à connaître un fort développement dans les prochaines années au Maroc. Ils devraient contribuer à encourager l’esprit d’entrepreneuriat, mais aussi à rétablir la confi ance entre investisseurs, fi nanciers et entreprises, et ainsi participer à l’amélioration globale du climat des aff aires. Ce mois-ci, Conjoncture revient sur un très bel événement : le Forum d’Aff aires Maroc-France de Laâyoune, organisé par la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra et la CFCIM. -
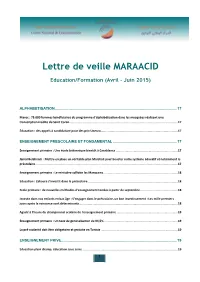
Education/Formation (Avril - Juin 2015)
Lettre de veille MARAACID Education/Formation (Avril - Juin 2015) ALPHABETISATION .................................................................................................................... 17 Maroc : 75.000 femmes bénéficiaires du programme d'alphabétisation dans les mosquées réalisent une transcription inédite du Saint Coran ..........................................................................................................................17 Éducation : des appels à candidature pour des prix Unesco .......................................................................................17 ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET FONDAMENTAL ............................................................. 17 Enseignement primaire : Une école britannique bientôt à Casablanca ......................................................................17 Jamal Belahrach : Mettre en place un véritable plan Marshall pour booster notre système éducatif et notamment le préscolaire .................................................................................................................................................................17 Enseignement primaire : Le ministère sollicite les Marocains ....................................................................................18 Education : Zakoura s’investit dans le préscolaire .....................................................................................................18 Ecole primaire : de nouvelles méthodes d'enseignement testées à partir de septembre ...........................................18 -

14Th Annual Stevie Awards for Women in Business
14th Annual Stevie® Awards for Women In Business AWARDS BANQUET AND CEREMONIES Friday, November 17, 2017 Marriott Marquis Hotel, New York, New York RED LADDER WOMEN IN TECHNOLOGY AWARDS SPONSORED BY ڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟ ڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟ Welcome to the 2017 Stevie® Awards for Women in Business. We welcome the 500+ nominated, amazing women and their guests who’ve gathered tonight for our 14th annual Women in Business Awards dinner. We also welcome the thousands of people around the world who will watch our Livestream broadcast of the awards presentations, and our live “red carpet” pre-show via Facebook Live. This year’s Stevie Awards for Women in Business received more than 1,500 entries from individuals and organizations in 25 nations. More than 170 professionals around the world participated in the judging process in September– October. The average scores of judges determined the Finalists and the Gold, Silver and Bronze Stevie Award placements that will be revealed tonight. All judges are acknowledged in this program. At the conclusion of tonight’s ceremony we’ll present Grand Stevie Award trophies to the five organizations that submitted the best body of entries to this year’s competition — be sure to stay till the end! I invite you to stay abreast of what’s new in the world of Stevie at our web site, StevieAwards.com, and through our presence on Facebook, LinkedIn, and Twitter. Thank you for coming tonight. I know you’ll enjoy yourself! Cordially, Michael Gallagher President The Stevie Awards Program Contents Mistress of Ceremonies -

Liste Des Auditions, Contributions Et Activités De La Commission Spéciale Sur Le Modèle De Développement
Liste des auditions, contributions et activités de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ANNEXE 3 AVRIL 2021 Liste des auditions, contributions et activités de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ANNEXE 3 AVRIL 2021 SOMMAIRE PARTIE I - AUDITIONS ET CONTRIBUTIONS ...............................................................7 INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES .........................................................................9 ACTEURS PUBLICS ......................................................................................................10 PARTIS POLITIQUES ....................................................................................................13 MONDE PROFESSIONNEL ET PARTENAIRES SOCIAUX ...............................................16 TIERS SECTEUR ...........................................................................................................19 AMBASSADEURS ET ACTEURS INTERNATIONAUX ....................................................26 CONFÉRENCES LABELLISÉES .....................................................................................27 ÉCOUTES CITOYENNES ET VISITES DE TERRAIN ......................................................29 Les écoutes citoyennes : 3 formats ...............................................................................29 Table ronde ...............................................................................................................30 Cycle de Rencontres Régionales ..................................................................................30 -

Aufaitmaroc.Com Edito Finances Publiques Encore De Contribution Et Gestion Des La Marge De Affaires Des MRE > P/06 Manœuvre
MARDI 14 février 2012 Proche-Orient. Palestiniens et Croissance économique. Casablanca 5 16 Arabes pour une conférence de Nizar Baraka table sur 5% pour 2011>p/07 Rabat 3 15 paix internationale>p/08 Journal Quotidien d’Information Générale • Edition du mardi 14 février 2012 • n°1126 • Prix: 0 Dh Can 2012 : Le bel hommage des Chipolopolos > p/15 www.aufaitmaroc.com Edito Finances publiques Encore de Contribution et gestion des la marge de affaires des MRE > p/06 manœuvre Nos indicateurs économiques ne sont pas très bons aujourd’hui mais ils ne sont pas mauvais au point de revoir notre politique monétaire. C’est un peu en Synergie dans substance la réaction de Nizar Baraka suite aux rumeurs sur une dévaluation probable. Les derniers chiffres confirment cette position. La dette publique est constituée principalement d’une dette intérieure à hauteur de 314 milliards de dirhams et la stratégie n’atteint pas encore les som- mets franchis par les pays euro- péens en difficulté. La baisse du taux de change du dirham n’ap- portera aucun allègement. De même, cette baisse éventuelle selon Nizar Baraka, ne pourra entraîner aucune baisse de nos ministérielle importations ou de nos exporta- tions. Les restrictions et les mesures économiques importantes que doivent effectuer aujourd’hui des pays comme la Grèce, l’Es- pagne et le Portugal sous la pression de l’Union européenne, le Maroc les a déjà connues dans les années 90 sous la pression de la banque mondiale. On n'avait pas pu baisser les salaires parce qu’ils étaient déjà très bas, mais beaucoup de sociétés publiques avaient été vendues, les inves- tissements avaient été ralentis et la dette intérieure a remplacé progressivement notre endette- ment international. -
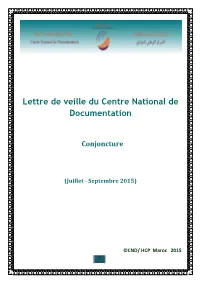
Finances Publiques
Lettre de veille du Centre National de Documentation Conjoncture (Juillet - Septembre 2015) ©CND/ HCP Maroc 2015 1 Lettre de veille CND Maraacid Conjoncture (Juillet - Septembre 2015) Sommaire CONJONCTURE ECONOMIQUE ................................................................................................. 15 « Sud : vers une nouvelle crise de la dette ? ..............................................................................................................15 Risque pays : le Maroc s’en sort bien .........................................................................................................................15 Les activités non agricoles ne redémarrent pas .........................................................................................................15 La note de conjoncture économique nationale n°223 , septembre 2015 ...................................................................15 Chine-Afrique : une autre idée de l'économie mondiale de demain ..........................................................................15 Accord entre le Crédit du Maroc et l'ASMEX pour l'accompagnement des exportateurs ...........................................16 Ralentissement en Chine: Quel impact sur l’économie mondiale et le Maroc ? .........................................................16 Une mission économique belge prospecte les opportunités d'affaires et d'investissement à Tanger ........................16 L'économie collaborative, nouvelle frontière des assureurs ......................................................................................17 -
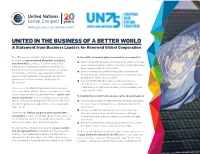
Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation
UNITED IN THE BUSINESS OF A BETTER WORLD A Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation The 75th anniversary of the United Nations comes In the spirit of renewed global cooperation, we commit to: at a time of unprecedented disruption and global ▪ Demonstrate ethical leadership and good governance through transformation, serving as a stark reminder that values-based strategies, policies, operations and relationships international cooperation must be mobilized across when engaging with all stakeholders borders, sectors and generations to adapt to changing ▪ Invest in addressing systemic inequalities and injustices circumstances. This message emerged loud and through inclusive, participatory and representative decision- clear from the hundreds of thousands of people who making at all levels of our business participated in global dialogues initiated by the ▪ Partner with the UN, Government and civil society to UN this year. strengthen access to justice, ensure accountability and In the face of the COVID-19 pandemic and converging transparency, provide legal certainty, promote equality and crises — including climate change, economic uncertainty, respect human rights social inequality and rising disinformation — public and In making that commitment, we also call on Governments to: private institutions need to show they are accountable, ethical, inclusive and transparent. This is the only way to ▪ Protect human rights, ensure peace and security, and uphold strengthen public trust and achieve a more sustainable the rule of law so that businesses, individuals and societies future for all. can flourish ▪ Create an enabling environment to serve the interests Over time, the UN has sought to unite stakeholders of people and planet, prosperity and purpose, through everywhere to tackle the world’s greatest challenges. -
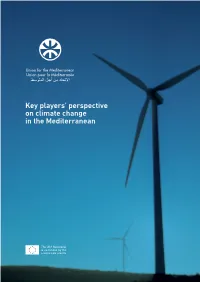
Key Players' Perspective on Climate Change in the Mediterranean
Union for the Mediterranean Key players’ perspective on climate change in the Mediterranean UfM – Key players’ perspective on climate change in the Mediterranean 1 Key players’ perspective on climate change in the Mediterranean TABLE OF CONTENTS Table of Contents 4 Preface – Mr Fathallah Sijilmassi, UfM Secretary General 6 The Paris Agreement provides a new push for a Mediterranean climate agenda – Mrs Ségolène Royal, President of the 21st Conference of Parties to the UNFCCC 8 The Mediterranean emergency – Ms Hakima El Haite, Moroccan Minister of the Environment, Climate Champion, Member of the COP22 Mediterranean Steering Committee 10 Making the Mediterranean a laboratory for international climate action – Mr Miguel Arias Cañete, EU Commissioner for Climate Action & Energy PART 1: CLIMATE CHANGE CHALLENGES IN THE MEDITERRANEAN 15 Regional dialogue and knowledge sharing for feeding the Mediterranean’s future – Prof Masum Burak, President of CIHEAM 20 The consequence of water scarcity on regional stability – Mr Munqeth Mehyar, Chairman and Jordanian Director of EcoPeace Middle East 22 Challenges for stability and peace in the Mediterranean region – Mr Senén Florensa i Palau, President of the Executive Committee of the European Institute of the Mediterranean (IEMed) 24 Climate change and development: same fight – Prof Jean-Paul Moatti, Chief Executive Officer of the French Research Institute for Development (IRD) 27 Impacts of climate change on Mediterranean coastal zones – Prof Maria Snoussi, Professor at the Mohammed V University, Rabat, -

Pdfs/WORLD%20PORT%20 RANKINGS%202011.Pdf AVANT-PROPOS - 27
N° 108 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2013 RAPPORT D’INFORMATION FAIT au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur la rive Sud de la Méditerranée, une zone de prospérité à construire, Par Mme Josette DURRIEU et M. Christian CAMBON, Sénateurs. (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère, président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner, vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard, secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini. - 3 - SOMMAIRE Pages INTRODUCTION ................................................................................................................... -

UNITED in the BUSINESS of a BETTER WORLD a Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation
UNITED IN THE BUSINESS OF A BETTER WORLD A Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation The 75th anniversary of the United Nations comes In the spirit of renewed global cooperation, we commit to: at a time of unprecedented disruption and global ▪ Demonstrate ethical leadership and good governance through transformation, serving as a stark reminder that values-based strategies, policies, operations and relationships international cooperation must be mobilized across when engaging with all stakeholders borders, sectors and generations to adapt to changing ▪ Invest in addressing systemic inequalities and injustices circumstances. This message emerged loud and through inclusive, participatory and representative decision- clear from the hundreds of thousands of people who making at all levels of our business participated in global dialogues initiated by the ▪ Partner with the UN, Government and civil society to UN this year. strengthen access to justice, ensure accountability and In the face of the COVID-19 pandemic and converging transparency, provide legal certainty, promote equality and crises — including climate change, economic uncertainty, respect human rights social inequality and rising disinformation — public and In making that commitment, we also call on Governments to: private institutions need to show they are accountable, ethical, inclusive and transparent. This is the only way to ▪ Protect human rights, ensure peace and security, and uphold strengthen public trust and achieve a more sustainable the rule of law so that businesses, individuals and societies future for all. can flourish ▪ Create an enabling environment to serve the interests Over time, the UN has sought to unite stakeholders of people and planet, prosperity and purpose, through everywhere to tackle the world’s greatest challenges. -

Israeli Bypass Water Project in the Jordan Valley
UPDATE IN THE PIPELINE: ISRAELI BYPASS WATER PROJECT IN THE JORDAN VALLEY FEBRUARY 2020 This update examines the construction of tlement enterprise at the expense of Pales- a bypass water pipeline on the lands of the tinian communities. The project’s execution Palestinian village of Bardala in the northern is made possible due to the involvement of Jordan Valley in the occupied West Bank. The Israeli and international private corporations, Bardala bypass project will transport fresh- including the German Herrenknecht AG and water extracted from occupied Palestinian the US-based CETCO Mineral Technology. water sources to nearby Israeli settlements, Control over water resources is of great geo- 1 bypassing Palestinian communities. Palestin- political importance, especially in the context ians have no independent access to the water of prolonged occupation. Exploitation of Pal- sources in question. The project, advanced by estinian and Syrian water resources by the oc- 2 Mekorot, Israel’s national water company, is cupying power has contributed to the expan- a mechanism for consolidating Israel’s hold sion of settlement agricultural production. At over Palestinian land and natural resources. the same time, occupied communities are de- Its route and raison d’être further entrench nied the right to control water and other nat- Israel’s occupation, benefitting the illegal- set ural resources, resulting in intense economic de-development. 1 MahsomWatch - Women for Human Rights and Against the Occupation, “A Tour in The Jordan Prior to publication, Who Profits contacted all Valley,” 10 April 2019. companies profiled herein. As of the date of 2 Who Profits, Mekorot’s Involvement in the publication no responses were received. -

Lokale Wirtschaftspolitik in Marokko Strukturen, Prozesse Und Inhalte Der Interessenvermittlung Zur Etablierung Eines Sektors Z
Lokale Wirtschaftspolitik in Marokko Strukturen, Prozesse und Inhalte der Interessenvermittlung zur Etablierung eines Sektors zum Offshoring von Dienstleistungen in der Stadt Fes Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zu Frankfurt am Main vorgelegt von Dipl. pol. Stefanie Slaoui-Zirpins aus: Hanau 2014 1. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Nölke 2. Gutachterin: Prof. Dr. Heike Holbig Tag der mündlichen Prüfung: 07.07.2014 I Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................... I Abkürzungsverzeichnis ......................................................................................................................... VI Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................................... IX Tabellenverzeichnis .............................................................................................................................. IX Teil A: Einleitung und Forschungsstand ................................................................................................ 1 1. Wandel erfassen und erklären .......................................................................................................... 1 1.1. Partizipation in der MENA-Region .............................................................................................