I. Territoire Et Fonctionnement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

OPEN BIKE GRANDVILLARD 2005 COURSE MOUTAIN-BIKE Résultats Officiels
OPEN BIKE GRANDVILLARD 2005 COURSE MOUTAIN-BIKE Résultats officiels Clt Dos Nom et prénom Année Domicile Temps Ecart MM01 Minimes 1 Garçons <<Soft>> 1997-1999 1,7 Km 1 1762 BARD ROMAIN 1997 Bulle 5:10.2 2 1800 BUSSARD JOHANN 1997 VUADENS 5:11.0 0.8 3 1759 BAPST VINCENT 1997 Gumefens 5:23.5 13.3 4 1756 SANER CAMILLE 1997 Busserach 5:28.3 18.1 5 1799 PASQUIER JOSSE 1998 SÂLES 5:30.2 20 6 1805 BUNTSCHU SANDRO 1997 ST-SILVESTER 5:38.0 27.8 7 1753 ECOFFEY MAXIME 1997 Villars-sous-Mont 5:43.3 33.1 8 1801 DELEZE ANTOINE 1998 HAUTE-NENDAZ 6:01.3 51.1 9 1774 BEAUD VICTOR 1998 Grandvillard 6:05.9 55.7 10 1811 DUPRE ARNAUD 1997 EPENDES 6:13.1 1:02.9 11 1793 PITTET LUCAS 1998 LA TOUR-DE-TREME 6:28.4 1:18.2 12 1767 DEILLON LEO 1998 Bulle 6:30.2 1:20.0 13 1807 PERRENOUD FABIEN 1999 LA VERRERIE 6:34.0 1:23.8 14 1755 CORMINBOEUF LORIC 1998 Le Pâquier-Montbarry 6:34.8 1:24.6 15 1763 PASQUIER ARNAUD 1997 Estavannens 6:44.7 1:34.5 16 1781 RUFFIEUX ANTOINE 1997 Estavannens 6:48.1 1:37.9 17 1788 NISSILLE MAXIME 1998 BULLE 6:50.3 1:40.1 18 1764 SANJUAN ADRIAN 1997 Grandson 6:53.3 1:43.1 19 1789 EBEL SYLVAIN 1999 MARIN-EPAGNIER 6:56.2 1:46.0 20 1766 HECKLY CEDRIC 1998 Grandvillard 6:57.6 1:47.4 21 1816 CHABLOZ EMANUEL 1998 CHÂTEAU-D'OEX 6:59.0 1:48.8 22 1794 L'HOMME YAN 1999 VUADENS 7:06.9 1:56.7 23 1786 FRANZEN MARC 1997 VILLARS-SOUS-MONT 7:08.5 1:58.3 24 1782 RABOUD BENJAMIN 1997 Grandvillard 7:10.3 2:00.1 25 1798 MACHERET STEPHANE 1998 BROC 7:14.9 2:04.7 26 1795 BERSET ALAN 1998 COURNILLENS 7:18.4 2:08.2 27 1784 GOLLIARD JUSTIN 1999 GRANDVILLARD 7:21.2 2:11.0 -

Rapport-Eausud2016 .Pdf
1 1. Entreprise 2 • Brève présentation 4 • Assemblée des actionnaires 6 • Actionnariat 7 • Organisation 8 • Chiffres-clés 2016 10 • Carte du réseau d’eau 11 2. Evénement 12 3. Infrastructures 16 4. Focus 20 5. Partie financière 26 • Comptes 2016 28 • Rapport de l’organe de révision 34 2 3 ENTREPRISE 1 4 5 AIRE DE DESSERTE (alimentation totale ou partielle) BRÈVE PRÉSENTATION 1. Attalens 2. Bossonnens 3. Botterens 23 4. Broc 5. Bulle 6. Val-de-Charmey (Cerniat) 18 7. Chapelle Créée en 2005, EauSud SA est une société de captage et sonnes une eau de qualité. Soulignons encore qu’en 2016, 8. Châtel-sur-Montsalvens 9. Corbières d’adduction d’eau en mains de communes ou d’associa- EauSud a élargi son champ d’action (voir « focus » en page 26 17 10. Crésuz 9 22 11 11. Echarlens tions de communes du sud fribourgeois. 22) tout en assurant la continuité de la philosophie appli- 19 25 28 12. Ecublens quée à ce jour et qui a montré son bien fondé. 30 13. Granges Le but de la société consiste à gérer les captages de Char- 29 20 3 10 14. Gruyères 5 8 6 15. La Verrerie mey et de Grandvillard ainsi que les adductions qui y sont 12 24 16. Le Flon 16 liées. Grossiste de la distribution d’eau, elle approvisionne 15 4 17. Marsens 18. Mézières 30 communes du sud du canton. 7 27 19. Montet 20. Morlon 21 21. Oron (VD) Au vu du développement actuel et à venir des communes 22. Riaz 14 qu’elle alimente, EauSud SA se doit de répondre, au- 23. -
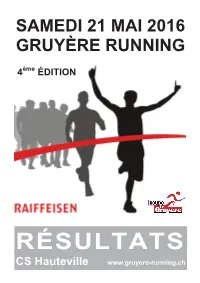
Classement Par Équipe Course Relais
SAMEDI 21 MAI 2016 GRUYÈRE RUNNING 4ème ÉDITION RÉSULTATS CS Hauteville www.gruyere -running.ch Gruyère-Running 2016 - 4ème édition Coupe "La Gruyère" COURSE PEDESTRE POPULAIRE Classement par équipe Scratch 2016 Dos. Nom et prénom Sexe AN CAT Domicile/Club Temps 1 - TEAM MOJITO Temps total : 1h31:20.4 39 COLLIARD Laura Dame 1988 RM B3 Bulle Triathlon 45:50.0 139 CHAUDOYE Fabien Homme 1983 RM B3 Bulle Triathlon 45:30.4 2 - L'équipe Temps total : 1h31:46.0 50 PUGIN Baptiste Homme 1998 RH SAB 42:35.9 150 KONRAD Niklas Homme 1999 RH SAB 49:10.1 3 - Les Stadistes Temps total : 1h32:39.7 66 PHILIPP Nathalie Dame 1992 RM Stade Genève 44:54.2 166 RISER Vincent Homme 1991 RM Stade Genève 47:45.5 4 - Sponsi Team Temps total : 1h33:05.3 20 JOLLIET Mathieu Homme 1993 RH Trilogie Running Team 48:17.5 120 GLARDON Leandro Homme 1992 RH B3, Bulle Triathlon 44:47.8 5 - Les CaDis en folie!!!! Temps total : 1h36:39.4 45 SALLIN Dimitri Homme 1988 RM CA Marly 42:01.3 145 THOMAS BERNARDO Camille Dame 1986 RM SA Bulle 54:38.1 6 - Les Capricornes Temps total : 1h36:58.0 81 THURLER Joël Homme 1986 RH SA Bulle 46:40.3 181 BOCA Peter Homme 1986 RH SA Bulle 50:17.7 7 - Equipe 1 Temps total : 1h37:38.0 30 FLEURY Lucien Homme 1993 RM Villarimboud 40:25.6 130 JOUE Karine Dame 1969 RM Châtonnaye 57:12.4 8 - Orange Temps total : 1h38:57.4 78 PILLOUD Olivier Homme 1978 RM SA Bulle 43:22.2 178 REPOND France Dame 1990 RM SA Bulle 55:35.2 9 - GM Temps total : 1h39:05.6 31 CHARRIÈRE Gaël Homme 1982 RH Lausanne 45:34.8 131 TINGUELY Matthieu Homme 1989 RH Attalens 53:30.8 10 - Les early birds Temps total : 1h40:29.6 59 LE GLAUNEC Julien Homme 1988 RM Vevey 47:17.6 159 BUTTICAZ Isabelle Dame 1988 RM Vevey 53:12.0 21.05.2016 / Hauteville Club Sportif Le 22.05.2016 à 16:19 / Page 1/8 Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 2.09 Soft Chrono Willy www.chronometrage.ch VolaSoftControlPdf Gruyère-Running 2016 - 4ème édition Coupe "La Gruyère" COURSE PEDESTRE POPULAIRE Classement par équipe Scratch 2016 Dos. -

Rapport Annuel 2018 1
EauSud SA, société gérée par Gruyère Energie SA Rue de l’Etang 20 | CP 651 | CH-1630 Bulle 1 | T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25 [email protected] | www.gruyere-energie.ch | [email protected] | www.eausud.ch RAPPORT ANNUEL 2018 1 1. Entreprise 2 • Brève présentation 4 • Prestations 6 • Assemblée des actionnaires 8 • Actionnariat 9 • Organisation 10 • Chiffres-clés 2018 12 • Carte du réseau d’eau 13 2. Infrastructures 14 3. Exploitation 18 4. Partie financière 22 • Comptes 2018 24 • Rapport de l’organe de révision 30 2 3 ENTREPRISE 1 4 5 AIRE DE DESSERTE (alimentation totale ou partielle) BRÈVE PRÉSENTATION 1. Attalens 2. Bossonnens 3. Botterens 23 4. Broc 5. Bulle 6. Val-de-Charmey (Cerniat) 18 7. Chapelle Créée en 2005, EauSud est une société active dans le captage 8. Châtel-sur-Montsalvens 9. Corbières et l’adduction d’eau en mains de communes ou d’associa- 26 17 10. Crésuz 9 22 11 11. Echarlens tions de communes du sud fribourgeois. 19 25 28 12. Ecublens 30 13. Granges Le but de la société consiste à gérer les captages de Charmey 29 20 3 10 14. Gruyères 5 8 6 15. La Verrerie et de Grandvillard ainsi que les adductions qui y sont liées. 12 24 16. Le Flon 16 Grossiste dans la distribution d’eau, elle approvisionne 15 4 17. Marsens 18. Mézières 30 communes du sud du canton. 7 27 19. Montet 20. Morlon 21 21. Oron (VD) Au vu du développement actuel et à venir des communes 22. -

Bulletin Numéro 81
COMMUNE DE GRANDVILLARD Bulletin d’information numéro 81 – novembre 2017 Commune de Grandvillard - Bulletin d’information numéro 81 – novembre 2017 I. Le mot du syndic II. Une mutation majeure dans notre administration communale III. Convocation à l’assemblée communale IV. Budgets 2018 V. Service du feu - participation à l’achat de véhicules Tonne-pompe et bus de transport pour la Vallée de l’Intyamon VI. Assainissement de la route reliant Grandvillard à Estavannens VII. Sécurité des enfants sur le chemin de l’école VIII. Regroupement scolaire de l’Intyamon IX. Course des aînés - mercredi 23 juillet 2017 X. Sécurisation du parc du Saudillet XI. Service de l’environnement - « Pour ne pas polluer les cours d’eau, ne jetez rien dans les caniveaux … » XII. Réseau d’alimentation en eau potable XIII. Haies vives - taille XIV. Rubrique « énergie » - Inauguration de la Centrale de biogaz XV. Evolution démographique 1990-2015, 2016 XVI. Gestion des déchets - Elimination des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins - Ramassage des déchets urbains - 2018 - Fêtes et jours fériés - changement de dates - Rappel du nouvel horaire de la Déchetterie intercommunale XVII. Le coin des sociétés et des manifestations - Société de musique - Echo du Vanil-Noir - 35ème Giron des musiques gruériennes - 18-21 mai 2017 - Open Bike Haute-Gruyère - Intersociété de Grandvillard - programme des manifestations 2017-2018 - Société d’Intérêts Villageois de Grandvillard - 100 ans du Musée gruérien - invitation aux communes XVIII. Divers - Transports publics - Cartes journalières « commune » - Transports publics - Nouveaux horaires TPF dès le 10 décembre 2017 - Site internet - Fêtes de fin d’année - Fermeture du Bureau communal 2 Commune de Grandvillard - Bulletin d’information numéro 81 – novembre 2017 I. -

Plans De Fusions Fusionspläne
Conseil d’Etat CE Staatsrat SR Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg T +41 26 305 10 45, F +41 26 305 10 48 www.fr.ch/ce Plans de fusions Fusionspläne Cartes et données statistiques Karten und statistische Angaben Documents pour la conférence de presse du 5 juin 2013 Unterlagen für die Pressekonferenz vom 5. Juni 2013 Fräschels M u r Kerzers te n ( R E i n e k d Bas-Vully l b .) e i K Galmiz er ze Haut-Vully rs r Gempenach lie te un M Murten / els en Ulmiz urm rtig G iez Morat u yr L ld Me a w g n lm e Münche- a Delley-Portalban r Salvenach G G wiler (BE) G Courge- l e t t vaux e Jeuss r e Cressier n n s e on g Saint-Aubin lev l. in V ur K s a Co ö l Gurmels B lo n Villarepos Bösingen Wünnewil- Wallenried Vernay Flamatt Ueberstorf in tep ur e Rueyres- Domdidier Co h Misery-Courtion rêc les-Prés Dompierre rbe Estavayer- Ba le-Lac Morens Schmitten Düdingen Sévaz Russy Grolley Heitenried Châtil- Bussy Léchelles La Sonnaz lon Châbles Granges- ts Belfaux te n d Paccot Lully o Ponthaux fon M uta Tafers Cheyres s A Givisiez Le Cugy f St. Antoni Montagny Chéso- eu bo Fribourg / pelloz in Noréaz rm Freiburg A Murist Fétigny o Villars-sur- lte C rs Glâne P w i il s Prez-vers- er Nuvilly re Avry ra niè fo Mé Noréaz Matran rt St. Ursen sc h a y Marly n re e Torny e g rs Neyruz in o e tl C La Brillaz iv n r e d C e Villarsel- T t Rechthalten ie lz hâ u sur-Marly r t a s o o H G i h Cheiry nn Ependes n m if ü ay f r u e Cottens e B Z Fer- S rs re e Arconciel t. -

Liste Des Récapitulative-Propriét.M2
Liste des propriétaires virtuels des m2 de pavage de Gruyères JJ MM AA Nom Prénom Rue CP Ville Pays Nbre 26 10 02 A3 1630 Bulle Suisse 1 Antonietti Isabelle 1663 Gruyères Suisse 1 Antonietti Jean-Luc 1663 Gruyères Suisse 1 Antonietti Sandrine 1663 Gruyères Suisse 1 Antonietti Xavier 1663 Gruyères Suisse 1 03 12 02 APW décoration Le Bourg 8 2087 Cornaux Suisse 1 02 11 02 Au Filet de Gruyères Michel Gachet Bourg d'EnHaut 45 1663 Gruyères Suisse 6 01 11 02 Bayandor-Boschung Véronique Ch. De Concava 2 1231 Conches Suisse 1 03 11 02 Bosc-Bussard Solange Stans Suisse 1 01 11 02 Boschung Alfred 1663 Epagny Suisse 1 01 11 02 Boschung Myriam Le Pont 1663 Epagny Suisse 1 Agencement de 01 11 02 Boschung SA Fermes 1664 Epagny Suisse 1 22 06 02 Bourgeois Marc Suisse 2 03 07 02 Bussard Christian 1663 Pringy Suisse 1 25 10 02 Castella Jacqueline 1663 Gruyères Suisse 1 07 07 02 Chardonnereau A & P Meggen Suisse 1 02 11 02 Charrière Bruno Rue de Vevey 20 1630 Bulle Suisse 1 01 11 02 City Pneus 1663 Epagny Suisse 1 28 04 03 Commune 1666 Grandvillard Suisse 1 09 05 03 Commune Pont-La-Ville Suisse 1 16 05 03 Commune Grolley Suisse 1 27 05 03 Commune Enney Suisse 1 28 05 03 Commune Bossonnens Suisse 2 02 06 03 Commune Riaz Suisse 2 03 06 03 Commune Charmey Suisse 1 26 06 03 Commune Crésuz Suisse 1 27 06 03 Commune Villars-sur-Glâne Suisse 2 05 08 03 Commune Barberêche Suisse 1 29 10 03 Commune La Roche Suisse 1 11 11 03 Commune Châtel-St-Denis Suisse 1 11 11 03 Commune Vuadens Suisse 1 03 12 02 Davet Alain Aire-la-Ville 1 27 10 02 Doutaz Félix Le Tôt 1667 Enney Suisse 1 30 10 02 Doutaz Isabelle Rte de Duvillard 38 1664 Epagny Suisse 1 03 07 02 Dupasquier Colette 1663 Epagny Suisse 1 20 10 03 ECAB Pierre Ecoffey 1702 Fribourg Suisse 1.5 20 11 07 Ember Bonnie 17158 Grand Av. -

Classement Du 13.09.2003
OPENBIKE : classement du 13.09.2003 MM01 Minimes 1 Garç ons <<Soft>> 1993-1995 1,7 Km Rang Dossard Nom Prénom Année Lieu Temps 1 1766 MURITH BASTIEN 95 Morlon 5:34.4 2 1785 Pittet Maxime 95 La Tour-de-Trê me 5:46.4 3 1773 Ebel Clément 1996 2074 Marien-Epagnier 5:56.3 4 1762 JAQUET COLIN 95 Grandvillard 5:58.6 5 1756 TORNARE SYLVAIN 95 Pâquier-Montbarry 6:01.1 6 1775 Jaquet Baptiste 1995 1635 La Tour-de-Trê me 6:02.5 7 1793 L'Homme Léo 96 VUADENS 6:05.9 8 1798 Corminboeuf Loris 95 1564 Domdidier 6:10.1 9 1797 Déglise Ayman 95 1617 Remaufens 6:12.9 10 1804 Jungo Xavier 95 Riaz 6:35.6 11 1774 Nissille Fabien 1995 Grandvillard 6:38.1 12 1808 Monney Joë l 97 St. Silvester 6:43.0 13 1768 Golliard Rémi 96 1630 Bulle 6:50.7 14 1778 Pittet Maro 96 Le Paquier 6:54.0 15 1780 Bapst Vincent 1997 1643 Gumefens 6:55.2 16 1776 Borcard Julien 96 1666 Grandvillard 6:59.8 17 1794 Schornoz Roman 96 Estavannens 7:05.6 18 1753 BUTTET GRÉ GORY 1996 Bulle 7:09.8 19 1760 CLUZEAU LUCAS 95 F- Bogeve 7:12.6 20 1792 Bard Romain 97 Bulle 7:14.6 21 1795 Dematraz Grégoire 97 1636 Broc 7:17.9 22 1803 Raboud Benjanmin 97 1666 Grandvillard 7:21.6 23 1800 Mauron Julien 95 Siviriez 7:26.8 24 1789 Charrière Julien 96 1630 Bulle 7:28.8 25 1770 Ecoffey Raphaë l 1997 1666 Villars-sous-Mont 7:34.8 26 1755 BARRAS SAMUEL 96 Broc 7:37.0 27 1784 Aubert Tim 96 1066 Epalinges 7:42.6 28 1777 Bapst Arnaud 95 1663 Pringy 7:44.6 29 1761 HERTLING NICOLAS 95 Posieux 7:55.4 30 1786 Delanef Florent 95 Epagny 8:03.3 31 1751 FRACHEBOUD CHRISTOPHE 96 Avully 8:06.2 32 1783 Gobet Simon 97 1746 -

Liste Des Propriétaires Virtuels Des Pavés De Gruyères
Liste des propriétaires virtuels des pavés de Gruyères Nom Prénom N° postal Ville Pays Nbre Abou Elenein Hamdy Martigny Suisse 1 Abou Elenein Shams Saillon Suisse 1 Adank Mathis Frauenfeld Suisse 1 8070 Aeberhard Christelle 1202 Genève Suisse 1 Aebischer André & Ursula 3186 Düdingen Suisse 5 Aebischer Nelly 3186 Düdingen Suisse 1 Aeby Christophe 1782 Belfaux Suisse 1 Aeby Daniel 1782 Belfaux Suisse 1 Aeby Elise 1782 Belfaux Suisse 1 Aeby Ernest 1630 Bulle Suisse 2 5484 Aeby Ernest 1630 Bulle Suisse 1 Aeby Florian 1630 Bulle Suisse 2 Aeby Jean-Théo 1782 Belfaux Suisse 2 Aeby Nicole 1782 Belfaux Suisse 1 Aekermann Gina 1632 Riaz Suisse 1 Aellen Frank 1630 Bulle Suisse 1 Aeschlimann Charles 1630 Bulle Suisse 4 Aigroz Marlyse Treytorrens Suisse 1 5432 Albasini Claude 1006 Lausanne Suisse 1 5431 Albasini Michel 1006 Lausanne Suisse 1 Allemann Jean-Claude 1566 St-Aubin Suisse 10 Allemann Marie-Lise 1632 Riaz Suisse 1 Alvarez Francisco 1630 Bulle Suisse 4 Andreoli Annick Renaison France 1 Andrey Claude 1023 Cressier (VD) Suisse 1 Andrey Jean-Louis 1647 Corbières Suisse 1 Andrey Jean-Pierre 1630 Bulle Suisse 1 Andrey Laurent 1724 Oberried Suisse 1 Andrey Lucie & Jean-Louis 1663 Epagny Suisse 2 Andrey Michel 1724 Oberried Suisse 1 Andrey Michel 1724 Oberried Suisse 5 Andrey Noémie 1630 Bulle Suisse 1 Andrey Patrice 1141 Severy Suisse 1 Andrey Philippe 1635 La Tour-de-Trême Suisse 2 Andrey Raoul Corminboeuf Suisse 1 Andrey Roger 1632 Riaz Suisse 1 5435 Anirudhan Pratheesh 1232 Confignon Suisse 1 8072 Annen Denis 1295 Mies Suisse 2 8073 Annen Denis -

No 2 2021 Avril
Bulletin paroissial et communal La Vie Brocoise Revue bimestrielle (6 parutions par a n: février - avril - juin - août - octobre - décembre) MARS-AVRIL 2021 N° 2 Le complexe sportif de la plaine des Marches le 18 mars 2021. (Phot o: Loïc Girschweiler) SOMMAIRE 2 Mémento 3 Pour ses 50 ans, La Vie Brocoise ... 4-5 Une année un peu particulière 6 Nous a quittés dernièrement 7-16 Commune de Broc, informations 17 Concours Eurovision de la chanson 2021 19-20 Carnet de bord 21 Recett e : pancakes 22 Avis de recherche 23-26 A la rencontre de... Stéphane Doutaz 28-29 Concours « La Route des fleur s» 30 Dates de clôture de rédaction 2021 31 La page des jeux 32 Il y a 80 an s ! Clôture de rédaction MÉMENTO Î PAROISSE DE BROC Î COMMUNE DE BROC Conseil de Paroiss e: ADMINISTRATION M. Sébastien Murith, président 079 754 00 20 Commune de Broc - Bourg de l’Auge 9 - 1636 Broc Secrétaria t: www.broc.ch Centre paroissial, rue des Écoles 7, 1636 Broc Secrétaria t/ Conseil [email protected] 026 921 90 98 026 921 80 10 Contrôle de l’habitant [email protected] E-mai l : [email protected] 026 921 80 10 Heures d’ouverture du secrétaria t : Mardi 9h –11h Caisse [email protected] Cure des Marche s: 026 921 17 19 026 921 80 11 UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE L’ÉVI Heures d’ouverture lu-je 10h -12h /13h 30 -17 h Curé modérateu r : Abbé Claude Deschenaux ve+veilles de fête s: 10h -12h /13h 30 -16 h 026 921 21 09 Syndi c: M. -

Fribourg Illustreé Bibliothèque Cantonale De Fribourg
Parution bimensuelle • 2 décembre 1981 • 36" année • N° 22 Fr. 2.90 Edition, impression, administration: Imprimerie Fragnière SA - 35, route de la Glane - 1700 Fribourg - Tél. 037 24 75 75 Rédaction: Case postale 331 - 1701 Fribourg - Tél. 037 24 75 75 - Télex 36 157 Rédacteur responsable: Gérard Bourquenoud maGozine Gymnastes fribourgeois à Attalens Promotion de nouveaux fromagers © Pour vos cadeaux de Noëlw Regard sur le Comptoir de Payerne Camp militaire et de vacances du Lac-Noir Les ferronniers de la Veveyse City-Fribourg: condamné à donner le maximum 2 _5Le monde de la £'Musique_ programme de cette grandiose mani¬ Assemblée de la Fédération cantonale festation qui réunira 55 sociétés d'ac¬ cordéonistes. Tout sera mis en œuvre pour que cette fête soit une réussite. Il fribourgeoise des accordéonistes, a également fait appel à des aides bénévoles pour assumer les différen¬ tes tâches de ce grand rendez-vous à Pont-la-Ville musical. Une équipe bien soudée C'est au café-restaurant de «L'Enfant-de-Bon-Cœur», à Pont-la-Ville, que s'est tenue Aucun changement n'est intervenu récemment l'assemblée annuelle de la Fédération cantonale fribourgeoise des accordéo¬ au sein du comité de la FCFA qui nistes, présidée avec beaucoup d'entrain et de dynamisme par M. Charles Pache, de se compose de MM. Charles Pache Fribourg, lequel eut le plaisir de saluer les délégués des sociétés affiliées à la FCFA. Il (Fribourg), président; Jean Charrière remercia M. Jean Charrière, président de «L'Echo des Roches», de La Roche, pour la (Arconciel), vice-président; Georges Aeby (Fribourg), caissier; Julia Aeschli¬ parfaite organisation de cette rencontre sur les hauts du lac de la Gruyère. -

DECISÃO DA COMISSÃO De 25 De Março De 1997 Que Estabelece As Listas Provisórias De Estabelecimentos De Países Terceiros
1997D0252 — PT — 09.03.2001 — 009.001 — 1 Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições " B DECISÃO DA COMISSÃO de 25 de Março de 1997 que estabelece as listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros a partir dos quais os Estados-membros autorizam a importação de leite e de produtos à base de leite destinados ao consumo humano (Texto relevante para efeitos do EEE) (97/252/CE) (JO L 101 de 18.4.1997, p. 46) Alterada por: Jornal Oficial n.o página data "M1 Decisão 97/480/CE da Comissão de 1 de Julho de 1997 L 207 1 1.8.1997 "M2 Decisão 97/598/CE da comissão de 25 de Julho de 1997 L 240 8 2.9.1997 "M3 Decisão 97/617/CE da Comissão de 29 de Julho de 1997 L 250 15 13.9.1997 "M4 Decisão 97/666/CE da Comissão de 17 de Setembro de 1997 L 283 1 15.10.1997 "M5 Decisão 98/71/CE da Comissão de 7 de Janeiro de 1998 L 11 39 17.1.1998 "M6 Decisão 98/87/CE da Comissão de 15 de Janeiro de 1998 L 17 28 22.1.1998 "M7 Decisão 98/88/CE da Comissão de 15 de Janeiro de 1998 L 17 31 22.1.1998 "M8 Decisão 98/89/CE da Comissão de 16 de Janeiro de 1998 L 17 33 22.1.1998 "M9 Decisão 98/394/CE da Comissão de 29 de Maio de 1998 L 176 28 20.6.1998 "M10 Decisão 1999/52/CE da Comissão de 8 de Janeiro de 1999 L 17 51 22.1.1999 "M11 Decisão 2001/177/CE da Comissão de 15 de Fevereiro de 2001 L 68 1 9.3.2001 1997D0252 — PT — 09.03.2001 — 009.001 — 2 !B DECISÃO DA COMISSÃO de 25 de Março de 1997 que estabelece as listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros a partir dos quais os Estados-membros autorizam a