Bureaucratisation Néolibérale Dans Le Développement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Esg 2019
RAPPORT ESG 2019 RAPPORT ANNUEL 2019 03 « CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE » S’appuyant sur ses ressources, ses filiales spécialisées et ses métiers complémentaires, le groupe Société Générale Maroc a pour ambition de poursuivre sa stratégie de croissance durable et de créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Résolument engagée dans les transformations positives de la société et l’économie marocaines, Société Générale Maroc souhaite apporter des solutions innovantes et responsables qui aient un impact positif. Ses valeurs de responsabilité, d’engagement, d’esprit d’équipe et d’innovation forment la marque de son empreinte, confortant sa volonté d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives du monde. 04 RAPPORT ANNUEL 2019 05 RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE NOS VALEURS RESPONSABILITÉ ENGAGEMENT ESPRIT D’ÉQUIPE INNOVATION En tant que banquiers, Notre engagement se nourrit Dans notre monde en Nous voulons améliorer nous contribuons au de la satisfaction durable mutation, nos clients veulent sans cesse l’expérience développement économique, de nos clients et de la fierté une banque qui soit un de nos clients en agissant social et environnemental que nous avons de nos partenaire responsable, ensemble pour adapter nos durable des territoires dans métiers et de notre Groupe. de confiance et agile. En solutions, nos pratiques et lesquels nous travaillons. Nous Ensemble, nous cherchons équipe, nous répondons nos relations aux usages de voulons aider nos clients à quotidiennement à faire la à leurs besoins grâce à un demain, en tirant notamment réaliser leurs projets tout en différence pour contribuer esprit de service nourri de profit des innovations étant attentifs aux risques dans à la réussite de nos clients la diversité des expertises technologiques. -

EQD-CL Final
EQDOM SA (Casablanca: EQD) ISIN Code Close (MAD) (17-May-2010) SEDOL EQDOM SA MA0000010357 1,799.00 6232669 Adress: 127, Boulevard Zerktouni Eqdom SA is a Morocco-based company that specializes in the provision of credits. The Upcoming Events 20100 Casablanca Company offers a range of products, such as Dispocredit, to finance a project or venture; Tel: +212 0 22 779290 Comanav Voyages, to finance a trip or holiday; and Massarrate, to finance wedding 05/20/10 / NTS Dividend For EQD.CS Fax: +212 0 22 250006 celebrations, among others. Eqdom SA operates through a network of agencies and various 12/07/10 - 12/14/10 / NTS Q1 2010 CREDIT EQDOM(SOC D'EQUIP DOM ET MN) Website: www.eqdomnet.ma distributors, including 300 partners across Morocco. The Company is a subsidiary of the IR tel: +212 22 779290 Societe Generale Group. Earnings Release IR contact: Mohamed Haizoune Relative % Change IR Email: [email protected] 5 days 1 Month 3 Months YTD 1 Year Credit EQDOM 6.01 10.10 21.14 26.69 24.07 Officers & Directors Overview EQDOM Vs Index 4.71 2.60 7.82 7.00 12.12 Name Current Position Director Since Officer Since (Casablanca Stock Exchange) Jean Yves Bruna Chairman of the Board -- -- M & A Overview/Detail (last 5 years) Total number of completed transactions 2 Abderrahim Rhiati Managing Director, Director -- -- Total deal value of completed transactions USD 58.49M Jaques Faucheux Deputy Managing Director -- -- Number of incomplete transactions 0 % completed vs announced (value) 100.00% (USD 58.49M) Typical deal strategy Friendly Christophe Laurent Deputy Managing Director -- -- Historical Price data Mohamed Abdelkhalek Torres Vice Chairman of the Board -- -- 1850 Mustapha Bakkoury Vice Chairman of the Board -- -- 1800 1750 Abdelaziz Tazi Director -- -- 1700 1650 Jean-Francois Gautier Director -- -- 1600 Dividend Overview/Detail 1550 Announcement Date Ex. -

Clusters Au Maghreb
Études & analyses Juillet 2014 Clusters au Maghreb Vers un modèle de cluster maghrebin spécifique PAULETTE POMMIER c l u s t e r s a u m a g h r e b ~ 3 Avertissement et remerciements La présente étude répond à une commande de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED). Réalisée dans un calendrier contraint (mars et avril 2014), elle présente une image instantanée à cette date de la carte des clusters (constitués ou attendus) dans les trois pays du Maghreb et de leurs initiatives, notamment de coopération, pour ceux déjà nés. Celles-ci font l’objet d’illustrations. Sa réalisation a reposé sur l’exploitation de la (rare) documentation existante et sur la conduite d’entretiens avec des personnes qualifiées des pays concernés. Plus de trente personnes ont été interviewées (en face à face ou par téléphone). Nous leur sommes reconnaissante d’avoir répondu à nos questions sans restriction, souvent avec passion, démontrant par là leur engagement sur le sujet. Nous remercions particulièrement les experts des agences de coopération française et allemande (Agence Française de Développement et GIZ) pour avoir partagé avec nous leur connaissance des acteurs des clusters. Personnes interviewées : M. Sami ARFAOUI, Chef de projet Industrialisation de l’entreprise EON, Tunis, Mme Wided BEN NACEUR, chargée de projets Appui au secteur privé - (Agence Française de Développement), Tunis, Mme Touria BENRABAH, chargée de mission Agadir Haliopôle, Agadir, Maroc, M. Omar BENSOUDA, Président d’Oceanopole TanTan, Maroc, M. Nourdine BOUYAAKOUB, Directeur général de CE3M, coordonnateur des clusters marocains Maroc, M. Hicham BOUZEKRI, DG de CMM, Maroc, M. -

Liste Des Auditions, Contributions Et Activités De La Commission Spéciale Sur Le Modèle De Développement
Liste des auditions, contributions et activités de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ANNEXE 3 AVRIL 2021 Liste des auditions, contributions et activités de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement ANNEXE 3 AVRIL 2021 SOMMAIRE PARTIE I - AUDITIONS ET CONTRIBUTIONS ...............................................................7 INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES .........................................................................9 ACTEURS PUBLICS ......................................................................................................10 PARTIS POLITIQUES ....................................................................................................13 MONDE PROFESSIONNEL ET PARTENAIRES SOCIAUX ...............................................16 TIERS SECTEUR ...........................................................................................................19 AMBASSADEURS ET ACTEURS INTERNATIONAUX ....................................................26 CONFÉRENCES LABELLISÉES .....................................................................................27 ÉCOUTES CITOYENNES ET VISITES DE TERRAIN ......................................................29 Les écoutes citoyennes : 3 formats ...............................................................................29 Table ronde ...............................................................................................................30 Cycle de Rencontres Régionales ..................................................................................30 -

Rapport Financier Annuel Exercice 2019
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER « EQDOM » RAPPORT FINANCIER ANNUEL EXERCICE 2019 Rapport Financier Annuel 2019 1 SOMMAIRE I – PARTIE I: RAPPORT DE GESTION 2019…….………………………………………………………3 RAPPORT D’ACTIVITE…………………………………………………..….……………………………….4 GESTION DES RISQUES…………………………………….………………………………………………15 PROJETS DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'AGO…….……………....…………………21 PROJETS DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'AGO DES OBLIGATAIRES….…….24 COMPTES ANNUELS SOCIAUX ET CONSOLIDES…..…………………………………………….25 II– PARTIE II: RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES………………….77 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES…………..……………….….…...78 ETAT DES HONORAIRES VERSES AUX CONTROLEURS DE COMPTES…………...........87 III-PARTIE III: COMMENTAIRE DES DIRIGEANTS ET PRESENTATION D’EQDOM…...88 COMMENTAIRE DES DIRIGEANTS……….…………….…………………………………….……….89 PRESENTATION GENERALE D’EQDOM……….……………………………..……….……………..90 IV-PARTIE IV: RAPPORT ESG……………………….…………………………………………………….....94 ELEMENTS GENEREAUX……….………………………………………………………………….………95 ELEMENTS SPECIFIQUES……………………………………………………….…………………………95 INFORMATION ENVIRONNEMENTALES……..…………………………………………………….95 INFORMATIONS SOCIALES……………………………………………………………………………….95 GOUVERNANCE..…………………………………………………………….……………………….……..…98 INFORMATIONS SUR LES PARTIES PRENANTES..….……………………………….….……..104 AUTRES..…………………………….……………………………………………………………….………….105 LISTE DES COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES EN 2019..………………………..…………106 Rapport Financier Annuel 2019 2 PARTIE I : RAPPORT DE GESTION Rapport Financier Annuel 2019 3 RAPPORT D’ACTIVITE Rapport Financier Annuel -

Enquête L'economiste-Sunergia La Moitié Du Gouvernement Peut S'en
2 EvènEmEnt Enquête L’Economiste-Sunergia La moitié du gouvernement peut s’en aller! • Pas une seule voix pour tout le équipe ne pèsent rien au regard du travail Les ministres qui réussissent secteur industriel et commercial que les citoyens attendent d’eux. Et pour faire bonne mesure, ne voilà-t-il El Houssaine Louardi 18% pas qu’un ministre politiquement impor- Aziz Rebbah 13% • Etrange phénomène avec tant, Mohand Laenser, se retrouve cité… Mustapha Ramid 11% avec l’opposition. Le gouvernement paye Aziz Akhannouch 9% Laenser! sans doute les rivalités puissantes qui op- Salaheddine Mezouar 6% posent le chef du Mouvement Populaire Mohamed Ouzzine 6% 5% avec le chef du PPS: pas un seul thème, Lahcen Daoudi • Le ministre de la Santé, El Mohamed Hassad 5% Cette année, nous n’avons pas mis pas un seul projet, sans qu’ils montrent Mohamed Boussaid 4% Benkirane dans la course avec ses Houssaine Louardi, reste le pré- publiquement leur désaccord, et sans que Mohamed Nabil Benabdellah 3% ministres, car les sondages précédents féré des Marocains le chef d’équipe n’entreprenne d’y mettre Mohamed El Ouafa 3% nous ont montré qu’il les écrase tant Mustapha El Khalfi 3% que leurs chiffres deviennent insigni- bon ordre. fiants. Apparemment, cela n’a pas Rachid Belmokhtar 2% Avec un étonnement navré, on notera suffi à les réhabiliter… C’EST clair, Benkirane peut virer Bassima Hakkaoui 2% la moitié de son gouvernement, personne que personne parmi les ministres et mi- Lahcen Haddad 1% ne s’en apercevra. Et parmi ceux qui res- nistres délégués chargés de la marche des Abdelkader Amara 1% tent, il n’y en a que quatre qui trouvent affaires et des entreprises n’est cité comme Mbarka Bouaïda 1% grâce, bien modestement. -

1019-Novembre-2019-Export.Pdf
www.cfcim.org 57e année Numéro 1019 15 novembre- 15 décembre 2019 Dispensé de timbrage autorisation n° 956 L’INVITÉE DE CONJONCTURE HÉLÈNE LE GAL Une place à Export prendre pour les PME marocaines Forum d’Aff aires Pavillon France sur le Abdellatif Zaghnoun, L’actualité vue par le Maroc-France de salon Pollutec Maroc invité du Forum Service économique de Dakhla Adhérents15 novembre de la CFCIM - 15 décembre 2019l’Ambassade - Conjoncture N° de 1019 France - 1 2 - Conjoncture N° 1019 - 15 novembre - 15 décembre 2019 Editorial Export : une place à prendre pour les PME marocaines Oser monter en puissance grâce Philippe-Edern KLEIN Président à l’export Le Maroc vient de gagner sept places dans le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale pour se positionner au 53e rang. C’est le signe que le climat des aff aires continue de s’améliorer et que nos entreprises sont de plus en plus compétitives. En progression régulière depuis ces dernières années, les exportations marocaines ont connu une vraie dynamique notamment grâce à l’automobile. Toutefois, dans certains secteurs comme l’agroalimentaire le Royaume exporte trop de produits en vrac et se prive ainsi d’une part non négligeable de la valeur ajoutée fi nale. Autre constat, les exportations marocaines sont principalement réalisées par les grandes entreprises comme Renault ou PSA et les « champions nationaux » tels que les banques. Les PME marocaines sont quasiment absentes des marchés internationaux alors que ces derniers représenteraient pour elles un important levier de développement. Beaucoup d’entre elles ont en eff et du mal à surmonter les diffi cultés rencontrées à l’export comme le manque de moyens fi nanciers et humains, l’indisponibilité des informations relatives aux marchés locaux, les risques d’impayés ou encore les barrières réglementaires étrangères. -

Kingdo O Om of Morocco
Kingdoom of Moroocco 2018|20199 Discovering Business EMBASSY OF in association with THE KINGDOM OF MOROCCO Copyright © Allurentis Limited 2018. All rights reserved. Allurentis is delighted to have been involved in association with the Department for International Trade on this, the first edition of the Kingdom of Morocco - Discovering Business, and would like to thank all sponsoring organisations for their kind contributions. Morocco is a hugely exciting market and with our deep rooted relationship the potential for business is vast. We are confident that this publication will raise awareness with all readers and prove to be an invaluable resource. Electronic copies of this publication may be downloaded from Allurentis Limited's website at www.allurentis.com, provided that the use of any copy so downloaded, complies with the terms and conditions specified on the website. Except as expressly stated above, no part of this publication may be copied, reproduced, stored or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing from Allurentis Limited. To enquire about obtaining permission for uses other than those permitted above, please contact Allurentis by sending an email to [email protected] Photos courtesy of: www.istockphoto.com | www.123rf.com | www.shutterstock.com USINESS B Contents ISCOVERING Introduction Morocco, the emerging powerhouse where Europe meets Africa 4 D - 2018|2019 Messages HMA Thomas Reilly: British Ambassador to the Kingdom of Morocco 8 H.E. Abdesselam Aboudrar: Kingdom of Morocco’s Ambassador -

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI Juillet 2015 - Juillet 2016 CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI - Juillet 2015 - Juillet 2016
CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI Juillet 2015 - Juillet 2016 CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SM LE ROI MOHAMMED VI - Juillet 2015 - Juillet 2016 - Chronologie des activités de SM le Roi Mohammed VI au cours de la période allant de juillet 2015 à juillet 2016 : 30 juillet 2015 - SM le Roi Mohammed VI adresse un discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, qui coïncide cette année avec le seizième anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres. - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, préside, au Palais Royal à Rabat, une réception à l’occasion du 16ème anniver- saire de l’accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres. A cette occasion, le Souverain a été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs voeux à SM le Roi et a décoré plusieurs personnalités marocaines et étrangères de Ouissams Royaux. 31 juillet 2015 - SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Lalla Asmaa à Rabat. - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, préside, à la place du Mechouar du Palais Royal de Rabat, la cérémonie de prestation de serment de 1.470 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires, et officiers issus des rangs, dont 268 officiers femmes. -
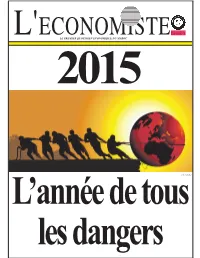
UNE RETROSPECTIVE 2015-A 2.Indd
Système de Management de la Qualité certifié ISO 9001 version 2008 par BUREAU VERITAS MAROC LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC 2015 (Ph. Fotolia) L’année de tous les dangers II Sommaire n Empreinte royale pour empreinte royale pour le développement II n elections locales: Les vrais et les faux gagnants III le développement n Chambre des conseillers: Les leçons d'une élection IV n Une année électorale pour les juges V n Les fondamentaux se redressent mais peu d’impact sur l’emploi VI-VII n Business et entreprises: pourquoi faut-il vite passer en 2016? VIII-IX n Bourse: La machine s'enraille X n education: Le rude chantier de la réforme XI n enseignement supérieur: Sur les chapeaux de roues XII n 2015, une année blanche pour Casablanca XIII Le Souverain a confirmé la vocation africaine du Maroc suite à la nouvelle tournée dans le continent, qui s’est soldée par une série d’accords de coopération autour de projets concrets. L’accueil réservé au Roi dans les différentes étapes de sa visite témoigne de sa popularité grandissante en Afrique (Ph. MAP) n transport, industrie, politique… n Des projets concrets pour déjà une réalité avec une multiplication phase qui consiste à transformer l'essai, les régions s'animent XIV d'accords au Sénégal, en Côte d’ivoire, déployer l'écosystème nécessaire pour l’Afrique au Gabon ou encore en Guinée Bissau. attirer les investissements et développer n Une page se tourne, une nouvelle L'impulsion royale a indiqué la voie à un marché. C'est en cours. -

Urban Politics in Morocco
URBAN POLITICS IN MOROCCO UNEVEN DEVELOPMENT, NEOLIBERAL GOVERNMENT AND THE RESTRUCTURING OF STATE POWER Koenraad Bogaert Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Politcal and Social Sciences, option Political Sciences Ghent University March 2011 Promotor: Prof. Dr. Sami Zemni … and the mighty multinationals have monopolized the oxygen so it’s as easy as breathing for us all to participate yes they’re buying and selling off shares of air and you know it’s all around you but it’s hard to point and say “there” so you just sit on your hands and quietly contemplate. (Ani Di Franco, Your next bold move) Table of contents General introduction............................................................................................ 11 Chapter 1: Method, fieldwork and critique as methodology ........................... 23 Not beyond but away from the regime paradigm: from an a-spatial to a spatial analysis of political transition ................................................................................ 25 Fieldwork and critical theory ................................................................................. 32 Some reflections on fieldwork ................................................................... 34 Critical theory ............................................................................................ 45 Chapter 2: The state, politics of neoliberal globalization and forms of actually existing neoliberalism ........................................................................... -

Secteur De La Presse Et Des Médias Au Maroc
www.cfcim.org 56e année Numéro 1001 15 mars - 15 avril 2018 Dispensé de timbrage autorisation n° 956 L’INVITÉ DE CONJONCTURE DRISS GUERRAOUI Secteur de la presse et des médias au Maroc À la recherche de nouveaux business models Soirée Startup à la Conjoncture célèbre Rencontre d’aff aires L’actualité vue par le veille de Futur.e.s in son 1000e numéro en dans les secteurs de la Service économique de Africa beauté chimie et des mines l’Ambassade de France Editorial Secteur de la presse et des médias au Maroc : à la recherche de nouveaux business models Philippe-Edern KLEIN Président Savoir se réinventer à l’ère du digital Comme partout dans le monde, le secteur des médias au Maroc connaît d’importants bouleversements depuis quelques années avec le développement du digital. Alors même qu’ils luttaient déjà pour survivre, certains supports de presse papier ont été touchés de plein fouet par la baisse du lectorat et des recettes publicitaires. Des titres, qui avaient pourtant toute leur place dans la diversité du paysage médiatique marocain, ont dû cesser leurs activités. Or, que l’on apprécie ou non son contenu, il est toujours triste de voir un journal fermer ses portes, car cela se fait généralement au détriment de l’information du public. À l’heure d’internet et de la prolifération des « fake news », trouver l’information de qualité n’est pas chose aisée, tout le monde pouvant s’improviser journaliste ou éditorialiste et répandre des données sans procéder aux vérifi cations d’usage. Le monde du digital impose de nouvelles règles du jeu et les médias qui ont su prendre ce virage ont souvent plusieurs cordes à leur arc, recherchant continuellement de nouveaux concepts pour séduire leur audience ou leur lectorat.