Autochtones Du Vaucluse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Map 15 Arelate-Massalia Compiled by S
Map 15 Arelate-Massalia Compiled by S. Loseby, 1995 Introduction Map 15 Arelate–Massalia Map 16 Colonia Forum Iulii–Albingaunum All the French départements covered here were treated in the CAGR series, beginning with its first volume, Alpes-Maritimes, in 1931. Its successor CAG is far more comprehensive, although unfortunately both maps were compiled before publication of the relevant volumes. Some references to them are incorporated in the Directories, however. Provence and Languedoc have in recent years been among the most dynamic regions of France in archaeological terms. As well as the periodic entries in Gallia Informations, the archaeology of the region sustains a series of journals, notably the Revue Archéologique de Narbonnaise, Documents d’Archéologie Méridionale, Bulletin d’Archéologie de Provence, Archéologie en Languedoc,andRevue des Etudes Ligures/Rivista di Studi Liguri.A comprehensive, up-to-date overview of the ancient history and archaeology of the region is lacking (Rivet 1988 is the best single work available); Bromwich (1993) at least provides a basic guide to the principal Greek and Roman remains. Of the numerous sites known exclusively from archaeology, only those significant enough to have attracted at least an article-length study are marked. The whole span from early Greek engagement with the region (c. 600 B.C.) is covered, up until c. A.D. 500; locations mentioned only in works associated with Caesarius of Arles are therefore excluded. From Cap Couronne eastwards (see La Couronne, Map 15 E3), the Provençal coastline appears to be little altered since antiquity, while on the western side of Map 15 the evolution of the shores of Languedoc has largely been gradual and minor–involving the shifting and consolidation of the sandbars which now separate the coastal étangs (lagoons) from the sea, but which seem to have been less developed in antiquity. -

The Herodotos Project (OSU-Ugent): Studies in Ancient Ethnography
Faculty of Literature and Philosophy Julie Boeten The Herodotos Project (OSU-UGent): Studies in Ancient Ethnography Barbarians in Strabo’s ‘Geography’ (Abii-Ionians) With a case-study: the Cappadocians Master thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master in Linguistics and Literature, Greek and Latin. 2015 Promotor: Prof. Dr. Mark Janse UGent Department of Greek Linguistics Co-Promotores: Prof. Brian Joseph Ohio State University Dr. Christopher Brown Ohio State University ACKNOWLEDGMENT In this acknowledgment I would like to thank everybody who has in some way been a part of this master thesis. First and foremost I want to thank my promotor Prof. Janse for giving me the opportunity to write my thesis in the context of the Herodotos Project, and for giving me suggestions and answering my questions. I am also grateful to Prof. Joseph and Dr. Brown, who have given Anke and me the chance to be a part of the Herodotos Project and who have consented into being our co- promotores. On a whole other level I wish to express my thanks to my parents, without whom I would not have been able to study at all. They have also supported me throughout the writing process and have read parts of the draft. Finally, I would also like to thank Kenneth, for being there for me and for correcting some passages of the thesis. Julie Boeten NEDERLANDSE SAMENVATTING Deze scriptie is geschreven in het kader van het Herodotos Project, een onderneming van de Ohio State University in samenwerking met UGent. De doelstelling van het project is het aanleggen van een databank met alle volkeren die gekend waren in de oudheid. -

Us M. Crossing Over. Here, As Often, Accipere Means “To Hear”. Priscus, -A, -Um, Original, Former, Previous
1 transitus, -us m. crossing over. Here, as often, accipere means “to hear”. priscus, -a, -um, original, former, previous. L. Tarquinius Priscus, the fifth king of Rome, ruled from 616-579 B.C. 2 Celtae, -arum m.pl. Celts. Gallia, -ae f. Gaul. penes + acc. in the power of, in the possession of, belong to. Bituriges, -um m.pl. a tribes of central Gaul with their capital at Bourges. 3 summa, -ae f. the highest, the most important. Celticus, -a, -um, Celtic. Here a substantive. 4 cum . tum, both . and. praepolleo, -ere, to be very powerful. 5 adeo . ut: “to such a degree that”. frux, frugis f. (usually pl. fruges, -um) fruits, produce, harvest; success. fertilis, -e, fertile. abundans, -antis, overflowing, abundant, numerous. vix adv. scarcely. rego, -ere, rexi, rectum, to direct, rule, govern. 6 magno natu: old. exorno (1) to unburden, unload, relieve. praegravo (1) to press heavily upon, weigh down. turba, -ae f. tumult, disturbance; crowd, throng; multitude, band, mob. Here ablative of separation. 7 sororis filius, nephew. impiger, -ra, -rum, diligent, active. 8 quas: read with sedes. Note the prepositioning of the relative pronoun. di = dei. augurium, -i n. augury, auspice. sedes, -is f. seat, chair; abode, home; base, foundation. ostendo, -ere, -i, -tum, to hold out, show, reveal, make clear. quantus, -a, -um interr. how great. 9 excieo (excio), -ire, -ii, -citum, to call out, arouse, summon. aliqui, aliqua, aliquod adj. any. arceo, -ere, -ui, to shut in; keep at a distance, prevent, keep away. 10 sors, sortis f. casting of lots; fate. dati = dati sunt. -

Annibal En Gaule
ANNIBAL EN GAULE PAR JEAN COLIN. CAPITAINE D'ARTILLERIE BREVETÉ PARIS - 1904 AVANT-PROPOS. CHAPITRE PREMIER. — La Région rhodanienne avant la conquête romaine. I. Géographie physique. — II . Géographie politique. CHAPITRE II. — Les textes. I. Polybe et Tite-Live. — II . Les historiens anciens. — III . La méthode de Tite- Live. — IV . Polybe. — V. Les textes perdus. — VI . Vie et travaux de Polybe. — VII . Travaux comparatifs sur Polybe et Tite-Live. — VIII . Comparaison des textes. — IX . Les connaissances géographiques des anciens. CHAPITRE III. — Le passage du Rhône. I. L'Emporium au Rhône. — II . Le point de passage. CHAPITRE IV. — La traversée des Alpes. I. La distance du Rhône aux plaines du Pô. — II . Les bords du Rhône. - L'Île. — III . L'entrée dans les Alpes. — IV . A travers les Alpes. — V. Le col. CONCLUSION. TRADUCTION DES TEXTES. I. Le récit de Polybe. — II . Le récit de Tite-Live. AVANT-PROPOS. Quelle route Annibal a-t-il suivie dans sa marche à travers la Gaule ? Il n'y a guère de problème historique plus captivant que celui-ci ; mais on lui a fait une réputation détestable; les savants le croient insoluble, et il leur paraît aussi fou de le reprendre pour la millième fois que de tenter la quadrature du cercle; encore n'est-ce pas aussi méritoire, car c'est une distraction accessible aux moindres talents. On n'admet pas que les données soient en nombre assez grand, et de nature assez précise : une dissertation sur la marche d'Annibal ne saurait être qu'une œuvre d'imagination, non un travail scientifique basé sur des faits positifs, aboutissant à des conclusions en règle. -

Tauole Della Geografia Antica, Moderna, Ecclesiastica E
. , 7^ / Jf''/ [y T A V OLE D E L L A , CIVILE MODERNA . ECCLESIASTICA E antica , OVERO divisione Stati Prouincie, Nelle fup principali Parti , Regioni, Regni, ^ Città , 6c altri luoghi rigu^rdeuoli Ohristian^ssimo » Opera cominciata da*' Signon SAMsoN Geografi del Re i * auole per t^na» altra ^^fporpAta in Italiano:, accrefciuta 4 gran numero di o volgare de* nomi antichi latini ^ l' enumeratione Geografia , con la fpiegatione in e del fidondo 3 i Gradi di latitudine , de* principali Fiumi 3 Laghi3 fidenti il Catalogo de ILefeouadi e longitudine delle Città principali ì di ciafichedteno Stato 3 Antichi 3 e J\dpderni 3 e IDominip nete del fidondo * e delle Religioni 3 Lingue 3 e fido DA FRAHCESCO DjSHNjt . I GLQ C QM LIC FNZ A VE SFPBR IO RI LE Agl’ Illuflrils."', & Ecceilentifs.'"' Signori * I SIGNORI D* INNOCENZO. D* CAMILLO. E D‘ GIROLAMO P A M P H I L I I* AUENDO l’Eccellcnzc U oftre potuto ritrarre dalla feria applicazione» con cui ogni giorno fi auanzanoneiracquifto delle feienze, quanto fia neceffario ad vn Principe anche quello del- la Geografia , non meno in riguardo delle no- tizie, le quali per fe ftelTa ci communica , che per lo lume , con ' cui ci fà Icona alla perfetta cognitione dell’ Hiftoria, non è da merauigliarfi , che fi fiano poi fEcccllenze Uoftre inuaghitc di 1 aggiongere qucfto à glialrri virtuofi eflcrcizij , con cui animo loronobilifsimocosìgloriofamentecoltiuano; onde bramofo lo di cooperare in qualche parte alla confeguzione del loro in- tento, ardifeo con tutta rhumiltàd offerire, e dedicare all Ec- cellenze -
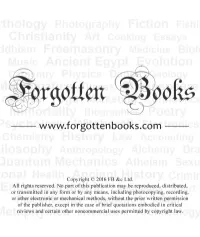
By Cecil Torr
P R E F A C E H AV E r i di u r I hea d this quest on sc ssed eve since was a child , r u but have never yet w itten anything abo t it except, in my Sma ll Ta lk a t Wre lc md . r I y In the First Se ies , page 75 , was talking r n I : about t avelli g on the Continent , and said Plenty of people went to Switzerland at the time when I first — — went 1 869 far more than when my father went there thi rty but i r r . years before , nothing l ke the c owds that go the e now They kept more to peaks and passes then ; and they were always talking ’ o : of Hannibal s passage of the Alps . 'unius was talked ut Tich borne and Dreyfus were yet to come ; and Hannibal filled the gap . I used to hear them at home as well as there ; and they all had their ’ u al — d Ar entiere r pet ro tes for Hannib Col g , Mont Genev e , Mont ni r Ce s , Little Mont Cenis , Little St Be nard and Great St Bernard , m and even Si plon and St Gothard . In 1 87 1 I went looking for traces of the vinegar on the Great St Bernard . My father upheld the Cenis routes as the onl y passes from which you can look down al upon the plains of Italy . I doubt if Hannib did look down . I think he may have shown his men their line of march up on a u Ari sta ora s u ShOW r r map , j st as g sed a map to the Spa tans thei line of march 282 years earlier . -

A History of Rome to 565 A. D. by Arthur Edward Romilly Boak
The Project Gutenberg EBook of A History of Rome to 565 A. D. by Arthur Edward Romilly Boak This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: A History of Rome to 565 A. D. Author: Arthur Edward Romilly Boak Release Date: May 31, 2010 [Ebook 32624] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A HISTORY OF ROME TO 565 A. D.*** A HISTORY OF ROME TO 565 A. D. BY ARTHUR E. R. BOAK, Ph. D., Professor of Ancient History in the University of Michigan v New York THE MACMILLAN COMPANY 1921 All rights reserved COPYRIGHT, 1921. By THE MACMILLAN COMPANY. Set up and electrotyped. Published December, 1921. vii PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA [v] PREFACE This sketch of the History of Rome to 565 A. D. is primarily intended to meet the needs of introductory college courses in Roman History. However, it is hoped that it may also prove of service as a handbook for students of Roman life and literature in general. It is with the latter in mind that I have added the bibliographical note. Naturally, within the brief limits of such a text, it was impossible to defend the point of view adopted on disputed points or to take notice of divergent opinions. Therefore, to show the great debt which I owe to the work of others, and to provide those interested in particular problems with some guide to more detailed study, I have given a list of selected references, which express, I believe, the prevailing views of modern scholarship upon the various phases of Roman History. -

La Langue Gauloise : Grammaire, Textes Et Glossaire
m COLLECTION POUR [ÉTUDE DES ANTIQUITÉS NATIONALES II LA LANGUE GAULOISE PAR G.DOTTIN amammama PARIS HBRAnilE CKimCKSIECK m-r- /t'uijui TldàSiâ^ LA LANGUE (GAULOISE Précédemment paru dans la même collection. G. DoTTiN, Les anciens peuples de l'Europe, in-H^ relié, 6 fP. COLLECTION POUR L'ETUDE DES ANTIQUITÉS NATIONALES II LA LANGUE GAULOISE COLLECTION POUR L'ÉTUDE DES ANTIQUITÉS NATIONALES II LA LANGUE GAULOISE GRAMMAIRE, TEXTES ET GLOSSAIRE Georges DOTTIN DOYEN \>V. LA IACH.TK I>I:s I.KTTl^RS DE HENNES PARIS LIBRAIRIE C. KLINCKSIEGK M, RUE DE LILLE, H 1918 Tous droits réservés. Copyright }>ij C. Klincki^leck, 191 S. Le livre de M. DoUin renferme tout ce que nous savons de la langne gauloise, c'esl-à-dir€ de la langue parlée dans la Ganie, il y a deux mille ans, par les peuples qui s'appelaient les Gaulois. Ce que dous savons de celle langue est malheureu- sement fort peu de chose : quelques; mots, conservés par les Anciens ; beaucoup de noms propres, dont le sens est souvent douteux lot assez restreint d'in- ; un scriptions, plus faciles à déchiffrer qu'à traditire. Si le vocabulaire ne nous est point inconnu, la strucliire de la langue, qui est l'essentiel, nous échappe à peu près complètement. Ce livre, si copieux soit^il, n'est donc qu'un monument d'attente en vue d'un avenir qu'on a le droit d'espérer. Je dis qu'on a le droit d'espérer un avenir qui nous fera connaître, de la langue gauloise, beaucoup de ce que nous ignorons. -

Aberystwyth University Dictionary of Continental Celtic Place-Names
Aberystwyth University Dictionary of Continental Celtic Place-Names Falileyev, Alexander; Gohil, Ashwin E.; Ward, Naomi; Briggs, Keith Publication date: 2010 Citation for published version (APA): Falileyev, A., Gohil, A. E., Ward, N., & Briggs, K. (2010). Dictionary of Continental Celtic Place-Names: A Celtic Companion to the Barrington Atlas of the Greek and Roman World. CMCS Publications. http://hdl.handle.net/2160/10148 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Aberystwyth Research Portal (the Institutional Repository) are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the Aberystwyth Research Portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the Aberystwyth Research Portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. tel: +44 1970 62 2400 email: [email protected] Download date: 02. Oct. 2021 Abalus Ins.? Reudigni? Lugdunum Matilo Aurelium Cananefatium Kaloukones? Rhenus fl.? Lugii? 52 Helinium? Levefanum Helinium fl.? Carvo Carvium Mosa fl.? Batavodurum Noviomagus Salas fl.? Ganuenta -

L'ethnicité En Mode Régressif, De L'âge Du Fer À L'âge Du
In : D. Garcia dir., L’Âge du bronze en Méditerranée. Recherches récentes. Paris, Errance, 2011, pp. 171-191. L’ethnicité en mode régressif, de l’Âge du fer à l’Âge du bronze Quelques problèmes épistémologiques Philippe Boissinot Parler de l’ethnicité pour l’Âge du bronze, à une période où l’on ne possède aucun texte relatant les agissements d’un quelconque peuple dans cette partie occidentale du monde antique (le midi de la France), ne peut se faire de la même manière qu’à l’Âge du fer où l’on peut (parfois) croiser des vestiges matériels et des énoncés déjà formulés, au moins à partir de la première implantation coloniale grecque (Marseille). Écrivant l’histoire à partir du présent, c’est toujours en mode régres- sif que l’on procède, si bien que l’on est amené, en remontant le temps, à perdre cette familiarité apparente des textes pour ne se consacrer qu’aux seules traces matérielles : celles-ci sont-elles aptes à faire émerger un discours de type ethnographique, sans que des noms nous aient été déjà don- nés ? Ces objets et ces habitats mis au jour sont-ils des moyens sûrs pour attribuer et qualifier une présence, des actions ? Peut-on être à un moment raccord – comme l’on dit au cinéma à propos de l’ajustement de plans successifs d’un film – entre ce qui a été dit et ce qui a été découvert ? Poser ces questions engage les capacités cognitives de l’archéologie et nécessite un examen théorique des philosophies de l’esprit requises pour penser les collectifs, car seule la pluralité est significative pour envisager les realia. -

The Romans in Italy, Spain, and Gaul 1 the Completion of the Roman Conquest of Italyand Spain
THE GREATNESS AND DECLINE OF THE CELTS PART TWO THE END OF THE CELTIC WORLD CHAPTER I THE ROMANS IN ITALY, SPAIN, AND GAUL 1 THE COMPLETION OF THE ROMAN CONQUEST OF ITALYAND SPAIN THE independence of the Celtic world was nearing its end. In addition to the Germanic danger, one yet more urgent appeared. The Roman Republic was preparing to complete its domination of the Gallic countries. In Italy [Chapot, CCCXI, English pp. 122 ff.] something still remained to be done. The four great Gallic peoples had been crushed, and what remained of them had been reduced to the status of civitates fæderatæ. But the condition of the Celtic or Ligurian peoples on the outskirts was very uncertain, and remained so for a long time. In the first century the peasant culture of the Cisalpine country was still entirely Gallic and no change seems to have occurred there when the Cimbri came in. After the end of the Cimbric invasion the policy of founding colonies was at once resumed. In 100 one was erected at Eporedia (Ivrea), to keep watch on the country of the Salassi. As a result of the Social War, the towns of the Insubres and Cenomani obtained Latin rights by the Lex Pompeia of 80. This privilege, which was of certain advantage to the towns, which were incorporated in the Italian municipal system, but of doubtful benefit to people living in the country, completed the breaking-up of the old nations. A few years later Sulla made the Cisalpine region a province, Gallia Cisalpina, which was attached to Italy in 42 and broken up. -

The Ethnology of Europe
THE ETHNOLOGY OF EUROPE BY R. G. LATHAM THE ETHNOLOGY OF EUROPE CHAPTER I. PRELIMINARY OBSERVATIONS.—THE PHYSICAL PECULIARITIES OF EUROPE.—GENERAL SKETCH OF ITS ETHNOLOGY.—STATEMENT OF PROBLEMS.—THE SKIPETAR, OR ALBANIANS.—THEIR LANGUAGE, DESCENT.—THE FOUR TRIBES.—HOW FAR A PURE STOCK.—ELEMENTS OF INTERMIXTURE. THE proper introduction to the ethnology of Europe is the following series of preliminaries:— 1. The physical peculiarities of the quarter of the world so called; 2. A general view of the stocks, families, or races which occupy it; 3. A statement of the chief problems connected with the Natural History of its populations. 1. The physical conditions of Europe are as remarkable in respect to their negative as their positive characters; in other words, there is a great number of points wherein Europe differs from Asia, Africa, America, and Polynesia, in respect to what it has not, as well as in respect to what it has. These negative points will be treated first. a. No part of Europe lies between the Tropics; so that the luxuriance of a spontaneous and varied vegetation, with its pernicious tendencies to incline the habits of its population to idleness, is wanting. The rank and rapid growth of the plants which serve as food to men and animals, and which dispense with labour, nowhere occurs. b. No part comes under the class of Steppes; or, at most, but imperfectly approaches their character. In Asia, the vast table-lands of the centre, occupied by the Turks and Mongols, have ever been the cradle of an active, locomotive, hungry, and aggressive population.