Femmes Et Vie Politique De La Conquête Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
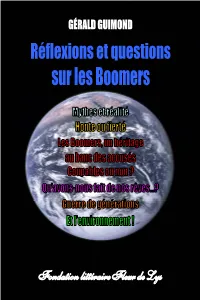
N.Gerald-Guimond.1.Pdf
Mythes et réalité Honte ou fierté Les Boomers, un héritage au banc des accusés Coupables ou non ? Qu’avons-nous fait de nos rêves…? Guerre de générations Et l’environnement ! Réflexions et questions sur les Boomers, Essai, Gérald Guimond, Fondation littéraire Fleur de Lys, Laval, Québec, 2009, 490 pages. Édité par la Fondation littéraire Fleur de Lys, organisme à but non lucratif, éditeur libraire québécois en ligne sur Internet. Adresse électronique : [email protected] Site Internet : www.manuscritdepot.com Tous droits réservés. Toute reproduction de ce livre, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous les pays. La reproduction d’un extrait quelconque de ce livre, par quelque moyen que ce soit, tant électronique que mécanique, et en particulier par photocopie et par microfilm, est interdite sans l’auto- risation écrite de l’auteur. Disponible en version numérique et papier ISBN 978-2-89612-289-9 ©Copyright 2008 Gérald Guimond Illustration en couverture : La Bille bleue, photo prise par l'équipage d'Apollo 17 le 7 décembre 1972 © NASA. Dépôt légal – 2e trimestre 2009 Bibliothèque et archives nationales du Québec Bibliothèque et archives nationales du Canada Imprimé à la demande au Québec. Dédicace À mes enfants Céline et Denis, à mes neveux et nièces, à tous ces jeunes côtoyés dans l’enseignement, espérant que vous y puiserez un goût de changer des choses dans ce monde marqué par le no future. 9 La recherche et l’écriture de ce livre ont été faites de mars 2005 à juin 2008, avant la crise financière des papiers commerciaux et les scandales qui y sont reliés. -

Le Temps De Parole
VOLUME 19, NUMÉRO 2, JUIN 2018 LE TEMPS DE PAROLE 50e anniversaire du Parti québécois L’assemblée générale annuelle du 16 mai 2018 Le mandat d’initiative sur la place des femmes en politique TABLE DES MATIÈRES LES PREMIERS MINISTRES PÉQUISTES 3 Mot du rédacteur DU QUÉBEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 4 Conseil d’administration 2018-2019 René Lévesque, 1976-1985 5 Rapport du président Fonds Assemblée nationale du Québec 9 Rapports des comités Photographe : Kedl 12 Prix de l’Amicale 17 Sous l’œil des photographes 50E ANNIVERSAIRE DU PARTI QUÉBÉCOIS 22 Le Parti québécois : un demi-siècle d’existence 27 Le gouvernement Lévesque : la deuxième phase Pierre Marc Johnson, 1985 de la Révolution tranquille Fonds Assemblée nationale du Québec Photographe : Kedl 31 Le gouvernement Parizeau propose la souveraineté du Québec 35 Le gouvernement Bouchard : redressement économique et progrès social 38 Le gouvernement Landry : miser sur le développement économique et la justice sociale 41 Le gouvernement Marois : un mandat bref, un bilan étoffé Jacques Parizeau, 1994-1996 Fonds Assemblée nationale du Québec AFFAIRES COURANTES Photographe : Daniel Lessard 45 La place des femmes en politique JE ME SOUVIENS 48 Le cimetière de la guerre de Sept Ans 51 Coups de crayon! La satire politique en dessins Lucien Bouchard, 1996-2001 EN PREMIÈRE LECTURE Fonds Assemblée nationale du Québec 52 En première lecture Photographe : Daniel Lessard EN DEUXIÈME LECTURE 55 Les Prix du livre politique de l’Assemblée nationale À L’ÉCRAN 56 Mémoires de députés Bernard Landry, 2001-2003 Fonds Assemblée nationale du Québec ANCIENS ET ANCIENNES PARLEMENTAIRES EN ACTION Photographe : Daniel Lessard 58 Anciens parlementaires en action 63 Songhaï : une Afrique qui relève la tête SOUVENONS-NOUS DE .. -

Government 95
Government 95 Minister responsible for Energy, Hon. Guy Minister of Cultural Affairs and Minister of Joron Communications, Hon. Louis O'Neill Minister of Consumer Affairs, Co-operatives Minister of Natural Resources and Minister of and Financial Institutions, Hon. Lise Payette Lands and Forests, Hon. Yves Bérubé Minister of Agriculture, Hon. Jean Garon Minister of Industry and Commerce, Hon. Minister of Social Affairs, Hon. Denis Lazure Rodrigue Tremblay Minister of Municipal Affairs, Hon. Guy Tardif Minister of Tourism, Fish and Game, Hon. Minister of Labour and Manpower, Hon. Yves Duhaime Pierre-Marc Johnson Public Service Minister and Vice-Président of Minister of Immigration, Hon. Jacques Couture the Treasury Board, Hon. Denis De Belleval Minister of Public Works and Supply, Hon. Jocelyne Ouellette. Ontario 3.3.1.6 The government of Ontario consists of a lieutenant-governor, an executive council and a Législative Assembly. In April 1974 the Honourable Pauline McGibbon took office as lieutenant-governor. The Législative Assembly is composed of 125 members elected for a statutory term not to exceed five years, At the provincial élection June 9, 1977, 58 Progressive Conservatives, 34 Libérais and 33 New Democrats were elected to the province's 3Ist Législature. In addition to the regular ministries are the following provincial agencies: the Niagara Parks Commission, the Ontario Municipal Board, Ontario Hydro, the St. Lawrence Development Commission, the Ontario Northland Transportation Commis sion, the Liquor Control Board and the Liquor Licence Board. Under the provisions of the Législative Assembly Act (RSO 1970, c.240 as amended) each member of the assembly is paid an annual indemnity of $15,000 and an expense allowance of $7,500. -

Journal Des Débats
journal des Débats Le mercredi 21 mars 1984 Vol. 27 - No 73 Table des matières Affaires du jour Projet de loi 48 - Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives Reprise du débat sur la prise en considération du rapport de la commission qui en a fait l'étude détaillée 5337 M. Herbert Marx 5337 Mme Lise Bacon 5338 M. Luc Tremblay 5340 M. Claude Dubois 5341 M. Georges Vaillancourt 5343 M. Gilles Baril 5344 M. Richard French 5345 M. William Cusano 5347 M. Roma Hains 5348 M. Lucien Caron 5350 M. John O'Gallagher 5351 M. Yves Beaumier 5352 M. Daniel Johnson 5353 M. Marc-Yvan Côté 5356 M. Patrice Laplante 5357 M. Claude Dauphin 5359 M. John J. Kehoe 5361 Mme Madeleine Bélanger 5363 Affaires courantes Le dépôt des pétitions 5364 Dépôt de documents Rapport annuel du ministère de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu 5365 Rapport annuel de la Caisse de dépôt et placement du Québec 5365 Rapports financiers de SIDBEC 5365 Questions et réponses orales La médecine d'urgence au Québec 5365 La révision du Code du travail 5367 L'abolition du péage sur les autoroutes 5369 Le dossier des loteries 5372 La privatisation des magasins de la SAQ 5373 L'engagement de M. Luc Cyr à la Société d'habitation du Québec (SHQ) 5374 Motions sans préavis Nouveaux membres du Bureau de l'Assemblée nationale 5380 Avis touchant les travaux des commissions 5380 Avis de débat de fin de séance 5380 Renseignements sur les travaux de l'Assemblée 5380 Affaires du jour Affaires inscrites par les députés de l'Opposition Reprise du débat sur la motion réclamant que des mesures soient prises pour corriger la situation créée par la loi 43 - Loi concernant les travailleurs au pourboire de la restauration et de l'hôtellerie 5381 M. -

Consulter Le Livre
Le Comité aviseur de l’action communautaire autonome Dix ans de luttes pour la reconnaissance Eliana Sotomayor Madeleine Lacombe Le Comité aviseur de l’action communautaire autonome Dix ans de luttes pour la reconnaissance Préface de Daniel Lamoureux Recherche et rédaction de l’historique : Eliana Sotomayor Entrevues : Madeleine Lacombe Coordination : Daniel Lamoureux Révision du texte et correction des épreuves : Monique Moisan Soutien technique, index des sigles : Céline Métivier Conception graphique et mise en page : Monique Moisan Maquette de la couverture : Monique Moisan Illustration : Sonio Benvenuto, Red Wave, 2000, 17 x 12,5 cm (6,5 x 5 po.), acrylique sur masonite. Édition et distribution : Comité aviseur de l’action communautaire autonome 4360, rue D’Iberville Montréal, QC H2H 2L8 [email protected] © Comité aviseur de l’action communautaire autonome, 2006 Tous droits réservés pour tous pays Imprimé au Canada sur les presses des ateliers de l’Imprimerie Marquis ISBN-13 : 978-2-9809663-0-9 ISBN-10 : 2-9809663-0-4 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2006 Remerciements e COMITÉ AVISEUR DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME remercie chaleureusement les coauteures du présent ouvrage, Eliana Sotomayor et MadeleineL Lacombe, qui ont accompli un remarquable travail de recherche et de synthèse dans un délai si court. Il remercie les autres membres de l’équipe de production : Monique Moisan, Jean Panet-Raymond, Pierre Valois, Daniel Lamoureux. Il remercie la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Centre de formation populaire et le Secrétariat à l’action communautaire autonome (ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, gouvernement du Québec) pour leur soutien financier. -

Politique Active Et Féminisme : Les Députées De L'assembleé Nationale
Document generated on 09/28/2021 7:17 a.m. Bulletin d'histoire politique Politique active et féminisme Les députées de l’Assembleé nationale Micheline Dumont Les femmes en politique québécoise depuis 50 ans Volume 20, Number 2, Winter 2012 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1055943ar DOI: https://doi.org/10.7202/1055943ar See table of contents Publisher(s) Bulletin d'histoire politique VLB Éditeur ISSN 1201-0421 (print) 1929-7653 (digital) Explore this journal Cite this article Dumont, M. (2012). Politique active et féminisme : les députées de l’Assembleé nationale. Bulletin d'histoire politique, 20(2), 47–60. https://doi.org/10.7202/1055943ar Tous droits réservés © Association québécoise d’histoire politique; VLB Éditeur, This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit 2012 (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Politique active et féminisme Les députées de l’Assemblée nationale MICHELINE DUMONT Professeure émérite Université de Sherbrooke Cinquante ans après l’élection de Marie-Claire Kirkland1, personne ne ques- tionne plus la pertinence que des femmes se retrouvent en politique ac- tive. Il n’en a pas toujours été ainsi. En 1964, Keith Spicer, alors adjoint du ministre de la Justice à Ottawa, déclarait à la télévision canadienne, dans le cadre de l’émission Sextant : « Une femme en politique est un objet de ridi- cule, c’est une bizarrerie. -

Asper Nation Other Books by Marc Edge
Asper Nation other books by marc edge Pacific Press: The Unauthorized Story of Vancouver’s Newspaper Monopoly Red Line, Blue Line, Bottom Line: How Push Came to Shove Between the National Hockey League and Its Players ASPER NATION Canada’s Most Dangerous Media Company Marc Edge NEW STAR BOOKS VANCOUVER 2007 new star books ltd. 107 — 3477 Commercial Street | Vancouver, bc v5n 4e8 | canada 1574 Gulf Rd., #1517 | Point Roberts, wa 98281 | usa www.NewStarBooks.com | [email protected] Copyright Marc Edge 2007. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, without the prior written consent of the publisher or a licence from the Canadian Copyright Licensing Agency (access Copyright). Publication of this work is made possible by the support of the Canada Council, the Government of Canada through the Department of Cana- dian Heritage Book Publishing Industry Development Program, the British Columbia Arts Council, and the Province of British Columbia through the Book Publishing Tax Credit. Printed and bound in Canada by Marquis Printing, Cap-St-Ignace, QC First printing, October 2007 library and archives canada cataloguing in publication Edge, Marc, 1954– Asper nation : Canada’s most dangerous media company / Marc Edge. Includes bibliographical references and index. isbn 978-1-55420-032-0 1. CanWest Global Communications Corp. — History. 2. Asper, I.H., 1932–2003. I. Title. hd2810.12.c378d34 2007 384.5506'571 c2007–903983–9 For the Clarks – Lynda, Al, Laura, Spencer, and Chloe – and especially their hot tub, without which this book could never have been written. -
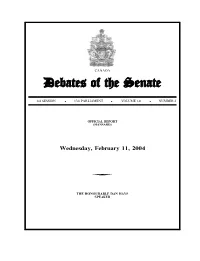
Debates of the Senate
CANADA Debates of the Senate 3rd SESSION . 37th PARLIAMENT . VOLUME 141 . NUMBER 6 OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, February 11, 2004 ^ THE HONOURABLE DAN HAYS SPEAKER CONTENTS (Daily index of proceedings appears at back of this issue). Debates and Publications: Chambers Building, Room 943, Tel. 996-0193 Published by the Senate Available from Communication Canada ± Canadian Government Publishing, Ottawa, Ontario K1A 0S9. Also available on the Internet: http://www.parl.gc.ca 112 THE SENATE Wednesday, February 11, 2004 The Senate met at 1:30 p.m., the Speaker in the Chair. I had the privilege and great pleasure of knowing Robert Stanfield for many years. His warmth and folksiness were Prayers. legendary, as was the huge, compassionate heart of this independently wealthy Red Tory. SENATORS' STATEMENTS Today I want to reflect on the late Dalton Camp's oft-quoted comment that Robert Stanfield ``may be too good for politics.'' TRIBUTES That reflection was, with the greatest respect to Dalton, inaccurate. THE LATE RIGHT HONOURABLE ROBERT L. STANFIELD, P.C., Q.C. Tough-minded, disciplined and possessed of remarkable intellectual flexibility, the man who became an icon in my The Hon. the Speaker: Honourable senators, I wish to advise province brought civility, honour and a new respect for the that I have received, pursuant to our rules, a letter from the political playing field, yet he was also a gifted tactician and a Honourable Senator Lynch-Staunton, Leader of the Opposition masterful strategist in battle. There is a great deal of credence in in the Senate, requesting that we provide for time this afternoon the very worthy observation that Robert Stanfield bore a for tributes to the Right Honourable Robert L. -

2018-10-09 – Henderson – Mémoire À La
500-09-027501-188 Court of Appeal of uébec Montréal On appeal from a Judgment of the Superior Court, District of Montréal, rendered on April 18, 2018 by the Honourable Claude Dallaire, J.S.C. No. 500-05-065031-013 S.C.M. KEITH OWEN HENDERSON APPEllANT - Petitioner v. ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC RES PONDENT - Respondent -and- ATTORNEY GENERAL OF CANADA MIS EN CAUSE -Intervener -and- SOCIÉTÉ SANT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE - Intervener APPELLANT'S BRIEF Volume 3: pages 396 to 779 Dated October 9, 2018 Me Brent D. Tyler Me Stephen A. Scott 83 Saint-Paul Street West 3644 Peel Street Montréal, Québec Montréal, Québec H2Y 1Z1 H3A 1W9 Tel. : 514966-2977 Tel. : 514398-6617 Fax: 514842-8055 Fax: 514 398-4659 [email protected] [email protected] Attorney for Appellant Counsel for Appellant THÉMIS MULTIFACTUM INC. 4, rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 188 Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861 [email protected] www.multifactum.com 500-09-027501-188 Court of Appeal of uébec Montréal Me Jean-Yves Bernard, Ad. E. Me Claude Jayal, Ad. E. BERNARD, Roy (JUSTICE-QUÉBEC) DEPARTMENT OF JUSTICE 1 Notre-Dame Street East Complexe Guy-Favreau, East Tower Suite 8.00 200 René-Lévesque 8lvd. West Montréal, Québec 9th Floor H2Y 186 Montréal, Québec H2Z 1X4 Tel. : 514393-2336, ext. 51467 Tel. : 514283-8768 Fax: 514873-7074 Fax: 514283-3856 jean-yves. [email protected] [email protected] Attorney for Respondent Attorney for Mis en cause Attorney General of Canada Me Marc Michaud MICHAUD SANTORIELLO AVOCATS 5365 Jean-Talon Street East Suite 602 Saint-Léonard, Québec H1S 3G2 Tel.: 514374-8777 Fax: 514374-6698 [email protected] Attorney for Mise en cause Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal THÉMIS MULTIFACTUM INC. -

L'impact Des Revendications Féministes Dans Les Réformes Du Code Du Travail
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL L'IMPACT DES REVEND ICATI ONS FÉMINISTES DANS LES RÉFORMES DU CODE DU TRAVAIL MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN DROIT PAR LAURENCE CÔTÉ-LEBRUN FÉVRIER 2017 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.1 0-2015). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l 'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l 'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire .» REMERCIEMENTS Je souhaite adresser quelques mots de remerciement aux féministes et hommes pro-féministes m'ayant entouré-e-s durant mon processus de rédaction et plus largement au courant de mon parcours à l'UQAM. -

Journal Des Débats
journal des Débats Le jeudi 20 mars 1980 Vol. 21 — No 96 Table des matières Questions orales des députés L'avenir des commissions scolaires 5361 Grève des cols bleus de Montréal 5363 Habitations à loyer modique 5365 Conflit de travail dans les raffineries de l'est de Montréal 5366 Les permis de travail dans la construction 5367 Les centres d'accueil de la région 04 manquent de ressources 5368 Motion non annoncée Membres des commissions scolaires 5369 Question de privilège Article de journal erroné 5369 Mme Jocelyne Ouellette 5369 Recours à l'article 34 M. André Raynauld 5370 Avis à la Chambre 5370 Travaux parlementaires 5371 Motion privilégiée relative à la question devant faire l'objet d'une consultation populaire sur une nouvelle entente avec le Canada Reprise du débat sur la motion principale, les trois motions d'amendement et la motion de sous-amendement 5374 M. Marc-André Bédard 5374 M. Gérard-D. Levesque 5376 M. Rodrigue Biron 5379 M. Patrice Laplante 5380 M. Jean Garon 5380 Mme Solange Chaput-Rolland 5382 M. Guy Chevrette 5383 M. Julien Giasson 5384 Mme Lise Payette 5386 M. John Ciaccia 5387 M. Claude Charron 5388 M. Rodrigue Tremblay 5389 Mme Thérèse Lavoie-Roux 5389 M. Camil Samson 5391 M. Michel Le Moignan 5392 M. Claude Ryan 5395 M. René Lévesque 5398 Mise aux voix de la motion d'amendement de M. Le Moignan 5401 Mise au voix de la motion d'amendement de M. Biron 5402 Mise aux voix de la motion de sous-amendement de M. Tremblay 5402 Mise aux voix de la motion d'amendement de M. -
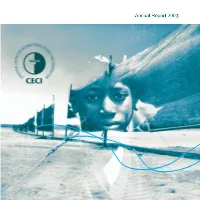
CECI RA 2002-2003 Anglaispdf
3 Table of Contents Message from the Chair and the Executive Director 2 Vision and Strategic Objectives for 2003-2008 3 Our Corporate Membership 3 Partnerships for the Future 4 An Exceptionally Busy Year 5 Achievements in the Field 6 Thank You to all of our Donors 11 Financial Statements 12 CECI in the World 16 WRITTEN AND COORDINATED BY Robert Hazel CONTRIBUTORS Ginette Chalifoux, Jocelyne Dallaire, Claude Perras, etc. GRAPHIC DESIGN AND PRODUCTION Corégraph communications TRANSLATION Tony Kwan 2003: The International Year of Fresh Water Photos:Cover Louis-Joseph Goulet (CECI). Gervais L’Heureux, in English and Spanish editions.This report is also available Number printed: 1,500 - Printed on recycled paper 2003 © CECI, August CECI (CECI) OULX R P ANIEL D HOTO BY P CECI combats poverty and exclusion. To this end, it "strengthens the development capacity of disadvantaged communities; supports ini- tiatives for peace, human rights and equity; mobilizes resources and promotes the exchange of know-how." CECI is governed by a Board of Directors composed of unremunerated members elected by CECI’s membership at the Annual General Assembly. CECI’s corporate membership is composed of nearly 100 volunteers from various sectors: religious institutions, academia, the business community, organizations active on the international stage, former CECI volunteers, etc. The Annual General Assembly was held in Montreal on Saturday, September 21, 2002. The organization carries out its mission via partnerships with organizations based in developing countries and in collaboration with part- ners in Canada or other countries from the North, such as France, Australia, the United States, etc.