Consulter Le Livre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
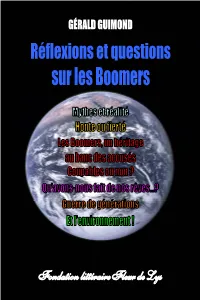
N.Gerald-Guimond.1.Pdf
Mythes et réalité Honte ou fierté Les Boomers, un héritage au banc des accusés Coupables ou non ? Qu’avons-nous fait de nos rêves…? Guerre de générations Et l’environnement ! Réflexions et questions sur les Boomers, Essai, Gérald Guimond, Fondation littéraire Fleur de Lys, Laval, Québec, 2009, 490 pages. Édité par la Fondation littéraire Fleur de Lys, organisme à but non lucratif, éditeur libraire québécois en ligne sur Internet. Adresse électronique : [email protected] Site Internet : www.manuscritdepot.com Tous droits réservés. Toute reproduction de ce livre, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous les pays. La reproduction d’un extrait quelconque de ce livre, par quelque moyen que ce soit, tant électronique que mécanique, et en particulier par photocopie et par microfilm, est interdite sans l’auto- risation écrite de l’auteur. Disponible en version numérique et papier ISBN 978-2-89612-289-9 ©Copyright 2008 Gérald Guimond Illustration en couverture : La Bille bleue, photo prise par l'équipage d'Apollo 17 le 7 décembre 1972 © NASA. Dépôt légal – 2e trimestre 2009 Bibliothèque et archives nationales du Québec Bibliothèque et archives nationales du Canada Imprimé à la demande au Québec. Dédicace À mes enfants Céline et Denis, à mes neveux et nièces, à tous ces jeunes côtoyés dans l’enseignement, espérant que vous y puiserez un goût de changer des choses dans ce monde marqué par le no future. 9 La recherche et l’écriture de ce livre ont été faites de mars 2005 à juin 2008, avant la crise financière des papiers commerciaux et les scandales qui y sont reliés. -
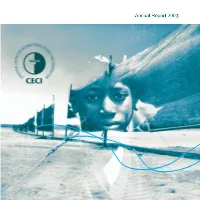
CECI RA 2002-2003 Anglaispdf
3 Table of Contents Message from the Chair and the Executive Director 2 Vision and Strategic Objectives for 2003-2008 3 Our Corporate Membership 3 Partnerships for the Future 4 An Exceptionally Busy Year 5 Achievements in the Field 6 Thank You to all of our Donors 11 Financial Statements 12 CECI in the World 16 WRITTEN AND COORDINATED BY Robert Hazel CONTRIBUTORS Ginette Chalifoux, Jocelyne Dallaire, Claude Perras, etc. GRAPHIC DESIGN AND PRODUCTION Corégraph communications TRANSLATION Tony Kwan 2003: The International Year of Fresh Water Photos:Cover Louis-Joseph Goulet (CECI). Gervais L’Heureux, in English and Spanish editions.This report is also available Number printed: 1,500 - Printed on recycled paper 2003 © CECI, August CECI (CECI) OULX R P ANIEL D HOTO BY P CECI combats poverty and exclusion. To this end, it "strengthens the development capacity of disadvantaged communities; supports ini- tiatives for peace, human rights and equity; mobilizes resources and promotes the exchange of know-how." CECI is governed by a Board of Directors composed of unremunerated members elected by CECI’s membership at the Annual General Assembly. CECI’s corporate membership is composed of nearly 100 volunteers from various sectors: religious institutions, academia, the business community, organizations active on the international stage, former CECI volunteers, etc. The Annual General Assembly was held in Montreal on Saturday, September 21, 2002. The organization carries out its mission via partnerships with organizations based in developing countries and in collaboration with part- ners in Canada or other countries from the North, such as France, Australia, the United States, etc. -

Le Parti Québécois : Bibliographie 1991-2003
__________________ Bibliographie et documentation, 47 DIRECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE SERVICE DE LA RÉFÉRENCE Le Parti québécois : bibliographie 1991-2003 par Gilberte Boilard en collaboration avec Claude Lajoie Québec Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec 2004 __________________ TABLE DES MATIÈRES DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX................................................................................. 3 INDEX - SUJETS............................................................................................................... 19 INDEX - AUX NOMS DES MINISTÈRES ...................................................................... 23 INDEX - AUX NOMS DES MINISTRES......................................................................... 25 DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE PARTI .............................................................................27 DOCUMENTS SUR LE PARTI ..............................................................................................45 Cette publication met à jour la bibliographie « Le Parti Québécois : bibliographie rétrospective » parue en 1991 et établie par MM. Robert Comeau et Michel Lévesque. Cette édition de 1991 correspond au no 38 de la collection Bibliographie et Documentation. Pour les fins de cette recherche, les sources suivantes ont été consultées : Cubiq, le catalogue collectif des bibliothèques gouvernementales, Amicus, le catalogue de la Bibliothèque nationale du Canada et le site Portail thèses Canada, Repère, la banque d'articles de périodiques, Canadian Periodical Index, BiblioBranché, -

«Je Me Souviens.» Devise Du Québec
«Je me souviens.» Devise du Québec Pour aider le gouvernement à retrouver la mémoire, voici quelques extraits des débats à l’Assemblée nationale ayant précédé immédiatement l’adoption de la loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté Les travaux parlementaires 36elégislature, 2e session (du 22 mars 2001 au 12 mars 2003) Journal des débats DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le mercredi 11 décembre 2002 Table des matières Souligner la présence du duc de Lévis Mirepoix, descendant direct du chevalier de Lévis Affaires courantes Présentation de projets de loi • Projet de loi n° 226 ― Loi concernant la Ville de Shawinigan • Mise aux voix • Renvoi à la commission de l'aménagement du territoire • Mise aux voix Dépôt de documents • Rapports annuels de la Corporation d'hébergement, d'Urgences-santé et de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie―Îles-de-la-Madeleine et rapport sur l'application de la procédure d'examen des plaintes de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec • Renvoi du rapport annuel de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie―Îles-de-la-Madeleine à la commission des affaires sociales pour examen • Rapports annuels du Comité d'orientation de la formation du personnel enseignant et du Comité sur les affaires religieuses • Rapports annuels de certains ordres professionnels • Rapport annuel de la Sûreté du Québec • Rapport annuel de la Société du Centre des congrès -

Sommaire Des Rapports De Dépenses Électorales Des Candidats Élections Générales Du 30 Novembre 1998
SOMMAIRE DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES DES CANDIDATS ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 30 NOVEMBRE 1998 ABITIBI-EST TOTAL FRAIS DÉPENSES TOTAL DES DÉPENSES DU FONDS BIENS ET LOCATION DE VOYAGE FAITES, ÉLECTORALES RÉCLAMATIONS CANDIDATS ÉLECTORAL PUBLICITÉ SERVICES DE LOCAUX ET REPAS NON RÉCLAMÉES ENGAGÉES ET ACQUITTÉES CONTESTÉES Lionel Brochu, P.L.Q. 33 016 $ 25 481 $ 5 464 $ 1 050 $ 907 $ -- 32 901 $ -- Daniel Falardeau, A.D.Q./É.M.D. 97 $ 97 $ -- -- -- -- 97 $ -- André Pelletier, P.Q. 32 996 $ 16 273 $ 12 259 $ 2 642 $ 1 573 $ -- 32 747 $ -- Jake Rouleau, P.D.S. -- -- -- -- -- -- -- -- Doris St-Pierre, IND. 838 $ 771 $ 68 $ -- -- -- 838 $ -- Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 33 016 $ ABITIBI-OUEST TOTAL TOTAL FRAIS DÉPENSES DES DÉPENSES DU FONDS BIENS ET LOCATION DE VOYAGE FAITES, ÉLECTORALES RÉCLAMATIONS CANDIDATS ÉLECTORAL PUBLICITÉ SERVICES DE LOCAUX ET REPAS NON RÉCLAMÉES ENGAGÉES ET ACQUITTÉES CONTESTÉES François Gendron, P.Q. 33 000 $ 20 590 $ 6 310 $ 1 368 $ 2 989 $ -- 31 257 $ -- René Lacroix, C.I.A. 870 $ 414 $ -- -- 36 $ -- 450 $ -- Michelle Melançon, A.D.Q./É.M.D. -- -- -- -- -- -- -- -- Martin Veilleux, P.L.Q. 33 651 $ 22 033 $ 7 389 $ 2 531 $ 1 685 $ -- 33 637 $ -- Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 33 663 $ ACADIE TOTAL TOTAL FRAIS DÉPENSES DES DÉPENSES DU FONDS BIENS ET LOCATION DE VOYAGE FAITES, ÉLECTORALES RÉCLAMATIONS CANDIDATS ÉLECTORAL PUBLICITÉ SERVICES DE LOCAUX ET REPAS NON RÉCLAMÉES ENGAGÉES ET ACQUITTÉES CONTESTÉES Yvan Bordeleau, P.L.Q. 37 962 $ 15 706 $ 18 024 $ 1 300 $ -- -- 35 030 $ -- Diane Boudreault, P.Q. 30 417 $ 23 805 $ 3 378 $ 1 100 $ 1 158 $ -- 29 440 $ -- Chantal Jean, P.C.Q. -

Mario Dumont N’Est Pas Pour Peu Que Nous Ayons Foi En Nous-Mêmes
LE BULLETIN HIVER 2003 Québec : pays d’Amérique « Et lorsque le Québec sera souverain ? » C’est la question que nous leur avons posée. À travers leurs témoignages, c’est le pays du Québec qui se dessine. IMAGINONS Rêver le Québec. Dessiner ses contours. SOMMAIRE Remplir ses formes avec un regard qui porte loin. Mettre en mots, en idées, en projets, ce pays qui doit naître. Pourquoi la souveraineté? Joindre au souffle de l’idéal des accents de réalisme. Dix bonnes raisons 4 Penser grand, généreux, audacieux. Le Québec souverain Pour nous-mêmes et pour celles et ceux qui nous suivent. sous toutes ses coutures 8 Pour la planète aussi, dont les défis nous interpellent. Les indépendances dans le monde 10 En un mot, imaginer la suite du monde, avec notre espace de liberté. Le Québec: pays d’Amérique 12 En marche vers le pays du Québec 17 C’est à cet exercice que vous invite ce bulletin. Vous serez inspirés par des données et des témoignages, Une école de pensée 17 surpris parfois par les gens qui vous parlent. Vous verrez prendre forme sous vos yeux Le saviez-vous? 22 de larges pans de notre histoire à venir, Mario Dumont n’est pas pour peu que nous ayons foi en nous-mêmes. souverainiste 23 De bien des horizons, avec des tonalités diverses, se disent dans ces pages les couleurs de notre pays. Avec les mots de la mémoire TÉMOIGNAGES comme avec ceux que nous inspire le présent, Pierre Paquette 6 Anik Pouliot 16 se précisent les bordures du rivage. Jean-Claude St-André 6 Maka Kotto 18 Diane Lemieux 6 Daniel Turp 18 Encore un petit coup de cœur et nous y serons. -
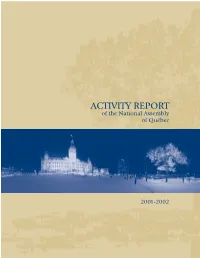
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2001-2002 1 This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2001 to 31 March 2002. Director: Patricia Rousseau Coordinator: Richard-Gilles Guilbault Supervisory and editorial committee: Jean Bédard Guy Bergeron Joan Deraîche Frédéric Fortin Yves Girouard Richard-Gilles Guilbault André Lavoie Denise Léonard Gilles Pageau Translation: Sylvia Ford Revision: Nancy Ford Design and page layout: Nathalie Cazeau Printing: National Assembly Press Photographs: Front cover: Denis Tremblay Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2002 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-39309-0 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .......................................................................................... 5 Foreword ............................................................................................. 6 The National Assembly ......................................................................... 8 its mission .................................................................................................. 9 the Members ............................................................................................ 10 The National Assembly and Parliamentary -

Vers Une Politique De Conciliation Travail-Famille Au Québec : Des Enjeux Complexes Et En Évolution
Université de Montréal Vers une politique de conciliation travail-famille au Québec : des enjeux complexes et en évolution par Nathalie St-Amour École de service social Faculté des arts et des sciences Thèse présentée à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de Ph.D. en service social Décembre 2010 © Nathalie St-Amour, 2010 Université de Montréal Faculté des études supérieures Cette thèse intitulée : Vers une politique de conciliation travail-famille au Québec : des enjeux complexes et en évolution présentée par : Nathalie St-Amour a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes : ________________________________________________ Christian Jetté, président-rapporteur ________________________________________________ Frédéric Lesemann, directeur de recherche ________________________________________________ Diane-Gabrielle Tremblay, codirectrice ________________________________________________ Renée B. Dandurand, membre du jury ________________________________________________ Nathalie Burlone, examinatrice externe i Résumé Au cours des dernières décennies, le thème de la conciliation travail-famille s’est taillé une place importante dans le discours populaire, médiatique et politique tant au Québec, dans les pays industrialisés que dans les organismes internationaux. L’expression désigne les défis que posent pour les individus, les couples, les familles, les milieux de travail et la société en général la relation nouvelle qui s’est développée entre ces deux sphères de vie avec le passage d’une société industrielle à une société dite postindustrielle. Ces défis perçus, ressentis, identifiés et définis différemment par l’un ou l’autre de ces acteurs se sont traduits par l’inscription de cette question à l’agenda politique des gouvernements, ici comme ailleurs. L’objet de la recherche est de comprendre les dynamiques entourant le développement des actions de l’État québécois sur le thème de la conciliation travail-famille. -

Femmes Et Vie Politique De La Conquête Du
Femmes et vie politique De la conquête du droit de vote à nos jours Assemblée nationale du Québec Hôtel du Parlement Québec (Québec) G1A 1A3 assnat.qc.ca [email protected] POSITION 1 866 DÉPUTÉS 1940-2010 Femmes et vie politique De la conquête du droit de vote à nos jours 1940-2010 Cette publication est une réalisation de l’Assemblée nationale du Québec. Dépôt légal – 2010 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 978-2-550-58536-7 Le droit de vote des femmes : ancré dans 70 ans d’histoire Les anniversaires nous permettent de mesurer le chemin parcouru et de réfléchir aux années à venir. L’année 2010 marque le 70e anniversaire du droit de vote et d’éligibilité des Québécoises, acquis en avril 1940 après des années de combats menés par des femmes comme Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. Il faut attendre 1961 pour qu’une première femme, Marie-Claire Kirkland, soit élue au Québec, suivie par Lise Bacon, en 1973. À mon entrée en politique, en 1973, Lise Bacon était la seule femme parlementaire, Marie-Claire Kirkland ayant quitté la politique quelques mois auparavant. De nos jours, pareille sous-représentation serait complètement impensable. Des pionnières d’hier aux battantes d’aujourd’hui, les femmes ont non seulement parcouru un chemin considérable, mais aussi enrichi le débat politique de leur voix. De plus, par leur engagement, elles ont fait progresser la société québécoise grâce à des lois favorisant toujours plus l’égalité entre les sexes. Depuis près d’un demi-siècle, plus d’une centaine de femmes se sont succédé au Parlement. -

Entre Les Femmes Et Les Hommes Dans L'égalité
Les députées de l’Assemblée nationale du Québec dans l’égalité entre les femmes et les hommes Les députées de l’Assemblée nationale du Québec dans l’égalité entre les femmes et les hommes Cette publication est une réalisation de l’Assemblée nationale du Québec. Dépôt légal – 2008 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 978-2-550-52780-0 Table des matières Mot du président de l’Assemblée nationale du Québec ...........................................................................................4 Mot de la première vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec .............................................................5 De 1961 à 2008 ..............................................................................................................................................................7 Historique du droit de vote et d’éligibilité..................................................................................................................8 Réalisations législatives des femmes parlementaires québécoises........................................................................10 Les parlementaires québécoises et leur rayonnement international ....................................................................12 Les premières..............................................................................................................................................................13 Notices biographiques des femmes parlementaires ...............................................................................................14 -
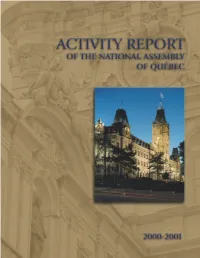
Rapport AN-2001
This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2000 to 31 March 2001. Director Cécilia Tremblay Coordinator Jean Bédard Supervisory Committee Jean Bédard Michel Bonsaint Hélène Galarneau Johanne Lapointe Patricia Rousseau Cécilia Tremblay Editor Johanne Lapointe assisted by Lise St-Hilaire Translator Sylvia Ford Revisors Nancy Ford Denise Léonard Design Joan Deraîche Page layout Robert Bédard Manon Dallaire Joan Deraîche Printing National Assembly Press Photographs Front cover: Eugen Kedl Luc Antoine Couturier Photographs of the Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2001 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-37742-7 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .............................................................................................................. 5 Foreword ........................................................................................................... 6 The National Assembly ......................................................................... 7 its mission ...................................................................................................... 9 the Members ................................................................................................. -

Souffez Karine 2008 Memoire.Pdf
Direction des bibliothèques AVIS Ce document a été numérisé par la Division de la gestion des documents et des archives de l’Université de Montréal. L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse. L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur. Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien que cela ait pu affecter la pagination, il n’y a aucun contenu manquant. NOTICE This document was digitized by the Records Management & Archives Division of Université de Montréal. The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and research purposes. The author and co-authors if applicable retain copyright ownership and moral rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without the author’s permission.