Hydro-Québec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
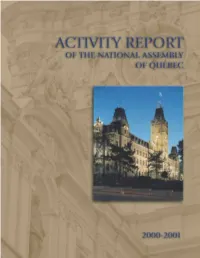
Rapport AN-2001
ACTIVITY REPORT OF THE NATIONAL ASSEMBLY 2000-2001 This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2000 to 31 March 2001. Director Cécilia Tremblay Coordinator Jean Bédard Supervisory Committee Jean Bédard Michel Bonsaint Hélène Galarneau Johanne Lapointe Patricia Rousseau Cécilia Tremblay Editor Johanne Lapointe assisted by Lise St-Hilaire Translator Sylvia Ford Revisors Nancy Ford Denise Léonard Design Joan Deraîche Page layout Robert Bédard Manon Dallaire Joan Deraîche Printing National Assembly Press Photographs Front cover: Eugen Kedl Luc Antoine Couturier Photographs of the Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2001 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-37742-7 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .............................................................................................................. 5 Foreword ........................................................................................................... 6 The National Assembly ......................................................................... 7 its mission ...................................................................................................... 9 the Members ................................................................................................. -
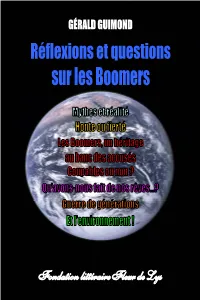
N.Gerald-Guimond.1.Pdf
Mythes et réalité Honte ou fierté Les Boomers, un héritage au banc des accusés Coupables ou non ? Qu’avons-nous fait de nos rêves…? Guerre de générations Et l’environnement ! Réflexions et questions sur les Boomers, Essai, Gérald Guimond, Fondation littéraire Fleur de Lys, Laval, Québec, 2009, 490 pages. Édité par la Fondation littéraire Fleur de Lys, organisme à but non lucratif, éditeur libraire québécois en ligne sur Internet. Adresse électronique : [email protected] Site Internet : www.manuscritdepot.com Tous droits réservés. Toute reproduction de ce livre, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous les pays. La reproduction d’un extrait quelconque de ce livre, par quelque moyen que ce soit, tant électronique que mécanique, et en particulier par photocopie et par microfilm, est interdite sans l’auto- risation écrite de l’auteur. Disponible en version numérique et papier ISBN 978-2-89612-289-9 ©Copyright 2008 Gérald Guimond Illustration en couverture : La Bille bleue, photo prise par l'équipage d'Apollo 17 le 7 décembre 1972 © NASA. Dépôt légal – 2e trimestre 2009 Bibliothèque et archives nationales du Québec Bibliothèque et archives nationales du Canada Imprimé à la demande au Québec. Dédicace À mes enfants Céline et Denis, à mes neveux et nièces, à tous ces jeunes côtoyés dans l’enseignement, espérant que vous y puiserez un goût de changer des choses dans ce monde marqué par le no future. 9 La recherche et l’écriture de ce livre ont été faites de mars 2005 à juin 2008, avant la crise financière des papiers commerciaux et les scandales qui y sont reliés. -

The Evolution of the Franco-American Novel of New England (1875-2004)
BORDER SPACES AND LA SURVIVANCE: THE EVOLUTION OF THE FRANCO-AMERICAN NOVEL OF NEW ENGLAND (1875-2004) By CYNTHIA C. LEES A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2006 Copyright 2006 By Cynthia C. Lees ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to the members of my supervisory committee, five professors who have contributed unfailingly helpful suggestions during the writing process. I consider myself fortunate to have had the expert guidance of professors Hélène Blondeau, William Calin, David Leverenz, and Jane Moss. Most of all, I am grateful to Dr. Carol J. Murphy, chair of the committee, for her concise editing, insightful comments, and encouragement throughout the project. Also, I wish to recognize the invaluable contributions of Robert Perreault, author, historian, and Franco- American, a scholar who lives his heritage proudly. I am especially indebted to my husband Daniel for his patience and kindness during the past year. His belief in me never wavered. iii TABLE OF CONTENTS Page ACKNOWLEDGMENTS ................................................ iii LIST OF FIGURES .................................................... vii ABSTRACT.......................................................... viii CHAPTER 1 SITING THE FRANCO-AMERICAN NOVEL . 1 1.1 Brief Overview of the Franco-American Novel of New England . 1 1.2 The Franco-American Novel and the Ideology of La Survivance ..........7 1.3 Framing the Ideology of La Survivance: Theoretical Approaches to Space and Place ....................................................13 1.4 Coming to Terms with Space and Place . 15 1.4.1 The Franco-American Novel and the Notion of Place . -

Group Continues to Lobby Quebec on Behalf
What’s going to cost more in 2020 Groceries In its Housing Market Outlook, the Canada Based on recent reports from universities Mortgage and Housing Corp. forecasts the researchers, food prices are expected to rise average price of a home to be in the range of between two and four per cent. $506,200 to $531,000 in 2020. For the average family following Canada’s food CMHC predicts modest home price increases guide, that can translate into an additional $487 over next two years. Quebec market will show on food, increasing the average household total “relatively strong” gains. grocery bill to $12,667. Also a report from Rentals.ca forecast that The cost of meats is expected to increase most overall, rents in the Greater Montreal Area, dramatically — between four to six per cent — will increase by 4.8 per cent. while on the low end of the spectrum, bakery Gasoline items are poised to stay the same or rise by If you were hoping for a break on gas, 2020 two per cent. won’t be your year. Housing Consumers that aren’t actively paying attention If you plan on moving or buying a home, those for lower prices, are going to end up spending costs are also expected to rise. anywhere from $200 to $300 more per year. Taxes, rebates and fees: What’s changing in Quebec in 2020 he new year means changes for your tax system for public daycare will be retroactive The savings will depend on where you live. Hydro-Québec rebate Tbill and your bottom line. -

Government of Lucien Bouchard
QUÉ BEC'S POSITIONS ON CONSTITUTIONAL AND INTERGOVERNMENTAL ISSUES FROM 1936 TO MARCH 2001 GOVERNMENT OF the popular vote each time expressed LUCIEN BOUCHARD and that, each time, our democracy (JANUARY 29, 1996 TO MARCH 8, 2001) has grown in strength, our right to choose become that much stronger. [...] There is nothing more sacred in the democratic life of a people than its capacity to dispose of its own des- tiny. This is the very essence of their liberty.400 379.As a reaction to federal intervention in the Bertrand case, the Québec National Assembly adopted the fol- lowing resolution: “That the National Assembly reaffirm that the people of Daniel Lessard Québec are free to take charge of their own destiny, to define without ••• Status of Québec interference their political status and 377.In North America, Québec is the only to ensure their economic, social and society with a French-Speaking major- cultural development.”401 ity, a well-defined territorial base, and political institutions it controls. The 380.The only judge and jury on the future people of Québec possess all the tra- of Québec happens to be the people of ditional characteristics of a nation. Québec. No judge can stand in the [...] The Québec people subscribe to way of a people’s democratic expres- the democratic concept of a French- sion. The government of Québec will Speaking nation, pluralist in its culture, not go before the Supreme Court of and open to international immigration Canada regarding the federal govern- [...].399 ment’s Reference concerning the future of the Québec people. -

Coalition Contre La Répression Et Les Abus Policiers
Mémoire au comité consultatif sur la réalité policière La réalité des victimes d’abus policiers Alexandre Popovic 15 octobre 2020 Table des matières Historique ............................................................................................................................................................................. p. 3 Avant-propos ...................................................................................................................................................................... p. 4 Une machine à rejeter les plaintes ............................................................................................................................. p. 9 Un BEI peu convaincant… ........................................................................................................................................... p. 21 Place aux enquêtes publiques du coroner ............................................................................................................. p. 26 Les interventions policières auprès de personnes en crise ............................................................................ p. 30 Les recommandations .................................................................................................................................................................... p. 39 2 Historique La Coalition contre la répression et les abus policiers été mise sur pied dans la foulée de la mort de Fredy Villanueva, qui a été abattu à l’âge de 18 ans lors d’une intervention du Service de police -

Consulter Le Livre
Le Comité aviseur de l’action communautaire autonome Dix ans de luttes pour la reconnaissance Eliana Sotomayor Madeleine Lacombe Le Comité aviseur de l’action communautaire autonome Dix ans de luttes pour la reconnaissance Préface de Daniel Lamoureux Recherche et rédaction de l’historique : Eliana Sotomayor Entrevues : Madeleine Lacombe Coordination : Daniel Lamoureux Révision du texte et correction des épreuves : Monique Moisan Soutien technique, index des sigles : Céline Métivier Conception graphique et mise en page : Monique Moisan Maquette de la couverture : Monique Moisan Illustration : Sonio Benvenuto, Red Wave, 2000, 17 x 12,5 cm (6,5 x 5 po.), acrylique sur masonite. Édition et distribution : Comité aviseur de l’action communautaire autonome 4360, rue D’Iberville Montréal, QC H2H 2L8 [email protected] © Comité aviseur de l’action communautaire autonome, 2006 Tous droits réservés pour tous pays Imprimé au Canada sur les presses des ateliers de l’Imprimerie Marquis ISBN-13 : 978-2-9809663-0-9 ISBN-10 : 2-9809663-0-4 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2006 Remerciements e COMITÉ AVISEUR DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME remercie chaleureusement les coauteures du présent ouvrage, Eliana Sotomayor et MadeleineL Lacombe, qui ont accompli un remarquable travail de recherche et de synthèse dans un délai si court. Il remercie les autres membres de l’équipe de production : Monique Moisan, Jean Panet-Raymond, Pierre Valois, Daniel Lamoureux. Il remercie la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Centre de formation populaire et le Secrétariat à l’action communautaire autonome (ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, gouvernement du Québec) pour leur soutien financier. -

A New Franco-American Society – La Bibliothèque Nationale Franco-Américaine
Le FORUM “AFIN D’ÊTRE EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS” VOLUME 34, #3 FALL/AUTOMNE 2009 New Website: francoamericanarchives.org another pertinent website to check out - Franco-American Women’s Institute: http://www.fawi.net $6.00 US Le Forum This issue of Le Forum is dedicated in loving memory to Marie-Anne Gauvin Ce numéro du “Forum” est dédié à la Le Centre Franco-Américain douce mémoire de Marie-Anne Gauvin, voir Université du Maine Orono, Maine 04469-5719 [email protected] page 4... Téléphone: 207-581-FROG (3764) Télécopieur: 207-581-1455 Sommaire/Contents Volume 34, Numéro 3 FALL/AUTOMNE Features Éditeur/Publisher Yvon A. Labbé Letters/Lettres...............................................................................3, 25-27 Rédactrice/Gérante/Managing Editor Lisa Desjardins Michaud L’État du Maine.........................................................4-10, 22, 23, 27, 44 Mise en page/Layout Lisa Desjardins Michaud L’État du Connecticut.....................................................................11-22 Composition/Typesetting Robin Ouellette L’État du Massachusetts......................................................................23 Lisa Michaud Aide Technique L’État du Minnesota.....................................................37, 38, 42, 47, 48 Lisa Michaud Yvon Labbé France-Louisiane..............................................................................50, 54 Tirage/Circulation/4,500 Imprimé chez/Printed by Books/Livres...............................................................................30, -

Le Forum, Vol. 41 No. 2 Lisa Desjardins Michaud, Rédactrice
The University of Maine DigitalCommons@UMaine Le FORUM Journal Franco-American Centre Franco-Américain 6-2019 Le Forum, Vol. 41 No. 2 Lisa Desjardins Michaud, Rédactrice Gérard Coulombe Guy Dubay James Myall Juliana L'Heureux See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/ francoamericain_forum Recommended Citation Michaud, Rédactrice, Lisa Desjardins; Coulombe, Gérard; Dubay, Guy; Myall, James; L'Heureux, Juliana; Lacroix, Patrick; Staples, Ann Marie; Moreau, Daniel; Lessard, Treffle;e P rreault, Robert B.; Gauvin, Marie-Anne; Bérubé, Robert; and Chenard, Robert, "Le Forum, Vol. 41 No. 2" (2019). Le FORUM Journal. 91. https://digitalcommons.library.umaine.edu/francoamericain_forum/91 This Book is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Le FORUM Journal by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. Authors Lisa Desjardins Michaud, Rédactrice; Gérard Coulombe; Guy Dubay; James Myall; Juliana L'Heureux; Patrick Lacroix; Ann Marie Staples; Daniel Moreau; Treffle Lessard; Robert B. Perreault; Marie-Anne Gauvin; Robert Bérubé; and Robert Chenard This book is available at DigitalCommons@UMaine: https://digitalcommons.library.umaine.edu/francoamericain_forum/91 Le FORUM “AFIN D’ÊTRE EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS” VOLUME 41, #2 SUMMER/ÉTÉ 2019 In This Issue: THE AMERICANIZATION OF THE MADAWASKA ACADIANS by GUY F. DUBAY Madawaska, -
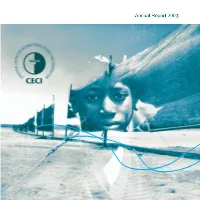
CECI RA 2002-2003 Anglaispdf
3 Table of Contents Message from the Chair and the Executive Director 2 Vision and Strategic Objectives for 2003-2008 3 Our Corporate Membership 3 Partnerships for the Future 4 An Exceptionally Busy Year 5 Achievements in the Field 6 Thank You to all of our Donors 11 Financial Statements 12 CECI in the World 16 WRITTEN AND COORDINATED BY Robert Hazel CONTRIBUTORS Ginette Chalifoux, Jocelyne Dallaire, Claude Perras, etc. GRAPHIC DESIGN AND PRODUCTION Corégraph communications TRANSLATION Tony Kwan 2003: The International Year of Fresh Water Photos:Cover Louis-Joseph Goulet (CECI). Gervais L’Heureux, in English and Spanish editions.This report is also available Number printed: 1,500 - Printed on recycled paper 2003 © CECI, August CECI (CECI) OULX R P ANIEL D HOTO BY P CECI combats poverty and exclusion. To this end, it "strengthens the development capacity of disadvantaged communities; supports ini- tiatives for peace, human rights and equity; mobilizes resources and promotes the exchange of know-how." CECI is governed by a Board of Directors composed of unremunerated members elected by CECI’s membership at the Annual General Assembly. CECI’s corporate membership is composed of nearly 100 volunteers from various sectors: religious institutions, academia, the business community, organizations active on the international stage, former CECI volunteers, etc. The Annual General Assembly was held in Montreal on Saturday, September 21, 2002. The organization carries out its mission via partnerships with organizations based in developing countries and in collaboration with part- ners in Canada or other countries from the North, such as France, Australia, the United States, etc. -

The Sentinelle Affair: a Study in Multilingual Language Practices
University of Rhode Island DigitalCommons@URI Open Access Dissertations 2015 THE SENTINELLE AFFAIR: A STUDY IN MULTILINGUAL LANGUAGE PRACTICES Jason Peters University of Rhode Island, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss Recommended Citation Peters, Jason, "THE SENTINELLE AFFAIR: A STUDY IN MULTILINGUAL LANGUAGE PRACTICES" (2015). Open Access Dissertations. Paper 307. https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/307 This Dissertation is brought to you for free and open access by DigitalCommons@URI. It has been accepted for inclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@URI. For more information, please contact [email protected]. ! ! ! THE SENTINELLE! AFFAIR: A STUDY IN MULTILINGUAL! LANGUAGE PRACTICES BY! JASON PETERS! ! ! ! ! ! ! A DISSERTATION SUBMITTED IN !PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR! THE DEGREE OF ! DOCTOR OF PHILOSOPHY! IN! ENGLISH RHETORIC! AND COMPOSITION ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! UNIVERSITY OF !RHODE ISLAND 2015 ! ! ! ! ! ! DOCTOR OF PHILOSOPHY! DISSERTATION OF! ! JASON PETERS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !APPROVED: !Dissertation Committee: !Co-Major Professor: Nedra Reynolds !Co-Major Professor: Caroline Gottschalk-Druschke ! Kim Hensley Owens ! Kenneth Rogers Nasser H. Zawia ! DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL ! ! ! UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 2015 ABSTRACT Rhetorical historiography needs to disrupt existing archival arrangements of language differences. These arrangements preserve an ideology of linguistic modernity that effaces and oversimplifies the complex multilingual practices of actual language users. By disrupting the principles of selection and arrangement that make up an archive’s evidential value, rhetorical researchers can undermine ideologies of linguistic modernity and can recover an array of rhetorical resistance strategies that multilinguals have historically taken towards the political and socioeconomic dominance of English. This project does this disruptive work by analyzing the multisitedness of Mount St. -

Annual Report 2015 2016 2016
2016 ANNUAL REPORT 2015 2016 Last year more than ever before, CECI held out the promise of better days for populations in need, particularly in Nepal, where we helped tens of thousands of people recover from the earthquake that struck in April 2015. © KIRAN AMBWANI CECI’s swift response to support people of all ages in the wake of the disaster made it easier for them to return to the course of everyday life, especially by limiting the number of displacements of families and citizens. © KIRAN AMBWANI CECI helps populations restart and grow their economic activities so they can proudly take part in rebuilding and reinvigorating their communities. © KIRAN AMBWANI CECI not only offers temporary shelter, water, and emergency care, but a new future founded on sustainable development. © KIRAN AMBWANI © BENOIT AQUIN 12 Strategic plan 14 Where we work 14 Africa 16 Asia 17 Latin America 18 Haiti 20 Volunteer cooperation 24 Humanitarian assistance 26 CECI communications 30 Donors and contributors 32 Financial information 2015–2016 36 Members 37 Programs and projects 40 Contact info The UN Summit in September CECI recently wrapped up the second GLOBAL 2015 adopted the 2030 Agenda for year of its 2014–2019 strategic plan, Sustainable Development, which set 17 with the ambitious aim to create an ISSUES Sustainable Development Goals (SDG) international CECI that mobilizes key and laid out an operating framework actors for change in both the South and AND for sustainable development actors the North. like CECI. The goals recognize the SUSTAINABLE universality and the interconnectedness Several important targets have been of the world’s most pressing issues, reached—we have created the first DEVELOP- prompting us to tackle the underlying two advisory committees in countries causes of inequality with innovation and belonging to the CECI family (Haiti MENT creativity.