Doss36 AAE Future-Of-European
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
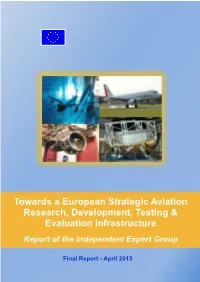
IEG Final Report Version 8
Towards a European Strategic Aviation Research, Development, Testing & Evaluation Infrastructure Report of the Independent Expert Group Final Report - April 2013 0 Towards a European Strategic Aviation RDT&E Infrastructure Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information. The views expressed in this publication are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of the European Commission. Contact: Dietrich Knoerzer – Stanley Tang European Commission Directorate-General for Research & Innovation Directorate H – Transport RTD-H.3 – Aeronautics B-1049 Brussels [email protected] [email protected] 0 Towards a European Strategic Aviation RDT&E Infrastructure Preface Tasked by the European Commission and ACARE Member States Group in September 2012, a group of independent experts (IEG) has produced the following report on a European Strategic Aviation Research, Development, Test and Evaluation Infrastructure (RDT&E) and has submitted it in February 2013. The mandate provided very limited time for the group to deliberate and did not allow the complete perimeter to be addressed in the necessary depth. The IEG therefore decided to make sure it covered areas where short-term advice actions were potentially needed and where its own expertise could contribute. Nevertheless the IEG was also able to review the entire spectrum of aviation RDT&E infrastructure (identifying several additional areas as potential "strategic RDT&E capabilities", ranging from aero-engine testing and ATM, E-infrastructures and large scale demonstrators to production technology capabilities) and to recommend further work on these and other topics that it considered necessary to provide a complete and in depth review in the longer term. -

Air Freight Transport a Strategic Modelling Approach on a Global Scale
Air freight transport A strategic modelling approach on a global scale GEORGIOS TZIMOURTOS Master Thesis May 2015 Air freight Transport A strategic modelling approach on a global scale By Georgios Tzimourtos Student number: 4185269 E-mail: [email protected] in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Transport, Infrastructure and Logistics at the Delft University of Technology, Thesis committee: Prof.dr.ir. L.A. Tavasszy – TLO/TPM Dr. Ron van Duin (J.H.R.) – TLO/TPM Dr. Milan Janic – CiTG Dr. B.F. (Bruno) Santos – ATO/L&R An electronic version of this thesis is available at http://repository.tudelft.nl/. Cover photo credits: Deutsche Lufthansa AG Table of Contents Chapter 1: Introduction ................................................................................................................................ 1 1.1 Problem statement ............................................................................................................................. 1 1.2 Research question and objectives ...................................................................................................... 2 1.3 Scope of this research ......................................................................................................................... 3 1.4 Approach and research methods ........................................................................................................ 4 1.5 Thesis structure .................................................................................................................................. -

Airbus/EADS Sign a Titanium Supply Agreement With
GDM 17/2009R 20th April 2009 Airbus/EADS sign a Titanium supply agreement with VSMPO-AVISMA, integrated structure of the Russian Technologies State Corporation Airbus/EADS and VSMPO-AVISMA boost their long-term relationship Airbus, the world’s leading aircraft manufacturer, its parent company EADS, a global leader in aerospace, defence and related services and the Russian Technologies State Corporation’s integrated structure VSMPO-AVISMA Corporation, the Russian Titanium manufacturer, have signed the biggest and longest-term contract in the history of Airbus/EADS cooperation with Russian industry. The agreement was signed today in Moscow by Sergey Chemezov, General Director of the Russian Technologies State Corporation and Tom Enders, President and CEO of Airbus in the presence of Vladimir Putin, Russian Prime-Minister, Walter Jürgen Schmid, German Ambassador to Russia, Jean de Gliniasty, French Ambassador to Russia and Juan Antonio March Pujol, Spanish Ambassador to Russia. The agreement covers the supply of Titanium to Airbus and other EADS Divisions until 2020. The scope of the contract includes the supply of Titanium and covers die forging parts for all existing Airbus aircraft, including new programmes such as the A350XWB. VSMPO-AVISMA Corporation may also machine Titanium products in order to develop a vertically integrated Titanium supply chain, starting from raw materials to finished products. The contract comes as a confirmation of the framework agreement signed in July 2008 at Farnborough Airshow. The new agreement further boosts the relationship between the companies, which dates back to the early 1990s. It also enlarges Airbus’ cooperation with the Russian aviation industry, which currently includes production of components for Airbus at Russian plants, passenger to freighter aircraft conversions (P2F) and joint Research & Technology (R&T) projects. -

Airbus/EADS Sign a Titanium Supply Agreement with VSMPO-AVISMA, Integrated Structure of ‘Russian Technologies’
GDM 17/2009R 20th April 2009 Airbus/EADS sign a Titanium supply agreement with VSMPO-AVISMA, integrated structure of ‘Russian technologies’. Airbus/EADS and VSMPO-AVISMA boost their long-term relationship Airbus, the world’s leading aircraft manufacturer, its parent company EADS, a global leader in aerospace, defence and related services and The Russian Technologies State Corporation integrated structure VSMPO-AVISMA Corporation, the Russian Titanium manufacturer, have signed the biggest and longest-term contract in the history of Airbus/EADS cooperation with Russian industry. The agreement was signed today in Moscow by Sergey Chemezov, General Director of ‘Russian Technologies’ state corporation and Tom Enders, President and CEO of Airbus in the presence of Vladimir Putin, Russian Prime-Minister, Walter Jürgen Schmid, German Ambassador to Russia, Jean de Gliniasty, French Ambassador to Russia and Juan Antonio March Pujol, Spanish Ambassador to Russia. The agreement covers the supply of Titanium to Airbus and other EADS Divisions until 2020. The scope of the contract includes the supply of Titanium and covers die forging parts for all existing Airbus aircraft, including new programmes such as the A350XWB. VSMPO-AVISMA Corporation may also machine Titanium products in order to develop a vertically integrated Titanium supply chain, starting from raw materials to finished products. The contract comes as a confirmation of the framework agreement signed in July 2008 at Farnborough Airshow. The new agreement further boosts the relationship between the companies, which dates back to the early 1990s. It also enlarges Airbus’ cooperation with the Russian aviation industry, which currently includes production of components for Airbus at Russian plants, passenger to freighter aircraft conversions (P2F) and joint Research & Technology (R&T) projects. -

How Airbus Surpassed Boeing: a Tale of Two Competitors
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 5-2007 How Airbus Surpassed Boeing: A Tale of Two Competitors William Alexander Burns University of Tennessee - Knoxville Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the Aerospace Engineering Commons Recommended Citation Burns, William Alexander, "How Airbus Surpassed Boeing: A Tale of Two Competitors. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2007. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/252 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by William Alexander Burns entitled "How Airbus Surpassed Boeing: A Tale of Two Competitors." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, with a major in Aviation Systems. Robert B. Richards, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Richard Ranaudo, U. Peter Solies Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by William A. Burns entitled “How Airbus Surpassed Boeing: A Tale of Two Competitors” I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, with a major in Aviation Systems. -
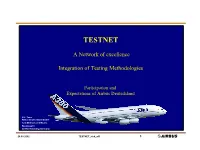
Integration of Testing Methodologies
TESTNET A Network of excellence Integration of Testing Methodologies Participation and Expectations of Airbus Deutschland H.J. Tews Airbus Deutschland GmbH Test Methods and Means Kreetslag10 D21129 Hamburg, Germany 24.09.2002 TESTNET_kick_off 1 Ownership of the Airbus (SAS) EADS (N.V.) BAE SYSTEMS 80% 20% Airbus SAS Airbus Airbus Airbus Airbus France Deutschland España UK Airbus is a company under French law (SAS). 24.09.2002 TESTNET_kick_off 2 Development of Aerospace Industry in Europe bis 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Breguet Dassault Aviation Marcel Dassault Air Fouga Morane-Saulnier Quest-Aviation Sud-Aviation Aerospatiale Nord-Aviation Arsenal AEA EADS MTU München Weser-Flug Focke-Wulf Heinkel VFW MTU MBB München HFB DASA Messerschmitt Bölkow Fairchild -Dornier Junkers Dornier CASA HASA Britisch Aircraft Corp Hawker Siddeley BAe BAe Systems Dynamics Marconi Electronic Scottish Aviation 50 years of restructuring efforts have led to a consolidation within the European Aerospace industry. 24.09.2002 TESTNET_kick_off 3 Airbus in Europe Meaulte Broughton • Cockpit-Structure • Wing • Shells, small part • Major part mach. Hamburg machining u Engineering Filton • FAL A319/A321 St. Nazaire u Engineering • Fuselage sections • Fuselage section • Wing assemblies • Mat.-,equip. –comp. • Metal components Bremen u Engineering Nantes • Wing equipment • Center wing box • Metal components • Mach. of maj. comp. Nordenham Toulouse • Fuselage shells u Engineering • Large sheets • FAL WB/LR,A320 • Pylons Stade • VTP Getafe • Composites u Engineering -

Aerospace and Antitrust: How the European Union Supports Its Interests to the Detriment of United States' Companies
University of Miami International and Comparative Law Review Volume 14 Issue 2 Volume 14 Issue 2 (Fall 2006) Article 6 10-1-2006 Aerospace And Antitrust: How The European Union Supports Its Interests To The Detriment Of United States' Companies Jason Thompson Follow this and additional works at: https://repository.law.miami.edu/umiclr Part of the Comparative and Foreign Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Jason Thompson, Aerospace And Antitrust: How The European Union Supports Its Interests To The Detriment Of United States' Companies, 14 U. Miami Int’l & Comp. L. Rev. 311 (2006) Available at: https://repository.law.miami.edu/umiclr/vol14/iss2/6 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at University of Miami School of Law Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in University of Miami International and Comparative Law Review by an authorized editor of University of Miami School of Law Institutional Repository. For more information, please contact [email protected]. AEROSPACE AND ANTITRUST: HOW THE EUROPEAN UNION SUPPORTS ITS INTERESTS TO THE DETRIMENT OF UNITED STATES' COMPANIES Jason Thompson* Synopsis ................................................................................................311 Introduction ......................................................................................... 311 I. The Purpose of the European Union .................................... 316 II. The National Champion Theory .......................................... -

Airbus and Boeing Case
St. Petersburg University Graduate School of Management Master in Corporate Finance VALUATION OF PRODUCT LINE EXTENSION SUCCESS: AIRBUS AND BOEING CASE Master’s Thesis by the 2nd year student Concentration – Master in Corporate Finance Milana Bubyakina Research advisor: Associate professor Anna Loukianova St. Petersburg 2017 ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Я, Бубякина Милана Александровна, студент второго курса магистратуры направления «Менеджмент», заявляю, что в моей магистерской диссертации на тему «Оценка успеха расширения продуктовой линейки: пример Airbus и Boeing», представленной в службу обеспечения программ магистратуры для последующей передачи в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки. Мне известно содержание п. 9.7.1 Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ о том, что «ВКР выполняется индивидуально каждым студентом под руководством назначенного ему научного руководителя», и п. 51 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» о том, что «студент подлежит отчислению из Санкт- Петербургского университета за представление курсовой или выпускной квалификационной работы, -

An Analysis of the Competitive Actions of Boeing and Airbus in the Aerospace Industry Based on the Competitive Dynamics Model
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity Article An Analysis of the Competitive Actions of Boeing and Airbus in the Aerospace Industry Based on the Competitive Dynamics Model Ayoung Woo, Bokyung Park, Hyekyung Sung, Hyunjin Yong, Jiyeon Chae and Seungho Choi * Department of Management and Strategy, Ewha School of Business, Ewha Womans University, 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul 121791, Korea; wooayoungoffi[email protected] (A.W.); [email protected] (B.P.); [email protected] (H.S.); [email protected] (H.Y.); [email protected] (J.C.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +82-232-774-138 Abstract: Focusing on competitive dynamics, this study examines the strategic issues Boeing has faced in seeking to maintain its leading position in the airline industry. Boeing’s status as a first mover in the aerospace industry has made it a world-leading company; however, the external environment and various pressures have allowed Airbus to emerge as a strong competitor. By conducting a descriptive case analysis, this paper identifies the competitive issues between these two giants, analyzing continuous action and reaction processes throughout the whole history of the airline industry. Finally, by examining Boeing’s main strengths, business diversification options, and risk-taking culture, this paper suggests ways Boeing can retake its place as the industry leader. Keywords: competitive dynamics; action and reaction; first mover advantage; open innovation; aerospace industry; Boeing; Airbus Citation: Woo, A.; Park, B.; Sung, H.; Yong, H.; Chae, J.; Choi, S. An Analysis of the Competitive Actions of Boeing and Airbus in the 1. Introduction Aerospace Industry Based on the Acknowledging the competitive actions of rivals is critical to firms’ survival. -

The Financial Impact of the A380 Project on EADS, Our Primary Focus Will Be on Financial and Ratio Analysis of the Company
Authors Title B. Chama, G. Nikolaishvili Impact of the A380 Project on the Financial Performance of EADS Revision Date 5.0 19-08-2007 School of Management Masters of Business Administration Masters Thesis, FEC066 The Impact of the A380 Project on the Financial Performance of EADS August 2007 Authors: George Nikolaishvili and Brian Chama Supervised by: Dr. Britt Aronsson 1 Authors Title B. Chama, G. Nikolaishvili Impact of the A380 Project on the Financial Performance of EADS Revision Date 5.0 19-08-2007 2 Authors Title B. Chama, G. Nikolaishvili Impact of the A380 Project on the Financial Performance of EADS Revision Date 5.0 19-08-2007 Acknowledgements We would like to express our gratitude to the department for affording us the time and research facilities without which this report would not have been possible. Special thanks go to the head of department Dr. Anders Hederstierna, our supervisor Dr. Britt Aronsson and the course coordinator Dr. Klaus Solberg. 3 Authors Title B. Chama, G. Nikolaishvili Impact of the A380 Project on the Financial Performance of EADS Revision Date 5.0 19-08-2007 Abstract Airbus has been making headlines in the past few months for all the wrong reasons. This iconic European corporation has undergone a turbulent period due to the problems surrounding the Airbus A380 project. A new flagship product that should have curved out an unassailable advantage for Airbus over Boeing went completely wrong. The Airbus A380 aircraft was a ground breaking concept that was meant to push EADS into a unique market segment. Instead, it threatened the very existence of the company and served as a catalyst for major surgery and a complete reorganization of the corporation starting from the top management down to the production floors. -

Stability Requires Change: Path Bending in the Case of Airbus’ Work-Share Allocation (A300-A350 XWB)
Stability requires change: Path bending in the case of Airbus’ work-share allocation (A300-A350 XWB) Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Wirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin Lisa Maria Arnold M.A., Dipl. Pol. Berlin, im November 2013 Erstgutachter: Prof. Dr. Arndt Sorge Zweitgutachterin: Prof. Dr. Jana Costas Tag der Disputation: 01. November 2013 Wege entstehen dadurch, daß man sie geht. ─ Franz Kafka Danksagung Das vor mir ausgewählte Eingangszitat dieser Arbeit trifft im übertragenen Sinne nicht nur auf die Entstehung und Entwicklung des Unternehmens Airbus, sondern auch auf diese Doktorarbeit zu. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg – mit all seinen Abzweigungen und Umwegen – gehen durfte. Ich möchte hier die Gelegenheit wahrnehmen, um den Menschen, die mich begleitet und unterstützt haben, aufrichtig zu danken. Zuallererst gebührt mein besonderer Dank meinem Erstbetreuer, Prof. Dr. Arndt Sorge. Ich hatte das große Glück, dass er sich als gelernter Luftbildmesstechniker und passionierter Segelflieger – nach eigener Aussage – noch mehr für Airbus und seine Geschichte interessiert als ich. Diese persönliche Begeisterung äußerte sich nicht nur in seiner stets offenen Bürotür, in langen und zahlreichen Betreuungsgesprächen, sondern auch in seiner vollen Unterstützung bei der Erschließung dieses nur schwer zugänglichen Feldes. Als große Bereicherung habe ich ferner seine Denkweise empfunden: Eine undogmatische Offenheit gegenüber den verschiedensten Theorien, ein aktives Kombinieren von Klassikern mit gegenwärtigen Ansätzen und eine unerschütterliche Auffassung, dass die soziale Welt zwingend komplex ist. Diese Geisteshaltung hat mich tief beeindruckt und hat bleibende Anstöße für das eigene Denken geliefert. Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Zweitbetreuerin, Frau Prof. -

Business, Legal and Corporate Responsibility 2007 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE and SPACE COMPANY EADS N.V
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS N.V. COMPANY DEFENCE AND SPACE AERONAUTIC EUROPEAN BOOK THREE www.eads.com 3 European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. Le Carré, Beechavenue 130 -132 Business, 1119 PR Schiphol-Rijk The Netherlands Legal This document is also available at the following addresses: and 2007 Responsibility and Corporate Business, Legal European Aeronautic Defence and Space Company Corporate EADS N.V. In France Responsibility 37, boulevard de Montmorency 75781 Paris cedex 16 – France 2007 In Germany 81663 Munich – Germany In Spain Avenida de Aragón 404 28022 Madrid – Spain 3 The complete EADS Annual Report Suite 2007 consists of: >@FKD @E>IIBKDBP RPFKBPP BD>I BIFSBOFKD FK>K@F>I >KA OBPRIQP Q>QBJBKQP LOMLO>QB >KA LOMLO>QB BPMLKPF?FIFQV LSBOK>K@B BOOK 1 BOOK 2 BOOK 3 FACING CHALLENGES FINANCIAL STATEMENTS AND BUSINESS, LEGAL AND DELIVERING RESULTS CORPORATE GOVERNANCE 2007 CORPORATE RESPONSIBILITY 2007 Annual Review Registration Document Part 1 Registration Document Part 2 Management & Responsibility Risk Factors Information on EADS Activities Together. Facing challenges. Net Assets – Financial Position – Results Corporate Social Responsibility Delivering results. Corporate Governance General Description of the The Business Year 2007 Company and its Share Capital EADS Drivers Useful Information www.eads.com The online version of the Annual Report Suite 2007 is available at www.reports.eads.com 1 2 3 4 Back to Contents Business, Legal and Corporate Responsibility EADS REGISTRATION DOCUMENT 2007 - PART 2 1 2 3 4 Back to Contents EADS REGISTRATION DOCUMENT - PART 2 Business, Legal and Corporate Responsibility (BOOK 3) European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.