L'histoire De L'humanité
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archives Du Directoire Exécutif. "Affaires Particulières" (An IV - an VIII)
Archives du Directoire exécutif. "Affaires particulières" (an IV - an VIII). Répertoire numérique des articles AF/III/268 à AF/III/280. Inventaire analytique manuscrit rédigé par N. Gotteri (1968) ; révision et première édition électronique par C. Robin (2016). Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2016 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_003820 Cet instrument de recherche a été encodé par l'entreprise Diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales. 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence AF/III/268 à AF/III/280 Niveau de description fonds Intitulé Archives du Directoire exécutif. "Affaires particulières" Intitulé AF/III/268 à AF/III/280 Date(s) extrême(s) An IV - an VIII Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine DESCRIPTION Présentation du contenu Importance matérielle 13 articles ; 2,16 mètres linéaires. Mode d’entrée Versement Producteur Directoire exécutif Historique de la conservation Au début du Consulat, les archives du Directoire exécutif mais aussi les dossiers en instance du Corps législatif furent versés aux archives du secrétariat général des Consuls pour assurer la continuité des affaires. En 1815, l’ensemble des archives de la Secrétairerie d’État impériale fut placé sous la surveillance du ministre de la Justice et conservé dans la grande galerie du Palais du Louvre jusqu’à son versement aux Archives nationales en 1849. Conservée sur le site de Paris jusqu’en 2012, la sous-série AF/III a été incluse dans le déménagement des fonds postérieurs à 1789 sur le site de Pierrefitte-sur-Seine en 2013. -

Napoléon Et La Mer Repères Et Documents Dossier Pédagogique
Napoléon et la mer Repères et documents Dossier pédagogique Napoléon et la Mer Repères et documents Autour de l’exposition présentée du 10 mars au 23 août 2004 au musée national de la Marine Napoléon et la mer un rêve d’empire ▪ Le souverain français qui a le plus SOMMAIRE navigué : 233 jours en haute mer de son vivant et 50 jours pour sa dernière traversée, ▪ Un grand voyage : depuis Sainte-Hélène et près de 80 jours de L’expédition d’Égypte 1798-1799 p. 2 navigation pour le voyage aller et retour vers l'Égypte. Il est y habitué de par son origine ▪ Duels avec l’Angleterre p. 5 insulaire, cependant il souffre du mal de ▪ La guerre sur mer et vie à bord p. 7 mer… ▪ Grandes batailles et prisonniers ▪ Dès l'arrivée de Bonaparte au pouvoir, des pontons p. 9 la Marine constitue l'une de ses principales préoccupations : il entend construire une ▪ La Marine de Napoléon p. 12 flotte aux dimensions de l'Europe. ▪ Derniers voyages p. 15 C’est bien d’une double histoire dont il s’agit : celle de la volonté et de la ténacité de ▪ Bibliographie, sitographie : quelques Napoléon, et celle de la contribution des références p. 17 marins à ce rêve impérial. 1 Napoléon et la mer Repères et documents Dossier pédagogique Océan, vaisseau de 118 canons dans son état de 1807, sur les plans de Jacques-Noel Sané. Ateliers de l’arsenal de Brest ©MnM/P. Dantec Un grand voyage : l’expédition d’Égypte 1798-1799 En 1798, le général Bonaparte n'est pas encore l'Empereur Napoléon, mais son ambition politique inquiète ses rivaux. -

SQUARING the CIRCLE S N I G R a M
SQUARING THE CIRCLE s n i g r a m d o o g 3 , r a l u g n a i r t , d 1 , e p o H d o o G f o e p a C Weekly transmission 012018 presents: 2018: Last Chance to Square the Circle of the Art Market ? II Te Square is a 2017 Swedish satirical drama flm written and directed by Ruben Östlund III Weekly Drawing by Téophile Bouchet: Squared IV Squares and Rectangles: Collecting Stamps and Postcards V Selected Examples from the Plon-Mainguet Album 1-21 A modest 2018 New Year address (Tribute to the 1863 Gettysburg Address) 22 Previous transmissions can be found at: www.plantureux.fr 2018: Last Chance to Square the Circle of the Art Market ? “Squaring the circle is a problem proposed by ancient geometers. It is the challenge of constructing a square with the same area as a given circle by using only a finite number of steps with compass and straightedge. In 1882, the task was proven to be impossible, as a consequence of the Lindemann–Weierstrass theorem which proves that pi (π) is a transcendental, rather than an algebraic irrational number; that is, it is not the root of any polynomial with rational coefficients. Approximate squaring to any given non-perfect accuracy, in contrast, is possible in a finite number of steps, since there are rational numbers arbitrarily close to π. The expression "squaring the circle" is sometimes used as a metaphor for trying to do the impossible.” (Wikipedia) 178 years ago, the invention of photography opened the way to create images and also to reproduce art, giving access to the multitude, promoting the frame of a market. -

Histoire De La Grèce Ancienne
HISTOIRE DE LA GRÈCE ANCIENNE PAR JEAN HATZFELD ANCIEN MEMBRE DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES - PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES DE BORDEAUX PARIS - PAYOT - 1926 AVANT-PROPOS. CHAPITRE PREMIER. — Le bassin de la Mer Égée. CHAPITRE II. — La civilisation égéenne. CHAPITRE III. — Les Grecs dans le bassin de la Mer Égée. CHAPITRE IV. — La civilisation mycénienne. Royauté et aristocratie. La cité. CHAPITRE V. — La colonisation grecque. CHAPITRE VI. — Changements dans la vie économique et sociale. CHAPITRE VII. — L'évolution religieuse. CHAPITRE VIII. — Les débuts de la littérature. Les poèmes homériques et l'histoire. CHAPITRE IX. — La formation des États grecs. CHAPITRE X. — Disparition du régime aristocratique. Tyrannie et démocratie. CHAPITRE XI. — Les mœurs, l'art et la science au VIe siècle. CHAPITRE XII. — La Grèce et les grandes nations méditerranéennes à la fin du VIe siècle. CHAPITRE XIII. — La révolte de l'Ionie. Marathon. CHAPITRE XIV. — La grande invasion de Xerxès. CHAPITRE XV. — Fin des guerres médiques. Constitution de l'empire athénien. CHAPITRE XVI. — Agriculture, industrie, commerce en Grèce au milieu du Ve siècle. CHAPITRE XVII. — L'organisation de la démocratie au Ve siècle. CHAPITRE XVIII. — La religion, les fêtes et les beaux-arts au Ve siècle. CHAPITRE XIX. — La curiosité scientifique et la réaction. CHAPITRE XX. — La guerre du Péloponnèse jusqu'à la paix de Nicias. CHAPITRE XXI. — L'expédition de Sicile et la chute d'Athènes. CHAPITRE XXII. — L'hégémonie spartiate et la Perse. Syracuse et Carthage. CHAPITRE XXIII. — La nouvelle confédération athénienne et la suprématie thébaine. CHAPITRE XXIV. — Changements matériels et moraux après la guerre du Péloponnèse. -

Chapter 6 LOCATING PLACES in GREECE
Chapter 6 LOCATING PLACES IN GREECE Since the main reason for emigration during Why is this step so important? Many the last part of the 19th and the first two places have the same or similar names that decades of the 20th century was financial may be easily confused. Greek place names reason, immigrants came from small are often misspelled in American sources. villages. When they were asked to declare The spelling may be badly changed in their birth place, feeling that the small transliteration. Difficult names may be village would not be recognized they gave shortened. It is crucial that these problems the name of the large city near that village. be resolved before you can start looking for the town on a gazetteer or on a map or looking for records of the place. GAZETTEERS A gazetteer is a dictionary of geographical names. It lists places in Greece, and gives sufficient information to uniquely identify a specific place. One must remember that several villages may have the same name but other factors, such as the nomos [νομός, Street of Athens, 1995 county] or eparhia [επαρχία, district] can be used to distinguish one place from another. A gazetteer also gives information which However, at that period of time those who will enable you to locate the records of that lived in large cities had no reason of going place. through the dangerous adventure of emigrating. Therefore if your immigrant Greece is divided geographically into ten ancestor has declared a large city as his/her main regions. Each region is divided into birth place, more research in the U.S.A. -
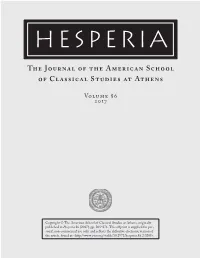
(BUTRINT) in the ARCHAIC and CLASSICAL PERIODS the Acropolis and Temple of Athena Polias
dining in the sanctuary of demeter and kore 1 Hesperia The Journal of the American School of Classical Studies at Athens Volume 86 2017 Copyright © The American School of Classical Studies at Athens, originally published in Hesperia 86 (2017), pp. 205–271. This offprint is supplied for per- sonal, non-commercial use only, and reflects the definitive electronic version of the article, found at <http://www.jstor.org/stable/10.2972/hesperia.86.2.0205>. hesperia Kerri Cox Sullivan, Interim Editor Editorial Advisory Board Carla M. Antonaccio, Duke University Angelos Chaniotis, Institute for Advanced Study Jack L. Davis, University of Cincinnati A. A. Donohue, Bryn Mawr College Jan Driessen, Université Catholique de Louvain Marian H. Feldman, University of California, Berkeley Gloria Ferrari Pinney, Harvard University Thomas W. Gallant, University of California, San Diego Sharon E. J. Gerstel, University of California, Los Angeles Guy M. Hedreen, Williams College Carol C. Mattusch, George Mason University Alexander Mazarakis Ainian, University of Thessaly at Volos Lisa C. Nevett, University of Michigan John H. Oakley, The College of William and Mary Josiah Ober, Stanford University John K. Papadopoulos, University of California, Los Angeles Jeremy B. Rutter, Dartmouth College Monika Trümper, Freie Universität Berlin Hesperia is published quarterly by the American School of Classical Studies at Athens. Founded in 1932 to publish the work of the American School, the jour- nal now welcomes submissions from all scholars working in the fields of -

Money and Banking in Albania, from Antiquity to Modern Times
M nk o a f a u B l b s a n e i a u 2015 m MONEY AND BANKING IN ALBANIA, FROM ANTIQUITY TO MODERN TIMES First Conference of the Museum of the Bank of Albania Proceedings 14-15 June 2017 2 Published by: © Bank of Albania Address: Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tirana, Albania Tel.: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3 Fax: + 355 4 2419408 E-mail: [email protected] Printed in: 200 copies ISBN: 978-9928-262-09-7 Data from this publication may be used, provided the source is acknowledged. The views expressed in the presentations to BoA’s conference on “Money and Banking in Albania: From Antiquity to Modern Times” are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Bank of Albania. MONEY AND BANKING IN ALBANIA, FROM ANTIQUITY TO MODERN TIMES - I-st Conference of the Museum of the Bank of Albania 3 CONTENTS OPENING ADDRESS 7 Gent Sejko, Governor, Bank of Albania THE BEGINNING OF COINAGE IN ILLYRIA AND THE TRADE BETWEEN ILLYRIANS AND GREEKS 11 Keynote speaker: Prof. Olivier Picard, former Director of the French Archaeological School at Athens, Professor at the Sorbonne University, Member of the Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Institute of France) SESSION I ANCIENT CIVILISATION AND MONEY AS A MEANS OF EXCHANGE, AT THE FOCUS OF THE ALBANIAN AND INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES 19 Session Chair: Prof. Olivier Picard, former Director of the French Archaeological School at Athens, Professor at the Sorbonne University, Member of the Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Institute of France) FROM BARTER ECONOMY TO COINAGE 21 Dr. -

Pays Annexés Ou Dépendants (1792-1815)
Pays annexés ou dépendants (1792-1815) Inventaire semi-analytique (F/1e/1-F/1e/205) Par R. Teulet et M. Prinet Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1900 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001532 Cet instrument de recherche a été encodé par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence F/1e/1-F/1e/205 Niveau de description fonds Intitulé Pays annexés ou dépendants Intitulé Inventaire sommaire de la Série F 1E (pays annexés ou dépendants.) Date(s) extrême(s) 1792-1815 Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu Inventaire de la Série F 1e Inventaire - Sommaire de 1891, p. 62-65. Pays annexés ou dépendants Les documents qui forment aujourd'hui la série F 1e intéressent l'administration des Pays annexés ou dépendants : Belgique, Rive-Gauche de Rhin, Hollande, etc. et sont compris entre les années 1792 et 1816. Ils sont entrés aux Archives Nationales à la suite de versements opérés par le Ministère de l'Intérieur aux dates suivantes : Avril 1811 (Consulte romaine) Mai 1811 (Belgique), Septembre 1814 (Juntes de Rome et de Toscane), octobre 1816 (Consulte romaine), Juin 1831 (Recettes des pays conquis occupés par l'arrt de Rhin et Moselle). D'autres documents, épars dans des versements postérieurs, ont été, par la suite, mis à leur rang logique dans la série F 1e Par la nature même des documents qui la composent, la série F 1e peut être considérée comme définitivement constituée, et selon toute prévision n'est plus susceptible d'accroissement. -

Rome and Constantinople, Popes and Patriarchs, 1204-1453
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Empires Reshaped and Reimagined: Rome and Constantinople, Popes and Patriarchs, 1204-1453 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Natalie Sherwan 2016 © Copyright by Natalie Sherwan 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Empires Reshaped and Reimagined: Rome and Constantinople, Popes and Patriarchs, 1204-1453 by Natalie Sherwan Doctor of Philosophy, History University of California, Los Angeles, 2016 Professor Patrick Geary, Co-chair Professor Claudia Rapp, Co-chair This dissertation discusses the politics of conquest and the strategies of legitimization pursued by Latin, Greek and Slav contenders for hegemonic rule in the northeastern Mediterranean after the collapse of the Byzantine Empire in the wake of the fourth crusade. It reevaluates the relationship between the concepts of empire and Christendom as played out in the process of political realignment, and closely examines the ways in which the key actors claiming to represent these concepts - emperors, popes, patriarchs - fought or cooperated with one another in order to assert regional preeminence. ii The first part of the dissertation focuses on the tension between the Roman/Byzantine ideal of universalism, which entailed a sole holder of imperial power, and the concrete reality of several empires coexisting within the same geographical area. Chapters one and two provide a survey of the main theoretical issues encountered in the study of medieval empires, and an assessment of the relationship between Byzantine basileis, patriarchs, popes and Western emperors prior to 1204. Chapters three and four investigate the competing but interconnected ruling systems which emerged in the Balkans, the Aegean and Asia Minor after 1204, tracing their policies of war and appeasement until the recovery of Constantinople by the Nicene Greeks in 1261. -

Re-Analyzing the Ottoman Apulian Campaign and Attack on Corfu (1537) in the Context of Ottoman-Habsburg Rivalry
ELVİN OTMAN ELVİN THE OTTOMAN AND CORFU APULIAN OTTOMAN CAMPAIGN (1537) ON THE ATTACK THE CRESCENT, THE AND LION THE EAGLE: RE IN THE CONTEXT OF CONTEXT THE OF OTTOMAN IN THE CRESCENT, THE LION AND THE EAGLE: RE-ANALYZING THE OTTOMAN APULIAN CAMPAIGN AND ATTACK ON CORFU (1537) IN THE CONTEXT OF OTTOMAN-HABSBURG RIVALRY A Ph.D. Dissertation by - HABSBURG RIVALRY ELVĠN OTMAN - ANALYZING ANALYZING Department of History Ġhsan Doğramacı Bilkent University Ankara Bilkent University 2018 University Bilkent January 2018 In Loving Memory of My TeyzoĢ ġeyda Müezzinoğlu THE CRESCENT, THE LION AND THE EAGLE: RE-ANALYZING THE OTTOMAN APULIAN CAMPAIGN AND ATTACK ON CORFU (1537) IN THE CONTEXT OF OTTOMAN-HABSBURG RIVALRY The Graduate School of Economics and Social Sciences of Ġhsan Doğramacı Bilkent University by ELVĠN OTMAN In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HISTORY THE DEPARTMENT OF HISTORY ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT UNIVERSITY ANKARA January 2018 ABSTRACT THE CRESCENT, THE LION AND THE EAGLE: RE-ANALYZING THE OTTOMAN APULIAN CAMPAIGN AND ATTACK ON CORFU (1537) IN THE CONTEXT OF OTTOMAN-HABSBURG RIVALRY Otman, Elvin Ph. D., Department of History Supervisor: Asst. Prof. Dr. Paul Latimer January 2018 This dissertation produces a detailed historical narrative of the Ottoman Apulian Campaign and the Attack on Corfu in 1537. Although the Apulian Campaign, a natural consequence of the Ottoman-Habsburg rivalry, which characterized the sixteenth-century Ottoman policies and discourse of universal sovereignty, was originally planned as an Ottoman-French joint military operation, it remained as an individual Ottoman attack on the south eastern Italy since the French King did not offer his already promised military support during the campaign. -

Flags Over Kythera by Ralph Kelly, Flags Australia
Flags over Kythera by Ralph Kelly, Flags Australia Historical Background As one of the Ionian Islands, Kythera has shared a complex history of conquest, trade and shared culture with Greece, the Byzantine Empire and Venice. In ancient times Kythera was settled by Greeks from the Peloponnese, which became controlled by the Roman Empire, and from 395 AD, by the Byzantine Empire. As a consequence of the conquest of the Byzantine Empire by the Fourth Crusade in 1204, Crete became controlled by the Republic of Venice, whilst Kythera became a possession of a Venetian noble, Marco Venier and the island was renamed Cerigo. Venice took formal control in 1325, though the Venier family remained 1 major feudal landowners for several centuries. This was the first of the Ionian Islands to become a possession of Venice.2 Venier family coat of arms The Venetian Republic was dissolved by Napoleon Bonaparte, resulting in Kythera being occupied by France in 1797. However the island was captured by a Russian-Turkish fleet in October the following year. From 1800 to 1807 it was part of the Septinsular Republic (State of the Seven United Islands), nominally under the soveriegnty of the Ottoman Empire, but in practice controlled by Russia. The Ionian Islands were reclaimed by France in 1807, but control was lost to Great Britain in October 1809 when the islands were captured by British forces. The Congress of Vienna established the British protectorate of the “United States of the Ionian Islands” in 1815, including Kythera. The Ionian Islands were regarded as being strategically important, being located near Greece and Italy and the trade routes to the Ottoman Empire. -

Manuel D'histoire Universelle, Résumé Raisonné Des Faits Et Événemens Les
MANUEL UNIVERSELLE, aiisaari n~iso~rslDES FAITS ET ~V$NEXENS LES PLUS nt- PORTARS; DES INVEITlOKS LES PLUS UTILES DES HOJlNES LES PLUS EEJIABQUABLHS DEPUIS LE COYhlERCENENT DU MOXDE JUSQU'IT~ 1856; PAR S. CASEN !* TRADUCTEITR DE LA B1Bl.E. PARIS, -4 LA LIBRAIRIE E~CYCLOPEDIQVEDE RORFIT, RUE HAUTEPEUILLE, ;YD IO ElS. 1836. INTRODUCTION. Si l'histoire a pour objet de faire con- naître ce qiii est arrivd , iine histoire uni- verselle ou générale devra riécessairement offrir le tableau complet de tous les faits qui ont eu lieil depuis que le monde existe. L'univers rcnferine clans son ensemble ce que nos sens et notre raison y aper- qoi\ieiit en detail. Mais la Giiblesse de l'es- prit humain ne lui permet même pas de niesilrer l'espace et le temps, ces deux bases esseri tielles des fai ts ;saisir l'en~emble dails son inimensité est une tAche trop dif- ficile pour la conception bornée de l'homme. 011 peut avoir sur cet ensemble des pressen- limens confus; mais pressentir n'est pas savoir, et l'histoire est de la science. Considérée sous un point de vue plus a (2) restreint, l'histoire générale est une Con. naissance autlienti que, un tableau exact des époqiics les plus importantes de la terre et du genre lirimain , des temps les plus anciens jusqu'aiix plus rapprochés de iious. Rlais s'il est difficile de décrire les 60 ou 80 ans d'un individu, la dilIiculté est bieii plus grande quand il s'agit des 6,000 ans qu'on attribiie à l'liuinanilé entikrc.