Fraude Financière, Dette Souveraine Et Impérialisme D'affaires Une Micro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Florida Historical Quarterly FLORIDA HISTORICAL SOCIETY
The Florida Historical Quarterly FLORIDA HISTORICAL SOCIETY V OLUME XLV July 1966 - April 1967 CONTENTS OF VOLUME XLV Abernethy, Thomas P., The Formative Period in Alabama, 1815- 1828, reviewed, 180 Adams, Adam, book review by, 70 Agriculture and the Civil War, by Gates, reviewed, 68 Alachua County Historical Commission, 89, 196 Alexander, Charles C., book review by, 186 “American Seizure of Amelia Island,” by Richard G. Lowe, 18 Annual Meeting, Florida Historical Society May 5-7, 1966, 199 May 5-6, 1967, 434 Antiquities Commission, 321 Appalachicola Historical Society, 308 Arana, Luis R., book review by, 61 Atticus Greene Haygood, by Mann, reviewed, 185 Bailey, Kenneth K., Southern White Protestantism in the Twen- tieth Century, reviewed, 80 Barber, Willard F., book review by, 84 Baringer, William E., book review by, 182 Barry College, 314 Batista, Fulgencio, The Growth and Decline of the Cuban Repub- lic, reviewed, 82 Battle of Pensacola, March 9 to May 8, 1781; Spain’s Final Triumph Over Great Britain in the Gulf of Mexico, by Rush, reviewed, 412 Beals, Carlton, War Within a War: The Confederacy Against Itself, reviewed, 182 Bearss, Edwin C., “The Federal Expedition Against Saint Marks Ends at Natural Bridge,” 369 Beck, Earl R., On Teaching History in Colleges and Universities, reviewed, 432 Bennett, Charles E., “Early History of the Cross-Florida Barge Canal,” 132; “A Footnote on Rene Laudionniere,” 287; Papers, 437 Bigelow, Gordon E., Frontier Eden: The Literary Career of Mar- jorie Kinnan Rawlings, reviewed, 410 “Billy Bowlegs (Holata Micco) in the Second Seminole War” (Part I), 219; “Billy Bowlegs (Holata Micco) in the Civil War” (Part II), 391 “Bishop Michael J. -

The Gregor Macgregor Scam
October 2016 | Lessons from the past 1822/3 The Gregor MacGregor scam History is full of bubbles, booms and busts, corporate William Paterson’s Darien Venture of the 1690s. collapses and crises, which illuminate the present MacGregor’s venture aimed to colonise an area of the financial world. Mosquito Coast called Poyais. Styling himself Cazique of Poyais, he and his wife, Princess Josefa of Poyais, a cousin of At Stewart Investors we believe that an appreciation Bolivar, made an exotic pair in 1820s London and were of financial history can make us more effective regarded as celebrities. investors today. Poyais, according to MacGregor, offered a marvellous investment opportunity. He claimed the area would benefit from burgeoning trade following the end of war with Spain, A case of financial and might develop further if a canal could be built across the isthmus. The Darien Scheme had been promoted with amnesia? exactly the same project in mind. Cash was raised from a number of sources. The Territory of Poyais issued 30-year bonds at an interest rate of 3%, taking advantage of the bull market in Latin American bonds to raise £200,000. In On 22 January 1823 the Kennersley Castle sailed from the addition, plots of land were sold to settlers, 100 acres Port of Leith in Scotland with 200 settlers bound for Central costing about £11. MacGregor targeted his fellow Scots as America. Two months later, when they reached their colonists, who included doctors, lawyers, farmers, artisans, destination, the colonists were shocked to find virgin jungle as well as a banker and a young man employed to manage rather than the mature settlement described by the the National Theatre of the colony. -

ANNUAL BUDGET and Program of Municipal Services Fiscal Year 2016 - 2017
ANNUAL BUDGET and Program of Municipal Services Fiscal Year 2016 - 2017 CITY OF FERNANDINA BEACH THE HISTORY OF FERNANDINA BEACH The City of Fernandina Beach is a seaside community with a rich history located on beautiful Amelia Island. The Timucuan Indians were among the first inhabitants of the area. Then in the 1500’s the first visitors from Europe discovered Fernandina Beach. Since that time eight different flags have flown over our city. The French were the first European visitors to take control of the island in 1562. They were defeated by the Spanish in 1565 who named the island Santa Maria. The Spanish and the English fought over control of the area for many years. In 1702 the Spanish Settlement was destroyed and James Edward Oglethorpe (Georgia’s founder and Colonial Governor) changed the name of the island to Amelia after the daughter of King George II. At the end of the American War of Independence (1783), an international treaty returned the province from Britain to Spain, who then established a provincial governor in St. Augustine. Yet, in 1812, the “Patriots of Amelia Island” overthrew the Spanish and hoisted their flag. A day later their flag was replaced by the American Flag. In 1817, Scottish mercenary Sir Gregor MacGregor overtook the island and hoisted the Green Cross of Florida. Due to lack of funds and men, when Spanish troops approached to reclaim the island, MacGregor left Jared Irwin and Ruggles Hubbard (two American adventurers) in command. Shortly thereafter, Pirate Luis Aury arrived with men and money and claimed the island alongside Irwin and Hubbard for the Mexican Rebels. -

American Clan Gregor Society INCORPORATED
YEAR BOOK OF THE American Clan Gregor Society INCORPORATED Containing the Proceedings of the 1954 Annual Gathering .. THE AMERICAN CLAN GREGOR SOCIETY INCORPORATED WASHIN GTO N, D. C. • Copyright, 1955 by T homas Gar land Magruder, ] r., Editor Cusson s, May & Co., Inc., Printers, Richmond, Va OFFI C ER S SIR MALCOLM MACGREGOR OF M ACGREGOR, BARONET ....H ereditary Chief "Edinchip," Lochearnhead, Scotland BRIG . GEN. MARSHALL MAGRUD ER, U. S. ARMY, Re tired Chieftain 106 Camden Road , N. E. , Atlanta, Ga. F ORREST S HEPPERSON H OL M ES Assistant to the Chieftain .. 6917 Carle ton Terrac e, College P ark. Md . R EV. D ANIEL RANDALL MAGRUDER Rallking D eputy Chieftain Hingham, Mass. M ISS A NNA L OUI SE R EyNOLD S Scribe 5524 8t h St., N . W ., W ashington , D. C. MRS. O . O. VANDEN B ERG........ .......................................... .....••..•R egistrar Th e H ighland s, A pt. 803, W ashington 9, D. C. MISS R EGINA MAGRUDER HILL...... .. .......•................ ........ ............Historian The H ighl and s, Apt. 803, W ashi ngton 9, D. C. C LARE N CE WILLIAM rVICCORM ICK Treasurer 4316 Clagett Road, University Pa rk, Md. R EV. REUEL L AMP HIER HOWE Chaplain Theological Se minary, Alexandria, Va, D R. R OGER GREGORY MAGRUDER Surgeon Lewis Mount ain Circle, Charl ott esville, Va, T HOMAS GARLAND MAGRUDER, J R E ditor 2053 Wil son Boulevard , Arlington, Va . C. VIRGI NIA DIEDEL Chancellor Th e Marlboro A pts., 917 18th St., N . W., Washington 6, D. C. MRS. J A M ES E . ALLGEYER (COLMA M Y ER S ) Deputy S cribe 407 Const itutio n Ave., N. -

Héroes De Carabobo Ediciones De La Presidencia De La República Caracas - Venezuela, 2004 Depósito Legal: Lf8002004900384 ISBN: 980-03-0338-3
EDICIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MANUEL ANTONIO BARROSO ALBERTO DIRECTOR DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE TCNEL. CARLOS JULIO RODRÍGUEZ RABAN DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN INTERNA CAP. CC. ERIKA VIRGÜEZ OVIEDO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DOLORES DAMARYS CORDERO NEGRIN COORDINADORA DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES (E) © Despacho del Presidente Los Héroes de Carabobo Ediciones de la Presidencia de la República Caracas - Venezuela, 2004 Depósito Legal: lf8002004900384 ISBN: 980-03-0338-3 Impresión: Anauco Ediciones, C.A. Diseño, Diagramación y Portada: José Alejandro Guzmán S. Héctor Bencomo Barrios LOS HEROES DE CARABOBO Ediciones de la Presidencia de la República 2004 ÍNDICE Prólogo 9 Introducción 13 Abreu e Lima, J. I. Ribeiro de 15 Alcántara, Francisco de Paula 19 Aramendi, Francisco 23 Arguindegui, José María 25 Arismendi, Juan Bautista 27 Arraiz, Manuel 33 Avendaño, Francisco de Paula 35 Bermúdez, José Francisco 41 Bolívar, Simón 47 Borrás, Miguel 55 Bravo, Juan Ángel 59 Briceño Méndez, Pedro 61 Camejo, Josefa 69 Carrillo, José de la Cruz 75 Castelli, Carlos Luis 81 Conde, Juan José 89 Demarquet, Carlos Eloy 91 Farfán, Francisco 99 Ferriar, Thomas Ilderton 101 Figueredo, Fernando 103 Flegel, Ludwig 109 Flores, Juan José 113 Gómez, Juan 123 Gravete, Antonio 129 Heras, José Rafael de las 131 Ibarra, Diego 133 Iribarren, Guillermo 139 Macero, Felipe 143 Manrique, Manuel 147 Manzo, Juan Manuel 153 Mariño, Santiago 155 Martin, Felipe Mauricio 165 Mellado, -

Flora Digital De La Selva Explicación Etimológica De Las Plantas De La
Flora Digital De la Selva Organización para Estudios Tropicales Explicación Etimológica de las Plantas de La Selva J. González A Abarema: El nombre del género tiene su origen probablemente en el nombre vernáculo de Abarema filamentosa (Benth) Pittier, en América del Sur. Fam. Fabaceae. Abbreviata: Pequeña (Stemmadenia abbreviata/Apocynaceae). Abelmoschus: El nombre del género tiene su origen en la palabra árabe “abu-l-mosk”, que significa “padre del almizcle”, debido al olor característico de sus semillas. Fam. Malvaceae. Abruptum: Abrupto, que termina de manera brusca (Hymenophyllum abruptum/Hymenophyllaceae). Abscissum: Cortado o aserrado abruptamente, aludiendo en éste caso a los márgenes de las frondes (Asplenium abscissum/Aspleniaceae). Abuta: El nombre del género tiene su origen en el nombre vernáculo de Abuta rufescens Aubl., en La Guayana Francesa. Fam. Menispermaceae. Acacia: El nombre del género se deriva de la palabra griega acacie, de ace o acis, que significa “punta aguda”, aludiendo a las espinas que son típicas en las plantas del género. Fam. Fabaceae. Acalypha: El nombre del género se deriva de la palabra griega akalephes, un nombre antiguo usado para un tipo de ortiga, y que Carlos Linneo utilizó por la semejanza que poseen el follaje de ambas plantas. Fam. Euphorbiaceae. Acanthaceae: El nombre de la familia tiene su origen en el género Acanthus L., que en griego (acantho) significa espina. Acapulcensis: El nombre del epíteto alude a que la planta es originaria, o se publicó con material procedente de Acapulco, México (Eugenia acapulcensis/Myrtaceae). Achariaceae: El nombre de la familia tiene su origen en el género Acharia Thunb., que a su vez se deriva de las palabras griegas a- (negación), charis (gracia); “que no tiene gracia, desagradable”. -

Inventory Acc.11713 Clan Gregor Centre Archive
Acc.11713 June 2011 Inventory Acc.11713 Clan Gregor Centre Archive (History and Genealogy) National Library of Scotland Manuscripts Division George IV Bridge Edinburgh EH1 1EW Tel: 0131-466 2812 Fax: 0131-466 2811 E-mail: [email protected] © Trustees of the National Library of Scotland Donated to the National Library of Scotland on behalf of the Clan Gregor Centre in February 1999. This is the second of three (as of April 2004) Clan Gregor deposits: for the first, see Acc.10664; for the third seeAcc.12335. This inventory has been compiled by Sheila McGregor, FSA Scot, for the Clan Gregor Centre. Introduction: This material represents the contribution of a rather small number of active individuals to the Clan Gregor Centre over many years of collecting and compiling. It represent both traditional knowledge and many years of research. It has occasionally been possible to attribute a file to a named individual but in most cases the folders are composite collections from many sources and these are attributed to me in my capacity as curator and general editor. The members of the Clan as a whole, who are extremely numerous, owe the active few a great deal since they have been among the very few to keep hold of their real past and to avoid the romantic escapism that pervades modern Highland culture, if that is the right word. It has been possible, with the support of these few active members and the willing collaboration of the National Library of Scotland, not only to preserve their knowledge but often to extend it since modern research tools have made it sometimes possible to find solutions to long-standing problems. -

La Condición De Extranjero En El Tránsito De La Colonia a La República En La Nueva Granada, 1750-1830
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositorio UASB-DIGITAL Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Historia Doctorado en Historia La condición de extranjero en el tránsito de la Colonia a la República en la Nueva Granada, 1750-1830 Por: Rodrigo de J. García Estrada 2012 2 CLAUSULA DE CESION DE DERECHO DE PUBLICACION DE TESIS/MONOGRAFIA Yo, Rodrigo de J. García Estrada, autor/a de la tesis intitulada La condición de extranjero en el tránsito de la Colonia a la República en la Nueva Granada, 1750‐1830 mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Doctor en Historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet. 2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad. -

International Bond & Share Society Journal (November 1995)
INTERNATIONAL BOND AND SHARE SOCIETY JOURNAL · YEAR 18 ISSUE 4 NOVEMBER 1995 INTERNATIONAL BOND &SHARE SOCIETY Founded in 1978 for the encouragement of Scripophily INTERNATIONAL COMMITTEE USA CHAIRMAN PRESIDENT Brian Mills, P.O. Box 9, Tadworth , Surrey Haley Garrison, Drawer JH, Williamsburg KT20 ?JU. UK Tel/Fax: (+44) 1737 842833 VA 23187 Tel : (+1) 804 220 3838 VICE PRESIDENT SECRETARY Richard Gregg, 15 Dyatt Place, P.O. Box 430, Peter Duppa-Miller, Beechcroft, Combe Hay, Hackensack, NJ 07602 Tel : (+1) 201 529 4126 Bath BA2 7EG. UK Tel : (+44) 1225 837271 SECRETARY/TREASURER Diana Herzog, 26 Broadway, Suite 271 TREASURER Martyn Probyn, 19 Nevern Square, New York , NY 10004 Tel: (+1) 212 943 1880 London SW5 9PD. UK Tel: (+44) 171 373 3556 CANADA MEMBERSHIP SECRETARY Peter Boag, 1 Crown Terrace, London NW2 1 EV. UK CHAIRMAN Raymond Schaffer, 80 Churchill Avenue, Tel/Fax: (+44) 181 450 9824 North York , Ontario M2N 1Y9 Tel : (+1) 416 223 5883 AUCTIONEER Bruce Castlo, 1 Little Pipers Close, Gotts Oak, VICE-CHAIRMAN/AUCTION DIRECTOR Waltham Cross ENS 5LH. UK Tel : (+44) 1707 875659 Geoff Cole, 6 Regency Court, Oakville, Ontario L6H 2P7 Tel: (+1) 905 845 2860 JOURNAL EDITOR Howard Shakespeare, 68 Viney Bank, Forestdale SECRETARY John Blumberg, Cranberry Resort, Box 4002, Croydon CRO 9JT. UK Tel: (+44) 181 657 7721 Collingwood, Ontario L9Y 2T9 Fax: (+44) 181 657 0744 Tel: (+1) 705 446 2858 TREASURER PUBLICITY OFFICER Bob Sycamore, 2266 Westman Road, Peter Rooley, 3 Helions Road, Mississauga, Ontario L5K 1M5 Steeple Bumpstead, Haverhill, Suffolk -

Macgregorâ•Žs Invasion of Florida
Florida Historical Quarterly Volume 7 Number 1 Florida Historical Quarterly, Vol 7, Article 5 Issue 1 1928 MacGregor’s Invasion of Florida T. Frederick Davis Part of the American Studies Commons, and the United States History Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/fhq University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Article is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Florida Historical Quarterly by an authorized editor of STARS. For more information, please contact [email protected]. Recommended Citation Davis, T. Frederick (1928) "MacGregor’s Invasion of Florida," Florida Historical Quarterly: Vol. 7 : No. 1 , Article 5. Available at: https://stars.library.ucf.edu/fhq/vol7/iss1/5 Davis: MacGregor’s Invasion of Florida MACGREGOR’S INVASION OF FLORIDA, 1817. By T. F REDERICK D AVIS Gregor MacGregor was the grandson of Gregor MacGregor, the Scotchman, who enlisted in the Black Watch, then Semphill’s Highlanders, and was called in Gaelic “Gregor, the Beautiful.” When the regiment was first ordered to England, in 1743, “Gregor, the Beautiful” and two others were sent on in advance to London, so that the king of England, who was on the point of starting for the continent, might see some soldiers of the regiment before leaving. One of the men died en route, but MacGregor and the other were paraded before the king at St. James’s and gave an ex- hibition of their dexterity with the broadsword and Lochabar axe. Both afterwards rose to commissions. MacGregor subsequently joined another regiment. -

ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW Records and Collections, 1768-1954 Reels M730-88
AUSTRALIAN JOINT COPYING PROJECT ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW Records and collections, 1768-1954 Reels M730-88 Royal Botanic Gardens Kew, Richmond London TW9 3AE National Library of Australia State Library of New South Wales Filmed: 1970-71 CONTENTS Page 4 Historical note 7 Kew collectors series, 1814-55 9 Papers relating to collectors, 1791-1865 10 Official correspondence of Sir William Hooker, 1825-65 17 Official correspondence, 1865-1928 30 Miscellaneous manuscripts 30 Manuscript of James Backhouse 30 Letters to John G. Baker, 1883-90 31 Papers of Sir Joseph Banks, 1768-1819 33 Papers of George Bentham, 1834-1882 35 Papers of Henry Burkill, 1893-1937 35 Records of HMS Challenger, 1874-76 36 Manuscript of Frederick Christian 36 Papers of Charles Baron Clarke 36 Papers of William Colenso, 1841-52 37 Manuscript of Harold Comber, 1929-30 37 Manuscripts of Allan Cunningham, 1826-35 38 Letter of Charles Darwin, 1835 38 Letters to John Duthie, 1878-1905 38 Manuscripts of A.D.E. Elmer, 1907-17 39 Fern lists, 1846-1904 41 Papers of Henry Forbes, 1881-86 41 Correspondence of William Forsyth, 1790 42 Notebook of Henry Guppy, 1885 42 Manuscript of Clara Hemsley, 1898 42 Letters to William Hemsley, 1881-1916 43 Correspondence of John Henslow, 1838-39 43 Diaries of Sir Arthur Hill, 1927-28 43 Papers of Sir Joseph Hooker, 1840-1914 2 48 Manuscript of Janet Hutton 49 Inwards and outwards books, 1793-1895 58 Letters of William Kerr, 1809 59 Correspondence of Aylmer Bourke Lambert, 1821-40 59 Notebooks of L.V. -
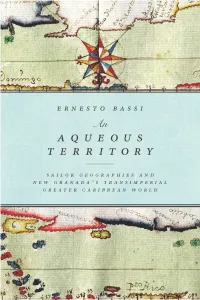
AN AQUEOUS TERRITORY This Page Intentionally Left Blank an AQUEOUS TERRITORY
AN AQUEOUS TERRITORY This page intentionally left blank AN AQUEOUS TERRITORY Sailor Geographies and New Granada’s Transimperial Greater Ca rib bean World ernesto bassi duke university press Durham and London 2016 © 2016 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of Amer i ca on acid- free paper ∞ Typeset in Minion Pro by Westchester Publishing Services Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Bassi, Ernesto, [date] author. Title: An aqueous territory : sailor geographies and New Granada’s transimperial greater Ca rib bean world / Ernesto Bassi. Description: Durham : Duke University Press, 2017. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: lccn 2016023570 (print) lccn 2016024535 (ebook) isbn 9780822362203 (hardcover : alk. paper) isbn 9780822362401 (pbk. : alk. paper) isbn 9780822373735 (ebook) Subjects: lcsh: Geopolitics— Caribbean Area. | Ca rib bean Area— Bound aries. | Ca rib bean Area— Commerce. | Ca rib bean Area— History. | Ca rib bean Area— Politics and government. | Imperialism. Classification: lcc f2175.b37 2017 (print) | lcc f2175 (ebook) | ddc 320.1/2— dc23 lc rec ord available at https:// lccn . loc . gov / 2016023570 Cover art: Detail of Juan Álvarez de Veriñas’s map of the southern portion of the transimperial Greater Caribbean. Image courtesy of Archivo General de Indias, Seville, Spain (MP-Panama, 262). TO CLAU, SANTI, AND ELISA, mis compañeros de viaje This page intentionally left blank CONTENTS acknowl edgments ix introduction: Uncovering Other Pos si ble