Gide Et L'espagne N° 119/120
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
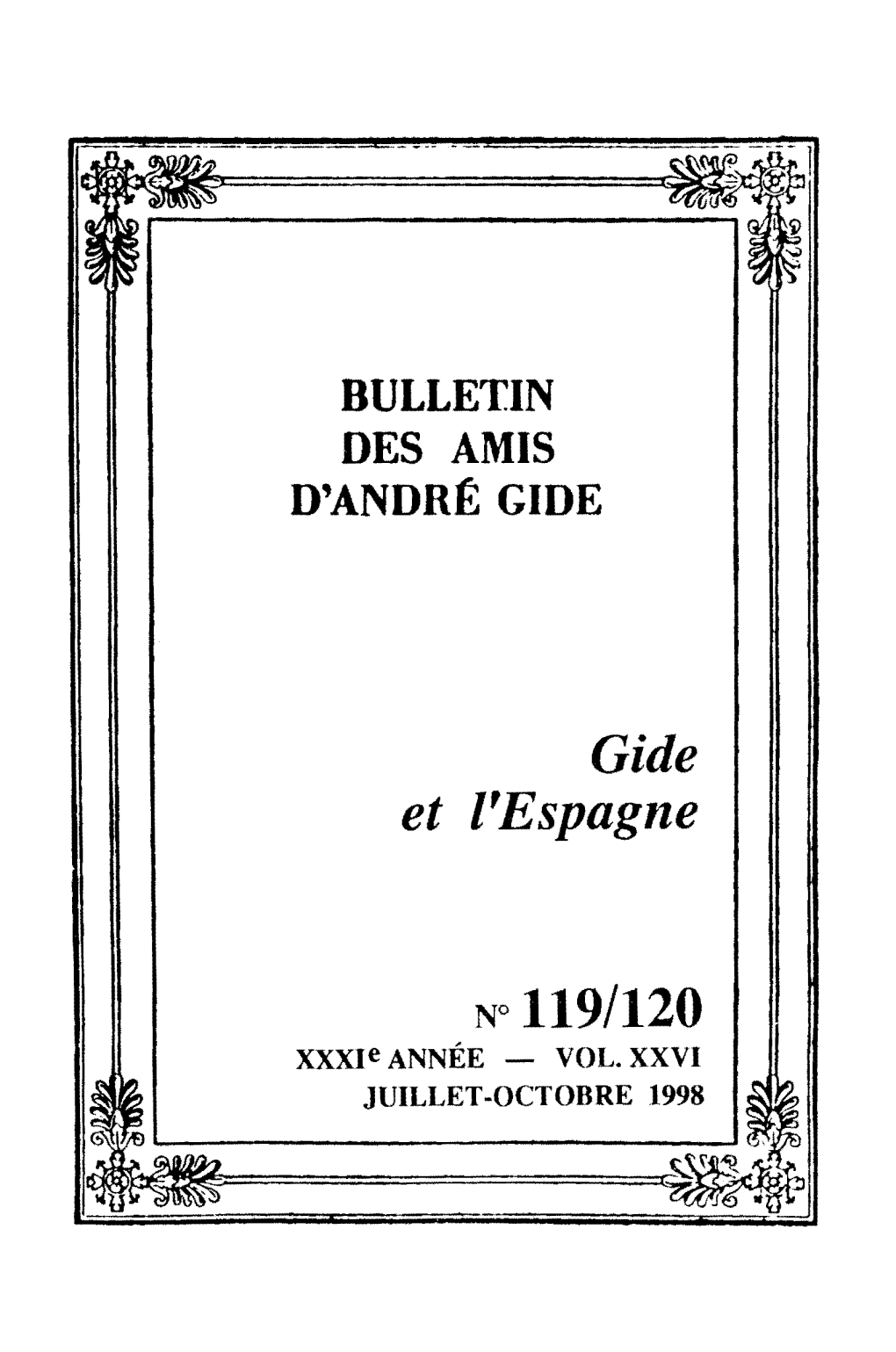
Load more
Recommended publications
-

Mouvement Sur Postes De Chef
Mouvement sur postes de chef : CAPN des 28 et 29 mars 2019 Type acad aff vill aff etab aff num aff fonc aff cat log Civilité Nom Prénom origine chef AIX MARSEILLE AIX EN PROVENCE LGT VAUVENARGUES 0130003H PRLY 5 F5 Mr VINCENT Philippe PRLY LYC JEAN PERRIN MARSEILLE AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE AIX EN PROVENCE LGT PAUL CEZANNE 0130002G PRLY 5 F6 Mr REYNAUD Jean-François PRLY LGT ARISTIDE BRIAND GAP CEDEX AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE AIX EN PROVENCE LGT EMILE ZOLA 0130001F PRLY 5 F5 Mme PORTIGLIATTI Elisabeth PRLY LGT MARIE MADELEINE FOURCADE GARDANNE CEDEX AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE ALLAUCH LYCEE 0134253C PRLY 2 F4 Mr SANTINI Christophe PACG CLG FRANCOIS VILLON MARSEILLE CEDEX 11 AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE ALLAUCH CLG YVES MONTAND 0133490Y PACG 4 F5 Mme TOINON Elisabeth PACG CLG UBELKA AURIOL AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE ARLES LYCÉE TECHNOLOGIQUE PASQUET 0130011S PRLY 4 F4 Mme FAGOT-BARRALY Jacqueline PRLP LP ARISTIDE BRIAND (COURS) ORANGE AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE ARLES CLG ROBERT MOREL 0131746C PACG 4 F5 Mme BARON MARIE-LAURE PACG CLG CENTRE GAP AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE AUBAGNE CEDEX CLG LOU GARLABAN 0132412B PACG 4 F6 Mme SPINELLI Véronique PACG CLG LES GORGUETTES GILBERT RASTOIN CASSIS AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE AURIOL CLG UBELKA 0133510V PACG 3 F5 Mr PLANCHAND Stéphane - Ministère Education Nationale PARIS PARIS chef AIX MARSEILLE AVIGNON CLG JOSEPH ROUMANILLE 0840007B PACG 4 F5 Mr TALBOT Pierre EREA EREA Paul Vincensini VEDENE Cedex AIX MARSEILLE chef AIX MARSEILLE BEDARRIDES CLG SAINT -

L'action Française Face À Victor Hugo Dans L'entre-Deux-Guerres1
Jordi Brahamcha-Marin (Le Mans Université) L’Action française face à Victor Hugo dans l’entre-deux-guerres1 L’histoire de l’Action française dans l’entre-deux-guerres est travaillée par un paradoxe2. D’un côté, ce mouvement, constitué autour d’un journal (fondé en 1898, devenu quotidien en 1908) et d’une ligue (fondée en 1905), ne parvient jamais vraiment à influencer le cours des événements politiques. Bien sûr, le « coup de force » souhaité par Maurras n’est pas réalisé ; en 1926, la mise à l’index, par le Saint-Siège, du quotidien L’Action française porte un coup d’arrêt à l’essor que le mouvement connaissait depuis la fin de la guerre ; dans les années trente, beaucoup de jeunes militants vont se détourner du royalisme au profit d’autres courants politiques jugés moins vieillots, et notamment des courants fascistes ; même sous le régime de Vichy, accueilli par Maurras comme une « divine surprise », les maurrassiens ne joueront qu’un faible rôle dans les sphères dirigeantes3. Les tirages du quotidien L’Action française demeurent, tout au long de la période, somme toute modestes, et tombe à quarante mille en 1939 – à comparer avec les presque deux millions de Paris-Soir, ou, en ce qui concerne la presse politique, les trois cent vingt mille exemplaires de L’Humanité, ou les cent quinze mille exemplaires du quotidien radical L’Œuvre4. De l’autre côté, Maurras et ses amis exercent un magistère intellectuel absolument incontestable, au point que le mouvement a pu exercer une certaine attraction intellectuelle sur des écrivains majeurs, comme Gide ou Proust dans les années dix. -

Sommaire De O. Dard, M. Leymarie & N. Mcwilliam ; Le Maurrassisme Et
Sommaire de l'ouvrage : Olivier DARD, Michel LEYMARIE & Neil McWILLIAM (édit.). LE MAURRASSISME ET LA CULTURE. L'Action française. Culture, Société, Politique (III). Actes du colloque organisé les 25-27 mars 2009 au Centre d'Histoire de Sciences Po, à Paris, avec le concours de l 'Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHIS), du Centre Régional Universitaire Lorrain d'Histoire (CRULH, Metz) et de Duke University. Villeneuve d'Asq : Presses Universitaires du Septentrion (Histoire et Civilisations), 2010. In-8°, 370 pages. ____________ L'Action française a de multiples facettes et le maurrassisme dépasse la personne et l’œuvre propre de Charles Maurras. Après une première série d'études sur les héritages, les milieux sociaux ou religieux, les cas régionaux et les vecteurs de diffusion du mouvement (L'Action française. Culture, société, politique, Septentrion, 2008), une deuxième rencontre a explicité les relations du doctrinaire avec ses interlocuteurs étrangers ainsi que la réception et les usages du maurrassisme hors de France (Charles Maurras et l'étranger. L 'étranger et Charles Maurras, Peter Lang, 2009). Ce troisième ensemble est plus spécifiquement consacré au maurrassisme et à la culture, aux liens entre politique, philosophie et esthétique. En effet, à l'Action française, le projet culturel est central. Fondé sur un corpus d'idées puisées dans des registres variés et diffusées selon des modalités diverses, porté par des individus ou des acteurs collectifs, bénéficiant d'appuis et de relais, le maurrassisme est un objet pluriel qui relève d'une histoire à la fois politique, sociale et culturelle. Son étude requiert, comme c'est le cas ici, les analyses menées en commun par des spécialistes français et étrangers, venus de diverses disciplines. -

Résumés Français Des Différentes
Résumés.qxp 15/05/2012 14:29 Page 1 Maurrassisme et littérature Résumés Martin Motte Mistral-Maurras : les enjeux d’une filiation Charles Maurras fut-il le fils spirituel de Frédéric Mistral ou détourna-t-il l’héritage du grand poète provençal ? La question ne peut être directement tranchée par comparaison de leurs idées politiques, celles de Mistral ayant été très fluctuantes. Le détour par la littérature s’avère en revanche plus fructueux, puisque c’est sur ce terrain-là qu’ils se sont rencontrés. Pour Maurras, la poésie de Mistral était l’antidote au nihilisme romantique et, de façon analogue mais sur un plan collectif, une forme d’action civique. L’engagement du jeune Mistral au sein du Félibrige se fit sous ces auspices, mais il se rendit vite compte que les hiérarques du mouvement étaient trop proches de la République jacobine pour ne pas trahir le rêve de Mistral ; aussi se convertit- il au monarchisme, persuadé que seul un roi pourrait restaurer les libertés régionales. En somme, Maurras pensait accomplir le mistralisme par les voies du politique. Mais il ne put jamais rallier Mistral à ses vues, car de nombreuses questions les divisaient – et d’abord le fait que le poète abhorrait la politique. Leurs désaccords sur des enjeux annexes masquent toutefois une grande proximité quant à la façon d’articuler littérature et engagement civique, qu’ils avaient tendance à rapprocher jusqu’à les confondre. Cela explique que confrontés à des cir- constances tragiques, la révolte des vignerons languedociens pour Mistral, le 6 février 1934 pour Maurras, l’un et l’autre se soient repliés sur l’écriture. -

La Dame Aux Éventails. Nina De Villard, Musicienne, Poète, Muse, Animatrice De Salon »
«La Dame aux éventails. Nina de Villard, musicienne, poète, muse, animatrice de salon » by Marie Boisvert A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of French University of Toronto © Copyright by Marie Boisvert 2013 « La Dame aux éventails. Nina de Villard, musicienne, poète, muse, animatrice de salon » Marie Boisvert Doctor of Philosophy Degree Département d’études françaises University of Toronto 2013 Résumé De 1862 à 1882, Nina de Villard attire chez elle à peu près tous les hommes qui laisseront leur marque dans le monde des arts et des lettres : Verlaine, Mallarmé, Maupassant, Manet et Cézanne figurent tous parmi ses hôtes. Ayant accueilli ces grands hommes, Nina et son salon trouvent, par la suite, leur place dans plusieurs livres de souvenirs et romans qui, loin de rendre leur physionomie et leur personnalité, entretiennent plutôt la confusion. Portraits fortement polarisés présentant une muse régnant sur un salon brillant d’une part, et de l’autre, une femme dépravée appartenant à un univers d’illusions perdues, ces textes construisent une image difforme et insatisfaisante de Nina et de ses soirées. Face à cette absence de cohérence, nous sommes retournée aux sources primaires en quête de la véritable Nina et de son salon. ii La première partie de notre thèse est consacrée à Nina qui, malgré des années de formation conformes à la norme, remet en question la place qui lui revient : celle d’épouse et de femme confinée à l’intérieur. Nina est avide de liberté et revendique l’identité de pianiste et une vie où elle peut donner des concerts, sortir et recevoir quand cela lui plaît. -

Consulter/Télécharger
S o MM a i r e • Journal littéraire Michel crépu 9 Bizub, Le Bihan, Gillet, Guilbert, d’Azay, Zorgbibe, Boddaert... • hommage eryck de rubercy 19 Reconnaissance à Hector Bianciotti • ÉTUDES, REPORTAGES, RÉFLEXIONS laurent Fabius 25 Remarques sur la situation de la France à quelques jours de l’élection présidentielle renaud girard 33 Carnets de route La Grèce, de justesse, se maintient dans la zone euro Jean-yveS boriaud 42 Une si chère Grèce ! alain bienayMé 50 L’art de réformer annick Steta 61 La bataille de l’eau Marin de viry 68 Rire du socialisme actuel en compagnie de Jules Michelet eryck de rubercy 72 Roberto Peregalli : de l’impermanence des choses et des lieux 2 sePteMBRe 2012 • un nouveau théâtre politique Jean-paul cléMent 85 Le centre disparu. De 1789 à la Première Guerre mondiale jacqueS de Saint victor 104 Les deux populismes alain-gérard SlaMa 122 Droite : que faire ? • le goût de la CRITIQUE angelo rinaldi 137 Entretien et eryck de rubercy Romancier, critique de profession véronique gerard powell 151 Louis Gillet, écrivain d’art olivier cariguel 157 Jean José Marchand, critique et homme-bibliothèque • CRITIQUES • livres Frédéric verger 163 Mandelstam • expositions robert kopp 173 Laurent Le Bon au Centre Pompidou Metz • Musique Mihaï de brancovan 180 De Rameau à Marco stroppa • disques Jean-luc Macia 183 Ces chers disparus : Leonhardt et Fischer-Dieskau • noteS de lecture 187 gérard Mairet par Henri de Montety, williaM MarX par Pauline Camille. 3 Éditorial Et maintenant e premier mot de cet éditorial de rentrée sera pour Hector Bianciotti, disparu en juin dernier. -

Regards Sur La Continuité De L'hellénisme Chez Les Écrivains
Regards sur la continuité de l’hellénisme chez les écrivains français du XXème siècle (1947-1967) : une image de la Grèce reconstruite Maria-Eleni Kouzini To cite this version: Maria-Eleni Kouzini. Regards sur la continuité de l’hellénisme chez les écrivains français du XXème siècle (1947-1967) : une image de la Grèce reconstruite. Littératures. Université Paul Valéry - Mont- pellier III, 2012. Français. NNT : 2012MON30039. tel-00806847 HAL Id: tel-00806847 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806847 Submitted on 2 Apr 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER III Arts – Lettres – Langues - Sciences Humaines et Sociales ÉCOLE DOCTORALE 58 Langues, littératures, cultures et civilisations DOCTORAT D’ÉTUDES NEO-HELLÉNIQUES (15 section CNU) Regards sur la continuité de l‟hellénisme chez les écrivains français du XXème siècle (1947-1967): Une image de la Grèce reconstruite THÈSE PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PAR Maria-Eléni KOUZINI Sous la direction Professeur émérite de Marie-Paule Masson Université Paul Valéry Montpellier III Membres du jury Nicolas Karapidakis Professeur, rapporteur Université Ionienne de Corfou Vassiliki Kontoyanni Professeur Université Démocrite de Thrace Michel Politis Professeur Université Ionienne de Corfou 19 DÉCEMBRE 2012 1 Regards sur la continuité de l’hellénisme chez les écrivains français du XXème siècle (1947-1967) : une image de la Grèce reconstruite. -

Lettres & Manuscrits Autographes
Lettres & Manuscrits autographes Salle des ventes Favart Mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018 Division Du catalogue Mercredi 16 mai Beaux-arts Nos 1 à 65 Musique et spectacle Nos 66 à 180 littérature Nos 181 à 375 Jeudi 17 mai sacha Guitry Nos 376 à 535 sciences, Médecine, voyaGes et technique Nos 536 à 631 Histoire Nos 632 à 768 Expert Thierry BODIN, Les Autographes Abréviations : Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art L.A.S. ou P.A.S. : lettre ou pièce autographe signée 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris L.S. ou P.S. : lettre ou pièce signée Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 - Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 (texte d’une autre main ou dactylographié) L.A. ou P.A. : lettre ou pièce autographe non signée [email protected] Mercredi 16 mai 2018 à 14 heures nos 1 à 375 Jeudi 17 mai 2018 à 14 heures nos 376 à 768 Vente aux enchères publiques Salle des Ventes Favart 3, rue Favart 75002 Paris Expert : Thierry BODIN, Les Autographes LETTRES & Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] MANUSCRITS Responsable de la vente : Marc GUYOT [email protected] AUTOGRAPHES Tél : 01 53 40 77 10 Exposition privée sur rendez-vous chez l’expert Expositions publiques Salle des Ventes Favart Mardi 15 mai de 11 h à 18 h Mercredi 16 mai de 11 h à 12 h Jeudi 17 mai de 11 h à 12 h Téléphone pendant l’exposition : 01 53 40 77 10 Catalogue visible sur www.ader-paris.fr Enchérissez en direct sur www.drouotlive.com En 1re de couverture, est reproduit le lot 671 En 2e de couverture, est reproduit le lot 73 En 4e de couverture, est reproduit le lot 201 9 4 7 2 BEAUX-ARTS 1. -

Monde.20020111.Pdf
LE MONDE DES LIVRES VENDREDI 11 JANVIER 2002 DOSSIER ESSAIS Sous le signe de Paris : Guerre et terrorisme : le grand œuvre André Glucksmann, de Karlheinz Stierle François Heisbourg, Page II Michael Barry, Philippe PATRICK CHAMOISEAU HISTOIRE Muray, Emmanuel Goujon... LE MONDE DES LIVRES DE POCHE Page IV Logiques de résistance Page IX Page XI Pages V à VIII Pierre Senges oiseaux, les insectes, les serpents ment à miner toute une civilisa- dans le Jardin botanique pour disséminer les pollens d’al- tion urbaine est-il salubre ou de Grenoble. lergies, encourage la prolifération non ? Ce cinglé vise-t-il à transfor- des algues tueuses et étudie leur mer sa ville peuplée d’endormis, a acheminement sans obstacles de de résignés, et d’aigris sans fou- des instruments de vengeances, la mer aux lavabos. gue en jardin d’Eden ? Est-ce un de pieds de nez ou d’attentats Le délire de cet adventiste pour paradis dont il plante les racines, expédiés à d’anciennes connais- qui le lierre grimpant constitue après avoir envisagé de lever une sances honnies. Dans Ruines-de- une armée des ombres est prétex- armée de révolutionnaires chena- Rome, qui joue encore sur l’inven- te à cours de jardinage autant que pans, de conduire une croisade Pierre Senges, taire encyclopédique, la profu- d’insurrection ; il vous apprend à tel le joueur de flûte de Hamelin sion verbale ludique et érudite, faire la différence entre laurier entraînant dans son sillage la hor- l’utilisation d’un corpus scientifi- sauce et laurier rose. C’est un his- de des révoltés bougons et des que pour refaire le monde, l’im- torien redoutable qui vous rappel- contribuables contrariés, de pro- précateur misanthrope est un le qu’en 1897, aux Etats-Unis, la voquer une crue d’eaux dorman- employé du cadastre qui sème la jacinthe d’eau causa tant de tes emportant portefeuilles, mauvaise graine. -

Bulletin Des Amis D'andré Gide
BULLETIN DES AMIS D'ANDRÉ GIDE GIDE & LA MUSIQJ!_E N° 85 JANVIER 1990 VOL. XVIII - xxme ANNÉE BULLETIN DES AMIS D'ANDRÉ GIDE N"85 VINGT TROISIÈME ANNÉE VOL.X:VTII 1990 Association des, Amis d'André Gide Comité d'honneur : Robert ANDRÉ, Jacques BRENNER, Jacques DROUIN, Dominique FERNANDEZ, Piene KLOSSOWSKI, Robert MAlLET, Jean MEYER, Maurice RHEIMS de l'Académie Française, Robert RICATIE, Roger VRIGNY Le Bulletin des Amis d'André Gide revue fondée en 1968 cfuigée par Oande Martin (1968-1985) puis Daniel Moutote (1985-1988) publiée par le CENTRE DES SCIENCES DU LIVRE & DE LA LITTÉRATURE UNIVERSITÉ DE PARIS-X NANTERRE avtx: le concours du CENTRE NATIONAL DES LEITRES paraissant en janvier, juillet et octobre est principalement diffusée par abonnement annuel ou compris dans les publications servies aux membres de l'Association des Amis d'André Gide an titre de leur cotisation pour l'année en cours. Tarifs en dernière page de chaque livraison. Tonte correspondance relative an BAAG doit être adressée à : DANIEL DUROSAY Dirtx:tenr responsable de la revue 32, rue du Borrégo F. 75020 PARIS TéL : (1) 47.97.58.87 relative àl'AAAG à: HENRI HEINEMANN Secrétaire Général de l'Association 59, avenue Carnot 80410 CA YEUX-SUR-MER Tél.: 22.26.66.58 BULLETIN DES AMIS D'ANDRÉ GIDE Vingt-deuxième année - Voi.XVIII - N°85.Janvier 1990 TÉMOINS Mari~HélèneDASTÉ Souvenirs d'enfance 7 Michèle MORGAN A propos de La Symphonie pastorale Il GIDE ET LA MUSIQUE Patrick POllARD Musique 17 Bernard MÉTAYER Gide et Chopin 65 * Norbert OODHLE Gide ou la révolution 93 Pascal DETHURENS Gide et la question européenne 109 CHRONIQUES GIDIENNES Pierre MASSON Décor et dualisme. -

Fascism, Liberalism and Europeanism in the Political Thought of Bertrand
5 NIOD STUDIES ON WAR, HOLOCAUST, AND GENOCIDE Knegt de Jouvenel and Alfred Fabre-Luce Alfred and Jouvenel de in the Thought Political of Bertrand Liberalism andFascism, Europeanism Daniel Knegt Fascism, Liberalism and Europeanism in the Political Thought of Bertrand de Jouvenel and Alfred Fabre-Luce Fascism, Liberalism and Europeanism in the Political Thought of Bertrand de Jouvenel and Alfred Fabre-Luce NIOD Studies on War, Holocaust, and Genocide NIOD Studies on War, Holocaust, and Genocide is an English-language series with peer-reviewed scholarly work on the impact of war, the Holocaust, and genocide on twentieth-century and contemporary societies, covering a broad range of historical approaches in a global context, and from diverse disciplinary perspectives. Series Editors Karel Berkhoff, NIOD Thijs Bouwknegt, NIOD Peter Keppy, NIOD Ingrid de Zwarte, NIOD and University of Amsterdam International Advisory Board Frank Bajohr, Center for Holocaust Studies, Munich Joan Beaumont, Australian National University Bruno De Wever, Ghent University William H. Frederick, Ohio University Susan R. Grayzel, The University of Mississippi Wendy Lower, Claremont McKenna College Fascism, Liberalism and Europeanism in the Political Thought of Bertrand de Jouvenel and Alfred Fabre-Luce Daniel Knegt Amsterdam University Press This book has been published with a financial subsidy from the European University Institute. Cover illustration: Pont de la Concorde and Palais Bourbon, seat of the French parliament, in July 1941 Source: Scherl / Bundesarchiv Cover design: Coördesign, Leiden Typesetting: Crius Group, Hulshout Amsterdam University Press English-language titles are distributed in the US and Canada by the University of Chicago Press. isbn 978 94 6298 333 5 e-isbn 978 90 4853 330 5 (pdf) doi 10.5117/9789462983335 nur 686 / 689 Creative Commons License CC BY NC ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0) The author / Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2017 Some rights reserved. -

LE PERSONNAGE DE ROMAN, DU XVIIE SIÈCLE À NOS JOURS P
Réviser son bac avec Français 1re, toutes séries Une réalisation de Avec la collaboration de : Alain Malle Valérie Corrège En partenariat avec © rue des écoles & Le Monde, 2016. Reproduction, diffusion et communication strictement interdites. © rue des écoles & Le Monde, 2016. Reproduction, diffusion AVANT-PROPOS Comment optimiser vos révisions et être sûr(e) de maîtriser en profondeur les thèmes et les enjeux du programme de français ? Le jour du bac, comment rendre une copie qui saura faire toute la différence et vous assurer la meilleure note possible ? Pour vous y aider, voici une collection totalement inédite ! Elle est la première et la seule à vous proposer – en plus des révisions traditionnelles – d’étoffer vos connaissances grâce aux articles du Monde. Citations, pistes de réflexion,arguments, exemples et idées clés : les articles sont une mine d’informations à exploiter pour enrichir vos dissertations et vos commentaires. Très accessibles, ils sont signés, entre autres, par Pierre Assouline, Philippe Sollers, Yves Bonnefoy (entretien), Robert Solé, Michel Contat, etc. Inspirée de la presse, la mise en pages met en valeur l’information et facilite la mémorisation des points importants. Sélectionnés pour leur pertinence par rapport à un thème précis du programme, les articles sont accompagnés : • de fiches de cours claires et synthétiques, assorties des mots clés et repères essentiels à retenir ; • de sujets de bac analysés et commentés pas à pas pour une meilleure compréhension. Sans oublier la méthodologie des épreuves et les conseils pour s’y préparer. Message à destination des auteurs des textes figurant dans cet ouvrage ou de leurs ayants-droit : si malgré nos efforts, nous n’avons pas été en mesure de vous contacter afin de formaliser la cession des droits d’exploitation de votre œuvre, nous vous invitons à bien vouloir nous contacter à l’adresse [email protected].