Actes De L'atelier ATELIER REGIONAL D'echanges SUR L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Concours Direct Cycle a Option "Diplomatie Arabisant"
N° de Date de Prénom(s) Nom Lieu de naissance table naissance 1 Abdel Kader AGNE 01/03/1989 Diourbel 2 Dieng AIDA 01/01/1991 Pattar 3 Adjaratou Sira AIDARA 02/01/1988 Dakar 4 Alimatou Sadiya AIDARA 06/01/1992 Thiès 5 Marieme AIDARA 06/02/1991 Nioro Du Rip 6 Mouhamadou Moustapha AIDARA 28/09/1991 Touba 7 Ndeye Maguette Laye ANE 10/06/1995 Dakar 8 Sileye ANNE 10/06/1993 Boinadji Roumbe 9 Tafsir Baba ANNE 19/12/1993 Rufisque 10 Gerard Siabito ASSINE 03/10/1991 Samatite 11 Tamba ATHIE 19/08/1988 Colibantan 12 Papa Ousseynou Samba AW 02/11/1992 Thiès Laobe 13 Ababacar BA 02/09/1991 Pikine 14 Abdou Aziz BA 08/02/1992 Rufisque 15 Abdoul BA 02/02/1992 Keur Birane Dia 16 Abdoul Aziz BA 22/11/1994 Ourossogui 17 Abdoul Mamadou BA 30/08/1992 Thiaroye Gare 18 Abdrahmane Baidy BA 10/02/1991 Sinthiou Bamambe 19 Abibatou BA 08/08/1992 Dakar 20 Aboubacry BA 01/01/1995 Dakar 21 Adama Daouda BA 08/04/1995 Matam 22 Ahmet Tidiane BA 22/02/1991 Mbour 23 Aliou Abdoul BA 26/05/1993 Goudoude Ndouetbe 24 Aly BA 20/01/1988 Saint-Louis 25 Amadou BA 01/12/1996 Ngothie 26 Amidou BA 06/12/1991 Pikine 27 Arona BA 02/10/1989 Fandane 28 Asmaou BA 03/10/1991 Dakar 29 Awa BA 01/03/1990 Dakar 30 Babacar BA 01/06/1990 Ngokare Ka 2 31 Cheikh Ahmed Tidiane BA 03/06/1990 Nioro Du Rip 32 Daouda BA 23/08/1990 Kolda 33 Demba Alhousseynou BA 06/12/1990 Thille -Boubacar 34 Dieynaba BA 01/01/1995 Dakar 35 Dior BA 17/07/1995 Dakar 36 El Hadji Salif BA 04/11/1988 Diamaguene 37 Fatimata BA 20/06/1993 Tivaouane 38 Fatma BA 12/01/1988 Dakar 39 Fatou BA 02/02/1996 Guediawaye 40 Fatou Bintou -
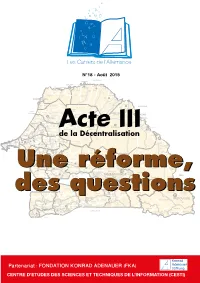
Acte III Une Réforme, Des Questions Une Réforme, Des Questions
N°18 - Août 2015 MAURITANIE PODOR DAGANA Gamadji Sarré Dodel Rosso Sénégal Ndiandane Richard Toll Thillé Boubakar Guédé Ndioum Village Ronkh Gaé Aéré Lao Cas Cas Ross Béthio Mbane Fanaye Ndiayène Mboumba Pendao Golléré SAINT-LOUIS Région de Madina Saldé Ndiatbé SAINT-LOUIS Pété Galoya Syer Thilogne Gandon Mpal Keur Momar Sar Région de Toucouleur MAURITANIE Tessekéré Forage SAINT-LOUIS Rao Agnam Civol Dabia Bokidiawé Sakal Région de Océan LOUGA Léona Nguène Sar Nguer Malal Gandé Mboula Labgar Oréfondé Nabbadji Civol Atlantique Niomré Région de Mbeuleukhé MATAM Pété Ouarack MATAM Kelle Yang-Yang Dodji Gueye Thieppe Bandègne KANEL LOUGA Lougré Thiolly Coki Ogo Ouolof Mbédiène Kamb Géoul Thiamène Diokoul Diawrigne Ndiagne Kanène Cayor Boulal Thiolom KEBEMER Ndiob Thiamène Djolof Ouakhokh Région de Fall Sinthiou Loro Touba Sam LOUGA Bamambé Ndande Sagata Ménina Yabal Dahra Ngandiouf Geth BarkedjiRégion de RANEROU Ndoyenne Orkadiéré Waoundé Sagatta Dioloff Mboro Darou Mbayène Darou LOUGA Khoudoss Semme Méouane Médina Pékesse Mamane Thiargny Dakhar MbadianeActe III Moudéry Taïba Pire Niakhène Thimakha Ndiaye Gourèye Koul Darou Mousty Déali Notto Gouye DiawaraBokiladji Diama Pambal TIVAOUANE de la DécentralisationRégion de Kayar Diender Mont Rolland Chérif Lô MATAM Guedj Vélingara Oudalaye Wourou Sidy Aouré Touba Région de Thiel Fandène Thiénaba Toul Région de Pout Région de DIOURBEL Région de Gassane khombole Région de Région de DAKAR DIOURBEL Keur Ngoundiane DIOURBEL LOUGA MATAM Gabou Moussa Notto Ndiayène THIES Sirah Région de Ballou Ndiass -

'Niŋ, -Pi-, -E and -Aa Morphemes in Kuloonay
The prefix ni- in Kuloonaay: grammaticalization pathways in a three-morpheme system By David C. Lowry August 2015 Word Count: 19,719 Presented as part of the requirement of the MA Degree in Field Linguistics, Centre for Linguistics, Translation & Literacy, Redcliffe College. DECLARATION This dissertation is the product of my own work. I declare also that the dissertation is available for photocopying, reference purposes and Inter-Library Loan. David Christopher Lowry 2 ABSTRACT Title: The prefix ni- in Kuloonaay: grammaticalization pathways in a three- morpheme system. Author: David C. Lowry Date: August 2015 The prefix ni- is the most common particle in the verbal system of Jola Kuloonaay, an Atlantic language of Senegal and The Gambia. Its complex distribution has made it difficult to classify, and a variety of labels have been proposed in the literature. Other authors writing on Kuloonaay and on related Jola languages have described this prefix in terms of a single morpheme whose distribution follows an eclectic list of rules for which the synchronic motivation is not obvious. An alternative approach, presented here, is to describe the ni- prefix in terms of three distinct morphemes, each following a simple set of rules within a restricted domain. This study explores the three-morpheme hypothesis from both a synchronic and a diachronic perspective. At a synchronic level, a small corpus of narrative texts is used to verify that the model proposed corresponds to the behaviour of ni- in natural text. At a diachronic level, data from a selection of other Jola languages is drawn upon in order to gain insight into the grammaticalization pathways by which the three morpheme ni- system may have evolved. -

Les Resultats Aux Examens
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Université Cheikh Anta DIOP de Dakar OFFICE DU BACCALAUREAT B.P. 5005 - Dakar-Fann – Sénégal Tél. : (221) 338593660 - (221) 338249592 - (221) 338246581 - Fax (221) 338646739 Serveur vocal : 886281212 RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION 2017 Janvier 2018 Babou DIAHAM Directeur de l’Office du Baccalauréat 1 REMERCIEMENTS Le baccalauréat constitue un maillon important du système éducatif et un enjeu capital pour les candidats. Il doit faire l’objet d’une réflexion soutenue en vue d’améliorer constamment son organisation. Ainsi, dans le souci de mettre à la disposition du monde de l’Education des outils d’évaluation, l’Office du Baccalauréat a réalisé ce fascicule. Ce fascicule représente le dix-septième du genre. Certaines rubriques sont toujours enrichies avec des statistiques par type de série et par secteur et sous - secteur. De même pour mieux coller à la carte universitaire, les résultats sont présentés en cinq zones. Le fascicule n’est certes pas exhaustif mais les utilisateurs y puiseront sans nul doute des informations utiles à leur recherche. Le Classement des établissements est destiné à satisfaire une demande notamment celle de parents d'élèves. Nous tenons à témoigner notre sincère gratitude aux autorités ministérielles, rectorales, académiques et à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette session du Baccalauréat. Vos critiques et suggestions sont toujours les bienvenues et nous aident -
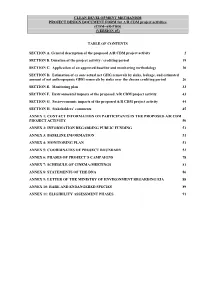
Cdm-Ar-Pdd) (Version 05)
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM for A/R CDM project activities (CDM-AR-PDD) (VERSION 05) TABLE OF CONTENTS SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity 2 SECTION B. Duration of the project activity / crediting period 19 SECTION C. Application of an approved baseline and monitoring methodology 20 SECTION D. Estimation of ex ante actual net GHG removals by sinks, leakage, and estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen crediting period 26 SECTION E. Monitoring plan 33 SECTION F. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity 43 SECTION G. Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity 44 SECTION H. Stakeholders’ comments 45 ANNEX 1: CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT ACTIVITY 50 ANNEX 2: INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 51 ANNEX 3: BASELINE INFORMATION 51 ANNEX 4: MONITORING PLAN 51 ANNEX 5: COORDINATES OF PROJECT BOUNDARY 52 ANNEX 6: PHASES OF PROJECT´S CAMPAIGNS 78 ANNEX 7: SCHEDULE OF CINEMA-MEETINGS 81 ANNEX 8: STATEMENTS OF THE DNA 86 ANNEX 9: LETTER OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT REGARDING EIA 88 ANNEX 10: RARE AND ENDANGERED SPECIES 89 ANNEX 11: ELIGIBILITY ASSESSMENT PHASES 91 SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity A.1. Title of the proposed A/R CDM project activity: >> Title: Oceanium mangrove restoration project Version of the document: 01 Date of the document: November 10 2010. A.2. Description of the proposed A/R CDM project activity: >> The proposed A/R CDM project activity plans to establish 1700 ha of mangrove plantations on currently degraded wetlands in the Sine Saloum and Casamance deltas, Senegal. -

Alice Joyce Hamer a Dissertation Submitted in Partial Fulfullment of the Requirements for the Degre
TRADITION AND CHANGE: A SOCIAL HISTORY OF DIOLA WOMEN (SOUTHWEST SENEGAL) IN THE TWENTIETH CENTURY by Alice Joyce Hamer A dissertation submitted in partial fulfullment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in The University of Michigan c'7 1983 Doctoral Committee: Professor Louise A. Tilly, Co-chair Professor Godfrey N. Uzoigwe, Co-Chair -Assistant Professor Hemalata Dandekar Professor Thomas Holt women in Dnv10rnlomt .... f.-0 1-; .- i i+, on . S•, -.----------------- ---------------------- ---- WOMEN'S STUDIES PROGRAM THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 354 LORCH HALL ANN ARB R, MICHIGAN 48109 (313) 763-2047 August 31, 1983 Ms. Debbie Purcell Office of Women in Development Room 3534 New State Agency of International Development Washington, D.C. 20523 Dear Ms. Purcell, Yesterday I mailed a copy of my dissertation to you, and later realized that I neglected changirg the pages where the maps should be located. The copy in which you are hopefully in receipt was run off by a computer, which places a blank page in where maps belong to hold their place. I am enclosing the maps so that you can insert them. My apologies for any inconvenience that this may have caused' you. Sincerely, 1 i(L 11. Alice Hamer To my sister Faye, and to my mother and father who bore her ii ACKNOWLEDGMENTS Numerous people in both Africa and America were instrumental in making this dissertation possible. Among them were those in Senegal who helped to make my experience in Senegal an especially rich one. I cannot emphasize enough my gratitude to Professor Lucie Colvin who honored me by making me a part of her distinguished research team that studied migration in the Senegambia. -
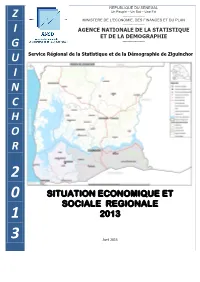
Z I G U I N C H
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Z ------------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ------------------ I AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE G ------------------ Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Ziguinchor U I N C H O R 2 0 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE REGIONALE 1 2013 3 Avril 2015 AVANT PROPOS Dans la réalisation de ses missions de coordination technique des activités du système statistique national et de production et diffusion des données statistiques, l’ANSD réalise régulièrement des publications parmi lesquelles la « Situation Economique et Sociale du Sénégal » et les « Situations Economiques et Sociales » régionales. Les Situations Economiques et Sociales (SES) régionales, élaborées chaque année par les Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD) pour l’année précédente, figurent en bonne place parmi les produits phares de l’ANSD. Elles constituent d’importants instruments de planification du développement économique et social régional et des outils d’aide à la décision aux niveaux régional et local. L’exercice d’analyse de la conjoncture qu’elles constituent n’a évidemment pas pour ambition l’exhaustivité, mais la présentation de manière synthétique des modes de fonctionnement essentiels de l’économie régionale. Chaque SES régionale essaie d’embrasser la quasi-totalité des secteurs de l’activité économique et sociale. Elle met surtout en relief l’information quantitative et tente, par des analyses sommaires, de décrire la situation de chaque secteur d’activité dans la région concernée. De 2006 à 2013, la publication des SES a été précédée d’une validation régionale au cours de réunions des Comités Régionaux de Développement (CRD). -

FY20 – Work Plan
FY20 – Work Plan Work Plan Year 3 Feed the Future Senegal Kawolor Originally Submitted September 2, 2019 Revised Submission November 4, 2019 Final Revision 30 January 2020 Cooperative Agreement No. 72068518CA00001 The National Cooperative Business Association • CLUSA International About Feed the Future Senegal Kawolor Feed the Future Sénégal Kawolor is a five-year USAID-funded cooperative agreement to increase the consumption of nutritious and safe diets within the Feed the Future Zone of Influence in Senegal. The National Cooperative Business Association, CLUSA International (NCBA CLUSA) and its partners, Dimagi Inc., Helen Keller International (HKI), JSI Research and Training Institute (JSI), and Sheladia Associates, Inc., are implementing the five-year cooperative agreement from November 2, 2017 through November 1, 2022. Disclaimer This report is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) under the terms of the Cooperative Agreement 72068518CA00001, managed by NCBA CLUSA. The contents are the responsibility of NCBA CLUSA and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. NCBA CLUSA 1775 Eye Street NW 8th Floor Washington, DC 20006 [email protected] www.ncbaclusa.coop Feed the Future Senegal Kawolor, FY20 Work Plan 2 List of Acronyms AIP Annual Investment Plans AMELP Activity Monitoring, Evaluation and Learning Plan CSP CultiVert Solution Provider CDP Communal Development Plans CLA Collaborating Learning and Adapting -

Mémoire De Confirmation
REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE INSTITUT SÉNÉGALAIS DE RECHFRCHES AGRICOLES MÉMOIRE DE CONFIRMATION présentépar Dr Cheikh Oumar BA Sociologue sousla Direction du Professeur Abdoulaye Bara DIOP Sur Migrations et organisations paysannes en Basse Casamance. Une première caractérisation à partir de l’exemple du village de Sue1 (Département de Bignona). Juin 1997 SOMMAIRE PAGE DE GARDE . .. .. .. .. .. .. .. SOMMAIRE ............................................................................................................................. 2 L., LISTE DES SIGLES................................................................................................................. 3:t: 5& AVANT-PROPOS.................................................................................................................... s 1. INTRODUCTION ................................................................................................................ S#i f 2. PREMIERE PARTIE : PRESENTATIONDE LA ZONE D’ETUDE ........................... 12 2.1. Organisationsociale Diola . .. .. .. .. .. .. .. ..*.................................. 13 2.2. Suel,un village typiquedu phénomènede mandinguisation.,..... .. .. ,.. ,, . .. .., 16 3. DEUXIEME PARTIE : CADRE THEORIQUE . .. ..*...............*....................................*... 19 3.1. État de la question.. .. ..f........... 19 3.2. Problématique. ..<....................................................*..............................,...,.*...........*....27 3.3. Méthodologie. ..~.............................................................f.................................. -

Liste Lettre Commentaires Incomplete
LISTE LETTRE COMMENTAIRES INCOMPLETE N° NUMERO PRENOM NOM DATE NAISSANCELIEU NAISSANCE OBSERVATION 1 1 LC001009 Chérif Sidaty DIOP 22/05/1993 Dakar INCOMPLET 2 2 LC001024 Malick NIANE 25/06/1994 Gandiaye INCOMPLET 3 3 LC001029 FARMA FALL 16/08/1999 Parcelles Assainies U12 INCOMPLET 4 4 LC001039 Adama NDIAYE 13/04/1997 Saldé INCOMPLET 5 5 LC001060 Amadou DIA 23/10/1994 Thiaroye sur mer INCOMPLET 6 6 LC001070 Mouhamadou BARRY 24/08/1997 Dakar INCOMPLET 7 7 LC001090 Ibrahima KA 03/03/1996 Dahra INCOMPLET 8 8 LC001095 Ousseynou SENE 01/01/2000 Kaolack INCOMPLET 9 9 LC001099 Papa Masow TINE 27/05/2000 Gatte Gallo INCOMPLET 10 10 LC001105 NGAGNE FAYE 20/09/2000 Dakar INCOMPLET 11 11 LC001144 Adama SADIO 07/06/1996 Dakar INCOMPLET 12 12 LC001156 Arfang DIEDHIOU 05/04/1996 MLOMP INCOMPLET 13 13 LC001160 Modoulaye GNING 03/06/1994 Keur matouré e INCOMPLET 14 14 LC001175 Ablaye DABO 17/04/1998 Kaolack INCOMPLET 15 15 LC001176 Ibrahima KA 04/12/1999 Diamaguene Sicap Mbao INCOMPLET 16 16 LC001183 Mansour CISSE 11/03/1994 Rufisque INCOMPLET 17 17 LC001186 Ngouda BOB 14/01/1996 Ngothie INCOMPLET 18 18 LC001193 Abdoukhadre SENE 28/10/1999 Mbour INCOMPLET 19 19 LC001195 Jean paul NDIONE 07/04/1998 fandene ndiour INCOMPLET 20 20 LC001201 Abdou NDOUR 10/10/1996 Niodior INCOMPLET 21 21 LC001202 Yves Guillaume Djibosso DIEDHIOU 19/11/2020 Dakar INCOMPLET 22 22 LC001203 Mamour DRAME 06/10/1995 Guerane Goumack INCOMPLET 23 23 LC001207 Libasse MBAYE 10/07/1998 Dakar INCOMPLET 24 24 LC001211 Modou GUEYE 26/11/1999 Fordiokh INCOMPLET 25 25 LC001224 Bernard -

Communaute Rurale De Mangagoulack
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un but - Une foi REGION DE ZIGUINCHOR DEPARTEMENT DE BIGNONA ARRONDISSEMENT DE TENDOUCK COMMUNAUTE RURALE DE MANGAGOULACK Janvier 2010 Réalisé par le Goupe OCC avec l’appui financier du PNDL Groupe OCC SARL E-mail [email protected] lot n° 323, Tiléne Kadior,sur Boulevard 54 m BP: 989 Ziguinchor Ziguinchor Téléphone 77 569 96 80 Table des matières Sigles et Acronymes ...............................................................................................................3 Introduction ............................................................................................................................4 I. Approche methodologique ...............................................................................................6 1.1. La demarche et les outils utilises ..............................................................................6 1.2. Les principales difficultes rencontrees dans la conduite du processus...................... 10 II. Presentation de la cr ................................................................................................... 11 2.1. Localisation geographique ...................................................................................... 11 2.2. Milieu physique ...................................................................................................... 11 2.3. Milieu humain ........................................................................................................ 11 2.4. Zonage de la communaute rurale ........................................................................... -

Casamance, 1885-2014
MAPPING A NATION: SPACE, PLACE AND CULTURE IN THE CASAMANCE, 1885-2014 A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Mark William Deets August 2017 © 2017 Mark William Deets MAPPING A NATION: SPACE, PLACE AND CULTURE IN THE CASAMANCE, 1885-2014 Mark William Deets Cornell University This dissertation examines the interplay between impersonal, supposedly objective “space” and personal, familiar “place” in Senegal’s southern Casamance region since the start of the colonial era to determine the ways separatists tried to ascribe Casamançais identity to five social spaces as spatial icons of the nation. I devote a chapter to each of these five spaces, crucial to the separatist identity leading to the 1982 start of the Casamance conflict. Separatists tried to “discursively map” the nation in opposition to Senegal through these spatial icons, but ordinary Casamançais refused to imagine the Casamance in the same way as the separatists. While some corroborated the separatist imagining through these spaces, others contested or ignored it, revealing a second layer of counter-mapping apart from that of the separatists. BIOGRAPHICAL SKETCH Mark W. Deets is a retired Marine aviator and a PhD candidate in African History at Cornell University. Deets began his doctoral studies after retiring from the Marine Corps in 2010. Before his military retirement, Deets taught History at the U.S. Naval Academy. Previous assignments include postings as the U.S. Defense and Marine Attaché to Senegal, The Gambia, Guinea-Bissau, Cape Verde, and Mauritania (2005-2007), as a White House Helicopter Aircraft Commander (HAC) and UH-1N “Huey” Operational Test Director with Marine Helicopter Squadron One (1999-2002), and as Assistant Operations Officer and UH-1N Weapons and Tactics Instructor with the “Stingers” of Marine Light Attack Helicopter Squadron 267 (1993-1998).