La République Des Sables. Anthropologie D'une Révolution
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
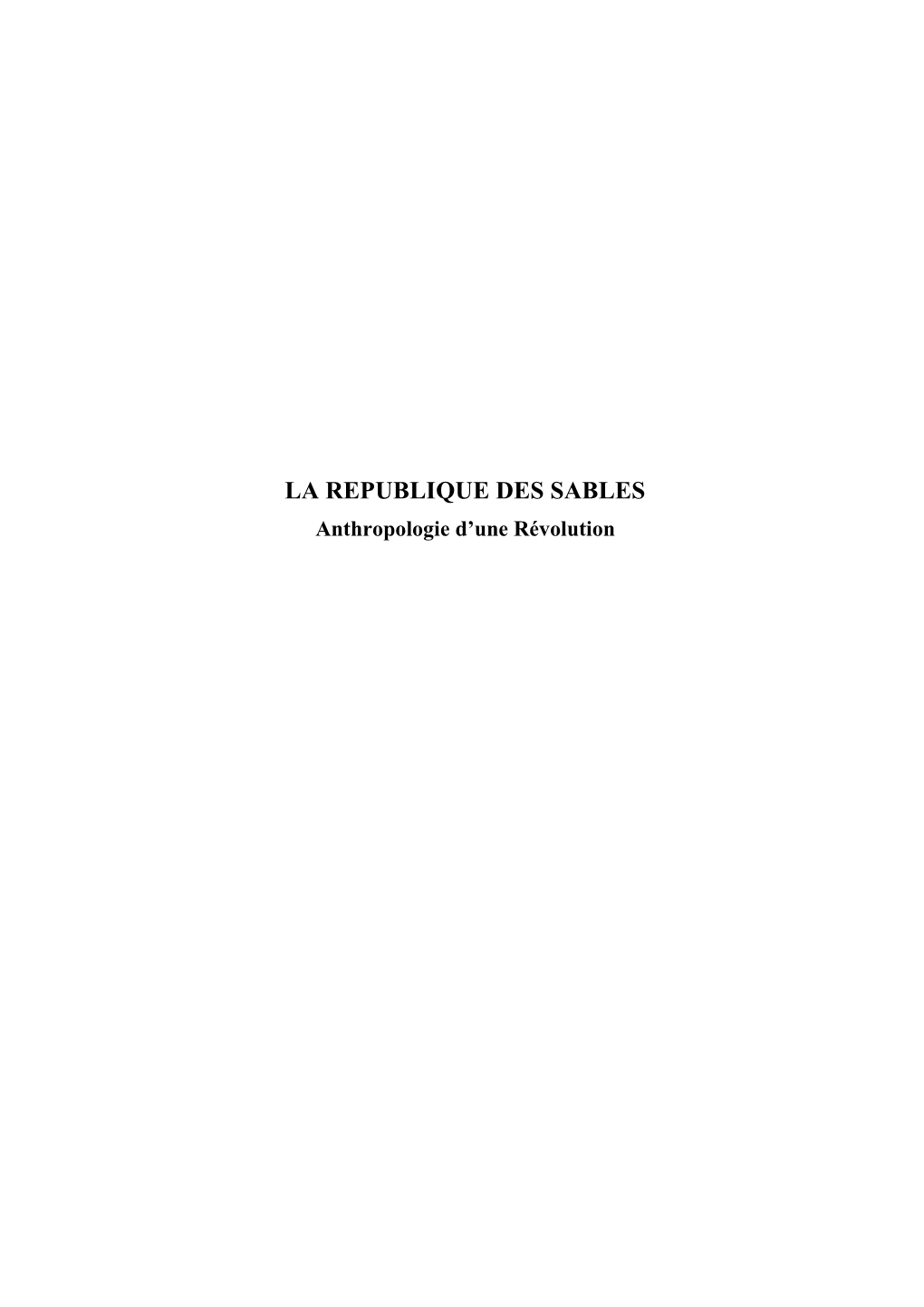
Load more
Recommended publications
-

The Lost & Found Children of Abraham in Africa and The
SANKORE' Institute of Islamic - African Studies International The Lost & Found Children of Abraham In Africa and the American Diaspora The Saga of the Turudbe’ Fulbe’ & Their Historical Continuity Through Identity Construction in the Quest for Self-Determination by Abu Alfa Umar MUHAMMAD SHAREEF bin Farid 0 Copyright/2004- Muhammad Shareef SANKORE' Institute of Islamic - African Studies International www.sankore.org/www,siiasi.org All rights reserved Cover design and all maps and illustrations done by Muhammad Shareef 1 SANKORE' Institute of Islamic - African Studies International www.sankore.org/ www.siiasi.org ﺑِ ﺴْ ﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ ا ﻟ ﺮﱠ ﺣْ ﻤَ ﻦِ ا ﻟ ﺮّ ﺣِ ﻴ ﻢِ وَﺻَﻠّﻰ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﻲ ﺳَﻴﱢﺪِﻧَﺎ ﻣُ ﺤَ ﻤﱠ ﺪٍ وﻋَﻠَﻰ ﺁ ﻟِ ﻪِ وَ ﺻَ ﺤْ ﺒِ ﻪِ وَ ﺳَ ﻠﱠ ﻢَ ﺗَ ﺴْ ﻠِ ﻴ ﻤ ﺎً The Turudbe’ Fulbe’: the Lost Children of Abraham The Persistence of Historical Continuity Through Identity Construction in the Quest for Self-Determination 1. Abstract 2. Introduction 3. The Origin of the Turudbe’ Fulbe’ 4. Social Stratification of the Turudbe’ Fulbe’ 5. The Turudbe’ and the Diffusion of Islam in Western Bilad’’s-Sudan 6. Uthman Dan Fuduye’ and the Persistence of Turudbe’ Historical Consciousness 7. The Asabiya (Solidarity) of the Turudbe’ and the Philosophy of History 8. The Persistence of Turudbe’ Identity Construct in the Diaspora 9. The ‘Lost and Found’ Turudbe’ Fulbe Children of Abraham: The Ordeal of Slavery and the Promise of Redemption 10. Conclusion 11. Appendix 1 The `Ida`u an-Nusuukh of Abdullahi Dan Fuduye’ 12. Appendix 2 The Kitaab an-Nasab of Abdullahi Dan Fuduye’ 13. -

Disputed Desert Afrika-Studiecentrum Series
Disputed Desert Afrika-Studiecentrum Series Editorial Board Dr Piet Konings (African Studies Centre, Leiden) Dr Paul Mathieu (FAO-SDAA, Rome) Prof. Deborah Posel (University of Witwatersrand, Johannesburg) Prof. Nicolas van de Walle (Cornell University, USA) Dr Ruth Watson (Newnham College, Cambridge) VOLUME 19 Disputed Desert Decolonisation, Competing Nationalisms and Tuareg Rebellions in Northern Mali By Baz Lecocq LEIDEN • BOSTON 2010 Cover picture: painting of Tamasheq rebels and their car, painted by a Tamasheq boy during the mid-1990s in one of the refugee camps across the Malian borders. These paintings were sold in France by private NGOs to support the refugees. Epigraphy: Terry Pratchett, Soul Music. Corgi Books, 1995, ISBN 0 552 14029 5, pp. 108–109. This book is printed on acid-free paper. ISSN 1570-9310 ISBN 978 90 04 139831 Copyright 2010 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Hotei Publishing, IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Brill has made all reasonable efforts to trace all right holders to any copyrighted material used in this work. In cases where these efforts have not been successful the publisher welcomes communications from copyright holders, so that the appropriate acknowledgements can be made in future editions, and to settle other permission matters. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill NV provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. -

Tekna Berbers in Morocco
www.globalprayerdigest.org GlobalDecember 2019 • Frontier Ventures •Prayer 38:12 Digest The Birth Place of Christ, But Few Will Celebrate His Birth 4—North Africa: Where the Berber and Arab Worlds Blend 7—The Fall of a Dictator Spells a Rise of Violence 22—Urdus: A People Group that is Not a People Group 23—You Can Take the Bedouin Out of the Desert, but … December 2019 Editorial EDITOR-IN-CHIEF Feature of the Month Keith Carey For comments on content call 626-398-2241 or email [email protected] ASSISTANT EDITOR Dear Praying Friends, Paula Fern Pray For Merry Christmas! WRITERS Patricia Depew Karen Hightower This month we will pray for the large, highly unreached Wesley Kawato A Disciple-Making Movement Among Ben Klett Frontier People Groups (FPGs) in the Middle East. They David Kugel will be celebrating Christmas in Bethlehem, and a few other Christopher Lane Every Frontier People Group in the Ted Proffitt places where Arabs live, but most will treat December 25 Cory Raynham like any other day. It seems ironic that in the land of Christ’s Lydia Reynolds Middle East Jean Smith birth, his birth is only celebrated by a few. Allan Starling Chun Mei Wilson Almost all the others are Sunni Muslim, but that is only a John Ytreus part of the story. Kurds and Berbers are trying to maintain PRAYING THE SCRIPTURES their identity among the dominant Arabs, while Bedouin Keith Carey tribes live their lives much like Abraham did thousands of CUSTOMER SERVICE years ago. Who will take Christ to these people? Few if any Lois Carey Lauri Rosema have tried it to this day. -

La Mauritanie Offshore
Politique africaine n° 114 - juin 2009 87 Armelle Choplin et Jérôme Lombard La « Mauritanie offshore ». Extraversion économique, État et sphères dirigeantes Le processus d’extraversion est au cœur du fonctionne- ment de l’État mauritanien. Dans la longue durée, il a produit une élite politico-commerciale qui a su valoriser © Karthala | Téléchargé le 17/12/2020 sur www.cairn.info via Institut de Recherche pour Développement (IP: 91.203.32.150) les richesses minières et halieutiques du pays. Avec la mise en exploitation de nouvelles ressources (pétrole et or), l’extraversion s’est récemment renforcée. Les connexions internationales se multiplient, en particulier avec les pays du Golfe, et favorisent des hommes d’affaires puissants et bien insérés dans les premiers cercles du pouvoir. La « Mauritanie offshore » prime désormais sur l’intérieur du pays et sur la société, desquels les élites se déconnectent progressivement. Sur le site Internet de la campagne de Mohamed Ould Abdel Aziz, un des candidats favoris à l’élection présidentielle de juillet 2009, une vidéo intitulée « Le changement constructif » montre l’édification d’une cité moderne en plein milieu du désert 1. Sous le regard bienveillant du candidat, tours d’aciers démesurées, canalisations, autoroutes, électricité, surgissent des dunes verdoyantes. Dubaï est clairement pris comme modèle. Se profile ainsi la promesse d’une Mauritanie semblable aux émirats du Golfe, fondant sa future prospérité sur des activités économiques extraverties, notamment l’exploi- tation de ressources pétrolières récemment découvertes. À l’image de la plupart des pays africains, la Mauritanie est engagée, sur la longue durée, dans un processus d’extraversion tel que mis en évidence par les réflexions de Cooper et de Bayart qui ont montré que le rapport à l’extérieur était une constante dans l’histoire des sociétés africaines, un élément 1. -

L 'Artisanat Berbère: Permanence Des Matériaux, Symbolisme Des Formes. Etude Historique Et Anthropologique, De L’Antiquité À Nos Jours
Université Paris Ouest-Nanterre La Défense École doctorale Mieux, cultures et sociétés du passé et du présent _________________ Thèse en vue de l’obtention du Doctorat de l’Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense Présentée par Loubna TRIKI Sous la direction du Professeur Charles Guittard Discipline : archéologie ______________________________________________________________________________ L'artisanat berbère : permanence des matériaux, symbolisme des formes. Étude historique et anthropologique, de l'antiquité à nos jours ______________________________________________________________________________ Année universitaire 2013-2014 Dédicace « Je dédie ce travail à ma mère, sous les pieds de laquelle se trouve mon Paradis et à mon père qui n’a eu de cesse de m’enseigner les innombrables vertus du savoir : à la Résurrection, ils auront ce privilège de porter des couronnes lumineuses. » Remerciements Je rends grâce à Dieu l’Omniscient qui m’a prêté vie et concédé une infime partie de son incommensurable savoir Je tiens à remercier mon directeur Charles Guittard d’avoir accepté de diriger cette thèse, et de m’avoir orienté sur ce thème. Tous les mérites reviennent à mes illustres professeurs, que je hisse sur les plus hauts piédestaux et auxquels je témoigne mon profond respect à Ms Mansouri Saddek et Ms Sallah. Toute ma gratitude à mes frères surtout Samir, mon fiancé Zouhir pour son aide et son soutient, mes sœurs surtout Habiba, mes amies surtout Samia. Et tous mes proches qui ont toujours su me témoigner leur sympathie et leur assistance dans le cadre de mes recherches d’études. Résumé La culture berbère trouve ses origines dans la lointaine protohistorique, elle se voit dans le lien indéfectible à la terre, le sens de la communauté, le rapport au sacré, et l’hospitalité.L’artisanat est aussi l’un des modes d’expression de cette culture traditionnelle.cet art authentique a longtemps été souvent méprisé tout au moins minorisé, devant une industrialisation très avancée. -

African Least-Reached** People Groups - Sorted by Country Names in English Data Source: Joshua Project, with MANI Edits
African Least-Reached** People Groups - Sorted by Country Names in English Data Source: Joshua Project, with MANI edits. % Evangelicals % Evangelicals Primary Language / % Primary Language / % People Name Dialect Population Adherents People Name Dialect Population Adherents Algeria (35 LR People Groups) Burkina Faso (28 LR People Groups) Algerian, Arabic-speaking Arabic, Algerian Spoken 24,161,000 0.19% Dogose, Doghosie Dogose 33,140 1.00% Arab, Iraqi Arabic, Mesopotamian Spoken 3,630 0.70% Dogoso Dogoso 11,710 1.00% Arab, Moroccan Arabic, Moroccan Spoken 144,000 0.15% Dzuun, Samogo Dzuungoo 19,120 Bedouin, Chaamba Arabic, Algerian Spoken 110,000 0.00% Fulani, Gorgal 5,850 0.10% Bedouin, Dui-Menia Arabic, Algerian Spoken 65,800 0.00% Fulani, Gurmanche 877,540 0.20% Bedouin, Laguat Arabic, Algerian Spoken 65,800 0.00% Fulani, Jelgooji 292,510 0.07% Bedouin, Nail Arabic, Algerian Spoken 30,700 0.00% Fulani, Maasina Fulfulde, Maasina 7,070 0.15% Bedouin, Ruarha Arabic, Algerian Spoken 65,800 0.00% Hausa Hausa 2,230 0.10% Bedouin, Sidi Arabic, Algerian Spoken 110,000 0.00% Jotoni, Jowulu Jowulu 1,130 1.60% Bedouin, Suafa Arabic, Algerian Spoken 65,800 0.00% Jula, Dyula Jula 273,830 0.02% Bedouin, Tajakant Arabic, Algerian Spoken 1,416,000 0.00% Karaboro, Western Karaboro, Western 49,150 2.00% Bedouin, Ziban Arabic, Algerian Spoken 219,000 0.00% Khe Khe 2,580 1.50% Belbali Korandje 3,130 0.00% Lobi, Lobiri Lobi 473,730 2.00% Berber, Figig Tamazight, Central Atlas 65,800 0.00% Maninka, Malinke Maninkakan, Eastern 121,700 1.20% Berber, Imazighen -

FNAS133656 Queries Ann Mcdougall
FNAS133656 Queries Ann Mcdougall Q1 Any update on publication details? FNAS133656 Techset Composition Ltd, Salisbury, U.K. 10/28/2005 Conceptualising the Sahara: the World of Nineteenth-Century Beyrouk Commerce ANN MCDOUGALL This article derives from work done several years ago in the context of a grant project on ‘A Family Affair’ – basically a study of how Saharan ‘families’, broadly defined, organized their interests in the trans-Saharan trade. While I have published an important piece from this project based on oral material, I have yet to exploit the micro-filmed/photocopied docu- mentation. My scanned files are now ready to work with and I want to begin. An important portion of the files relates specifically to something called the ‘Beyrouk Registers’ – a series of commercial accountings (‘registers’) revealing the interests of an important southern Moroccan family, the Beyrouk. Some have argued that these registers represent a model of the trans-Saharan trade both in terms of content (arrangement of credit, commodities, person- alities) and of organisation (networking, social categories, theories thereof). Indeed, the family itself has been credited with controlling, if not constituting, the ‘essence’ of this trade in the early-to-mid nineteenth century. I’m more skeptical of both the model and the content of the ‘registers’. My skepticism derives from my experiences in doing fieldwork in southern Morocco (specifically Goulimine, the ‘home’ of the Beyrouk), my close examination of these ‘registers’ in comparison with other source materials (notably those of Paul Pascon on the ‘House of Illigh’ – also southern Morocco) and my consideration of what I believe these registers really CAN tell us in the context of recent work on the topic of trans-Saharan trade. -

2021 Daily Prayer Guide for All Africa People
2021 Daily Prayer Guide for all Africa People Groups & Least-Reached-Unreached People Groups (LR-UPGs) Source: Joshua Project; www.joshuaproject.net To order prayer resources or for inquiries, contact email: [email protected] 2021 Daily Prayer Guide for all Africa People Groups & all LR-UPGs = Least-Reached--Unreached People Groups. 49 Africa countries & 9 islands & People Groups & LR-UPG are included. AFRICA SUMMARY: 3,713 total People Groups; 996 total Least-Reached--Unreached People Groups. Downloaded in August 2020 from www.joshuaproject.net LR-UPG defin: less than 2% Evangelical & less than 5% total Christian Frontier (FR) definition: 0% to 0.1% Christian Why pray--God loves lost: world UPGs = 7,407; Frontier = 5,042. * * * Color code: green = begin new area; blue = begin new country * * * "Prayer is not the only thing we can can do, but it is the most important thing we can do!" * * * Let's dream God's dreams, and fulfill God's visions -- God dreams of all people groups knowing & loving Him! * * * Revelation 7:9, "After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and in front of the Lamb." Why Should We Pray For Unreached People Groups? * Missions & salvation of all people is God's plan, God's will, God's heart, God's dream, Gen. 3:15! * In the Great Commissions Jesus commands us to reach all peoples in the world, Matt. 28:19-20! * People without Jesus are eternally lost, & Jesus is the only One who can save them, John 14:6! * We have been given "the ministry & message of reconciliation", in Christ, 2 Cor. -
Geografía Comercial
^BVIST^ DE GEOGRAFÍA COMERCIAL. AÑO II. MADRID 30 DE ABRIL DE 1886. NÚMS. 20 Y 21. antiguo muelle, de una extensión de 200 metros, (1) EL SUS, SEGÚN GATELL, por 8 ó 10 de anchura, y que podría fácilmente agrandarse. Estas rocas se inclinan hacia el S., y su extremidad forma al E. un ángulo entrante, en (CONCLUSIÓN.) el cual se abre una playa larga y estrecha, con fon Costas y puertos.— La costa del Sus, presenta di do de arena y guijarros. Cerca de esta playa hay versos aspectos. Desde el Tamarakt, limite N. del una motfía. ó depósito de agua, de construcción pais, bástalas cercanías de Agader-Iguir, se ex moderna, y á poca distancia del muelle, cerca del tiende una serie de playas apenas interrumpidas por mar, un pozo construido por los europeos, y lla algunas ramificaciones de las montañas' próximas. mado por los indígenas Tanut-Er-Runai (pozo del Estas ramificaciones llegan más allá de Agader; á cristiano). partir de este punto, la playa, entremezclada con El fondeadero está muy cerca de la orilla. En el algunas dunas, se prolonga hasta los alrededores color y en el movimiento de las olas se ve que, en de Aguilú. Desde Aguilú hasta el Uad-Asaka, lí el mismo sitio de las rocas, hay suficiente profundi mite meridional del Sus, y aun más allá, la costa dad para barcos de 200 toneladas. He leído más es alta, formada por escarpados y sólo presenta al tarde en un derrotero inglés, que el fondo es de 9 gunas playas de poca extensión. -

Editorial Comment Cent History
ing for Islam a significantly magnifi- Editorial Comment cent history. When the Muslims took over Egypt Ralph D. Winter they ended a war between two kinds of Christians and declared toleration of to the supreme being religion. of the Bible. Today 60 When the Muslims took over Jeru- Whether it is about million Christians still salem they ruled the city with equa- nimity, assigning equal space inside Islam or secularized have the word Allah in their Bibles for the the walled city for Jews, Christians and public school books, One we, in English, call themselves. This lasted for 1300 years. God. Today, 30 million But, suddenly when Gutenberg getting the right things unleashed the Bible to run strong in the to the right people is Christians in Indonesia attract Muslims to a societal bloodstream of these northern very crucial. better understanding of savages (but not within Islam), what the Allah in their Chris- happened? tian Bibles and New One result was the sudden bloom- Testaments and Gospel portions. Where ing of science, from astronomy to biol- Best Mission Book Yet did Mohammed get the word “Allah”? ogy. Another was the industrial rev- olution building on the mass market n the bulletin you hold in your From the Christians of his day! newly created by Wesley’s evange- hands we present one of the chap- lism—namely, the unprecedented bond ters of perhaps the best book Christian Jihads? of trust between newly-honest people Iintroducing missions in the past However, a flood of letters pro and from city to city, without which mass few years. -

2021 Daily Prayer Guide for All People Groups & LR-Upgs of Eurasia
2021 Daily Prayer Guide for all People Groups & LR-Unreached People Groups of Eurasia AGWM ed. Source: Joshua Project data, www.joshuaproject.net I give credit & thanks to Asia Harvest & Create International for permission to use their people group photos. 2021 Daily Prayer Guide for all People Groups & LR-UPGs of Eurasia (India & South Asia = separate DPG) SUMMARY: 2,061 total People Groups; 1,462 LR-UPG (this DPG) LR-UPG = 2% or less Evangelical & 5% or less Christian Frontier (FR) definition: 0% to 0.1% Christian Why pray--God loves lost: world UPGs = 7,407; Frontier = 5,042. Color code: green = begin new area; blue = begin new country Downloaded from www.joshuaproject.net September 2020 "Prayer is not the only thing we can can do, but it is the most important thing we can do!" Luke 10:2, Jesus told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Let's dream God's dreams, and fulfill God's visions -- God dreams of all people groups knowing & loving Him! Revelation 7:9, "After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and in front of the Lamb." Why Should We Pray For Unreached People Groups? * Missions & salvation of all people is God's plan, God's will, God's heart, God's dream, Gen. 3:15! * In the Great Commissions Jesus commands us to reach all peoples in the world, Matt. -

The Long-Run Effects of the Scramble for Africa∗
The Long-Run Effects of the Scramble for Africa∗ Stelios Michalopoulos†, Elias Papaioannou‡ January 2011 Abstract We examine the economic consequences of the partitioning of Africa among European powers in the late 19th century; a process historically known as the scramble for Africa. First, using information on the spatial distribution of African ethnicities before colonization we establish that border drawing was largely arbitrary. Apart from the land mass and water area of an ethnicity’s historical homeland, no other geographic, ecological, historical, and ethnic-specific trait predicts which ethnic groups have been partitioned by the national borders. Second, employing data on the location of civil conflicts after independence we show that compared to ethnicities that have not been impacted by the border design, partitioned ethnic groups have suffered significantly more, longer, and more devastating civil wars. Third, we find that economic development —as reflected by satellite data on light density at night- is systematically lower in the historical homeland of partitioned ethnicities. These results are robust to a rich set of controls at a fine level and the inclusion of country and ethnic-family fixed-effects. Our regressions thus identify a sizable causal negative effect of the scramble for Africa on comparative regional development. Keywords: Africa, Borders, Ethnicities, Conflict, Development. JEL classification Numbers: O10, O40, O43, N17, D74, Z10. ∗We thank Gregorios Siourounis, Heiwai Tang and participants at the Econometric Society Meetings in Denver for useful comments. All errors are our sole responsibility. †Tufts University, Braker Hall, 8 Upper Campus Rd., Medford, MA 02155. E-mail: ste- [email protected].