COMMUNE DU PLANAY Département De La Savoie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
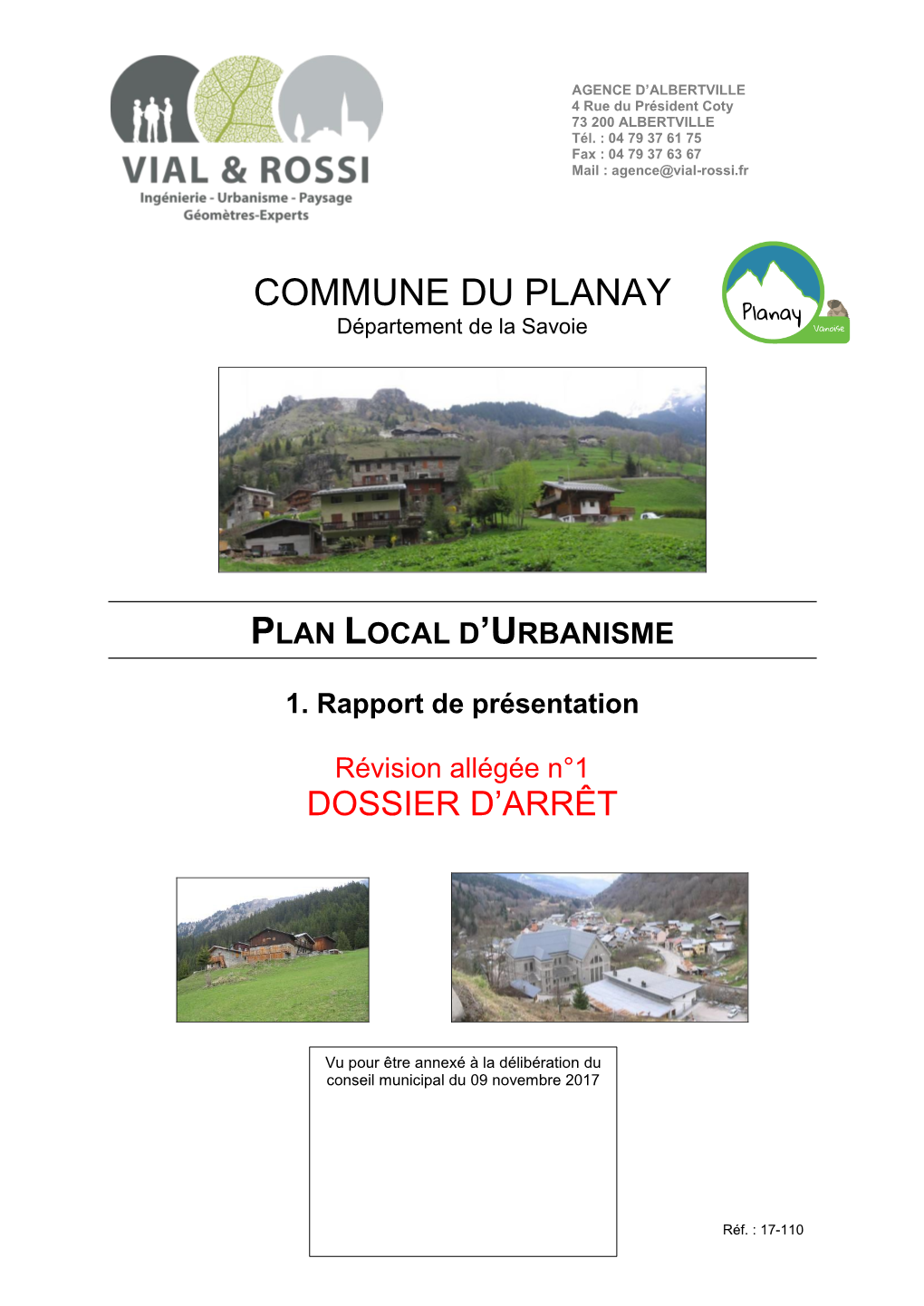
Load more
Recommended publications
-

Moûtiers Doucy Station Valmorel
MOÛTIERS T1 DOUCY STATION T2 VALMOREL Moûtiers Gare routière – SNCF La Région Du 6 juillet 2019 vous transporte au 31 août 2019 T1 Saint Oyen T2 Aigueblanche Centre Centre T1 Doucy (Ecole) T2 Le Bois Saint Hélène / Les Cours T1 Doucy-Station Centre Le Sappey / Les Carlines Oice du tourisme T2 Aigueblanche Eau Rousse Crey / Les Emptes T2 Les Avanchers Le Fey Dessous Chef lieu Le Pré T2 Valmorel Bourg Morel Crève Cœur TARIFS Guichet En ligne * Aller simple (AS) adulte 13,40€ 13,40€ Aller simple 11,40€ 10,00€ moins de 26 ans et saisonniers Aller-retour (AR) adulte 24,00€ 22,70€ Aller-retour 22,70€ 20,00€ moins de 26 ans / saisonniers Abonnement 67,00€ 67,00€ *Frais de réservation : 1,00€ (+1,90 € en cas d’envoi postal) Tourisme © Christian Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : vente-bellesavoieexpress.fr DOUCY STATION MOÛTIERS DOUCY STATION T1 VALMOREL T1 VALMOREL MOÛTIERS N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous T2 T2 Les jours de circulation des services sont abrégés comme suit : LUN : lundi Sam Sam Sam Sam Sam Dim Sam Sam Sam SamMAR : mardiSam, Dim 1 1 1 1 1 2 1 1 1 MER 1 : mercredi 1 2 JEU : jeudi T1 DOUCY STATION MOÛTIERS VEN : vendredi T1 MOÛTIERS DOUCY STATION SAM : samedi DIM : dimanche MOÛTIERS DOUCY Station 9.45 11.40 15.15 - - - 13.30 15.50 18.30 - - - Gare routière Mobilité DOUCY Bourg 10.00 11.55 15.30 La- ligne est accessible- aux- SAINT-OYEN 13.40 16.00 18.40 - - - personnes à mobilité réduite SAINT-OYEN 10.10 12.05 15.40 le samedi- uniquement.- - Réservation obligatoire le jeudi DOUCY Bourg 13.50 16.10 18.50 - - - avant 17h au 09 70 83 90 73 MOÛTIERS 10.20 12.15 15.50 - - - DOUCY Station 14.05 16.25 19.05 - - - Gare routière Attention Les horaires sont succeptibles T2 MOÛTIERS VALMOREL T2 VALMOREL MOÛTIERS d’être modifiés, pensez à vérifier les informations avant MOÛTIERS VALMOREL - - - 9.45votre voyage.15.20 Les horaires16.10 sont - - - 9.00 14.30 15.25 accesssibles dans la limite Gare routière des places disponibles. -
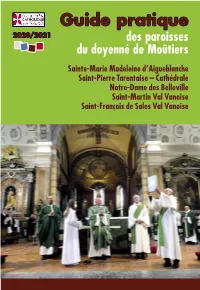
Guide Pratique
Guide pratique 2020/2021 des paroisses du doyenné de Moûtiers Sainte-Marie Madeleine d’Aigueblanche Saint-Pierre Tarentaise – Cathédrale Notre-Dame des Belleville Saint-Martin Val Vanoise Saint-François de Sales Val Vanoise Guide pratique du doyenné de Moûtiers CE GUIDE A ÉTÉ CONÇU ET RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE COMMUNICATION DES PAROISSES DU DOYENNÉ EN COLLABORATION AVEC Bayard Service Tél. 04 79 26 28 21 RÉALISATION TECHNIQUE Bayard Service Centre-Alpes - Grand Sud Savoie Technolac - Allée Lac de Garde CS 20308 - 73 377 Le Bourget-du-Lac Cedex [email protected] - www.bayard-service.com CONCEPTION GRAPHIQUE : KARINE MOULIN - ASSISTANT D’ÉDITION ET MISE EN PAGE : FRANCIS PONCET IMPRIMERIE Gutenberg - 74960 Meythet - Dépôt légal : à parution - CREDIT PHOTOS : © Paroisse de Moûtiers , diocèses de Savoie sauf mention contraire Éditorial Découvrir par soi-même des lieux moins connus... Avant de partir en vacances, j’aime me plonger dans des guides de la région où je me rends et aussi découvrir des sites internet qui sont généralement bien faits. Mon objectif est de ne pas rater des lieux et des événements importants. Sur place, j’ai aussi la possibilité de flâner et de découvrir par moi-même des lieux moins connus. Nous vous proposons avec ce guide paroissial et aussi avec nos sites internet actuellement en construction de pouvoir voyager avec nous et de vivre une belle aventure. L’Église a pour vocation de permettre de découvrir le Christ Vivant, Ressuscité, chemin qui conduit à Dieu. Vous qui vous repérez facilement dans nos cinq paroisses, vous trouverez des renseignements mis à jour. -

Foncier Agricole
SCOT TARENTAISE Schéma de COhérence Territoriale VANOISE TARENTAISE Assemblée du Pays UNE VALLÉE DURABLE POUR TOUS SCoT Tarentaise Diagnostic foncier agricole Document contributif pour le SCoT – juillet 2013 – n° 3 2 Contexte du diagnostic agricole Les particularités géographiques de la L’objectif du diagnostic foncier agricole vallée de la Tarentaise, notamment l’alti- est de répondre à plusieurs questions : tude et la topographie, structurent le fon- cier agricole. — Quelle est la situation de l’agriculture en Tarentaise aujourd’hui ? L’espace est extrêmement contraint : 3 % — Quels sont ses atouts et ses fai- du territoire est à la fois à une altitude in- blesses ? férieure à 1 500 m et présente une pente — Quels sont ses besoins en foncier ? modérée (moins de 25 %) ! Ces 3 % sont — Où est localisé le foncier stratégique déjà fortement occupés par les infrastruc- pour l’agriculture ? tures et l’urbanisation et sont convoités — Peut-on mieux valoriser certains sec- pour de multiples usages dont l’activité teurs ? agricole. L’agriculture couvre aujourd’hui 40 % du territoire. Elle est encore bien présente et structurée, mais fortement dépendante du foncier. Elle est, par ailleurs, une com- posante essentielle du cadre de vie pour les habitants et touristes. Vallée des Glaciers – Bourg-Saint-Maurice Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), en tant qu’outil de planification, devra se positionner sur l’usage du fon- cier. Pour cela, une bonne connaissance de l’activité agricole et des enjeux liés au foncier est indispensable. L’étude sur le foncier agricole est une des approches thématiques réalisée préala- blement à l’élaboration du Projet d’Amé- nagement et de Développement Durable du SCoT. -

Annexe 2 Listes Communes Isolées AAC Octobre 2019
ANNEXE 2 Listes communes de montagne hors unité urbaine • AIGUEBELETTE-LE-LAC (73610) • AIME-LA –PLAGNE (73210) • AILLON-LE-JEUNE (73340) • AILLON-LE-VIEUX (73340) • AITON (73220) • ALBIEZ-LE-JEUNE (73300) • ALBIEZ-MONTROND (73300) • ALLONDAZ (73200) • APREMONT (73190) • ARGENTINE (73220) • ARITH (73340) • ARVILLARD (73110) • ATTIGNAT-ONCIN (73610) • AUSSOIS (73500) • AVRESSIEUX (73240) • AVRIEUX (73500) • AYN (73470) • BEAUFORT (73270) • BELLECOMBE-EN-BAUGES (73340) • BELMONT-TRAMONET (73330) • BESSANS (73480) • BILLIEME (73170) • BONNEVAL-SUR-ARC (73480) • BONVILLARD (73460) • BONVILLARET (73220) • BOURDEAU (73370) • BOURGET-EN-HUILE (73110) • BOZEL (73350) • BRIDES-LES-BAINS (73570) • CEVINS (73730) • CHAMOUX-SUR-GELON (73390) • CHAMP-LAURENT (73390) • CHAMPAGNEUX (73240) • CHAMPAGNY-EN-VANOISE (73350) • CLERY (73460) • COHENNOZ (73590) • CONJUX (73310) • CORBEL (73160) • COURCHEVEL (73120) • CREST-VOLAND (73590) • CURIENNE (73190) • DOUCY-EN-BAUGES (73630) • DULLIN (73610) • ECOLE (73630) • ENTRELACS (73410) • ENTREMONT-LE-VIEUX (73670) • EPIERRE (73220) • ESSERTS-BLAY (73540) • FEISSONS-SUR-SALINS (73350) • FLUMET (73590) • FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE (73300) • FRENEY (73500) • FRETERIVE (73250) • GERBAIX (73470) Mis à jour octobre 2019 ANNEXE 2 • GRAND AIGUEBLANCHE (73260) • GRESY-SUR-ISERE (73460) • HAUTECOUR (73600) • HAUTELUCE (73620) • HAUTEVILLE (73390) • JARRIER (73300) • JARSY (73630) • JONGIEUX (73170) • LA BAUCHE (73360) • LA BIOLLE (73410) • LA CHAPELLE (73660) • LA CHAPELLE-BLANCHE (73110) • LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT (73370) -

Concours Départemental Des Villes, Villages Et Maisons Fleuris
CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS PALMARÈS 2019 LA SAVOIE « Département fleuri » 2 Le Département s’enorgueillit de nouveau de se voir décerner le « Label Département Fleuri », par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris, pour une durée de 5 ans. Le fleurissement contribue aux actions menées par le Département dans les collectivités locales en faveur de la gestion du foncier, la qualité des eaux, la protection des paysages d’exception, la qualité de l’environnement. A cet égard, depuis plus de 20 ans le Département s’est engagé dans une politique environnementale très ambitieuse dont le fleurissement est un des volets. 2019 SEPTEMBRE LA SAVOIE DÉPARTEMENT FLEURI CANDIDATURE AU RENOUVELLEMENT DU LABEL DÉPARTEMENT FLEURI Le concours départemental des villes, villages et maisons fleuris Le Département de la Savoie a Qui peut participer ? 4 donné délégation à l’Agence Alpine Toutes les communes de Savoie ainsi des Territoires pour l’organisation que les particuliers dont la commune du Concours des villes, villages et a fait acte de candidature. maisons fleuris avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie des Comment s’inscrire ? habitants et renforcer l’attractivité Le bulletin d’inscription est adressé du territoire. La démarche consiste à toutes les communes de Savoie à accompagner et à distinguer les accompagné de son règlement actions des collectivités locales et fin avril. L’inscription est payante des particuliers qui contribuent à la et obligatoire pour permettre aux mise en valeur de nos paysages, de particuliers de participer au concours. nos espaces publics dans le respect L’inscription doit impérativement être de l’environnement et à récompenser retournée avant le 31 mai. -

Press Dossier Winter 2018-2019 Summary
FROM FATHER TO SON, THE HEART OF THE SAVOY PRESS DOSSIER WINTER 2018-2019 SUMMARY 4 3 stars in the Michelin Guide: an historic first 20 The story of a family with a passion for building for the Savoy 22 The Savoy: historical and culinary heritage 6 Events • A Menu with 4 triple starred Savoyard Chefs 30 A cuisine signed “Meilleur” th • Oenological evenings: La Bouitte celebrates the 50 ! 36 Les 3 Vallées in the Vanoise, beyond one’s imagination ... 10 New in 2018 and 2019: 40 A ***** “Relais & Châteaux” hotel • Creation of the Maison Meilleur in Saint Martin de Belleville • La Bouitte*****, a unique experience combining authenticity, 42 The Bèla Vya Spa: philosophy and choice the art of living and luxury 47 Practical information and tariffs • Spa "La Bèla Vya": treatments, equipments and a growing cosmetic brand • New culinary creations “La Bouitte … or a family adventure which has become a saga! Year after year, in complete discretion, René and Maxime Meilleur – a father and son partnership – have forged a restaurant with a rare genuineness, a superb ode to the Savoy. Each ingredient has its place, cooked to perfection, with no excess. The dishes, overflowing with original aromas, exude, just simply, happiness.” “If you have come a long way to enjoy La Bouitte’s culinary excellence, why not stay the night? In an adjoining chalet, 6 “mountain/chic” bedrooms and suites are waiting for you. A real cocoon!” (The 2018 Michelin Guide – Restaurant classification: 3 stars and 3 red forks – Hotel classification: 3 red lodges) 2 RESTAURANT RENÉ -

Notre Brochure Présentant L'offre Du Parc En Matière D'accessibilité
Parc national de la Vanoise © Aurélie Pallard © Aurélie 04 79 62 30 54 www.vanoise-parcnational.fr [email protected] Bienvenue rando.vanoise.com Découverte Situé en Savoie, le Parc national de la Vanoise Savoie Mont-Blanc Tourisme d’une nature est l’aîné des dix parcs nationaux de France. www.savoie-mont-blanc.com exceptionnelle pour les Ceux-ci préservent et font découvrir au grand personnes en public leurs richesses naturelles, culturelles SITRA (réseau d’informations touristiques) en Vanoise situation de et paysagères exceptionnelles. www.sitra-rhonealpes.com handicap Cette brochure présente les lieux et les activités accessibles à tous, sites par sites. Ils ont été mis Oces de tourisme avec référent accessibilité en œuvre par le Parc national ou en partenariat. Aussois : 04 79 20 42 22, [email protected] Les sorties accompagnées ont été développées Champagny-en-Vanoise : 04 79 55 06 55 en collaboration avec des associations locales [email protected] de personnes handicapées. Maurienne Vanoise : 04 79 05 99 06 [email protected] Quelles que soient vos aptitudes, vous trouverez Méribel : 04 79 08 56 70, [email protected] des idées de sorties accessibles, même en haute montagne. Les chiens guides et d’assis- Pralognan-la-Vanoise : 04 79 08 79 08 tance sont autorisés dans le Parc. [email protected] Avec Tignes : 04 79 40 04 40 le soutien de Venez partager une expérience unique [email protected] Un Parc national pour tous et conviviale avec nous ! Date de parution : 2015 © Rédaction : Caroline Jules et Parc national de la Vanoise Carte au dos Graphisme et photo de couverture : Aurélie Pallard Impression : Imprimerie Gonnet Parc national de la Vanoise © Aurélie Pallard © Aurélie 04 79 62 30 54 www.vanoise-parcnational.fr [email protected] Bienvenue rando.vanoise.com Découverte Situé en Savoie, le Parc national de la Vanoise Savoie Mont-Blanc Tourisme d’une nature est l’aîné des dix parcs nationaux de France. -

Pistes De Ski De Fond De Meribel Altiport
Mairie des Allues Chef-lieu 73 550 LES ALLUES Tél.04.79.08.61.04 Fax. 04.79.08.52.07 PISTES DE SKI DE FOND DE MERIBEL ALTIPORT Station : MERIBEL Commune : LES ALLUES Dossier de servitude au titre des articles L342-20 à L342-26 du Code du tourisme 1- Délibération de la commune 2- Notice explicative 3- Caractéristiques de la servitude 4- Dossier technique 5- Plan parcellaire 6- Etat parcellaire ABEST – N° 16-070 Tracés pistes Méribel/08-URB/DS/ind E/17eme Etat_Parcellaire_IHypo d 153-17.doc INDICE DATE ETAB. VERIF. OBSERVATIONS - MODIFICATIONS 0 09-02-2018 Mesur’Alpes DL Première diffusion A 10-04-2018 MG DL Modif. suite rq MO B 27-04-2018 MG DL Modif. état parcellaire et notices (état 12) C 27-09-2018 MG DL Modif. suite avancement état parcellaire pendant instruction D 05-02-2019 LL DL Modif. suite avancement état parcellaire pendant instruction Mesur'ALPES ETAT PARCELLAIRE Page - 1 Géomètres Experts Associés 04/02/2019 D153-17 Liste des propriétaires SERVITUDE PISTE DE SKI 185 - SERVITUDE PISTE DE SKI DU FOND DE L’ALTIPORT - LES ALLUES LES ALLUES PROPRIETE 100 PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) PROPRIETAIRE - Commune des Allues Représentée par Monsieur MONIN Thierry son Maire en exercice Siren : 217 300 151 Siège Social : MAIRIE Chef-Lieu LES ALLUES (73550) Emprise piste Servitude Projet Référence cadastrale Emprise travaux de Lot BND actuelle talus compris (m²) terrassements en m² Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface en m² Emprise Servitude Reliquat B 1235 FUTAIE CASSANUIT 1140 24 0 24 1116 B 1239 -

PLAN VTTVALLEES E120 WEB.Pdf
VALLÉE DE MÉRIBEL VALLÉE DE COURCHEVEL VALLÉE DES BELLEVILLE ENDURO PISTES DE DESCENTES ENDURO ENDURO ) >) ) ) ) La Forêt de Pas de E.1 7.6km -470m DH.1 Bike Slope 5,5km -555m E.1 Le Bondge 3,7km +45/-184m E.1 8,3km -973/+6m l’Altiport Cherferie Dégage à E.2 La Croé 2,1km +11/-107m E.2 20,2km -2065/+205m E.2 Les Villages 9.6km -890m DH.2 Bellevue 8,9km -950m Moûtiers La Dérot- E.3 4,1km +42/-222m Le Doron chu DH.3 Blue Line 5,9km -590m E.3 (Menuires > 7,2km -427m/+29m E.3 Les Combes 9km 800m St Martin) E.4 Lou Virolets 6,6km -513m DH.9 Woodstocked 1,6km -290m Combe de +390/- E.5 La To-drè 2,4km +3/-216m E.7 6,8km -423/+10m Partagez vos plus beaux souvenirs E.4 Top Down 19,7km Thorens en taguant vos photos avec 2470m DH.5 Forest Jump 2,3km -420m E.6 La Foré 3km +40/-100m DH.6 Motta Red 2,3km -600m +410/- E.8 La Loyale 12,2km -1141/+173m E.7 Les Crètes 18,3km +50/- #LES3VALLEES et #MYPLAYGROUND 1690m E.7 L’Intégral 13km DH.11 Red Line 1,6km -250m 1430m PISTES DE DESCENTES Le Creux de la +280/- E.9 11,9km DH.4 Tougnète Rocket 3,3km -520m PISTES DE DESCENTES Stetta 1240m DH.1 Easy Rider 8km -605m DH.7 La 7 3,2km -480m Funny E.10 Corbassière 23.2km -2480m DH.1 3km -300m 3vallees.france les3vallees_officiel Track 1 DH.4 Les Girauds 6,3km -485m DH.10 GO Pro + GForce 2,15 km -550m CIRCUITS VTTAE DH.6 Bruyères 3,1km -397m Funny DH.1 3km -300m VAE La Truite 7,5km +300m Track 2 DH.9 La Chasse 3,1km -223m Courchevel - DH.10 La Gentiane 4,2km -413m VAE 20,5km 930m Funny Méribel DH3 3km -300m | SUMMER Track 3 DH.5 Petits Creux 4,4km -485m ÉTÉ 2020 -

Conflicts, Acceptance Problems and Participative Policies in the National Parks of the French Alps
Research eco.mont – Volume 9, special issue, January 2017 46 ISSN 2073-106X print version – ISSN 2073-1558 online version: http://epub.oeaw.ac.at/eco.mont https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-9-sis46 Conflicts, acceptance problems and participative policies in the national parks of the French Alps Samuel Depraz & Lionel Laslaz Keywords: social acceptance, conflicts, charter, participation, national parks, French Alps Abstract Profile This article provides an updated insight into the now completed compliance process Protected area with the charters of the French Alpine national parks (Vanoise, Ecrins, Mercantour), a participative measure that was initiated in 2006. A theoretical approach to social Vanoise, Ecrins and acceptance is given, followed by an analysis of the upsurge or the rise of conflicts during the negotiation process with local municipalities of the national park perim- eter in a more empirical way. It will be demonstrated that fostering acceptability and Mercantour NP participation does not necessarily produce wider social acceptation. Mountain range Alps Country France Introduction hopefully open, for those who initiate the conflict, a productive readjustment in the balance of powers be- Why are there so often conflicts concerning the cre- tween stakeholders – following the sociological tradi- ation and management of protected areas? Establish- tion of Simmel (1908). ing protected areas seems to be a positive measure that In this respect, the French Alps have been at the prevents the depletion of natural resources, enhances heart of acute conflicts since the first launch of na- the touristic value of the landscape and even reinforc- tional parks (NPs) in France in the 1960s. -

Fiche De Poste Chef·Fe De Secteur De Pralognan
Fiche de poste Chef·fe de secteur de Pralognan IDENTIFICATION DU POSTE Intitulé du poste Chef·fe de secteur Nature du poste Ingénieur·e ou agent·e de catégorie A Position normale d’activité pour un fonctionnaire d’Etat, détachement de la fonction publique territoriale, subsidiairement, CDD d’une durée de 3 ans éventuellement reconductible une fois AFFECTATION, PRESENTATION DU SERVICE Service d'affectation Secteur de Pralognan. Communes de Pralognan-la-Vanoise, Champagny-en-Vanoise, Planay, Courchevel, Les Allues, Bozel, Les Belleville Mission principale du Le secteur correspond à l'unité territoriale de base de gestion du parc national service tant pour le cœur que l'aire d'adhésion. Il a pour objectif, en assurant des relations de proximité avec les collectivités et les partenaires, de mettre en œuvre sur ce territoire la politique du parc dans tous ses domaines de compétence : surveillance et gestion, connaissance, sensibilisation à l'environnement et développement durable. Composition du service Effectifs permanents : un chef de secteur, un technicien patrimoine naturel (effectif) adjoint au chef de secteur, une technicienne agriculture/tourisme adjointe au chef de secteur, 6 agents techniques gardes-moniteurs, un secrétaire Effectifs temporaires : ouvriers, hôtesses, gardes animatrices RNN, animatrice nature et éventuellement services civiques et stagiaires à certaines saisons (principalement l'été), agents temporaires chargés de projets Positionnement de Le/la chef·e de secteur est placé·e sous l'autorité hiérarchique directe de la l'agent dans directrice de l'établissement et participe au Comité de direction. Il/elle l'organigramme du entretient des relations fonctionnelles avec les chefs de pôle du siège. -

Carte Touristique Tarentaise Vanoise
Base eau vive Col accessible en voiture Eglise - Chemin du baroque Golf et/ou practice Hameau ou village de caractère Lac ou plan d’eau aménagé LÉGENDEPlan d’eau - baignade surveillée Point Infos Tourisme Pour vos déplacements, pensez à l’autostop organisé grâce à Rezo Pouce. 1 Refuge numéroté Retrouvez tous les arrêts en Tarentaise : Base eau vive Site et panorama exceptionnel www.rezopouce.fr Col accessible en voiture Sommet accessible Téléchargez l’application sur l’App Store et Google Play en remontée mécanique Eglise - Chemin du baroque Station Thermale Golf et/ou practice Via Ferrata Hameau ou village de caractère Parapente Lac ou plan d’eau aménagé Limite du cœur du Parc national Plan d’eau - baignade surveillée de la Vanoise Point Infos Tourisme Voie verte 1 Refuge numéroté Grande traversée des Alpes Site et panorama exceptionnel Sommet accessible en remontée mécaniqueLIEUX À VISITER Station Thermale AIGUEBLANCHEVia Ferrata LES AVANCHERS 1 Moulin à huile 18 Musée des traditions 07 81 95Parapente 19 56 04 79 09 83 27 ➜ www.aigueblanche-patrimoine.comLimite du cœur du Parc na tional 19 Espace patrimonial AIME LAde PLAGNEla Vanoise 04 79 09 83 27 2 Basilique Saint Martin LES BELLEVILLE Tour MontmayeurVoie verte 20 Musée de St Martin EspaceGrande archéologique traversée des Alpes (Saint Martin) «des pierres et des hommes» 04 79 00 70 75 Pierre Borrione 21 Moulin de Burdin 04 79 55 67 00 (Saint Marcel) ➜ www.laplagne-vallee.com 04 79 00 20 00 2 Maison des arts 22 Mellifera, la maison de l’abeille noire 04 79 55 21 57 et de la nature