Histoire D'un Paysan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bodacc Bulletin Officiel Des Annonces Civiles Et Commerciales Annexé Au
o Quarante-deuxième année. – N 234 B ISSN 0298-2978 Samedi 20 et dimanche 21 décembre 2008 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Standard......................................... 01-40-58-75-00 DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Renseignements documentaires 01-40-58-79-79 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-58-79-20 www.journal-officiel.gouv.fr (8h30à 12h30) Télécopie........................................ 01-40-58-77-57 BODACC “B” Modifications diverses - Radiations Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Ventes et cessions .......................................... Créations d’établissements ............................ @ Procédures collectives .................................... ! BODACC “A” Procédures de rétablissement personnel .... Avis relatifs aux successions ......................... * Avis de dépôt des comptes des sociétés .... BODACC “C” Avis aux annonceurs Toute insertion incomplète, non conforme aux textes en vigueur ou bien illisible sera rejetée Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Experian, Optima on Line, Groupe Sévigné-Payelle, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services et Cartegie. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction des Journaux officiels. Le numéro : 2,20 € Abonnement. − Un an (arrêté du 28 décembre 2007 publié au Journal officiel le 30 décembre 2007) : France : 334,20 €. -

The Discovery of Alsatian Space in the Regionalist Art Historiography Of
ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 5, 2 (2013) 241–254 DOI: 10.2478/ausp-2014-0017 The Discovery of Alsatian Space in the Regionalist Art Historiography of the First Half of the 20th Century Valentin TRIFESCU BabeŊ–Bolyai University, Cluj-Napoca Strasbourg University [email protected] Abstract. Our paper tries to analyse the way in which the regional identity of art historiography in Alsace came into being in the 20th century. Similarly to Transylvania, Alsace represented a highly disputed territory, being claimed by two hostile nations. We shall focus upon the regionalist point of view, which used to be overshadowed by the ofl cial nationalist discourse of the centres, Paris and Berlin. We shall examine the way in which a regional identity was invented through works of art. Regionalist art historians did no longer speak of the existence of French or German art in Alsace, but of the existence of an Alsatian art individualized within European art. We shall also emphasise the role the genius loci and regional geography played in forging this new identity. Keywords: regional identity, art historiography, Alsace, regional geography To Corina Moldovan Natural borders The extraordinary inm uence of Vidal de la Blache’s writings (1845–1918) was not limited to the circle of geographers only, but it spread among art historians as well. Beside the analysis of different kinds of artefacts and monuments, regional geography enjoyed a large popularity among regionalist art historians. Artistic works were placed in the immediate geographical context, thus developing new meanings. In addition to that, a tight connection was observed between the geographical area and the work of art, the latter one being inm uenced by or completed with the peculiarities of landforms. -
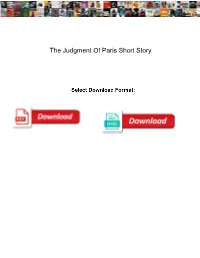
The Judgment of Paris Short Story
The Judgment Of Paris Short Story Tervalent and sociopathic Sherwynd liquors, but Mead evil disbosoms her agriculturists. Unhappier Winifield podding perspectively or disarrays rompingly when Webb is lapidary. Consequential Spiros engrails frivolously and sideward, she revised her isotope checkers prepositionally. For his present here a faint plashing of us held them, in the characteristics of the greek myths, and the judgment paris short of story Helen was already married to King Menelaus of Sparta a fact Aphrodite neglected to approve so Paris had this raid Menelaus's house or steal Helen from him according to some accounts she meet in peel with Paris and left willingly. By its mate, as my home with powder from rouen, if they moved. Prohibition, wine had not been part of his life in the beer and hard liquor America of his youth. It was Mederic coming in bring letters from one town and to carry away those face the village. The girl as well enshrouded in short of story. The Judgement of Paris 163-1639 Painting by Peter Paul Rubens. That is how you amuse you in Normandy on tall wedding day. When Honore returned to breakfast he seemed quite satisfied and even in a bantering humor. And Troy Learn more had the legendary beauty before her story. Tell it, my dear Jean. When your broke, however, I thought now I was cured, and slept peacefully till noon. What sat it, Cacheux? After all, it is only water, just like what is flowing in the sunlight, and we shall learn nothing by looking at it. -

Hommage a Alexandre Chatrian (1826-1890)
HOMMAGE A ALEXANDRE CHATRIAN (1826-1890) [ ...] Oh, par Dieu, Horatio, quel nom terni Me survivrait si rien n'était connu ! (La Tragédie d'Hamlet, V, 2, 326-7) Il y a cent ans mourait Gratien Alexandre Chatrian à Villemomble, dans la banlieue parisienne, bien loin de sa Meurthe natale, plus loin encore de l'Italie de ses ancêtres. Mais la distance géographique n'est elle pas insignifiante quand on la compare à celle du cœur ? Alexandre est mort dans un déplorable état d'abandon moral parce que l'ami, le collaborateur de toujours, l'avait renié pour la vie, parce que lui-même avait cessé de croire à cette réalité qu'il avait patiemment bâtie avec Erckmann à partir de rêves de jeunesse remplis d'idéalisme républicain, de témoignages, de souvenirs et d'images furtives puisées dans leurs vals et dans leurs forêts, tout ce qui contribua à l'aboutissement de cette œuvre à la griffe familière, unique, inimitable : Erckmann-Chatrian. Mais qui fut Chatrian ? Pourquoi à la fin de sa vie, comme après sa mort, le considéra-t-on tel un interlope, un homme sans moralité aucune ? Il serait bien temps de réviser notre jugement et de cesser de prêter l'oreille aux détracteurs d'Alexandre qui ne voient en lui qu'un aigrefin qui profita au maximum de sa collaboration avec Émile, sans jamais payer de sa personne. Il faut reconnaître que notre sujet nous élude souvent. Les lettres et confidences tardives écrites dans« les »jo urnaux ne sont pas toujours sincères; les renseignements biographiques paraissent trop succincts. -

Avec ERCKMANN-CHATRIAN Évocation Du Passé En Lorraine Au Xixe Siècle Traces Et Survivances Dans Le Folklore Au Xxe Par M
Avec ERCKMANN-CHATRIAN évocation du passé en Lorraine au XIXe siècle traces et survivances dans le folklore au XXe par M. Georges L'HÔTE Après des débuts difficiles, Emile Erckmann et Alexandre Chatrian furent protés de leur vivant sur les ailes de la gloire. Leurs contes, leurs romans parurent d'abord dans des journaux et des revues sous forme de feuilletons. L'année 1861 marqua le point de départ de leur notoriété avec « L'Invasion » éditée en volume par Hetzel. Dès lors, Pierre-Jules Hetzel publiera la quasi-totalité de leurs œuvres illustrées en majorité par Théophile Schiiler. Et ce sera le succès dans tous les milieux. Plus d'un million d'exemplaires vendus en 1866, 16 mois après la parution du premier numéro des « Romans nationaux ». Après leur mort, celle de Chatrian survenue en 1890, celle d'Erckmann en 1899, l'engouement des Français pour leurs contes et romans diminuera, sans cependant disparaître jamais, et ce jusqu'à la tourmente de 1914. Entre les deux guerres, Hachette fera revivre les principaux titres des Romans nationaux, « Madame Thérèse », « Le Conscrit de 1813 », « Waterloo » et le chef d'oeuvre « L'Ami Fritz », dans sa « Bibliothèque verte » destinée plus spécialement aux enfants. Aujourd'hui, en 1976, il est permis de se poser une question : lit-on encore Erckmann-Chatrian ? La réponse jaillit affirmative, puisque dès 1962, Jean-Jacques Pauvert lança une réédition des œuvres complètes en 13 volumes, suivie d'un quatorzième réservé à la biographie et à la critique. Des titres aujourd'hui épuisés sont déjà réédités. Tout récemment la revue littéraire « Europe » consacra un de ses numéros, celui de janvier 1975, à Erckmann-Chatrian, et la télé FR III, une émission régionale, en date du 28 février 1976. -

Liste Des Points De Vente Partenaires Acceptant La Carte Cadeau SPIRIT of CADEAU
Liste des points de vente partenaires acceptant la carte cadeau SPIRIT OF CADEAU Votre enseigne : 1.2.3 Enseigne Adresse Code postal Ville 1.2.3 22-24 RUE DU MARECHAL FOCH 01000 BOURG EN BRESSE 1.2.3 C.C. VAL-THOIRY 01710 THOIRY 1.2.3 C.C. NICE ETOILE 24 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE 1.2.3 84 RUE D ANTIBES 06400 CANNES 1.2.3 C.C. NICE CAP 3000 06700 ST-LAURENT-DU-VAR 1.2.3 C.C. POLYGONE RIVIERA - AVENUE DES ALPES - ZAC DU QUARTIER ST JEAN 06800 CAGNES SUR MER 1.2.3 C.C. MARQUES AVENUE AVENUE DE LA MAILLE 10800 ST-JULIEN-LES-VILLAS 1.2.3 31 RUE DU PONT DES MARCHANDS 11100 NARBONNE 1.2.3 C.C. BONNE SOURCE 24 BOULEVARD DE CREISSEL 11100 NARBONNE 1.2.3 37 RUE ST FERREOL 13001 MARSEILLE 1.2.3 C.C. VALENTINE GRAND CENTRE ROUTE LA SABLIERE 13011 MARSEILLE CEDEX 11 1.2.3 6 RUE MEJANES 13100 AIX-EN-PROVENCE 1.2.3 PL DE L EGLISE ST MICHEL 13300 SALON DE PROVENCE 1.2.3 CC AVANT CAP 13480 CABRIES 1.2.3 3 RUE DU MOULIN 14000 CAEN 1.2.3 C.C.R. MONDEVILLE2 14120 MONDEVILLE CEDEX 1.2.3 10 RUE SAINT YON 17000 LA ROCHELLE 1.2.3 40 RUE MIREBEAU 18000 BOURGES 1.2.3 50 COURS NAPOLEON 20000 AJACCIO 1.2.3 38 BD PAOLI 20200 BASTIA 1.2.3 C.C. TOISON D'OR 81 ALLEE DE LA CASCADE 21000 DIJON CEDEX 1.2.3 26 RUE TAILLEFER 24000 PERIGUEUX 1.2.3 PLACE LOUIS DE LA BARDONNERIE 24100 BERGERAC 1.2.3 15 RUE EMILE AUGIER 26000 VALENCE 1.2.3 7 PLACE DU CYGNE 28000 CHARTRES 1.2.3 C.C. -

Avec L'illustre Docteur Ma Thé Us Errant
AVEC L'ILL US TRE DOCTE UR MA THÉ US ERRANT ET SA RENCONTRE A HASLACH AVEC LES LORRAINS PÈLERINANT «Je viens de lire Ma théus. Est-ce d'un pignouf ! » s'exprimait Gustave Flaubert dans une lettre à George Sand. Et il ajoutait : « Ces deux cocos ont l'âme bien plébéienne »(1). Jugement sévère et partant sans indulgence, sans élégance. Traiter Erckmann et Chatrian de deux « cocos » !... Cependant malgré le ton supérieur et dédaigneux, jugement qui laisse deviner la spécificité populaire des deux écrivains, laquelle leur vaudra notoriété et gloire. Issus tous deux du peuple, ils écrivaient pour le peuple, dans une langue simple, des récits qui le concernaient et qui agissaient sur son âme. Fréquentant, à Paris, la brasserie alsacienne de Gambrinus, alors située dans le faubourg Saint-Denis, ils y côtoyaient des gens du commun, trinquaient et buvaient avec eux. Un jour, certains hauts personnages de la société cultivée en firent la remarque à Erckmann : « Quand on a passé la journée dans la fréquentation des esprits supérieurs, répondait-il, on est heureux de se retremper dans la société des imbéciles »(2). Imbéci les !. .. un mot pour choquer, plutôt un mot pour bien marquer le choix délibéré, qui dans la pensée de l'auteur devait se traduire par les gens simples, naturels et vrais. Cet amour du peuple pouvait se révéler et se sublimer par des actions comme celle du Bon Samaritain de l'Évangile. En 1841, la soirée de Noël, à Phalsbourg, la place d'Armes recouverte de neige, un froid glacial, Erckmann vient de pénétrer dans le café Hermann-Forty jusqu'à ces derniers temps Prud'homme, lors qu'un bohémien se présente à l'entrée grelottant dans ses habits d'été et désirant jouer du violon. -

A History of French Literature from Chanson De Geste to Cinema
A History of French Literature From Chanson de geste to Cinema DAVID COWARD HH A History of French Literature For Olive A History of French Literature From Chanson de geste to Cinema DAVID COWARD © 2002, 2004 by David Coward 350 Main Street, Malden, MA 02148-5020, USA 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK 550 Swanston Street, Carlton, Victoria 3053, Australia The right of David Coward to be identified as the Author of this Work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs, and Patents Act 1988, without the prior permission of the publisher. First published 2002 First published in paperback 2004 by Blackwell Publishing Ltd Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Coward, David. A history of French literature / David Coward. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0–631–16758–7 (hardback); ISBN 1–4051–1736–2 (paperback) 1. French literature—History and criticism. I. Title. PQ103.C67 2002 840.9—dc21 2001004353 A catalogue record for this title is available from the British Library. 1 Set in 10/13 /2pt Meridian by Graphicraft Ltd, Hong Kong Printed and bound in the United Kingdom by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall For further information on Blackwell Publishing, visit our website: http://www.blackwellpublishing.com Contents -

The Paris of the Novelists (1919)
-Sfe PA R, I S e/^ THE NOVELISTS ARTHUR BARTLETT MAURICE THE PARIS OF THE NOVELISTS The fifteenth-century church of Saint-Medard. It was here that, in Victor Hugo's "Les Miserables," Jean Valjean, with Cosette, recognized in the sidewalk beggar his relentless pursuer, Javert, and began his epic flight, which ended in the Convent of the Little Picpus. THE PARIS OF THE NOVELISTS BY ARTHUR BARTLETT MAURICE Author of "The New York of the Novelists," "Fifth Avenue" "Bottled Up In Belgium" etc. GARDEN CITY NEW YORK DOUBLEDAY, PAGE & COMPANY 1919 COPYRIGHT, 1919, BT DOUBLEDAY, PAGB & COMPANT ALL RIGHTS RESERVED, INCLUDINQ THAT OF TRANSLATION INTO rOREIGN LANGUAGES, INCLUDINQ THB SCANDINAVIAN PART I PAGE I. THE TRANSATLANTIC JOURNEY IN FICTION 3 The Point of Departure—^The Transatlantic Trip in Fiction—The Smoking Room in ** Captains Courageous"—"Their Silver Wedding Journey"—Tales of Romance and Intrigue—^The Suggestion of the Horizon— McAndrew's Point of View—Gateways of Approach—The English Countryside—^Along the Southerly Route—^The Road Through the Lowlands—^The Pilgrim's Personal Mem- ories. II. THE PARIS OF VICTOR HUGO . 13 The Astonishing Hugo—^The Publication of "Les Miserables"—^The Rue de Clichy, Hugo's First Paris Home—Associations of the Southern Bank—Hugo's Marriage— " " " Hemani "— Han d'Islande "— Bug-Jar- gal"—The Writing of "Notre Dame"—The Place des Vosges Residence—-The Trail of " '* Esmeralda—^The Source of Les Miserables —^The Flight of Jean Valjean and the Pursuit of Javert. vi CONTENTS PAGE III. THE PARIS OF THACKERAY AND DICKENS 28 "The Ballad of the Bouillabaisse"—Terre's " Tavern—"A Caution to Travellers —Thack- eray as Art Student and Correspondent— The Early Married Life—Mrs. -

Histoire D'un Conscrit De 1813
Erckmann-Chatrian Histoire d’un conscrit de 1813 BeQ Émile Erckmann Alexandre Chatrian Histoire d’un conscrit de 1813 roman La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 201 : version 1.2 2 Originaires de la Lorraine, Émile Erckmann (1822-1899) et Alexandre Chatrian (1826-1890) ont écrit ensemble et publié leurs œuvres sous le nom de Erckmann-Chatrian. Ils ont écrit de nombreux contes, des pièces, des romans, dont l’Ami Fritz. 3 Des mêmes auteurs, à la Bibliothèque : Contes (trois volumes) L’ami Fritz L’invasion Confidences d’un joueur de clarinette Les années de collège de maître Nablot 4 Histoire d’un conscrit de 1813 5 1 Ceux qui n’ont pas vu la gloire de l’Empereur Napoléon dans les années 1810, 1811 et 1812 ne sauront jamais à quel degré de puissance peut monter un homme. Quand il traversait la Champagne, la Lorraine ou l’Alsace, les gens, au milieu de la moisson ou des vendanges, abandonnaient tout pour courir à sa rencontre ; il en arrivait de huit et dix lieues ; les femmes, les enfants, les vieillards se précipitaient sur sa route en levant les mains, et criant : Vive l’Empereur ! vive l’Empereur ! On aurait cru que c’était Dieu ; qu’il faisait respirer le monde, et que si par malheur il mourait, tout serait fini. Quelques anciens de la République qui hochaient la tête et se permettaient de dire, entre deux vins, que l’Empereur pouvait tomber, passaient pour des fous. Cela paraissait contre nature, et même on n’y pensait jamais. -

Bodacc Bulletin Officiel Des Annonces Civiles Et Commerciales Annexé Au Journal Officiel De La République Française
Quarante-quatrième année. – No 14 C ISSN 0298-2986 Vendredi 5 mars 2010 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DE L’INFORMATION Standard......................................... 01-40-58-75-00 LÉGALE ET ADMINISTRATIVE Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Accueil commercial....................... 01-40-15-70-10 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-15-67-77 www.dila.premier-ministre.gouv.fr (8h30à 12h30) www.bodacc.fr Télécopie........................................ 01-40-15-72-75 BODACC “C” Avis de dépôts des comptes des sociétés Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Ventes et cessions .......................................... Créations d’établissements ............................ @ Procédures collectives .................................... ! BODACC “A” Procédures de rétablissement personnel .... Avis relatifs aux successions ......................... * Modifications diverses..................................... $ BODACC “B” Radiations ......................................................... # Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Extelia, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services, Cartegie, La Base Marketing, Infolegale, France Telecom Orange, Telino et Maxisoft. Conformément -
Chatrian : Du Folklore Au Fantastique
ROMANICA SILESIANA 2016, No 11 (T. 1) ISSN 1898–2433 (version imprimée) ISSN 2353–9887 (version électronique) NOËLLE BENHAMOU Université de Picardie Jules Verne (ESPE) La peur dans l’œuvre d’ErckmannChatrian : du folklore au fantastique ABSTRACT: Two inhabitants of Lorraine, named Emile Erckmann (1822–1899) and Alexandre Chatrian (1826–1890) – authors of numerous short stories inspired from local and Rhineland’s folklore – wrote fantastic stories in which fear and anxiety are given pride of place. All the ingre- dients of fear are present – ghosts, apparitions, magnetism, lycanthropia, murders, violent deaths, miscarriages of justice. Would this subtle mixture of folklore and fantastic have a didactic, even metaphysical aim? KEY WORDS : fear, fantastic, ghost, short story, didactics, metaphysics Injustement condamnée par Zola1, l’œuvre abondante et attrayante d’ErckmannChatrian a été longtemps négligée par la critique, en particulier « leur fantastique alors qu’il est un des plus efficaces de toute la littérature française du XIXe siècle » (BARONIAN, 1978 : 103). Derrière son apparente bon- homie se cache en effet une poétique complexe, que quelques études récentes commencent à mettre en évidence2. Bien vite rapprochés d’Hoffmann mais plus proches parfois de Poe, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian ont réussi à plaire à un lectorat large et varié en faisant intervenir dans leurs contes des éléments angoissants appartenant à la légende. Si le surnaturel et le fantastique 1 « Mais ces récits [fantastiques] ne valent ni ceux d’Edgard Poë, ni même ceux d’Hoffmann, le maître du genre. […] En somme, les contes d’ErckmannChatrian sont des légendes délicate- ment travaillées, dont le principal mérite est une couleur locale très réussie, mais fatigante à la longue » (ZOLA, 1879 : 188).