Les Cahiers Ducfpci
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tenores De Aterúe
Volume 49, Number 8 NEWSLETTERwww.fsgw.org April 2013 FSGW MONTHLY program–frEE TO MEMBErs Tenores de Aterúe The Lost Art of Sardinian Cantu a Tenore Saturday, April 20, 8 pm Come join Tenores de Aterúe (“Singers from Elsewhere” in Sardinian) for some beautiful cantu a tenore songs, and a smattering of songs from Corsica and the Italian lauda tradition. Cantu a tenore is an a cappella quartet tradition from the Island of Sardinia that was declared a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO. Tenores de Aterúe came together in 2004, when singers Doug Paisley (boche) and Carl Linich (contra) discov- ered a mutual fascination with Sardinian cantu a tenore singing. The idea of learning Sardinian songs remained a fantasy until 2008, when Carl discovered videos of the group Tenores di Bitti performing, with each voice part sung in isolation, and then together with the other parts. Armed with this knowledge, they found two other sing- ing friends who were already versed in throat-singing styles; Avery Book (bassu) and Gideon Crevoshay (mesu boche). Shortly after their first recordings appeared online, native Sardinians responded enthusiastically, forging partnerships for the group’s continued exploration of the art of cantu a tenore. Their quartet has been singing Sardinian songs together for about four years, and they’d love to share this unique, powerful, and subtle polyphonic tradition with you! Washington Ethical Society, 7750 16th St., N.W., Washington, D.C. Free to FSGW members/$20 non- members. Info and reservations, Betsy at [email protected], or 301.717.4641. -

Klassisk Sång
1 SÅNGLÄRA 1.0 © Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2016 2 3 KULTURKAPITAL AB ISBN 978-91-87737-02-2 SÅNGLÄRA 1.0 © Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2016 Innehåll Resonanser ............................................31 Sångutbildningen ................................. 63 Sammanfattning ..................................31 Kastratsångarnas egenskaper ............... 64 DEL 1 RÖSTLÄRA Kastratinspelningarna från 1902-04 ..... 64 1. INLEDNING .....................................6 DEL 2 SÅNGSÄTT Franz Haböck ...........................................65 Män och kvinnor ......................................7 6. INLEDNING ...................................34 Nutida motsvarigheter? ........................ 65 När började människan sjunga? ............ 34 Sammanfattning ..................................65 2. ANDNING ........................................8 Är sång äldre än talspråk? ........................34 Andningsmusklerna ...................................8 Varför sjunger man? .............................. 34 DEL 4 BILAGOR Lågandning ..........................................10 Sång och genus .....................................35 Bilaga 1: ORDLISTA ................................68 Högandning ..........................................11 1900-talet ..............................................35 Bilaga 2: ”VETENSKAPLIGA” SÅNGSÄTT ....72 Diafragman (mellangärdesmuskeln) ......12 Bilaga 3: MER OM SÅNG OCH ANDNING ....73 7. NÅGRA SÅNGSÄTT .......................36 3. FONATION/TONBILDNING ..........14 Före 1850 .................................................73 -
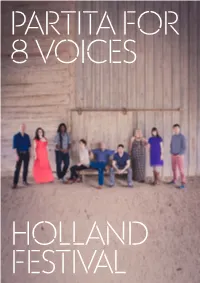
Partita-For-8-Voices-Programme.Pdf
PARTITA FOR 8 VOICES HOLLAND FESTIVAL PARTITA FOR 8 VOICES Roomful of Teeth thanks to production partner patron CONTENT Info & context Credits Programme Notes About the artists Friends Holland Festival 2019 Join us Colophon INFO CONTEXT date & time introduction Sat 15 June 2019, 8.30 pm by René van Peer 7.45 pm venue Muziekgebouw running time 1 hour 30 minutes including one interval CREDITS music William Brittelle Caleb Burhans Judd Greenstein Caroline Shaw performed by Roomful of Teeth Eric Dudley Thomas McCargar Estelí Gomez Abigal Lennox Martha Cluver Thann Scoggin Cameron Beauchamp Caroline Shaw with support from Brook Foundation website Roomful of Teeth PROGRAMME Done No Why Say Do (2010) William Brittelle Beneath (2010) Caleb Burhans The Isle (2016) Caroline Shaw AEIOU (2009) Judd Greenstein interval Partita for 8 Voices (2009-2011) Caroline Shaw NOTES Caroline Shaw Roomful of Teeth have been hailed as the future of choral music. The eight singers that make up the American vocal ensem- ble – four women, four men – together span five octaves, and accordingly their range runs the full gamut from deep growl to high-pitched shriek. Three of them have perfect pitch; all eight of them are classically trained. Singer and conductor Brad Wells established the group in 2009 and since then has flown in a host of different experts to teach his singers the most wide-ranging and obscure vocal techniques in an effort to broaden their pal- ette. From yodelling to death metal growling and throat singing - there’s nothing that’s too out there for the ensemble. The bulk of their repertoire has been written especially for them, and so they are able to incorporate all of these disparate techniques into their concerts, resulting in a truly unique sound. -

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity As Heritage Fund
ElemeNts iNsCriBed iN 2012 oN the UrGeNt saFeguarding List, the represeNtatiVe List iNTANGiBLe CULtURAL HERITAGe aNd the reGister oF Best saFeguarding praCtiCes What is it? UNESCo’s ROLe iNTANGiBLe CULtURAL SECRETARIAT Intangible cultural heritage includes practices, representations, Since its adoption by the 32nd session of the General Conference in HERITAGe FUNd oF THE CoNVeNTION expressions, knowledge and know-how that communities recognize 2003, the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural The Fund for the Safeguarding of the The List of elements of intangible cultural as part of their cultural heritage. Passed down from generation to Heritage has experienced an extremely rapid ratification, with over Intangible Cultural Heritage can contribute heritage is updated every year by the generation, it is constantly recreated by communities in response to 150 States Parties in the less than 10 years of its existence. In line with financially and technically to State Intangible Cultural Heritage Section. their environment, their interaction with nature and their history, the Convention’s primary objective – to safeguard intangible cultural safeguarding measures. If you would like If you would like to receive more information to participate, please send a contribution. about the 2003 Convention for the providing them with a sense of identity and continuity. heritage – the UNESCO Secretariat has devised a global capacity- Safeguarding of the Intangible Cultural building strategy that helps states worldwide, first, to create -

Norfolk Chamber Music Festival Also Has an Generous and Committed Support of This Summer’S Season
Welcome To The Festival Welcome to another concerts that explore different aspects of this theme, I hope that season of “Music you come away intrigued, curious, and excited to learn and hear Among Friends” more. Professor Paul Berry returns to give his popular pre-concert at the Norfolk lectures, where he will add depth and context to the theme Chamber Music of the summer and also to the specific works on each Friday Festival. Norfolk is a evening concert. special place, where the beauty of the This summer we welcome violinist Martin Beaver, pianist Gilbert natural surroundings Kalish, and singer Janna Baty back to Norfolk. You will enjoy combines with the our resident ensemble the Brentano Quartet in the first two sounds of music to weeks of July, while the Miró Quartet returns for the last two create something truly weeks in July. Familiar returning artists include Ani Kavafian, magical. I’m pleased Melissa Reardon, Raman Ramakrishnan, David Shifrin, William that you are here Purvis, Allan Dean, Frank Morelli, and many others. Making to share in this their Norfolk debuts are pianist Wendy Chen and oboist special experience. James Austin Smith. In addition to I and the Faculty, Staff, and Fellows are most grateful to Dean the concerts that Blocker, the Yale School of Music, the Ellen Battell Stoeckel we put on every Trust, the donors, patrons, volunteers, and friends for their summer, the Norfolk Chamber Music Festival also has an generous and committed support of this summer’s season. educational component, in which we train the most promising Without the help of so many dedicated contributors, this festival instrumentalists from around the world in the art of chamber would not be possible. -

A Cappella 2014 Will Be COOL & JAZZY from Moscow, Who Will Be Celebrating Their Twentieth An- Amarcord & Lautten Compagney Niversary with a Lively Stage Show
Leipzig · 9 – 18 May 2014 International Festival of Vocal Music Kindly supported by www.a-cappella-festival.com Having the time of your life is certainly something worth singing about! We’re clearly not the only Friday 9 May 2014, 8pm ones who think so – which is why in 2014, the a cappella International Festival of Vocal Music will Michaeliskirche be held for the fifteenth time! It’ll feature top stars from the world of vocal music, ambitious young Opening concert singing groups, and also vocal artistes appearing in Leipzig for the first time. Among the newcomers at a cappella 2014 will be COOL & JAZZY from Moscow, who will be celebrating their twentieth an- amarcord & Lautten Compagney niversary with a lively stage show. Young British ensemble THE MARIAN CONSORT will also be making Germany their a cappella debut with music by outstanding English composers from the Golden Age. At three recitals we’ll be able to enjoy four past and present prize-winners of the International A CAPPELLA Madrigals, Chansons and Dances from the Teütsch Contest. The prize-winners’ concert will be shared by MIXTET from Estonia and THE QUINTESSENTIAL Lute Book (1566) by Melchior Neusidler FIVE from Georgia, both of whom put in breath-taking performances which went down a storm with both audience and jury in 2013. KLANGBEZIRK will be presenting the family concert in their inimitably amarcord have something special up their sleeve for the open- charming fashion. And OMMM, that astonishingly creative ensemble from France, will be setting off ing concert of the fifteenth a cappella festival! The hosts will musical fireworks at the end of the festival. -

“Intangible” Through Ict
EXPLORING THE “INTANGIBLE” THROUGH ICT A. Antonaci1, P. Bravi2, F. Dagnino1, M. Lutzu2, M. Ott1, S. Pilosu2, F. Pozzi1 1 CNR National Research Council – ITD Institute of Educational Technology Genoa (ITALY) 2 Conservatorio “G. P. Palestrina” Cagliari (ITALY) Abstract In recent times in most EU countries educational policies encourage schools to sustain and promote awareness of local cultures and heritage; as a consequence, spreading knowledge about local traditions is becoming a target also for educators, who need suitable tools and pedagogies, as well as appropriate sources of information. This paper refers to those cultural expressions that are defined by UNESCO as ICH (Intangible Cultural Heritage) and argues that ICT-based tools can contribute to their diffusion and to the “passing down” to the new generations of the rare know- how behind them. After briefly dealing with the concept of ICH and its value within local communities, the paper refers, as an example, to Cantu a Tenore, a typical singing expression from Sardinia-Italy which is listed in the “Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”. The Cantu a Tenore is a cultural practice that is not yet well known outside Sardinia and so far its transmission has been mainly based on practicing together with peers, looking at and listening to master singers. Corrently, Net –Technologies can play a major role in supporting the diffusion of information regarding the Cantu a Tenore and also its “learning” and “transmission”. This feeling is also widespread among the “living human treasures” themselves, namely in those humans who are the depositary of this peculiar and relevant cultural heritage. -

Eurostat – Culture Statistics 2019 Edition
Culture statistics 2019 edition STATISTICAL BOOKS Culture statistics 2019 edition Printed by Imprimerie Bietlot Manuscript completed in September 2019 Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of the following information. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019 Theme: Population and social conditions Collection: Statistical books © European Union, 2019 Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). Copyright for photographs: cover: © toriru/Shutterstock.com; Chapter 1: © Dodokat/ Shutterstock.com; Chapter 2: © dmitro2009/Shutterstock.com; Chapter 3: © Stock-Asso/ Shutterstock.com; Chapter 4: © Gorodenkoff/Shutterstock.com; Chapter 5: © Elnur/Shutterstock. com; Chapter 6: © Kamira/Shutterstock.com; Chapter 7: © DisobeyArt/Shutterstock.com; Chapter 8: © Dusan Petkovic/Shutterstock.com; Chapter 9: © Anastasios71/Shutterstock.com. For any use or reproduction of material that is not under the EU copyright, permission must be sought directly from the copyright holders. For more information, please consult: https://ec.europa.eu/eurostat/about/policies/copyright Print: ISBN 978-92-76-09703-7 PDF: ISBN 978-92-76-09702-0 doi:10.2785/824495 doi:10.2785/118217 Cat. No: KS-01-19-712-EN-C Cat. No: KS-01-19-712-EN-N Abstract Abstract This fourth edition of publication Culture statistics — 2019 edition presents a selection of indicators on culture pertaining to cultural employment, international trade in cultural goods, cultural enterprises, cultural participation and the use of the internet for cultural purposes, as well as household and government cultural expenditure. -

Cultural Heritage
CULTURAL HERITAGE in the LIVE PERFORMANCE SECTOR 25 - 26 MAY 2018 PEARLE 55TH CONFERENCE TALLINN - ESTONIA Editor: Pearle* - Live Performance Europe, Square Sainctelette 19/6, B-Brussels. [email protected], www.pearle.eu Notice: No part of this publication may be reproduced without clear reference to the source. For further information, please contact Pearle*. Publisher: Pearle*- Live Performance Europe (Performing Arts Employers Associations League Europe) Special thanks to: Photographies: Katleen Michiel (page 4), Marc Maillard (page 5), Théâtre Royale de Liège (page 8), Diego Franssens (page 10), Herman Sorgeloos (page 11), Pommelien Koolen (page 14) ; the members of Pearle* for their support. Publication date: April 2018 1 PREFACE The 2018 European Year of Cultural Heritage (EYCH) was launched by the European Commission in December 2017 in Milan, at the occasion of the European Culture Forum. Pearle* - Live Performance Europe took an active part in preparing the EYCH as part of the EU stakeholder group. With this publication, it contributes to the ongoing debate around heritage, gives an insight into the live performance sector and the notion of heritage in various projects set up in different countries and finally provides recommendations to European institutions with the aim to recognise the immense wealth of intangible and tangible heritage in future policy proposals. The EYCH slogan “Our heritage: where the past meets the future” defines actions taken in the live performance sector such as the webpage “On Stage 2018”. This joint project of the European Theatre Convention, Pearle* and Opera Europa highlights the diversity of live events throughout Europe, considering the rich past of cultural heritage and at the same time setting the tone for and building up the heritage of the future, whilst also acknowledging a national dimension of cultural heritage. -
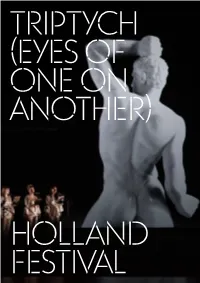
Triptych (Eyes of One on Another) Holland Festival Triptych (Eyes of One on Another)
TRIPTYCH (EYES OF ONE ON ANOTHER) HOLLAND FESTIVAL TRIPTYCH (EYES OF ONE ON ANOTHER) Bryce Dessner Kaneza Schaal Korde Arrington Tuttle Roomful of Teeth Asko|Schönberg thanks to production partner patron this performance has been made possible by this performance is part of the HF Young programme YOUNG Y CONTENT Info & context Credits American Wedding Triptych (Eyes of One on Another) About the artists Friends Holland Festival 2019 Join us Colophon INFO CONTEXT date & starting time introduction Tue 18 June 2019, 8.30 pm by Charlotte van Lingen Wed 19 June 2019, 8.30 pm 7.45 pm venue meet the artist Internationaal Theater Amsterdam, Wed 19 June - after the performance Grote Zaal moderator Charlotte van Lingen running time Eyes on Robert 1 hour 10 minutes 18 June – 31 July no interval Melkweg Expo works by: Ari Versluis, Daan Couzijn, Dustin language Thierry, Dylan van Vliet, Ferry van der English Nat, Henri Verhoef, Martijn Mendel and Vytautas Kumza CREDITS music mover Bryce Dessner Martell Ruffin libretto production Korde Arrington Tuttle ArKtype / Thomas O. Kriegsmann text in collaboration with Essex Hemphill & Patti Smith The Robert Mapplethorpe Foundation direction associate director Kaneza Schaal Lilleth Glimcher music direction associate music director Brad Wells William Brittelle soloists set, costumes Alicia Hall Moran, Isaiah Robinson Carlos Soto performed by light Roomful of Teeth Yuki Nakase Estelí Gomez Abigail Lennox video Martha Cluver Simon Harding Eliza Bagg Eric Dudley production management Thomas McCargar William Knapp -

Book of Abstracts 2
1 INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC 44TH WORLD CONFERENCE 13 - 19 JULY 2017 BOOK OF ABSTRACTS 2 Kai Åberg (University of Eastern Finland) Finnish Romani songs – a product or a process? the constructivist perspective to the music of the Finnish Kaale Over the past 25 years among the Finnish Romani musicians (and elsewhere in Europe), I have sought various things in the empirical material of my research. The basic question, however, was already crystallized in an early stage of the research process: How are the elements of cultural meaning of the songs and the informants’ conceptions of the songs constructed? Because legacies may be constituted in a multiple and flexible way, the purpose of my presentation is not only to describe the songs or events of song culture, or to chart their distribution, but also to seek more complex ways of understanding and explaining them: How are the meanings of the Romani music constructed in different times and places? Although we can be partly freed from determinism by underscoring the role of humans in construction of their own reality, people should not, however, be defined as independent of their culture. Seen from a folkloristic perspective, the same could be said in other terms; even constructivists have not ignored that people belong to their heritage before heritage belongs to them. When speaking of a collective musical tradition we must not forget that underlying tradition there is a social group and people tend to act differently in groups than on their own. My approach is based on the notion of knowledge as socially constructed. -

Hoomei: Tecnica E Performance
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale Tesi di Laurea Hoomei: tecnica e performance Relatore Ch. Prof. Livio Zanini Laureando Garrucciu Marco Matricola 822097 Anno Accademico 2013 / 2014 1 INDICE Abstract Cinese …………………………………..………………………….... pag. 4 Inglese…………………………………..…….……………...……… pag. 5 Introduzione………………………………………………………… pag. 6 Traduzione Abstract….…………………………….……….……………….…. pag. 14 Secondo Capitolo: analisi e performance dello Hoomei…...……. pag. 16 Terzo Capitolo: la relazione tra lo Hoomei e le altre forme musicali tipiche della Mongolia…………………………..…….… pag. 28 Commento Traduttologico ………………………..……………… pag. 38 1. Tipologia testuale ……………………………..…………………... pag. 38 2. Dominante ………………………………..………………………...pag. 39 3. Lettore modello ……………………..……………………………...pag. 40 4. Illustrazione della macrostrategia traduttiva ..……………….….pag. 41 5. Microstrategie ……………………………..…………………….…pag. 42 5.1 Fattori lessicali ……………………………..………………………pag. 43 5.1.1 Nomi propri: toponimi e nomi di persona …………...……….pag. 43 5.1.2 Terminologia tecnica e specifica ……………..…………….pag. 45 5.1.2.1 Termini in lingua mongola ……..……………....pag. 45 5.1.2.2 Realia …………………………..…………….…..pag. 47 5.1.2.3 Lessico tecnico ………………..………………....pag. 50 5.2 Sintassi ……………….………………...……………....pag. 52 2 5.3 Errori del prototesto …………………………………..pag. 55 5.4 Elementi grafici ……………..…………….……...……pag. 58 Glossario ……………………………………………..……………..pag. 60 Conclusioni …………………………………………………………pag. 64 Bibliografia …………………………………………………………pag.