Politique De L'environnement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Permanent Neutrality Treaties
THE PERMANENTNEUTRALITY TREATIES The present European war has thrown into sharp relief the status of those smaller governments which, although in nowise shorn of attributes of sovereignty within their own borders, have nevertheless been placed by virtue of most solemn inter- national guarantees in a position of perpetual neutrality towards all other Powers. They are not to wage offensive warfare, nor, if the obligations resulting from these guarantees are faithfully observed, may their territories be in any degree the theatre of hostilities. While the chief examples of this peculiar status,- Belgium, Luxemburg and Switzerland,-are plainly, by reason of restricted area and population, in no condition to cope with the greater powers surrounding them, it is not alone their lack of size or strength that has marked them out for permanent neutrality or neutralization, but rather their essential relation to the map of Europe and the many conflicting interests innate in its geographical outlines which have seemed to make neces- sary their fixed withdrawal from plans of rivalry or territorial ambition and the creation in this manner of certain inter-spaces destined for peace whatever may be the fate of their more powerful neighbors. The precise conditions of such a neutrality are to be found in a long line of treaties and agreements comprising within their horizon a great variety of objects. For the purpose of the present examination, however, we shall lay out of detailed view all aspects of permanent neutrality save those attaching to the three governments just named since to consider the various phases of the subject would require much more space than that at the disposal of a single article. -

01 Diss Cover Page
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860-1880 Permalink https://escholarship.org/uc/item/8dj2f20d Author Sawchuk, Mark Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge Professor Carla Hesse, Chair Professor James P. Daughton Professor John Connelly Professor Jonah Levy Spring 2011 The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 Copyright 2011 Mark Alexander Sawchuk Abstract The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Carla Hesse, Chair Using the French philosopher Ernest Renan’s dictum that the “nation’s existence is ... a daily plebiscite” as an ironic point of departure, this dissertation examines the contours of oppositional political culture to the French annexation of the County of Nice and the Duchy of Savoy in 1860. Ceded by treaty to France by the northern Italian kingdom of Piedmont-Sardinia, these two mountainous border territories had long been culturally and geo-strategically in the French orbit. Unlike their counterparts in any other province of France, the inhabitants of the two territories were asked to approve or reject the annexation treaty, and thus their incorporation into France, in a plebiscite employing universal male suffrage. -

Habitations Du Xiiie Siècle À Hermance
Habitations du XIIIe siècle à Hermance Autor(en): Bujard, Jacques Objekttyp: Article Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte = Revue suisse d'art et d'archéologie = Rivista svizzera d'arte e d'archeologia = Journal of Swiss archeology and art history Band (Jahr): 46 (1989) Heft 3 PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-168995 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Habitations du XIIIe siècle à Hermance par Jacques Bujard ¦»'.< - 'r- ..- '-¦•>•,; ¦•¦-:< -S- "À 7 <¦¦¦ Ji3 Jj Äfei.J. m Hermance et le Jura * C012 PHARNACX fRÈRES Sj Ç°,, pENÈvE * i Fig. -
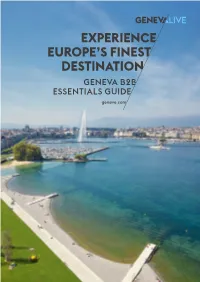
Essentials Guide
EXPERIENCE EUROPE’S FINEST DESTINATION GENEVA BB ESSENTIALS GUIDE geneve.com / EXPLORE THE CITY’S DIVERSE ANDWith its prime FUN location on EXPERIENCES the banks of Lake Geneva, the city provides breathtaking views and serves as the ideal starting point to the Alps. Geneva is renowned as the cradle of / THE ESSENTIALS luxury watchmaking and the place with the most exclusive boutiques. Playing an important humanitarian role, the “Peace Capital” is also the meeting place of the world's business leaders. Geneva is more fun than you can imagine! The vibrant cultural life and world-class events of this cosmopolitan boutique town offer experiences to cherish forever. 1 The best starting point to the Alps, Geneva is located only 1 hour away from Mont-Blanc, Europe's highest mountain at 4,810 m (15,776 ft) 2 The birthplace of Haute Horlogerie and the world centre of luxury watchmaking which showcases the world's best watchmaking manufacturers 3 Capital of Peace & Freedom the international city is home to the UN European Headquarters and the birthplace of the Red Cross 4 The city offers a vibrant cultural life with its unique museums, world-acclaimed events and the Bains district dedicated to contemporary art / CHECK OUR ONLINE PLATFORMS FOR ALL THE LATEST NEWS IN GENEVA 5 A gourmet paradise Go online to explore all the latest events, news where local delicacies, top quality and activities, get inspired and find everything you products and haute cuisine co-exist need for a visit to Geneva in 7 different languages. in the city's 60 award-winning -

Centre D'hébergement Collectif D'anières
CENTRE D’HÉBERGEMENT COLLECTIF D’ANIÈRES (capacité de 263 personnes) Adresse du centre : Chemin des Ambys 65 1247 Anières N° du Centre : 022 420 54 00 UN PEU D’HISTOIRE… C’est l’histoire d’un bâtiment du 19ème siècle perdu au milieu de la campagne aniéroise. Entouré de champs à perte de vue, il accueille, depuis une quinzaine d’années environ, un centre de requérants d’asile. L’histoire de cette immense bâtisse est peu connue de la population locale. Pourtant, elle a derrière elle un passé singulier. Un hôpital pour les indigents Tout commence en 1873, au décès du duc de Brunschwig. Ce personnage, fantasque et original, lègue sa fortune entière à la ville de Genève. De nombreux bâtiments sont construits grâce à cet argent et notamment, à Anières, un centre d’accueil pour des personnes âgées indigentes. Cet hôpital, ancêtre de l’Hospice général, fonctionne jusqu’au début du 20ème siècle, avant de devenir, entre les deux guerres, un centre de formation pour gardes-frontières. Former des jeunes juifs A la fin de la seconde guerre mondiale, le bâtiment est racheté par l’ORT (Organisation, Reconstruction, Travail). Cette organisation hébraïque, créée en 1881, à Saint Pétersbourg, a pour objectif de former les jeunes juifs à travers le monde. En 1947, un des leaders de l’ORT, Aaron Syngalowski, décide de créer un institut pour la formation d’enseignants et de cadres et l’installe au centre d’Anières. La shoah a décimé une grande partie de la population juive en Europe et a fait disparaître avec elle des pans entiers de connaissances et de compétences. -

3150 Lausanne-Ouchy - Genève (Lac Léman) État: 7
ANNÉE HORAIRE 2020 3150 Lausanne-Ouchy - Genève (Lac Léman) État: 7. Octobre 2019 15.12.–9.04., 26.10.–12.12. 331 491 493 Lausanne-Ouchy (lac) 20 00 St-Sulpice VD (lac) Morges (lac) 20 30 22 45 St-Prex (lac) Rolle (lac) Yvoire (F) (lac) Yvoire (F) (lac) Nernier (F) (lac) Nyon (lac) Nyon (lac) 13 40 Céligny (lac) Hermance (lac) Coppet (lac) 14 05 Versoix (lac) 14 20 Anières (lac) Corsier GE (lac) Genève-Eaux-Vives (lac) Genève-Pâquis (lac) Genève-Jardin-Anglais (lac) Genève-Mt-Blanc (lac) 14 55 3150 Genève - Lausanne-Ouchy - (Lac Léman) État: 7. Octobre 2019 15.12.–9.04., 26.10.–12.12. 330 492 494 Genève-Mt-Blanc (lac) 12 20 Genève-Jardin-Anglais (lac) Genève-Pâquis (lac) Genève-Eaux-Vives (lac) Corsier GE (lac) Anières (lac) Versoix (lac) 12 50 Coppet (lac) 13 05 Hermance (lac) Céligny (lac) Nyon (lac) 13 30 Nyon (lac) Nernier (F) (lac) Yvoire (F) (lac) Yvoire (F) (lac) Rolle (lac) St-Prex (lac) Morges (lac) 20 30 St-Sulpice VD (lac) Lausanne-Ouchy (lac) 22 10 23 15 1 / 5 ANNÉE HORAIRE 2020 3150 Lausanne-Ouchy - Genève (Lac Léman) État: 7. Octobre 2019 10.4.–20.6., 7.9.–25.10. 321 421 365 105 327 491 387 493 Lausanne-Ouchy (lac) 10 50 14 05 20 00 St-Sulpice VD (lac) 11 07 14 22 Morges (lac) 11 24 14 39 20 30 22 45 St-Prex (lac) 11 39 14 54 Rolle (lac) 12 08 15 22 Yvoire (F) (lac) 12 35 15 52 Yvoire (F) (lac) 12 05 12 40 13 45 15 55 16 45 Nernier (F) (lac) 12 47 16 02 Nyon (lac) 13 02 16 17 17 05 Nyon (lac) 16 25 17 10 Céligny (lac) Hermance (lac) Coppet (lac) 16 55 17 35 Versoix (lac) 17 10 17 50 21 25 Anières (lac) Corsier GE (lac) Genève-Eaux-Vives (lac) 17 35 Genève-Pâquis (lac) 14 55 18 25 22 00 Genève-Jardin-Anglais (lac) 15 00 18 30 22 10 Genève-Mt-Blanc (lac) 13 05 17 45 3150 Genève - Lausanne-Ouchy - (Lac Léman) État: 7. -

Living in Geneva: the Intern’S Perspective 18 with Ms
THE OFFICIAL MAGAZINE OF INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS Founded in 1949 FEATURED / À LA UNE Interview with Ambassador LIVING IN Salman Bal, Director of CAGI – p.8 GENEVA WHO / OMS Coaching. How to create cultures that value connection and staff engagement – p. 34 UNITED NATIONS / NATIONS UNIES ICSC global staff survey. Please read this before you answer – p. 36 791 – JUL-AUG 2019 Thinksafer,BETTER, longerliving. Supplemental health insurance for UN, ILO and WHO staff members New attractive conditions 2019 www.gpafi.org www.uniqa.ch Werbung 1114_19_Inserat_Denk_sicher_besser_laenger_leben_A4abf.indd 1 19.06.19 16:49 ALEXANDER MEJIA © atelier-schnegg.ch Editor-in-chief / Rédacteur en chef EDITOR’S NOTE / ÉDITORIAL 3 When we decided to focus on living in Lorsque nous avons décidé de consacrer Geneva for the summer issue, we did it with le numéro d'été à la vie à Genève, nous FEATURED / À LA UNE our readers interests in mind. Geneva offers l'avons fait dans l'intérêt de nos lecteurs. The world’s smallest metropolis 5 unique opportunities, but is one of the most Genève offre des opportunités uniques mais Interview with Ambassador Salman Bal, expensive cities in the world and living here c’est l'une des villes les plus chères du Director of CAGI 8 can be challenging. In this edition, we have monde, et vivre ici peut vite devenir un provided selected information about the défi. Nous avons voulu apporter des infor- Public Transportation in Geneva. Interview with Ms. Anne Hornung- most pressing questions for any newcomer. mations substantielles sur les questions les Soukup, Chair of the Board of TPG 10 plus pressantes pour tout nouvel arrivant. -

A Guide to a Joyful Summer in Geneva for Parents of 2-5 Year Olds
STAYCATION JULY 2017 a guide to a joyful summer in Geneva for parents of 2-5 year olds Edition 2017 Written by Olga Sokolik This guide was created to help make summer in Geneva a little bit easier (and fun!) especially for those with children aged 2-5 years. Some of the options are suitable for younger and older kids too - adults included! At least one activity has been proposed per day for the duration of the summer holidays. Additionally, at the end you'll find a list of "When it rains" places, as well as air-conditioned options for when heatwaves hit. Even though Geneva has a lot to offer to younger kids, this guide also includes places that are up to 1.5h drive away from the city. There is no better time than summer to check them out! You can stick to the planner or simply use it as inspiration, or a guide to new places. I wish you a great summer staycation! Olga Sokolik Parentville.ch Find what you need, share what you know Without written consent from the owner of Parentville.ch, no portion of this copyrighted ebook may be reproduced or copied. The publisher and the author do not assume, thereby disclaiming, any liability to any individual for any loss or damage caused by inacuracy. Copyright © 2017 Parentville. All rights reserved. Book design and production by Parentville.ch Written by Olga Sokolik www.parentville.ch BEFORE YOU START In order to make the guide easy to use, each activity has been linked to a specific date. -

Welcome Booklet 2021-2022 Daycare Centre
Welcome booklet 2021-2022 Daycare centre Contents 1 INTRODUCTION AND GENERAL PRINCIPLES ............................................................... 3 2 CHILDCARE OPTIONS ........................................................................................................... 3 2.1 TODDLERS’ NURSERY FROM 8:00 AM TO 12:00 PM............................................................... 3 2.2 OPEN-PLAN DAYCARE CENTRE – MORNINGS FROM 8:00 AM TO 12:00 PM ........................... 3 2.3 OPEN-PLAN DAYCARE CENTRE – MORNINGS & AFTERNOONS WITH LUNCH-NAP- WORKSHOP FROM 8:00 AM TO 4:00 PM............................................................................................ 4 3 ADMISSION AND REGISTRATION ..................................................................................... 4 3.1 ADMISSION PRIORITIES .......................................................................................................... 4 3.2 REGISTRATION ....................................................................................................................... 4 3.3 SCHOOL FEES ......................................................................................................................... 5 3.4 INCOME EVALUATION ............................................................................................................ 5 3.5 SCHOOL FEES’ TABLE ............................................................................................................ 6 3.6 DEFINITION OF THE MONTHLY SCHOOL FEES ....................................................................... -

Cham'art Organise Une Exposition Au Grand
Lundi 17 mai 2021 Sommaire Bellevue Tribune Journal des communes Un vieux chêne casse 2 d’Anières, Bellevue, Choulex, Anières Recyclez vos vélos! 3 Cologny, Corsier, Genthod, Cologny Hermance, Meinier, Des Unes au musée 4 Pregny-Chambésy Rives-Lac Editeur: La Tribune de Genève SA. Rédactrice responsable: Stéphanie Jousson. Prochaine parution: [email protected] Tél. 022 733 40 31 Lundi 7 juin Pregny-Chambésy accueille cette année Le covoiturage semble la deuxième étape du Tour du Canton de Genève avoir de l’avenir à Meinier On va courir pendant un l’édition 2021. La Commune de au 20 juin. Les participants pour- également prévu une catégorie qui Une nouvelle association seuls à aller faire leurs courses, mois sur les chemins Pregny-Chambésy a décidé de ront télécharger une application s’adresse aux marcheurs. est née dans notre village. deux amis y aillent ensemble. de la commune. maintenir son engagement en qui leur permettra durant un mois Attention au nombre de Les coûts de consommation de accueillant la deuxième étape, – en respectant les dates du tour – places limitées. Si l’événement C’est l’histoire de trois voisins, la voiture sont évalués et gérés bé- La course du Tour du Canton de comme prévu en 2020. de réaliser cette course pédestre ac- sportif devait être annulé due à d’amis, qui réalisent ne pas névolement par une comptable. Genève ayant été annulée l’an- tive sur notre canton depuis vingt- la situation sanitaire, les frais avoir besoin de leur voiture ré- Un pécule est aussi mis de côté née dernière pour des raisons Inscriptions six ans. -

20 Ans De Renaturation Des Cours D'eau À Genève
20 ANS DE RENATURATION DES COURS D’EAU À GENÈVE 20 ANS DE RENATURATION DES COURS D’EAU À GENÈVE Département du territoire – Office cantonal de l’eau – Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche du canton de Genève Sommaire 20 ans de renaturation des cours d’eau à Genève 5 100~ réalisations en 20 ans 9 Rive gauche ~ L’Hermance 17 ~ Nant d’Aisy 25 ~ La Haute-Seymaz 31 ~ La Seymaz urbaine 39 ~ Le Foron 45 ~ L’Arve 53 Entre Arve et Rhône ~ La Drize 59 ~ L’Aire 67 ~ Nant de Couchefatte 77 Rive droite ~ Le Rhône 85 ~ L’Allondon et ses affluents 91 ~ Nant d’Avril 97 ~ Le Marquet, Gobé, Vengeron 105 ~ Nant de Braille 111 ~ Le Brassu 119 ~ La Versoix 127 Lac Léman ~ Chens-sur-Léman 141 ~ Rive-Belle 147 ~ Quai de Cologny 151 ~ Les Eaux-Vives 157 Détail des 100 réalisations en 20 ans 165 Synthèse et musique d’avenir 169 Mandataires 171 3 20 ans de renaturation des cours d’eau à Genève Antonio Hodgers Conseiller~ d’État en charge du Département du territoire Vingt ans, l’âge de raison, a-t-on coutume de Dès la fin du Moyen Âge, l’eau offrit l’occasion dire… Cette phrase, que l’on tient le plus sou- de procurer de nouvelles voies pour le trans- vent pour un lieu commun, est pourtant particu- port de marchandises, par le creusement de lièrement recevable en ce qui concerne la canaux, dont l’ampleur ira grandissant jusqu’à renaturation des cours d’eau à Genève. -

Hermance Rouvre Une Auberge Pieds Dans L'eau
Tribune de Genève | Lundi 1er juin 2015 Genève communes 19 Restauration Nouvelle ligne U: tracé et terminus retenus Hermance rouvre une Chavannes-des-Bois Château de Chavannes Observatoire VAUD Prolongement auberge pieds dans l’eau possible ROUTE DE SAUVERNY FRANCE La Commune a investi de gros montants. E62 Versoix Un chef étoilé cuisinera… aussi GENÈVE pour la cantine ROUTE DE L'ÉTRAZ scolaire DE SAINT-LOUPROUTE Richelien Lac Luca Di Stefano Léman G. LAPLACE. SOURCE: TPG. La date d’inauguration n’a rien de hasardeux. Hier, Hermance a fêté l’ouverture du café-restaurant du Quai, dont la Commune sera pro- Versoix aura enfin sa priétaire. Au même moment, une législature laisse place à la sui- vante. «Ce projet, c’était le bébé ligne de bus TPG interne de l’ancien maire. Il avait fixé cette date pour terminer en V. Principal objectif: réduire le tra- beauté», rappelle Karine Bruchez Le Municipal accepte le fic d’entrée et de sortie de la com- Gilberto, maire actuelle, réélue en financement d’une desserte mune ainsi que l’utilisation de voi- avril. entre Richelien et tures personnelles à l’intérieur de Celui qu’on appelle toujours Chavannes-des-Bois celle-ci. «le maire» à Hermance, c’est Ber- La commission a accepté l’en- nard Laperrousaz, en poste de- GEORGES CABRERA Les Versoisiens l’attendaient de- gagement de 350 000 francs du- puis 1991 et décédé en 2014. La cheffe Karine Manifacier (à g.) ouvrait hier le restaurant du Quai avec la maire Karine Bruchez Gilberto. puis des années, le magistrat sor- rant trois ans.