Plan Local D'urbanisme De La Commune De Brumath Et Constitue Une Servitude D'utilité Publique (SUP)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Strasbourg > Haguenau
Fiche Horaire 04 Strasbourg > Haguenau 0 805 415 415 Du 17 juillet 2021 au 11 décembre 2021 Mise à jour le : 24 juin 2021 Du lundi au vendredi O O O O O O O O O O O 1 O O 2 Strasbourg 6.00 6.18 6.51 7.0 3 7.07 7.35 7. 51 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.21 12.05 12.35 12.51 13.05 13.35 14.05 14.35 15.03 15.35 15.51 16.05 16.21 16.25 16.35 16.51 16.55 17.0 3 17.21 17.25 17.35 17. 51 17. 55 18.03 Mundolsheim 6.06 | | | 7.13 7. 41 | 8.11 8.41 9.11 | 10.11 10.41 11.11 | 12.11 12.41 | 13.12 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.11 | | 16.41 | | 17. 0 9 | | 17. 4 2 | | 18.10 Vendenheim 6.09 | | | 7.16 7. 4 4 | 8.15 8.44 9.14 | 10.14 10.44 11.14 | 12.14 12.44 | 13.15 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.15 | 16.32 | | 17. 0 2 17.12 | 17. 3 2 17. 4 5 | 18.03 18.13 Hoerdt 6.15 | | | 7. 2 2 7. 5 0 | 8.20 8.50 9.20 | 10.20 10.50 11.20 | 12.20 12.50 | 13.20 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.20 | | 16.48 | | 17.18 | | 17. 5 0 | | 18.18 Weyersheim 6.18 | | | 7. -

RAPPORT ET CONCLUSIONS Du Commissaire-Enquêteur
PREFECTURE DU BAS-RHIN ENQUETE PUBLIQUE du 16 octobre au 16 novembre 2018 en Mairie de HOERDT (BAS-RHIN) concernant la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Gravières d’Alsace Lorraine pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une gravière à Hoerdt RAPPORT ET CONCLUSIONS du Commissaire-Enquêteur Marie KAM-LARQUE - Commissaire-Enquêteur 11 rue de Labaroche - 67100 Strasbourg - Tél. 03 89 83 12 67 - 06 23 60 94 25 Demande d’autorisation environnementale présentée par la société Gravières d’Alsace Lorraine pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une gravière à Hoerdt Enquête Publique du 16 octobre 2018 au 16 novembre 2018 SOMMAIRE RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 2 2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 3 2.1 Désignation du Commissaire-Enquêteur 3 2.2 Elaboration de l’Arrêté Préfectoral 4 2.3 Information du public 4 2.4 Démarches préalables 5 2.5 Dossier d’enquête 5 2.5 Déroulement de l’enquête 6 3. ANALYSE COMPTABLE DES OBSERVATIONS 7 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 1. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE 10 2. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 10 3. COMMENTAIRES SUR LE PROJET 11 4. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 17 ANNEXES Demande d’autorisation environnementale présentée par la société Gravières d’Alsace Lorraine pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une gravière à Hoerdt Enquête Publique du 16 octobre 2018 au 16 novembre 2018 ENQUETE PUBLIQUE concernant la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Gravières d’Alsace Lorraine pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une gravière à Hoerdt RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 1/17 Demande d’autorisation environnementale présentée par la société Gravières d’Alsace Lorraine pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une gravière à Hoerdt Enquête Publique du 16 octobre 2018 au 16 novembre 2018 1. -
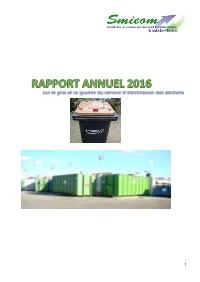
Introduction
1 INTRODUCTION LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 1. TERRITOIRE DESSERVI 2. QUELQUES CHIFFRES LES DECHETERIES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ET COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE INDICATEURS FINANCIERS 2 Introduction Le SMIEOM assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés composé de deux Communautés de Communes membres, pour 24 Communes soit près de 60 000 habitants. Les Services Administratifs et Techniques de la collectivité se composent : Service Administratif : Une Directrice des Services Administratifs Deux Agents Les bureaux se situent à Drusenheim. Service Technique : Un Directeur des Services Techniques 10 Agents dont 1 en longue maladie 5 déchèteries sont à disposition des usagers sur le Territoire : Bischwiller, Drusenheim, Gambsheim, Roeschwoog et Sessenheim. 3 La collecte des déchets ménagers 1. TERRITOIRE DESSERVI Au 1er janvier 2016, le Syndicat se compose de deux Communautés de Communes, celle de Bischwiller et Environs qui comptabilise 6 Communes et 23 248 habitants et celle du Pays Rhénan qui comptabilise 18 Communes et 36384 habitants, adhérentes au SMIEOM. Populations légales en vigueur au 1er janvier 2016 sur la base 2013 Nom de la commune Population Population Population totale municipale comptée à part BISCHWILLER 12 718 151 12 869 KALTENHOUSE 2 220 23 2 243 OBERHOFFEN SUR MODER 3 419 44 3 463 23 248 ROHRWILLER 1 708 14 1 722 SCHIRRHEIN 2 212 30 2 242 SCHIRRHOFFEN 703 6 709 AUENHEIM 913 5 918 DALHUNDEN 1 010 12 1 022 DRUSENHEIM 5 090 53 5 143 FORSTFELD 729 5 734 FORT-LOUIS 312 3 315 GAMBSHEIM 4 615 54 4 669 HERRLISHEIM 4 818 50 4 868 KAUFFENHEIM 211 2 213 KILSTETT 2 555 36 2 591 36 384 LEUTENHEIM 854 10 864 NEUHAEUSEL 359 2 361 OFFENDORF 2 352 22 2 374 ROESCHWOOG 2 291 42 2 333 ROPPENHEIM 951 15 966 ROUNTZENHEIM 1 063 20 1 083 SESSENHEIM 2 201 20 2 221 SOUFFLENHEIM 4 946 64 5 010 STATTMATTEN 689 10 699 TOTAL 58 939 693 59 632 59 632 4 2. -

Info-G-2015.Pdf
N° 38 Janvier 2015 Gambsheim journal d'informations municipales de gambsheim www.mairie-gambsheim.fr InfoG_38-2015.indd 1 16/01/15 09:35 Sommaire journal d'informations municipales de Gambsheim 2015 Le mot du Maire..........................................................................p. 3 Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim ............p. 22 - 23 Installation du Conseil Municipal ...........................................p. 4 - 5 (Juillet, août, septembre, octobre) Il se passe toujours quelque chose à Gambsheim ................p. 6 - 7 Mémoire collective (Janvier, février, mars, avril) 75e anniversaire de l’évacuation vers la Haute-Vienne ..p. 24 - 25 Délibérations du Conseil Municipal 2014 ....................................p. 8 Les honorés de la commune .....................................................p. 26 Recensement de la population .....................................................p. 8 Mouvements de personnel ........................................................p. 26 Il y a 50 ans ..................................................................................p. 9 Canal Gambsheim Extraits de délibérations du Conseil Municipal de 1964 20 ans déjà... ..........................................................................p. 27 Top 20 des aînés ..........................................................................p. 9 Les grands anniversaires ...........................................................p. 27 Intercommunalité La Société de Gymnastique de Gambsheim Le Pays Rhénan - 1er anniversaire..........................................p. -

Strasbourg > Haguenau
Fiche Horaire 04 Strasbourg > Haguenau 0 805 415 415 Horaires valables du 28 avril au 2 mai : circulations adaptées dans le cadre des mesures sanitaires. Mise à jour le : 28 avril 2021 Du lundi au vendredi 1 1 1 c c c Strasbourg 6.00 6.18 6.51 7.35 7. 51 8.05 10.05 11.05 12.05 12.35 13.05 14.05 15.03 15.35 16.05 16.21 16.25 16.35 17.0 3 17.21 17.25 17.35 17. 51 18.35 18.51 19.03 19.25 19.51 21.25 22.25 23.25 Mundolsheim 6.06 | | 7. 41 | 8.11 10.11 11.11 12.11 12.41 13.12 | | 15.41 16.11 | | 16.41 17. 0 9 | | 17. 4 2 | 18.41 | 19.09 | 19.58 | | | Vendenheim 6.09 | | 7. 4 4 | 8.15 10.14 11.14 12.14 12.44 13.15 | | 15.44 16.15 | 16.32 | 17.12 | 17. 3 2 17. 4 5 | 18.44 | 19.12 19.32 20.01 | | | Hoerdt 6.15 | | 7. 5 0 | 8.20 10.20 11.20 12.20 12.50 13.20 | | 15.50 16.20 | | 16.48 17.18 | | 17. 5 0 | 18.50 | 19.18 | 20.06 | | | Weyersheim 6.18 | | 7. 5 3 | 8.23 10.23 11.23 12.23 12.53 13.23 | | 15.53 16.23 | | 16.51 17. 21 | | 17. 5 3 | 18.53 | 19.21 | 20.09 | | | Kurtzenhouse 6.21 | | 7. 5 6 | 8.27 10.26 11.27 12.27 12.56 13.27 | | 15.56 16.27 | | 16.54 17. -

Touristische Landkarte
PASSAGE309 - RHEINAREAL TOURIST INFO 8 Musée de la poterie / 12 Maison rurale de l’Outre-Forêt / 18 Maison de l’archéologie avec 25 Musée de la bataille du 6 août 34 Die Kasematte Rieffel Außerdem, GAMBSHEIM-RHEINAU PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG Töpfermuseum Das Landhaus von Outre-Forêt sa maison du néolithique / Haus 1870 / Museum der Schlacht vom In Oberroedern Kasematten in Dambach TOURISMUS PAVILLON Eine reiche Kollektion alter und Alter Bauernhof, der restauriert und der Archäologie mit dem Haus 6. August 1870 Tel. +33 (0)3 88 80 01 35 Tel. +33 (0)3 88 09 21 46 2 avenue du Général Schneider zeitgenössischer Keramikwaren in in ein Museum umgebaut wurde. des Neolithikums Dieses Museum ist der Schlacht vom Heidenbukel in Leutenheim Ecluses du Rhin F-67470 SELTZ Präsentation des elsässischen 6. August 1870 gewidmet, die auch „die einem herrlichen Bauernhof. Archäologische Forschung im Nord- 35 Die Infanterie-Kasematte Esch Tel. +33 (0)3 88 86 40 39 F-67760 GAMBSHEIM Tel. +33 (0)3 88 05 59 79 Kulturerbes. Schlacht von Reichshoffen“ genannt wird. Betschdorf Elsass, von der Vorgeschichte bis Tel. +33 (0)3 88 96 44 08 [email protected] Kutzenhausen Woerth In Hatten Tel. +33 (0)3 88 54 48 07 [email protected] www.tourisme-pays-seltz- Tel. +33 (0)3 88 80 53 00 zum industriellen Zeitalter. Überreste Tel. +33 (0)3 88 09 30 21 Tel. +33 (0)3 88 80 96 19 www.betschdorf.com www.passage309.eu lauterbourg.fr www.maison-rurale.fr der ehemaligen römischen Therme. http://webmuseo.com/ws/ Niederbronn-les-Bains musee-woerth 30 Musée français du pétrole / 5 Cave vinicole de Cléebourg / 13 Musée d’arts et traditions Tel. -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture
ISSN 0299-0377 PRÉFECTURE DU BAS-RHIN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE ANNEE 2010 BIMENSUEL N° 17 1er septembre 2010 RAA N° 17 du 1 ER septembre 2010 1033 RAA N° 17 du 1 ER septembre 2010 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE Année 2010 - N° 17 1er septembre 2010 S O M M A I R E INFORMATIONS GENERALES Les textes cités peuvent être communiqués ou consultés dans leur version intégrale sous le timbre des services concernés Le recueil des actes administratifs est consultable sur le site : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr rubrique « publications officielles » ACTES ADMINISTRATIFS MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau des Cultes - Culte catholique : nominations – 21.06.2010 ……………………………………………….. 1037 - Culte protestant : nominations – 18.05.2010 au 26.07.2010 ………………………………… 1037 AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE - Nomination du Délégué Territorial Adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine du département du Bas-Rhin : M. David TROUCHAUD , Sous-Préfet chargé de mission auprès du Préfet de la Région Alsace – 06.05.2010 ………………………………… 1039 SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DES AFFAIRES CIVILES ET ECONOMIQUES DE DEFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE - Arrêté préfectoral relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs : liste des communes concernées – 19.08.2010 …………………………………………. 1040 commune de DORLISHEIM – 19.08.2010 ……………………………………………. 1048 commune de MOLSHEIM – 19.08.2010 ………………………………………………. 1049 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Bureau de la Réglementation - Aménagement commercial : décisions – 19.08.2010 ……………………………………….. 1049 ZEEMANN et OPTICAL CENTER, RD 1004 à OTTERSWILLER ensemble commercial, rue du Fossé des Treize à STRASBOURG ensemble commercial, rue du Général Leclerc à OBERNAI Bureau de la Circulation Routière - Autorisation d'une manifestation motorisée (Motos et Quads) le 29 août 2010 sur le ban communal de DORLISHEIM – 20.08.2010 ……………………………………………….. -

Le Canal De La Marne Au Rhin
CANAUX ET VÉLOROUTES D’ALSACE Wasserwege und Fernradwege im Elsass Waterways and Cycle routes in Alsace Waterwegen en Fietspaden in de Elzas 5 Sarre-UnionLe canal de la Marne au Rhin | 86 km 3.900 KM 4 km EUROVÉLO 5 : Harskirchen (Section Réchicourt > Strasbourg)(Abschnitt Réchicourt > Straßburg) 17 km (Section Réchicourt > Strasbourg) Sarrewerden Der Rhein Marne Kanal Ecluse 16 /Altviller 16 The Rhine-Marne canal(stuk Réchicourt > Straatsburg) 5 Marne-Rijnkanaal PARC NATUREL 2H30 Diedendorf RÉGIONAL 13 km 14 ALSACE BOSSUE DES VOSGES DU NORD HAGUENAU Mittersheim 13 Fénétrange Schwindratzheim 10,7 km 64 Mutzenhouse Bischwil St-Jean-de-Bassel 11,5 km 6 H 20 km Niederschaeffolsheim Albeschaux Steinbourg Waltenheim 5 H Hochfelden 87 2H 44 sur Zorn Henridorff 37 Rhodes Langatte 41 en cana SAVERNE 4,3 km Brumath nci l 4,8 km A liger Ka ma na 5 km 1 SARREBOURG e er can l 8,2 km 4 h rm al 20 3 H 30 11 km e o F 31 Zornhoff Dettwiller 3H30 6,5 km Monswiller Lupstein Wingersheim Niderviller Vendenheim Kilstett 10 km 5 H Houillon Lutzelbourg Mittelhausen Reichstett Arzviller Saint-Louis 5 km GONDREXANGE 2H45 Guntzviller Marmoutier 2H30 Plaine-de-Walsch Souffelweyersheim 18 Hesse Hohatzenheim 3,8 km Xouaxange Bischheim La Landange 1H15 RÉCHICOURT Schiltigheim KOCHERSBERG 51 15,8 km 15,8 5 km 15,8 Kehl 6 9 km 857 Offe STRASBOURG 85 Bas-Rhin 1 2 3 5 6 7 LORRAINE (F) 9,2 km LOTHRINGEN 2H30 Neuried (D) PFALZ (D) Lauterbourg 6,7 km BAS-RHIN Plobsheim ALSACE 1H Réchicourt Strasbourg LORRAINE 3 km 80 BADENKrafft Colmar SCHWARZWALD (D) Fribourg (DE) Mulhouse -

Zones PTZ 2017
Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 67 Bas-Rhin Adamswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Albé Alsace C 67 Bas-Rhin Allenwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Alteckendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Altenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Altwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Andlau Alsace C 67 Bas-Rhin Artolsheim Alsace C 67 Bas-Rhin Aschbach Alsace C 67 Bas-Rhin Asswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Auenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Baerendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Balbronn Alsace C 67 Bas-Rhin Barembach Alsace C 67 Bas-Rhin Bassemberg Alsace C 67 Bas-Rhin Batzendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Beinheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bellefosse Alsace C 67 Bas-Rhin Belmont Alsace C 67 Bas-Rhin Berg Alsace C 67 Bas-Rhin Bergbieten Alsace C 67 Bas-Rhin Bernardvillé Alsace C 67 Bas-Rhin Berstett Alsace C 67 Bas-Rhin Berstheim Alsace C 67 Bas-Rhin Betschdorf Alsace C 67 Bas-Rhin Bettwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Biblisheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bietlenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bindernheim Alsace C 67 Bas-Rhin Birkenwald Alsace C 67 Bas-Rhin Bischholtz Alsace C 67 Bas-Rhin Bissert Alsace C 67 Bas-Rhin Bitschhoffen Alsace C 67 Bas-Rhin Blancherupt Alsace C 67 Bas-Rhin Blienschwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Boesenbiesen Alsace C 67 Bas-Rhin Bolsenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Boofzheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bootzheim Alsace C 67 Bas-Rhin -

0 CC De La Basse- Zorn 0 Foncier Portrait
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier CC de la Basse- Bietlenheim, Geudertheim, Gries, H?rdt, Kurtzenhouse, Weitbruch, Weyersheim Zorn 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC de la Basse-Zorn Périmètre Communes membres 01/2019 7 ( Bas-Rhin : 7) Surface de l'EPCI (km²) 80,63 Dépt Bas-Rhin Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 213 Poids dans la ZE Haguenau*(60,4%) Strasbourg(39,6%) ZE 161 Pop EPCI dans la ZE Haguenau(5,1%) Strasbourg(1,2%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 16 890 2016 17 189 Évolution 2006 - 2011 108 hab/an Évolution 2011 - 2016 60 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Hoerdt 4 324 25,2% Weyersheim 3 335 19,4% 0 Weitbruch 2 863 16,7% Gries 2 861 16,6% Geudertheim 2 491 14,5% Kurtzenhouse 1 049 6,1% Bietlenheim 266 1,5% - - - - - - - - - Données de cadrage Évolution de la population CC de la Basse-Zorn CC de la Evolution de la population depuis 1968 Composante de l'évolution de la population en base 100 en 1962 de 2011 à 2016 (%) 160 3% 2,0%1,9% 140 2% 1,8% 1,3% 2% 1,1% 120 1% 0,8% 0,8% 0,4% 1% 0,3% 100 0,0% 0,1% 0% 80 -1% -1% 60 -0,8% 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 EPCI ZE Département Grand Est Région Département ZE EPCI Evolution totale Part du solde naturel Part du solde migratoire Age de la population Population par tranches d'âge (2016) Part des + de 74 ans dans la population 30% 9,5% 9,3% 24,2% 9,0% -

(M Supplément) Administration Générale Et Économie 1800-1870
Archives départementales du Bas-Rhin Répertoire numérique de la sous-série 15 M (M supplément) Administration générale et économie 1800-1870 Dressé en 1980 par Louis Martin Documentaliste aux Archives du Bas-Rhin Remis en forme en 2016 par Dominique Fassel sous la direction d’Adélaïde Zeyer, conservateur du patrimoine Mise à jour du 19 décembre 2019 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) Page 2 sur 204 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) XV. ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE COMPLEMENT Sommaire Introduction Répertoire de la sous-série 15 M Personnel administratif ........................................................................... 15 M 1-7 Elections ................................................................................................... 15 M 8-21 Police générale et administrative............................................................ 15 M 22-212 Distinctions honorifiques ........................................................................ 15 M 213 Hygiène et santé publique ....................................................................... 15 M 214-300 Divisions administratives et territoriales ............................................... 15 M 301-372 Population ................................................................................................ 15 M 373 Etat civil ................................................................................................... 15 M 374-377 Subsistances ............................................................................................ -

Bulletin Départemental D'information 07/2020
Bulletin Départemental d’Information n° 07/2020 Modalités de mise à disposition du public En application de l’article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales et selon les termes du décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993, sont publiés dans le recueil des actes administratifs, le dispositif des délibérations du Conseil Départemental et des délibérations de la Commission Permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du Conseil Départemental, à caractère réglementaire. *** L’intégralité des délibérations et des annexes aux délibérations de l’Assemblée Plénière et de la Commission Permanente, ainsi que la retranscription intégrale des débats de l’Assemblée Plénière, peuvent être consultées : - Au Service des Ressources Info-Documentaires à l’Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc 67964 STRASBOURG Cedex - Sur le site Internet www.bas-rhin.fr>rubrique « Le Conseil Départemental » ISSN 2554-7976 Bulletin Départemental d’Information n° 07/2020 SOMMAIRE DELIBERATIONS COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Réunion du 10 juillet 2020 . Délibérations ............................................................................................................................................ 2 ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT ADMINISTRATION - Arrêté portant attribution de subventions aux associations ........................................................................ 94 - Arrêté portant modification des modalités d’attribution de subventions aux associations .......................... 132 -