Contribution Au Diagnostic De L'assainissement Individuel Et De L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Societes Ultramarines Face Aux Risques De Montee Du Niveau Marin. Quelles Strategies D'adaptation?
Les societes ultramarines face aux risques de montee du niveau marin. quelles strategies d’adaptation ? : exemples des iles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou Sophie Bantos To cite this version: Sophie Bantos. Les societes ultramarines face aux risques de montee du niveau marin. quelles strate- gies d’adaptation ? : exemples des iles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou. Géographie. Université de la Sorbonne (Paris 4), 2011. Français. tel-01172166 HAL Id: tel-01172166 https://hal.ird.fr/tel-01172166 Submitted on 7 Jul 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université Paris 4 - Sorbonne Université de la Nouvelle Calédonie IRD, US ESPACE Thèse de Doctorat de Géographie Nouveau Régime intitulée : Les sociétés ultramarines face aux risques de montée du niveau marin. Quelles stratégies d’adaptation ? Exemples des îles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou. Présentée et soutenue publiquement le 17 janvier 2011 par : Sophie BANTOS Sous la direction de : Christian Huetz de Lemps, Professeur et Michel Allenbach, Maître de conférences-HDR Devant le jury composé de : Professeur Franck Dolique Professeur Richard Laganier Professeur Christian Huetz de Lemps Maître de conférences-HDR Michel Allenbach Professeur Jean-Paul Amat - Avant-propos - AVANT-PROPOS La thématique de l’adaptation à la montée des eaux dans les petites îles tropicales est abordée dans ce mémoire d’un point de vue sociétal. -

Introduction À La Végétation Et À La Flore Du Territoire De Wallis Et Futuna
CONVENTION ORSTOM/SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE DE WALLIS ET FUTUNA INTRODUCTION ALA VEGETATION ET ALA FLORE DU TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA • (Rapport des 3 missions botaniques effectuées dans ce territoire en 1981-1982) P. MORAT J.M.· VEILLON M. HOFF OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE_MER OCTOBRE 1983 ______1 CENTRE OoRoSoToOoMo DE NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE ·1 OFFICE DE LA REC~ERCHE SCIENTifIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER. CENTRE DE NOUMEA. INTRODUCTION ALA VEGETATION ET ALA FLORE DU TERRITOIRE DE ~1ALLIS ET FUTUNA 1 -O§O- PAR Philippe MORAT Jean-Matie VEILLON Mi che l HOFF Rapp~rt des mi~sions botaniques effectuées dans ce tp.rritoire en 1981-1982. OCTOBRE 1983. TABLE DES MATIERES. Page..6 . INTRODUCTION 1 1 - Le milieu 2 1.1. Situation géographique - Relief - Géologie 2 1. 2. Sols 3 1.3. Réseau hydrographique 3 1. 4 Cl i mat 4 1.5. Peuplement humain 4 -' 2 - La végétation 5 2.1. La végétation autochtone 5 2.1.1. la mangrove 5 2.1.2. la végétation littorale 6 2. 1.2. 1. .ecu gJLoupement.6 p.6ammophUe..6. 2.1.2.2• .ea fioJLêt littoJLale 2.1.3. la forêt sempervirente 8 ·2.1.4. la végétation marécageuse 11 2.2. La végétation modifiée 12 2.2.1. les forêts secondarisées et les fourrés 12 2.2.2. cultures, jachères, végétation des zones fortement anthropisées 13 2.2.3. landes à V-i.CJtMOpteJU.o ou IItoafa li 14 3 - La Flore 16 4 - Conclusions - Recommandations 17 5 - Bibliographie 23 ANNEXES 1 - Carte des itinéraires et lieux prospectés au cours des 3 missions ~I - Liste des espèces et échantillons collectés ainsi que leurs biotopes III - Carte de Végé.tation IV - List~ rles noms sciehtifiques et leur correspondances en noms vernaculaires connys. -

Commercial Enterprise and the Trader's Dilemma on Wallis
Between Gifts and Commodities: Commercial Enterprise and the Trader’s Dilemma on Wallis (‘Uvea) Paul van der Grijp Toa abandoned all forms of gardening, obtained a loan, and built a big shed to house six thousand infant chickens flown in from New Zealand. The chickens grew large and lovely, and Toa’s fame spread. Everyone knew he had six thousand chickens and everyone wanted to taste them. A well-bred tikong gives generously to his relatives and neighbours, especially one with thousands of earthly goods. But . Toa aimed to become a Modern Busi- nessman, forgetting that in Tiko if you give less you will lose more and if you give nothing you will lose all. epeli hau‘ofa, the tower of babel Recently, the model of the trader’s dilemma was developed as an ana- lytical perspective and applied to Southeast Asia. The present paper seeks to apply this model in Western Polynesia, where many Islanders, after earning wages in Australia, New Zealand, the United States, or New Cale- donia, return to open a small shop in their home village. Usually, after one or two years of generous sharing, such enterprises have to close down. I analyze this phenomenon through case studies of successful indigenous entrepreneurs on Wallis (‘Uvea), with special attention to strategies they have used to cope with this dilemma. The Paradigm of the Trader’s Dilemma The trader’s dilemma is the quandary between the moral obligation to share wealth with kinfolk and neighbors and the necessity to make a profit and accumulate capital. Western scholars have recognized this dilemma The Contemporary Pacific, Volume 15, Number 2, Fall 2003, 277–307 © 2003 by University of Hawai‘i Press 277 278 the contemporary pacific • fall 2003 since the first fieldwork in economic anthropology by Bronislaw Malinow- ski (1922), Raymond Firth (1929; 1939), and others. -

Inventaire Et Fouille Des Sites Archéologiques Et
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER CENTRE DE NOUMÉA SCIENCES HUMAINES O.FRIMIGACCI -JP.SIORAT -B. VIENNE MISSION ORSTOM-CNRS 1983 INVENTAIRE ET FOUILLE DES SITES ARCHEOLOGIQUES . ET ETHNOHISTORIQUES DE L'ILE D'UVEJ CENTRE ORSTOM - B.P. A 5 - NOUMËA NOUVELLE- CALËOONIE _. INVENTAIRE ET FOUILLE DES SITES ARCHEOLOGIQUES . ET ETHNOHISTORIQUES DE L'ILE D'UVEA \ \ 1 UVEA DANS L'ENSEMBLE PACIFIQUE SUD OUEST N t , TUVALU • TOKELAU. - 1 1 • SANTA CRUZ ~ 10° S 1 SAMOA FUTUNA Ôa "TI ; BANKS ~.. • , ..... ... 1 li --\ - 15°S ~$ .- -...~ FIDJI VANUATU ,. .--.- .. ", 1 • NIUE TONGA .' ~ 20 0 S NOUVELLE CALEDONIE ----~----TROPIQUE DU CAPRICORNE --- --~----- --~--- 1 1-- - -\- -- -- o 100 300 500 Km -1---_ !: •, ! ! \ E 1700 E 180° 1 170°'-N 3 INTRODUCTION Ceci est le deuxième rapport de mission sur l 'ethno-archéologie de l'île d'UVEA - territoire des îles Wallis et Futuna - entrepris en AoOt~ Septem bre et Octobre 1984. Ce travail de recherche sur le Passé d'UVEA a été réalisé à l'instigation de l'Association Socio-culturelle pour l'art Wallisien et Futunien. Sans l'aide des membres de cette association il aurait été impossible d'envisa ger une telle entreprise~ grâce à eux~ nous avons obtenu tous les accords et la confiance des plus hautes autorités coutumières. Tous les membres de la mission étaient hébergés au presbytère de MUA par le père Petelo FALELAVAKI~ nous tenons à le remercier tout particulièrement de son hospi talité bienveillante. Ce travail a été réalisé par B. VIENNE~ anthropologue de l 'ORSTOM~ D. FRIMIGACCI~ Préhistorien du CNRS et J.P. SIORAT, Conservateur adjoint du Musée Néo-Calédonien de Nouméa. -

LIVRET D'accueil Wallis Et Futuna
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA LIVRETLIVRET D'ACCUEILD'ACCUEIL WallisWallis etet FutunaFutuna 1 LELE MOTMOT DUDU PREFETPREFET L'archipel des îles Wallis et Futuna, à 20 000 km de la Métropole, au coeur du Pacifique Sud, est un jeune territoire français, qui a fêté ses 50 ans d'existence en 2011. L'organisation institutionnelle de cette collectivité d'outre-mer est atypique: l'Etat, le Territoire, les autorités coutumières et religieuses y exercent ensemble leurs responsabilités. Les fonctionnaires qui ont fait le choix de mettre leurs compétences au service de l'Etat et du Territoire à Wallis et Futuna doivent faire preuve de solides capacités d'adaptation. Mais ils vivront une expérience unique, dans ce monde polynésien qui a su conserver beaucoup de ses traditions, au sein d'un environnement remarquable. Ce livret d'accueil a vocation à vous présenter à grands traits ce territoire, et vous aider à préparer le voyage qui vous attend. Je remercie et félicite le Service des Ressources Humaines qui a pris l'initiative de réaliser ce document qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais s'efforce de donner à celles et ceux qui s'apprêtent à exercer leurs fonctions à Wallis et Futuna, des informations qui leur seront utiles. Michel JEANJEAN 2 LIVRET D'ACCUEIL ILES WALLIS ET FUTUNA SOMMAIRE: 1/ PRESENTATION GENERALE A/ Repères historiques B/ Géographie et démographie des îles C/ Coutumes et traditions 2/ LES SERVICES ADMINISTRATIFS A/ L'Administration Supérieure a- Organisation et fonctionnement b- Organigramme B/ -
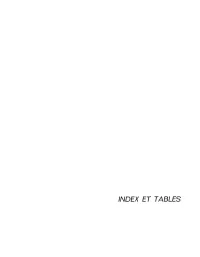
Index Et Tables Index
INDEX ET TABLES INDEX des principaux personnages, toponymes et thématiques narratives Les numéros renvoient à ceux du répertoire 1970-1971 en annexe. Les indications de pages qui font suite à la série des numéros se réfèrent à la pagination de cet ouvrage. Les noms de personnages, suivant la pratique adoptée, sont donnés en capitales, et leur signification entre parenthèses, de façon à les distinguer des toponymes et des noms communs. Les noms communs sont classés suivant l'ordre alphabétique des termes français, traduits en wallisien en caractères maigres. En se servant du lexique botanique et zoologique, il est facile, en partant du vocable wallisien, de retrouver le correspondant français. Les espèces difficilement identifiables sont regroupées sous les entrées : coquillages, crabes, oiseaux, plantes, poissons. Nous remercions M. Richard Rossille pour sa contribution à cet index partiel. Afrique, Afelika : n°s 108, 1.053, 1.185, 1.286 — pp. 19, 98, bananier, fusil : 403, 897, 946, 1.176, 1.207, 1.212, 1.249, 100, 155, 184. 1.271, 1.277 — pp. 66, 69, 72, 74, 75, 77, 177, 182, 183. AGO-MUA (Curcuma-premier) : 144, 177, (396) — p. 96. bêche-de-mer, loli : 580 — p. 141. Ahoa, village du district de Hahake : 826, 935, 987, 1.168, Belle au bois dormant, thématique : 753 — p. 138. 1.235, 1.241, SElvlTSI 1932-2 — pp. 18, 102. bénitier, gaegae : 13, 144, 195, 222, 304, 396, 402, 487, aigle, akuila : 244, 474, 736, 1.053, 1.185 — pp. 34, 115. 741, 895, 1.000, 1.094 — pp. 95 111, 161. ALAALAMAIPE (Réveille-toi) : 325 — p. -

IMPO X4 LIFESTYLE #1 07/28/03 11:02 AM Page 1
DOC COUV XPRESS 07/31/03 4:01 PM Page 1 IMPO X4 LIFESTYLE #1 07/28/03 11:02 AM Page 1 Secretariat of the Pacific Community LIFESTYLE DISEASES IN PACIFIC COMMUNITIES by Terry Coyne edited by Robert Hughes and Sarah Langi i IMPO X4 LIFESTYLE #1 07/28/03 11:02 AM Page 2 © Secretariat of the Pacific Community, 2000 All rights for commercial / for profit reproduction or translation, in any form, reserved. The SPC authorises the partial reproduction or translation of this material for scientific, educational or research purposes, provided that the SPC and the source document are properly acknowledged. Permission to reproduce the document and / or translate in whole, in any form, whether for commercial / for profit or non-profit purposes, must be requested in writing. Original SPC artwork may not be altered or separately published without permission. Original edition: English Secretariat of the Pacific Community cataloguing-in-publication Coyne,Terry, Lifestyle diseases in Pacific communities / author:Terry Coyne, editors: Robert Hughes and Sarah Langi. (Technical paper / Secretariat of the Pacific Community; no. 219) 1. Public health--Oceania--Bibliography. 2. Diet--Oceania. 3. Cardiovascular system--Diseases--Oceania. 4. Diabetes--Oceania. 5. Cancer--Oceania. 6. Obesity--Oceania I. Coyne,Terry II. Hughes, Robert III. Langi, Sarah IV.Secretariat of the Pacific Community V. Title VI. Series 616.9800990 ISBN 982-203-793-7 AACR2 ISSN 0081-2862 Author 1. Terry Coyne, NCD Project Officer, Secretariat of the Pacific Community, BP D5, 98848 Noumea Cedex, New Caledonia Editors 1. Robert Hughes, Nutritionist/NCD Epidemiologist, Secretariat of the Pacific Community, BP D5, 98848 Noumea Cedex, New Caledonia 2. -

Livret D'accueil 2019
PRÉFET ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR CHEF DU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA LIVRETLIVRET D’ACCUEILD’ACCUEIL ADMINISTRATION SUPÉRIEURE – PRÉFECTURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA 20192019 Mis à jour le 30/04/2019 SOMMAIRE P a g e s Avant-propos : Le mot du Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna............................................. 3 CHAPITRE I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE A/ Repères historiques …........................................................................................................................................... 4 B/ Présentation Géographique ….............................................................................................................................. 4 C/ Le Climat à Wallis et Futuna ............................................................................................................................... 5 D/ Données Démographiques .................................................................................................................................... 5 E/ Cadre Institutionnel .............................................................................................................................................. 6 1) Le Statut de 1961 .......................................................................................................................................6 2) L’État …..................................................................................................................................................... 6 3) Le Territoire …...........................................................................................................................................6 -

Enquête Sur La Filariose À Wallis
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER 20. Rue Monsieur PARIS 7' ENQUÊTE SUR LA FILARIOSE À WALLIS par Jean RAGEAU avec la collaboration du Dr. J. ESTIENNE, • 1NSTITUT FRAN ÇAI S D'OCÉAN 1E NOUMÉA, Nouvelle,Calédonie OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER INSTITUT FRANÇAIS O/OCEANIE Laboratoire d'Entomologie médicale et vétérinaire ENQUÊTE SUR LA FILARIOSE À WALLIS par Jean RAGEAU avec la collaboration du Dr. J. ESTIENNE, Midecin-Chef du Service médical des Iles Wallis et Futuna Avril 1969 r- i ENQUETE SUR LA lILARIOSE A WALLIS • -:-:-:-:-:- • l.N.TI3:0DUC T!ON La. filariose humaine à. Wuc_hAre;r::ia bW.c:.rofti compte parmi les endémies majeures de l'1le Wallis. La lutGe contre cette très grave pa rasitose se limite acblellem~nt à. la di$tribution de Notézine aux malades souffrant de lymphangite filarie!J~e et à. quelques interventions chirurgi cales dans les cas op8rables diéléphantiasis. Ni la proph~rlaxie entomologique, ni la chimioprophylaxie n'ont été tentées, bien q~lun cinqui3me au moins de la pop·~tion ~~lli~ie!Jne renferme des microfilaires dans le sang et qu"un wallisien sur douze sou~ fre de manifestations filarie~~es. Notre enqu~te avait pour objectif principal l'étlme épidémie logique de la filariose àe~e Eancroft dans l'11e VAllie 8t elle nous a per mis de dresser un tableau. de la sitLo.ationsitLo.atio::l actuelle de cette IIl9.ladie. Lf8nqu~te hémuto1og5.que a été réalisée avec la collaboration du Dr. J. Esttep.nc, Médecin de l'île '-{allis, d'octobre 1958 à fé-rrier 1959 ainsi que l'étude sur la morpholoeie des microf..i.laires de W. -

PLANT DISEASES Caused by Viruses & Virus-Like Pathogens in the French Pacific Overseas Country of FRENCH POLYNESIA & the French Pacific Territory of WALLIS & FUTUNA
SPC Techncal Paper No. 226 Surveys for PLANT DISEASES caused by Vruses & Vrus-lke pathogens n the French Pacific Overseas Country of FRENCH POLYNESIA & the French Pacific territory of WALLIS & FUTUNA By R.I. DavisA, L. MuB, A. MalauC, P. JonesD A Plant Protection Service, Secretariat of the Pacific Community (SPC), PMB, Suva, Fiji Islands BService du Développement Rural, Département de la Protection des Végétaux, BP 100, Papeete, French Polynesia CService de l’agriculture à Wallis, Services Territoriaux des Affaires Rurales et de la Peche, BP 19, Mata’utu, 98600 Uvea, Wallis and Futuna Islands D Plant–Pathogen Interactions Division, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ, UK Published with financial assistance from European Union SPC Land Resources Dvson Suva, Fj October 2006 © Copyright Secretariat of the Pacific Community 2006 All rights for commercial / for profit reproduction or translation, in any form, reserved. SPC authorizes the partial reproduction or translation of this material for scientific, educational or research purposes, provided that SPC and the source document are properly acknowledged. Permission to reproduce the document and/or translate in whole, in any form, whether for commercial / for profit or non-profit purposes, must be requested in writing. Original SPC artwork may not be altered or separately published without permission. Orgnal text : Englsh Secretariat of the Pacific Community Cataloguing-in-publication data Davs, R.I. et al. Surveys for plant diseases caused by viruses and virus-like pathogens in the French Pacific overseas country of French Polynesia and the French Pacific territory of Wallis and Futuna / R.I. Davis, L. Mu, A. Malau, P. -

Développements Récents Dans La Connaissance De L’Océanologie Du Lagon De Wallis
XIIIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil Dunkerque, 2-4 juillet 2014 DOI:10.5150/jngcgc.2014.012 © Editions Paralia CFL disponible en ligne – http://www.paralia.fr – available online Développements récents dans la connaissance de l’océanologie du lagon de Wallis Thierry HOIBIAN 1, Enelio LIUFAU 2, Michel ALLENBACH 1, Carole MANRY 2, Atoloto MALAU 2 1. Université de la Nouvelle-Caléonie, PPME – EA3325, BP R4, 98851 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie. [email protected] 2. Service Territorial de l'Environnement, BP 294 - Mata'Utu – Uvea, 98600 Wallis et Futuna. [email protected] Résumé : De nouvelles acquisitions de données courantologiques obtenues dans le suivi océanologique du lagon de Wallis entrepris depuis 2006, ont permis de mieux définir le schéma de circulation général du lagon de Wallis. L’importance des entrées d’eau océaniques dues au déferlement des vagues par-dessus la barrière récifale, mesurées dans plusieurs situations météo-océanologiques, aboutissent à la définition du concept de bourrelet de surpression créé par le déferlement des vagues par-dessus la barrière récifale qui se développe du coté au vent de l’île. L’importance de ce bourrelet de surpression conditionne la circulation dans le lagon par le biais des échanges entre bassins lagonaires au travers des chenaux internes et des passes. En fonction des conditions météo-océanologiques, il se développe une circulation circulaire conduisant au déplacement des masses d’eau excédentaires dans les bassins situés du côté opposé de l’île, et à leur évacuation par les passes et par-dessus le récif. Mots-clés : Courantologie doppler, Lagon, Marées, Houles, Suivi du réchauffement climatique, Wallis, Pacifique Sud-Ouest. -

Capture Section Report of Wallis and Futuna Fish Aggregating Device (FAD): Technical Assistance Project
Capture Section Report of Wallis and Futuna Fish Aggregating Device (FAD) Technical Assistance Projects 25 August to 15 September 1992; 7–11 November 1992; and 23–29 July 1995 by Steve Beverly Masterfisherman Aymeric Desurmont Masterfisherman and Satalaka Petaia Fisheries Development Officer © Copyright Secretariat of the Pacific Community 1999 The Secretariat of the Pacific Community authorises the production of this material, whole or in part, in any form, provided that appropriate acknowledgment is given. Original text: English Secretariat of the Pacific Community cataloguing-in-publication data Beverly, Steve Capture Section Report of Wallis and Futuna Fish Aggregating Device (FAD): Technical Assistance Project 1. Fish Aggregating Device (FAD)—Wallis and Futuna 2. Tuna Fishing—Wallis and Futuna 3. Fisheries—Equipment and Supplies I. Title II. Secretariat of the Pacific Community Coastal Fisheries Capture Section 639.2028 AACR2 ISBN 982 – 203 – 651 – 5 Secretariat of the Pacific Community BP D5 98848 Noumea Cedex New Caledonia Telephone: + 687 26 20 00 Facsimile: + 687 26 38 18 E-mail: [email protected] http://www.spc.org.nc/ Prepared for publication and printing at Secretariat of the Pacific Community headquarters Noumea, New Caledonia, 1999 ii ACKNOWLEDGEMENTS The Secretariat acknowledges with gratitude the assistance of the administration and staff of Territory’s Service de l’Economie Rurale et de la Pêche—SERP. Particular thanks are offered to, André Ledreau, Director; Daniel Tahimili, Fisheries Officer; Petelo Mafutuna, boat builder and boat pilot; and Bruno Mugneret who served as interpreter. Thanks are also offered to those on Futuna who assisted the survey project, particularly Jean Muro, Délégué du Gouverneur; Dominique Sage, of SERP; and boat owner–operator, Patrick Tortey.