Marechal-Ney
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pierre Riel, the Marquis De Beurnonville at the Spanish Court and Napoleon Bonaparte's Spanish Policy, 1802-05 Michael W
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2005 Fear and Domination: Pierre Riel, the Marquis de Beurnonville at the Spanish Court and Napoleon Bonaparte's Spanish Policy, 1802-05 Michael W. Jones Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES Fear and Domination: Pierre Riel, the Marquis de Beurnonville at the Spanish Court and Napoleon Bonaparte’s Spanish Policy, 1802-05 By Michael W. Jones A Dissertation submitted to the Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Spring Semester 2005 Copyright 2004 Michael W. Jones All Rights Reserved The members of the Committee approved the dissertation of Michael W. Jones defended on 28 April 2004. ________________________________ Donald D. Horward Professor Directing Dissertation ________________________________ Outside Committee Member Patrick O’Sullivan ________________________________ Jonathan Grant Committee Member ________________________________ James Jones Committee Member ________________________________ Paul Halpern Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii This dissertation is dedicated to the memory of my father Leonard William Jones and my mother Vianne Ruffino Jones. iii ACKNOWLEDGEMENTS Earning a Ph.D. has been the most difficult task of my life. It is an endeavor, which involved numerous professors, students, colleagues, friends and family. When I started at Florida State University in August 1994, I had no comprehension of how difficult it would be for everyone involved. Because of the help and kindness of these dear friends and family, I have finally accomplished my dream. -

Rien Ne Va Plus 2 Dieser Vierte Band Über Das Leben Des Generals Lazare Hoche (1768-97) Befasst Sich Mit Den Beiden Jahren 1796 Und 1797
1 Gott schenkte Adam den Frieden, die Freiheit und das Paradies. Die Men- schen nahmen sich die Freiheit und wählten die Früchte vom Baum der Erkenntnis. Denn Wissen ist Macht. Die Macht, die sie sogleich miss- brauchten und fortwährend missbrauchen. Lazare Hoche (1768 -1797)1 Rien ne va plus 2 Dieser vierte Band über das Leben des Generals Lazare Hoche (1768-97) befasst sich mit den beiden Jahren 1796 und 1797. Gekürzte Quellenangaben bedeuten: „Rousselin 2“: A. Rousselin, „Vie de Lazare Hoche, Géné- ral des armées de la République“, tome second, 1797/8; Briefkopiensammlung der Mme Hoche „Vendéens et Chouans“: "Collection des mémoires rela- tifs à la Révolution française – Guerre des Vendéens et des Chouans contre la République Française ou Annales des départements de l’Ouest”, Paris 1825, "par un officier supé- rieur des armées de la République". Sammlung von Akten aus dieser Zeit. „Des Elends Sohn“, 2007, Hoche 1773-1793 „Quatrevingt-quatorze“: 2008, Hoche 1794 „Politiker und Soldaten“: 2009, Hoche 1795 Wer den vielen Links nachgehen möchte, schreibt in das Adressfeld seines Explorers: http://pclavadetscher.magix.net/website/ oder http://db.peterclavadetscher.ch/ Dort findet man den Text meines Buches und kann die Links direkt anklicken. Wollen wir hoffen, die Inhalte seien zwi- schenzeitlich gleich geblieben! Anmerkungen und Glossen zum Text sind in Fussnoten, bio- graphische Notizen (und lange Anfügungen) aber in Endno- ten am Schluss des 7. Kapitels festgehalten (S.368). Alle geographischen Namen, die mit einer Tiefzahl zwischen 56 und 62 versehen sind, finden sich in einer der auf Seite 56 – 62 eingefügten Karten wieder. Auch dieses Jahr sind meine unbedarften Einwürfe kursiv geschrieben. -
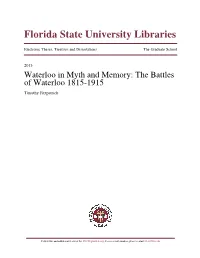
Waterloo in Myth and Memory: the Battles of Waterloo 1815-1915 Timothy Fitzpatrick
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2013 Waterloo in Myth and Memory: The Battles of Waterloo 1815-1915 Timothy Fitzpatrick Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES WATERLOO IN MYTH AND MEMORY: THE BATTLES OF WATERLOO 1815-1915 By TIMOTHY FITZPATRICK A Dissertation submitted to the Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall Semester, 2013 Timothy Fitzpatrick defended this dissertation on November 6, 2013. The members of the supervisory committee were: Rafe Blaufarb Professor Directing Dissertation Amiée Boutin University Representative James P. Jones Committee Member Michael Creswell Committee Member Jonathan Grant Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the dissertation has been approved in accordance with university requirements. ii For my Family iii ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank Drs. Rafe Blaufarb, Aimée Boutin, Michael Creswell, Jonathan Grant and James P. Jones for being on my committee. They have been wonderful mentors during my time at Florida State University. I would also like to thank Dr. Donald Howard for bringing me to FSU. Without Dr. Blaufarb’s and Dr. Horward’s help this project would not have been possible. Dr. Ben Wieder supported my research through various scholarships and grants. I would like to thank The Institute on Napoleon and French Revolution professors, students and alumni for our discussions, interaction and support of this project. -

Jean-Marie-Victor Viel
Jean-Marie-Victor Viel Jean-Marie-Victor Viel. Jean-Marie-Victor Viel 1796â“1863 was a French architect who designed the Palais de l'Industrie Palace of Industry an exhibition hall located between the Seine River and the Champs-Élysées which was erected for the Paris World Fair in 1855. Notes. ^ "The Foreign Soul & The Angelus" de Maupassant,G trans: Wilson, J Notes p94 Lambeth, Duchy of Lambeth 2008 ISBN 978--0-9558525-1-0. Jean Victor Marie Moreau (14 February 1763 â“ 2 September 1813) was a French general who helped Napoleon Bonaparte to power, but later became a rival and was banished to the United States. Moreau was born at Morlaix in Brittany. His father was a successful lawyer, and instead of allowing Moreau to en Jean-Marie-Victor Viel was a French architect who designed the Palais de l'Industrie an exhibition hall located between the Seine River and the Champs-Élysées which was erected for the Paris World Fair in 1855.[1]. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Jean- Marie-Victor Viel. Home. News. Random Article. Install Wikiwand. Follow Us. Send a suggestion. Add. Jean-Marie-Victor Viel. + . Read more. Full Wikipedia Article. Jean-Marie-Victor Viel. Architect. 50% (1/1). + . Read more. Architect. American Institute of Architects Architectural firm Architectural technologist. Exposition Universelle (1855). Jean Victor Marie Moreau. Marshal of France. Wikipedia. Date of birth. 14 February 1763 Morlaix. Date of death. 2 September 1813 Louny. Jean-Victor Moreau.jpg 808 × 858; 153 KB. -

Leadership and Demands of the Imperial Guard
DePaul University Via Sapientiae Napoleon Translations French Program 1-1-2011 Leadership and Demands of the Imperial Guard George Overton Kenya Tapia Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/napoleon Recommended Citation Overton, George and Tapia, Kenya. (2011) Leadership and Demands of the Imperial Guard. https://via.library.depaul.edu/napoleon/16 This Translation is brought to you for free and open access by the French Program at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Napoleon Translations by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. Leadership and Demands of the Imperial Guard By Paul, Soldier of the former Imperial Guard. Translated by: George Overton and Kenya Tapia “He who serves his country well does not need elders.” Voltaire PARIS. 1814. Translators’ Introduction: For years, under Napoleon, the French Army fought hard and won numerous important victories. Although many died, they were a united cause and made much progress under Napoleon up until his defeat at Leipzig on October 19 th , 1813. However, with Napoleon now gone, new leaders indicted him as a thief and a bandit, effectively discrediting both Napoleon and his soldiers who had worked so hard for their nation’s cause. One soldier, Paul, writes in “Leadership and Demands of the Imperial Guard” against this newfound sentiment. Free of intrigue and any kind of political parties, a soldier knows neither pride nor the lowness of courts. The nation appoints him a leader. Loyal to the country, it is all he knows, he is happy to die for her. -

Il Guascone Di Fougères: Il Marchese De La Rouërie, Eroe Dei Due Mondi
Peter Altenberg (Richard Engländer) e la poesia del frammento Peter Altenberg (Richard Engländer) e la poesia del frammentodi Giuseppe Baiocchi del 30-08-2021 Per chi si reca nel famoso Cafe Central di Vienna, vicino all’ingresso, scorgerà una tipica statua che i viennesi – i pochi che si recano ancora al caffè turistico per eccellenza – conosco oramai bene, anche se mal fatta. Ebbene l’opera rappresenta un personaggio, che spesso sconfina nella leggenda: il poeta Peter Altenberg. Analizzando più approfonditamente Richard Engländer, siamo davanti ad uno scrittore molto particolare, che raramente si ha il piacere di leggere. Calvo, dai baffi spioventi alla slava, si presentava leggermente trasandato e possedeva molte amicizie discutibili: dai letterati ai camerieri, fino alle prostitute. Peter Altenberg nella cittadina di Gmunden nell’Alta Austria. Dall’inizio degli anni 1880, la famiglia Engländer si reca per le vacanze estive nel Salzkammergut, principalmente a Ischl, che divenne Bad Ischl solo nel 1907. Il figlio maggiore Richard, che poi si fa chiamare Peter Altenberg come scrittore, rimane fedele al Salzkammergut per tutta la vita – il suo posto preferito è Gmunden. Molti dei suoi schizzi e scene poetiche trattano esplicitamente o implicitamente esperienze e osservazioni in questo paesaggio e contengono tutte le sfaccettature dell’opera di Altenberg: la densità poetica con cui sa dipingere le persone come paesaggi in piccole istantanee, la tendenza all'”idealizzazione kitsch” o il pathos vuoto con cui getta i suoi giudizi sul calpestio dei segni di punteggiatura selvaggi, e la sua dubbia tendenza alla pedofilia. Di contro, se il lettore dovesse pensare ad un individuo burbero e rissoso, rischierebbe di commettere un macroscopico errore: Richard era una di quelle persone dalla calma frizzante, parsimonioso, buongustaio e scrupoloso come ogni vero viennese. -

Napoleon's Heavy Cavalry, the Cuirassier and Carabinier: Their Arms, Armor, and Tactics
Napoleon's Heavy Cavalry, the Cuirassier and Carabinier: Their Arms, Armor, and Tactics Ricky E. Parrish Napoleon Bonaparte came to power in France after his coup of 18 Rmmaire year WIT (9 November 1799). Guided by his organizational genius, each branch of the French army- infantry, cavalry, and artillery-underwent a reorganization. Napoleon had definite ideas as to the role of each of these services, and he wanted to mold them into the most efficient army in Europe. According to Napoleon, there were four types of cavalry: scouts, light cavalry, dragoons, and Cuirus- siers (heavy cavalry).' On 17 September 1802, Napoleon ordered the heavy cavalry within the army to be reduced to twenty regiments: two Carabiniers and eighteen cuirassier^.^ (The Carabi- niers were elite heavy cavalry units), Originally, only six of these units were to be issued the cuirass; however, by the first problem was the weight of the weapon. The flat, end of 1803 twelve regiments of armored heavy cavalry unfullered blade was very heavy, and the troopers com- existed within the French army. 'l'wo more regiments of plained about this weight. The second problem was the Cuirassier were added by 1810, and the two Carabinier construction of the hilt. The three side bars did not extend regiments were armored after taking heavy casualties during into the pommel, which was a cause of weakness in the hilt. the 1809 campaign.3 Therefore, there were a total of sixteen The lack of a brass ferrule at the base of the grip gave the armored cavalry regiments in the French army at the height of weapon a tendency to split. -

Political Conspiracy in Napoleonic France: the Malet Affair Kelly Diane Whittaker Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2007 Political conspiracy in Napoleonic France: the Malet affair Kelly Diane Whittaker Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the History Commons Recommended Citation Whittaker, Kelly Diane, "Political conspiracy in Napoleonic France: the Malet affair" (2007). LSU Master's Theses. 1437. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/1437 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. POLITICAL CONSPIRACY IN NAPOLEONIC FRANCE: THE MALET AFFAIR A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts In The Department of History by Kelly Diane Whittaker B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University, 2002 December, 2007 TABLE OF CONTENTS Abstract . iii Introduction . .1 Chapter One General Malet: A Biography . 8 Two Hopes and Disappointments in Napoleonic France . 46 Three General Malet’s Final Attempt, 22 October 1812 . 73 Conclusion . 95 Notes . .100 Bibliography . .112 Vita . 115 ii ABSTRACT The French Revolution ushered in a period of political unrest in France which appeared never-ending, even when a seemingly stable government rose to power. After a series of failed Republican governments, Napoleon Bonaparte seized control on 18 Brumaire VIII, promising to uphold the revolutionary ideals that had permeated the nation. -

Napoleonic Scholarship
Napoleonic Scholarship The Journal of the International Napoleonic Society No. 8 December 2017 J. David Markham Wayne Hanley President Editor-in-Chief Napoleonic Scholarship: The Journal of the International Napoleonic Society December 2017 Illustrations Front Cover: Very rare First Empire cameo snuffbox in burl wood and tortoise shell showing Napoleon as Caesar. Artist unknown. Napoleon was often depicted as Caesar, a comparison he no doubt approved! The cameo was used as the logo for the INS Congress in Trier in 2017. Back Cover: Bronze cliché (one sided) medal showing Napoleon as First Consul surrounded by flags and weapons over a scene of the Battle of Marengo. The artist is Bertrand Andrieu (1761-1822), who was commissioned to do a very large number of medallions and other work of art in metal. It is dated the year X (1802), two years after the battle (1800). Both pieces are from the David Markham Collection. Article Illustrations: Images without captions are from the David Markham Collection. The others were provided by the authors. 2 Napoleonic Scholarship: The Journal of the International Napoleonic Society December 2017 Napoleonic Scholarship THE JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NAPOLEONIC SOCIETY J. DAVID MARKHAM, PRESIDENT WAYNE HANLEY, EDITOR-IN-CHIEF EDNA MARKHAM, PRODUCTION EDITOR Editorial Review Committee Rafe Blaufarb Director, Institute on Napoleon and the French Revolution at Florida State University John G. Gallaher Professor Emeritus, Southern Illinois University at Edwardsville, Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques Alex Grab Professor of History, University of Maine Romain Buclon Université Pierre Mendès-France Maureen C. MacLeod Assistant Professor of History, Mercy College Wayne Hanley Editor-in-Chief and Professor of History, West Chester University J. -

Napoleon Bonaparte Očima Francouzských Řadových Vojáků a Důstojníků
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická NAPOLEON BONAPARTE OČIMA FRANCOUZSKÝCH ŘADOVÝCH VOJÁKŮ A DŮSTOJNÍKŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2014 Bc. Filip TRDLA Poděkování Děkuji PhDr. Pavlu Smržovi za jeho pomoc při psaní této diplomové práce. Především za jeho rady, objektivní kritiku a věcné připomínky. Poděkování patří také všem, kteří mě během celého studia podporovali. Anotace Diplomová práce se na základě pramenů osobní povahy a sekundární literatury snaží rekonstruovat vztah řadových francouzských vojáků a důstojníků k Napoleonovi Bonapartovi a obecně zmapovat pohled vojáků na jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců a politiků (nejen) 18.–19. století. Cílem práce je též analýza příčin glorifikace Napoleonovy osobnosti a snaha vysvětlit důvody vzniku Napoleonova "kultu neporazitelného génia". Tento vztah bude analyzován z hlediska časového, kdy bude srovnáván pohled na historicky prvního francouzského císaře v období raných úspěchů s vnímáním jeho osoby v době největších úspěchů, ale i pádů. Druhým hlediskem bude určování a analýza vztahů k Napoleonovi z pohledu osob různé vojenské hodnosti včetně maršálů napoleonské Francie. V práci jsou použity metody komparace a analýzy. Klíčová slova 18. století 19. století historie Francie maršálové Francie Napoleon Bonaparte napoleonské války paměti vojáků propaganda První císařství Alexander Louis Berthier Jean Lannes Marcellin de Marbot Paul Charles Thiébault Marengo Slavkov Annotation Diploma thesis based on a personal character of sources and secondary literature attempts to reconstruct a relationship of ordinary French soldiers and officers to Napoleon Bonaparte and generally to map a view of the soldiers on one of the greatest generals and politicians (not only) 18th to 19th century. The aim of this work is an analysis of the causes of the glorification of Napoleon's personality and attempts to explain the reasons for the emergence of Napoleon's "cult of undefeated genius". -

Teacher, Traitor, Marshal Ney?
Newsletter of the Mecklenburg Historical Association Docents Promoting Local History through Education and Research http://www.meckdec.org November, December 2018 Volume 24, Number 5 Look Inside This Issue − Teacher, Traitor, Marshal Ney? − Historic Mapping Congress Annual Meeting – Charlotte 250 th − Revolutionary War Reenactment at Camden, SC − A Christmas “Candle Tea” at the Little Church on the Lane, − SAR Rev War Memorial Dedication at Centre Church − Now is the Time to Renew your MHA Membership − Latta Welcomes New Executive Director Teacher, Traitor, Marshal Ney? One of the most enigmatic characters to set foot in North Carolina was a country schoolteacher named Peter Stewart Ney. Or was he really Michel Ney, Napoleon’s Marshal of France? Michel Ney was born in 1769 on the border between France and Germany. His father’s name was Peter and his mother’s maiden name was Stewart. As a young man he enlisted in Napoleon’s army. Napoleon quickly recognized Ney’s military brilliance, and within a dozen years he achieved the rank of Marshal, the highest in the army. He thrived on the dangers and glories of war, fighting alongside Napoleon, suffering many wounds, and enduring the disastrous attempt to take Russia in 1812. Napoleon dubbed him “Bravest of the Brave!” Yet after Waterloo, Ney was blamed for the loss, tried for treason, and in 1815 was executed by firing squad. Or was he? The place of execution was changed at the last moment. The firing squad consisted of Ney’s own men. It was claimed that an animal bladder filled with red dye was found where the body fell. -

Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 7-1-2020 Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835) Gregory DeVoe Tomlinson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the European History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Tomlinson, Gregory DeVoe, "Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)" (2020). LSU Doctoral Dissertations. 5308. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/5308 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. RESHAPING AN EARTHLY PARADISE: LAND ENCLOSURE AND BAVARIAN STATE CENTRALIZATION (1779-1835) A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Gregory DeVoe Tomlinson B.A., San José State University, 2009 M.A., San José State University, 2012 August 2020 Acknowledgments The Central European History Society (CEHS) funded a visit to the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München in the summer of 2016. Further support came from the LSU history department and the generous contributions of members of the LSU Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) for a subsequent visit in the summer of 2018. The staffs of the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München are extremely dedicated, professional, and were more than helpful with their assistance.