Rapport Annuel 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jean Bernard a La Une
JEAN BERNARD A LA UNE N°9 du mois de janvier 2014 L'actu du mois En bref Dieudonné privé de scène ? Fin de la note de vie scolaire Les élèves de 6ème jusqu'à la 3ème ne Le spectacle de Dieudonné, « Le MUR », est considéré comme recevront plus de note de «vie scolaire» antisémite (contre les personnes qui pratiquent la religion juive). dans les collèges. C'est pour cette raison que le ministre de l'Intérieur Manuel Elle disparaît car elle ne permet pas Valls, veut l'interdire. Il a demandé aux préfets (représentants de d'améliorer l'ambiance et le comportement l' État dans les régions) de ne pas autoriser le show. Mais en des élèves, notamment dans les collèges les France, il existe un droit qui s'appelle « la liberté de plus difficiles. l'expression » chacun est libre de s'exprimer, de donner son Certains le regretteront d'autres non. opinion. Un bras de fer s'est donc engagé entre l' État et le droit. Mais finalement le comédien a décidé de modifier son spectacle Sources : JDE, n° 1437, jeudi 23/01/14 et d'en supprimer les aspects antisémites. Barbara Commentaire : « Je pense que c'est important d' évoquer cet événement car on ne peut pas s'amuser de tout ; cela peut être En bref douloureux pour certains. » la Miss France 2014 Camil Miss France 2014 est Flora Coquerel ; pour Source : Le journal des enfants, n°1436, 16 janvier 2014 elle c'est un exploit. Elle est très heureuse car elle pourra devenir un vrai modèle pour toutes les jeunes filles de France. -
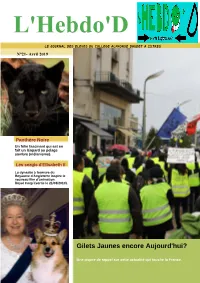
Lhebdod 21 1 .Pdf
L'Hebdo'D LE JOURNAL DES ELEVES DU COLLEGE ALPHONSE DAUDET A ISTRES N°21- Avril 2019 0101 Panthère Noire Un félin fascinant qui est en fait un léopard au pelage sombre (mélanisme). Les corgis d'Elisabeth II La dynastie à fourrure du Royaume d'Angleterre inspire le nouveau film d'animation Royal Corgi (sortie le 21/03/2019). Gilets Jaunes encore Aujourd'hui? a Une piqure de rappel sur cette actualité qui touche la France. Edito Bienvenue au printemps En ce printemps qui a du mal à chasser l'hiver, toute l'équipe est heureuse de vous présenter son nouveau numéro. Pour la première fois, découvrez la rubrique actualités dont François peut être fier. Et comme toujours la rubrique sciences de Florent et le coin pratique d'Elodie mais aussi d'autres sujets plus ou moins sérieux qui pourront vous intéresser. Adresse : Collège Alphonse Daudet Bonne lecture! 1 Avenue Radolfzell 13800 Istres 04.42.56.14.27 http://www.clg-daudet- Sabine Santoni istres.acaix-marseille.fr/spip L'Hebdo'D N° 21 Directrice de la publication : L. SPEZIANI Rédactrice en chef : Sabine SANTONI Rédaction : Arocas-Delesty Florent, Balme Aurélia, Djouhri Enzo, Espanet Elodie , Ganteaume Elian, Hebert Lily, Marty François, Moreau Ilona, Queva Jessica, Ribot Lisa, Villette Moragane, Sommaire ACTUALITES CITOYENNETE ANIMAUX 03 Gilets jaunes, Brexit, 07 Les restos du coeur 12 Les Corgis de la Reine Elections Européennes... La panthère noire COLLEGE VOYAGES COIN PRATIQUE 04 Rencontres d'auteurs 08 Les hautes Pyrénées 14 Comment apprendre ses Contre la Discrimination leçons plus facilement ? SCIENCES CULTURE CUISINE 06 Les trous noirs 09 La Bohème 16 Moelleux au chocolat Miss France Once Upon a Time L'Hebdo'D N° 21- Avril 2019 ACTUALITÉS Élections Européènnes Actualités Cette année 701 personnes Les Gilets jaunes, encore aujourd'hui ? se présenteront aux titres de Le phénomène des gilets jaunes est 100 000 personnes sur les routes et représentanst européens maintenant connu partout dans le les rues de France. -

Vaimalama Chaves, Miss France
Starfish Collection Jewelry inspired by nature hinerava.com . [email protected] . +(689) 40 83 52 22 Éditorial Votre magazine Reva Tahiti a l’habitude de vous proposer les portraits de personnalités exceptionnelles de par leur parcours, leurs valeurs, leur caractère exemplaire ou inspirant, afin de vous permettre de mieux appréhender l’essence même de l’âme polynésienne. Et l’on pouvait difficilement rêver destinée plus inspirante dans l’actualité récente de nos îles que celle de Vaimalama Chaves, jeune beauté de 24 ans, qui a rempli les Polynésiens de fierté le 15 décembre 2018 en devenant, quelques mois après son élection en tant que Miss Tahiti, Miss France. Partie à la conquête d’un destin, Vaimalama Chaves revient dans nos pages sur son expérience afin de la partager avec ceux qui sont sensibles à tout ce que notre Fenua peut apporter à ce monde. Reva Tahiti a d’ailleurs saisi l’occasion de revenir plus largement sur l’histoire de nos ambassadrices de la Polynésie, à travers un article qui retrace les destinées de nos Miss Tahiti, un come-back de 60 ans célébrant la beauté des vahinés… Malgré cette réjouissante actualité, nous n’en avons pas oublié pour autant de rendre hommage à nos illustres tupuna, les anciens, qui ont inscrit l’histoire de la Polynésie en lettres d’or au cœur de celle de l’Humanité. Au sommaire de ce numéro, vous trouverez donc un portrait de Tupaia, homme remarquable s’il en fût, aquarelliste, cartographe et surtout navigateur polynésien, né vers 1725 à Raiatea, dont la science de la navigation fut mise à profit par le capitaine Cook durant ses expéditions dans nos îles à bord du Endeavour. -
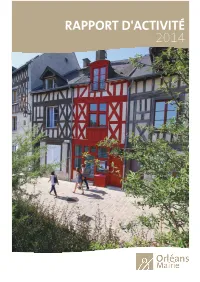
Rapport D'activité 2014
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 ÉDITO DU MAIRE En 2014, les Orléanais ont reconduit l’équipe municipale et avec elle, les axes qui depuis de nombreuses années marquent son ambition pour Orléans et orientent toutes ses actions : • la proximité, en répondant toujours mieux aux besoins du quoti- dien pour faciliter la vie des Orléanais, • le développement durable, parce qu’Orléans, ville jardin, ville du- rable, veut contribuer à la santé et la pérennité de notre planète, • l’attractivité et le rayonnement parce que la Cité johannique regorge de talents, qu’elle encourage la création et l’innovation, qu’elle est chaque jour plus belle et qu’elle veut le faire savoir. Le rapport d’activité de l’année 2014 illustre, au fil des pages, la richesse et la diversité des missions de la Ville, l’ampleur de sa mobilisation au quotidien et les actions qu’elle a menées pour qu’Orléans continue à être une capitale régionale dynamique, animée où il fait bon vivre. Toutes ces réalisations, la ville d’Orléans les doit principalement à sa situation financière qui, malgré un contexte économique difficile, reste saine. Elle a pu ainsi poursuivre un programme d’investissement soutenu de 42,4 M€, sans recourir à la dette (en diminution de 3M€ par rap- port à 2013), ni à la fiscalité. La conduite d’une gestion financière rigoureuse, s’appuyant sur une maîtrise des dépenses de gestion courante, lui a permis ainsi de préserver sa capacité d’autofi- nancement. À ce titre, je remercie l’ensemble des agents qui veillent, chaque jour, à placer l’usager au cœur de leurs missions. -

Miss France Est Un Concours De Beauté Pour Les Jeunes Femmes Entre 18 Et 24 Ans Qui Se Déroule Tous Les Ans
Le concours miss France est un concours de beauté pour les jeunes femmes entre 18 et 24 ans qui se déroule tous les ans. Pour cela, il faut: Quels sont les critères pour participer au concours Miss France : • être née de sexe féminin • de nationalité française • avoir un âge compris entre 18 et 24 ans à la date du 15 novembre de l’année en cours, • mesurer, au minimum, 1 m 70 • être célibataire et sans enfant, • ne pas vivre en concubinage, • posséder un casier judiciaire vierge Pour participer au concours Miss France, il ne faut pas: • avoir posé partiellement ou totalement dénudée • avoir déjà participé à Miss France • avoir des artifices (perruque, lentilles de cou- leur…) La première étape pour pouvoir participer à l’élection Miss France c’est de participer a l’élec- tion de notre ville. Pour Dreux c’est miss agglo. Cette année, c’est Marion Brandt qui a été élue miss agglo ainsi que Apol- line Vallegeas, 1ère Dauphine et Chloé Moreau, 2ème dauphine. Ce concours se passe au ciné centre de Dreux. Pour cela il faut habiter à Dreux ou dans les alentours, mesurer 1 m 70. Miss France 2000, Miss France 2001, Sonia Roland Elodie Gossuin Miss France 2002, Syl- vie Tellier Miss France 2003, Corinne Coman Miss France 2004, Miss France 2005, Laetitia Bléger Cindy Fabre Miss France Rachelle legrain- 2006, Alexandra trapini miss France Rosenfeld 2007 Chloé Mortaud, miss France 2009 Valérie bègue, miss France 2008 Laury thilleman, miss Malika Ménard, France 2011 miss France 2010 Marine l’orfelin miss France 2013 Delphine Wespiser , miss France 2012 Miss Eure-et-Loir est un concours pour élire la miss du département d’Eure-et-Loir. -

Deschangementsàla Chambredesdéputés
«L’essentiel»t’offretes places pour le concert de BiffyClyro (voirp.26) Des changements à la LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 N°1424 Chambre des députés Monde 10 La Chambre des députés est devenue femmes sont 17, pour 43 hommes. Au L’Afrique du Sud pleure plus jeune mais aussi plus féminine. niveau des commissions, les trois par- et danse pour Mandela S'ils sont désormais sept âgés de tis de coalition se sont partagé les pré- moins de 40 ans, le Parlement a perdu sidences, n'en laissant que deux au dix députés de plus de 60 ans. Et les CSV et une à l'ADR. PAGES 3 et 4 ...................................................................................................................................................... Flora Coquerel, nouvelle Miss France Économie 12 Premier accord depuis sa création pour l'OMC Sports 17-20 Quatre pages Coupe du monde 2014 à garder Miss Orléanais, Flora Coquerel, est devenue Miss France 2014, samedi, à Dijon. Elle est âgée de 19 ans et mesure 1,82 m. Météo 36 «Je suis très fière de représenter France 2014. Flora Coquerel, La jeune fille, Miss Orléanais, a une France cosmopolite», a dit, Franco-Béninoise âgée de accédé au titre de Miss France MATIN APRÈS-MIDI immédiatement après son cou- 19 ans, est étudiante en 2e année 2014, devançant de peu Miss Ta- 1° 5° ronnement, la nouvelle Miss de BTS commerce international. hiti, 1re dauphine. PAGE 21 Découvrez la nouvelle application de «L’essentiel»! Rendez-vousenpage 20 2 Actu LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 / WWW.LESSENTIEL.LU Un jeune homme Les jouets contrefaits saisis tué en Moselle SAINT-AVOLD - Un homme de 27 ans, disparu depuis mer- devaient inonder l’Europe credi soir, a été retrouvé mort, hier matin, près de Biding. -
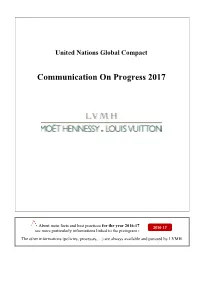
LVMH COP 2017 Global Compact B
United Nations Global Compact Communication On Progress 2017 About main facts and best practices for the year 2016-17 201 6-17 see more particularly informations linked to the pictogram : The other informations (policies, processes,…) are always available and pursued by LVMH. - 2 / 121 - Summary Statement from the CEO 3 Implementing the Ten Principles into Strategies & Operations : Criterion 1 : The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units 6 Criterion 2 : The COP describes value chain implementation 10 Robust Human Rights Management Policies & Procedures : Criterion 3 : The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights 30 Criterion 4 : The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles 33 Criterion 5 : The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights 42 integration Robust Labour Management Policies & Procedures : Criterion 6 : The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labour 44 Criterion 7 : The COP describes effective management systems to integrate the labour principles 46 Criterion 8 : The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour principles 54 integration Robust Environmental Management Policies & Procedures : Criterion 9 : The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of environmental 59 stewardship Criterion 10 : The COP describes effective management systems to integrate the environmental 71 principles -

Journal Mars 2014-2.Pdf (
Romain Lorenzini 3° talentueux graphiste a réalisé notre nouveau logo !découvrez son site : http://www.youtube.com/user/skyrom89 Collège Parc des Chaumes L’Actu Des Chaumes N°4 Mars 2014 Prix de vente papier : 0.20 cts La 4G : ouveau numéro, nouveau logo ! N L’Actu des Chaumes inaugure le l'arnaque changement avec l’arrivée à la rédaction en chef de Floryan Tienda ! De nouveaux membres sont venus du siècle? agrandir l’équipe du club journal et ils participent activement à la vie du journal. Nous nous retrouvons encore cette année toujours dans la bonne humeur ! Nous remercions vivement Romain Lorenzini pour sa réalisation du logo et nous vous invitons à découvrir ce jeune artiste dans notre prochain numéro ! Notre journal se tourne vers l’évolution du numérique pour vous en présenter certains aspects, Clément Villisek, notre spécialiste informatique très prolifique se donne à cœur joie de vous La 4G, c'est la nouvelle génération de réseau sans fil : une vitesse informer sur le sujet ! d'affichage « plus rapide », « plus accessible »...mais ?p.2 Bonne lecture à tous ! FAST & FURIOUS Toutes les 5 secondes, soit le temps que tu perd son héros ! lises ces lignes… 1 enfant de moins de 10 ans meurt de faim ! La vitesse a eu raison de Source : rapport Ziegler ONU : « 100 000 l’acteur Paul WALKER, le personnes meurent de faim tous les jours. 30 novembre 2013, il est L’agriculture mondiale peut nourrir 12 milliards de décédé à l’âge de 40 ans personne (F.A.O). Les enfants qui meurent de faim dans un terrible accident de sont donc assassinés. -

Registration Document 2013
2013 REGISTRATION DOCUMENT BUSINESS ACTIVITIES AND CSR – FULL-YEAR FINANCIAL REVIEW BOUYGUES CONSTRUCTION BOUYGUES IMMOBILIER COLAS TF1 BOUYGUES TELECOM CONTENTS Interview with Martin Bouygues, Chairman and CEO 2 THE GROUP 5 INFORMATION ON THE COMPANY 193 1.1 Profi le 6 6.1 Legal information 194 1.2 Bouygues and its shareholders 15 6.2 Share capital 197 1 1.3 2013 fi nancial year 17 6 6.3 Share ownership 201 1.4 Main events since 1 January 2014 25 6.4 Stock market information 203 6.5 Bouygues (parent company) results for the last fi ve fi nancial years 205 BUSINESS ACTIVITIES 27 CONSTRUCTION BUSINESSES 28 2.1 Bouygues Construction 28 FINANCIAL STATEMENTS 207 2 2.2 Bouygues Immobilier 36 7.1 Consolidated fi nancial statements 208 2.3 Colas 42 7.2 Auditors’ report on the consolidated fi nancial statements 272 MEDIA 50 7 2.4 TF1 50 7.3 Parent company fi nancial statements (French GAAP) 274 TELECOMS 56 2.5 Bouygues Telecom 56 7.4 Auditors’ report on the parent company fi nancial statements 289 PARENT COMPANY 64 2.6 Bouygues SA 64 POWER-TRANSPORT-GRID 66 COMBINED ANNUAL GENERAL MEETING 2.7 Alstom 66 OF 24 APRIL 2014 291 8.1 Agenda 292 HUMAN RESOURCES, ENVIRONMENTAL 8 8.2 Board of Directors’ report on the resolutions AND SOCIAL INFORMATION 71 submitted to the Combined Annual General Meeting 293 3.1 Group CSR policy and reporting methodology 72 8.3 Auditors’ reports 302 3 3.2 Human resources information 76 8.4 Draft resolutions 310 3.3 Environmental information 90 3.4 Social information 109 3.5 Independent auditor’s assurance report 120 CONCORDANCE 316 Headings of Annex 1, EU Regulation No. -

N° 138 Retour En Images 70E Anniversaire De La Libération De Chartres 13-14 Septembre Tranquilitéédito
CHARTRES 2014 OCTOBRE Vo t r e Ville chartres. fr Une fête de la Lumière à couper le souffle ! L’interview de rentrée de Jean-Pierre Gorges N° 138 Retour en images 70e anniversaire de la libération de Chartres 13-14 septembre TranquilitéÉdito À Chartres comme nulle part ailleurs Les 6 et 7 septembre derniers, le salon des associations a accueilli de très nom- breux visiteurs venus découvrir les activités proposées par quelques 150 associations chartraines. Une occasion pour moi de saluer une nouvelle fois le travail des bénévoles qui participent activement à l’animation de la ville mais aussi au tissage d’un lien social de plus en plus fort, entre quartiers, entre passionnés, entre sportifs… Autre temps fort, celui de la soirée de lancement de la nouvelle saison du Théâtre de Chartres. En offrant la prestation unique de l’humoriste Baptiste Lecaplain aux Chartrains, Jérôme Costeplane, le Directeur, a fait déplacer près de 800 spectateurs… pour seulement 500 places… La rançon du succès. Pour la saison 2014-2015, le théâtre enregistre déjà près de 1500 abonnements avec une programmation aussi étonnante que variée et des grands noms, de plus en plus nombreux, qui semblent se bousculer pour fouler les planches du Théâtre de Chartres. Autre succès, celui de la Fête de la Lumière. Une 12e édition plus spectaculaire encore que les années précédentes. Par la diversité et la multiplicité des sites et animations pro- posées, mais aussi de nouveaux spectacles, de nouvelles techniques qui font aujourd’hui de la maîtrise de la lumière un art à part entière. -

Rapport Responsabilité Sociale 2016
Rapport Responsabilité sociale 2016 Le présent « Rapport de responsabilité sociale 2016 » décrit la démarche de responsabilité sociale du groupe LVMH, sa politique et ses actions. Pour toute information complémentaire concernant les données sociales et sociétales du groupe LVMH, il convient de consulter les tableaux de concordance en page 73. Photo de couverture : présentation des créations de Camille Boillet, lauréate du prix Jeune Talent du Défilé Cultures et création, lors du Greenshowroom de Berlin. 2 SOMMAIRE LES PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIAUX DE L’ANNÉE 2016 ..................................... 4 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2016 ...................................................................... 6 LES RECONNAISSANCES EXTERNES .................................................................................. 8 LES PILIERS DE LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE .................................. 9 Les valeurs historiques du groupe LVMH ............................................................................................... 9 La diversité des métiers .................................................................................................................... 10 Les principales problématiques sociales ............................................................................................... 11 La stratégie de responsabilité sociale ................................................................................................... 12 Les engagements internationaux de LVMH .......................................................................................... -

4 Menus De Fête À L'eurélienne
Actualités Gens d'ici À l'affi che Internet : des armoires Flora Coquerel, Scènes euréliennes pour un territoire qui Miss France 2014 monte en débit page 06 page 21 page Abacapress 28 Magazine EurélienLe magazine trimestriel du Conseil général d’Eure-et-Loir - N˚28 - Hiver 2014 Dossier 4 menus de fête à l'eurélienne En pages centrales,retrouvez notre infographie spéciale Élections départementales 2015 Le Sommaire Eurélien n°28 - Hiver 2014 03 L’ÉDITO 21 GENS D’ICI Flora Coquerel, Miss France 2014 04 RETOUR EN IMAGES Vernissage de l’exposition 22 DÉCOUVERTES « Les cartes et les territoires » Cocooning dans les spas 09 d’Eure-et-Loir ACTUALITÉS 06 ACTUALITÉS Orientations budgétaires : 24 MÉMOIRES VIVES maintenir le cap malgré 1914-1918 : l’Eure-et-Loir la crise économique et la Grande Guerre 11 DOSSIER 26 À L’AFFICHE Quatre menus de fête à l'eurélienne 16 30 TRIBUNES SPÉCIAL ÉLECTIONS 16 COMPÉTENCES Comment ça marche ? 31 PARCE QU’ON EST JEUNES Spécial Élections départementales 18 INITIATIVES 21 Ils ont osé : Les rockeurs nogentais ont du cœur ! GENS D’ICI Made in : Parmentine Abacapress LE DÉCLIC DU MOIS À ILLIERS-COMBRAY, LES PETITS AMBASSADEURS DÉCOUVRENT LA LANTERNE MAGIQUE, CHEZ TANTE LÉONIE Photo : Arnaud Lombard 2 Eurélien Magazine n°28 • HIVER 2014 Un temps où l'impératif de la solidarité doit s'exprimer plus que jamais en direction des personnes Rejoignez-nous sur : fragilisées. www.facebook.com/ eureliens www.twitter.com/ eurelien L’ÉDITO du Président ’année s’achève, une année et surtout profiter d’instants 2014 marquée par tant qui restent magiques pour vivre, Eurélien n°28 - Hiver 2014 L d’événements qui s’entre- chacun à son façon, des plaisirs mêlent dans notre mémoire col- simples.