Musique Celtique.Pub
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bilan Médias Denez
Denez Bilan médias An enchanting garden - Ul liorzh vurzhudus Sortie le 7 avril 2015 chez Coop Breizh Contact presse Claire Lextray 06 07 91 47 07 - [email protected] - www.claire-lextray.com PRESSE A/R MAGAZINE: chronique AUJOURD'HUI EN FRANCE: 12 août ARMEN: juillet BRETAGNE: mai, août CARREFOUR SAVOIRS (enseigne Carrefour ) : mai CHASSE MAREE: août CFDT MAGAZINE: mai CONTACT CITY - CONTACT HEBDO ( 700 000 exemplaires - enseigne Carrefour City ) COTÉ BREST: 6 mai CÔTÉ MORLAIX: avril COTE QUIMPER: mai FEMME ACTUELLE: 3 août FRANCE CATHOLIQUE: 12 juin GUITARE SÈCHE: juin GRANDS REPORTAGES: mai, juillet KELTIA: été 2015 KEYBOARDS RECORDING: 21 août KTO MAG: avril LA CROIX : 20 juin LATINA ( magazine japonais ) : juin LA LETTRE DU SPECTACLE: 17 avril LA VIE: 25 juin LE FESTICELTE: août LE FRANÇAIS DANS LE MONDE: juillet LE MONDE DU PLEIN AIR: mai LE NOUVEL OBSERVATEUR / L'OBS LE PEUPLE BRETON: mai LE TÉLÉGRAMME: 30 mars LIBERATION: 2 mai, 12 juin MAGIC: mai NOUVELLE VIE OUVRIERE : chronique 22 juin OUEST FRANCE édition nationale: 7 avril OUEST FRANCE - édition régionale : 18, 19 mars TELERAMA : annonce émission spéciale France Musiques 1 avril, chronique album 15 avril TELE STAR: 11 mai TGV MAGAZINE: avril TRAD MAGAZINE: interview N° mai/juin US MAGAZINE: 30 juin VENTILO: juin Agences de presse : AFP: interview Denez + annonce sortie d'album 1 avril, 7 août RELAX NEWS RADIOS A2PRL - AFP AUDIO - diffusion sur 140 radios en France - 3 millions d’auditeurs " BACKSTAGE " Entre le 30 juin et 7 juillet: interview Denez + diffusion de titres, -

Mai 2008 Souscription Permanente Mai/Mae 2008 Comme Chaque Mois, Nous Vous Remercions De Votre Générosité
BRETON PEUBLE VREIZH/LE POBL ! 3,50 / 532 N° INFORMÉ ÊTRE C’EST LIBRE, ÊTRE AUJOURD’HUI, MENACESMMENACESMEENNAACCEESS SURSSURSUURR LL’HÔPIT’’HÔPIT’HHÔÔPPIITTALAALALL ENEENENN BRETBBRETBRREETTAGNEAAGNEAGGNNEE 2008 L’UDB et mai 68 MAI/MAE L ’ I N V I T É E Publique, laïque et bretonne ES FONDEMENTS de l’école publique ont Doit-on offrir à chaque enfant la possi- support des apprentissages est la Lsouvent été remis en cause, et sans bilité d’être initié à la langue bretonne ou meilleure voie d’acquisition des lan- doute plus encore ces derniers mois. Le doit-on privilégier un apprentissage en gues. C’est par souci d’efficacité que les dernier avatar en date est le projet de profondeur permettant une réelle appro- enseignants adoptent ces méthodes. nouveaux programmes, recentré sur priation de la langue ? Doit-on, au nom Des ponts s’installent entre les diffé- des supposés fondamentaux, associé à de l’égalitarisme, offrir à tous les enfants rentes filières. De nouvelles circulaires une nouvelle organisation de la semaine le même enseignement, quitte à ne faire sont publiées en 2001. La langue bre- scolaire et à la création de stages de rat- que saupoudrer, ou doit-on privilégier tonne va pouvoir enfin bénéficier de trapage pendant les vacances, tout cela un enseignement de qualité pour quel - moyens à hauteur des enjeux. sous couvert de meilleure prise en char- ques-uns ? Doit-on considérer l’idéolo- Le débat s’installe dans les instances ge de la difficulté scolaire. Travailler plus gie nationaliste qui sous-tend l’une ou des écoles publiques : est-il suppor- pour réussir mieux ! Une déclinaison du l’autre proposition ? table qu’un enseignement différent soit « travailler plus pour gagner plus » tout dispensé à des enfants ? Les vieux dé- aussi racoleuse et tout autant inexacte. -

Language Diversity and Linguistic Identity in Brittany: a Critical Analysis of the Changing Practice of Breton
Language diversity and linguistic identity in Brittany: a critical analysis of the changing practice of Breton Adam Le Nevez PhD 2006 CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY I certify that the work in this thesis has not been previously submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text. I also certify that this thesis has been written by me. Any help I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis. Signature ________________________________________ Adam Le Nevez i Acknowledgements There are many people whose help in preparing this thesis I would like to acknowledge and many others whom I would like to thank for their support. Many thanks go to Alastair Pennycook, Francis Favereau and Murray Pratt for their encouragement, support, advice and guidance; to Julie Chotard, Amandine Potier- Delaunay, Justine Gayet and Catherine Smith for their proofreading and help in formatting. Thanks too to my family and the many friends and colleagues along the way who encouraged me to keep going. Special thanks go to Astrid and Daniel Hubert who lent their farmhouse to a stranger out of the kindness of their hearts. Finally, thanks go to the generosity of all those who participated in the research both formally and informally. Without their contributions this would not have been possible. ii Table of Contents ABSTRACT................................................................................................................................................ V INTRODUCTION....................................................................................................................................... 1 CHAPTER 1: THEORETICAL APPROACHES TO LINGUISTIC DIVERSITY .......................... -

Les Mondes Celtes
LES MONDES CELTES sélection de la Bibliothèque de Toulouse dans le cadre du festival Rio Loco 2016 Introduction 7 sommaire Qu’est-ce que les mondes celtiques ? 8 Racines et patrimoine 10 Bretagne 66 Musique ! 10 • Musique ! 66 Cultures vivantes 13 • Cultures vivantes 74 • Civilisations celtes 13 • Littératures et récits de voyage 75 • Religions 16 • Arts et cinéma 80 • Traditions et symboles 17 • Jeune public : 81 Littératures et récits de voyages 19 contes et découvertes • Récits de voyages 23 Europe et ailleurs 84 Arts et cinéma 24 Europe 84 Jeune public : 26 Espagne : Asturies et Galice 84 contes et découvertes Asturies 84 Royaume-Uni 30 • Musique ! 84 Écosse 30 Galice 85 • Musique ! 30 • Musique ! 85 • Cultures vivantes 36 • Cinéma 86 • Littératures et récits de voyage 37 Italie : Vallée d’Aoste 87 • Arts et cinéma 39 • Musique ! 87 • Jeune public : 40 Ailleurs en Europe 87 contes et découvertes • Musique ! 87 Île de Man 41 • Cultures vivantes 88 • Musique ! 41 • Jeune public : 89 • Cultures vivantes 41 contes et découvertes Pays de Galles 42 Ailleurs 89 • Musique ! 42 • Musique ! 89 • Cultures vivantes 44 • Littératures 92 • Littératures 44 Cornouailles 45 ZOOM SUR… • Musique ! 45 La cornemuse 11 • Jeune public : 47 Les langues celtiques 13 contes et découvertes Jean Markale 18 Irlande 48 La Légende arthurienne 19 • Musique ! 48 Ken Loach 63 • Cultures vivantes 57 Lexique 93 • Littératures et récits de voyage 58 Remerciements 99 • Arts et cinéma 61 • Jeune public : 63 contes et découvertes Introduction 7 sommaire Qu’est-ce que les -

La Culture Bretonne
Hugvísindadeild La culture bretonne La culture bretonne, vivante et menacée Ritgerð til B.A. prófs Yannick Víkingur Hafliðason Desember 2008 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Franska La culture bretonne La culture bretonne, vivante et menacée Ritgerð til B.A.prófs Yannick Víkingur Hafliðason Kt.: 2108782039 Leiðbeinandi: Gérard Lemarquis Desember 2008 Table des matières 1) Introduction: p.2-4 2) L‘économie: p.5 3) Les emblèmes: p.6-9 4) L'Histoire: p.9-15 5) La langue: p.15-21 6) La musique: p. 22-33 7) La littérature: la matière de Bretagne: p.34-39 8) Les contes et légendes: p.39-51 9) La gastronomie: p.52-57 10) Les arts plastiques: p.57-60 11) Les traditions vestimentaires: p.60-62 12) Conclusion: p.62-63 13) Annexes: p.64-72 14) Sources: p.73-75 1 La culture bretonne est vivante, et s'exprime dans les arts, la musique, la littérature ou le mode de vie. Mais elle est aussi menacée, car le breton est en régréssion, et les médias modernes uniformisent les régions. Mais la culture bretonne dispose aussi d'autres cultures celtes soeurs auprès desquelles elle peut se ressourcer. La menace est un handicap, car intérioriser le déclin est une incitation á renoncer. Mais c'est aussi une chance, car elle pousse á la résistance, qui peut stimuler la créativité. La Bretagne (Breizh en breton) est une région française située á l'ouest de la France et est habitée par environ 4,2 millions de personnes. Elle est composée de quatre départements:L'Ille et Vilaine (22), Les Côtes d'Armor (35), Le Morbihan (56) et le Finistère (29). -

L'ordre De L'hermine Titulaires Contemporains Christian Troadec, Maire De Carhaix Et Conseiller Départemental Et Patrick Ma
L’Ordre de l’Hermine Titulaires contemporains Créé en 1381, l’ordre de l’Hermine est un des plus anciens parmi les ordres militaires et honorifiques en Europe. En 1972 à Pontivy En 1997 à Quintin En 2007 à Saint-Brieuc Christian Troadec, René PLEVEN † Jean-Jacques HENAFF Rhisiart HINCKS maire de Carhaix et conseiller départemental En 1973 à Rome et Rennes Jean L’HELGOUACH † Martial PEZENNEC † En 1344, Édouard III d’Angleterre fonde l’ordre des «Chevaliers de Gabriele PESCATORE Dodik JEGOU Job an IRIEN et Patrick Malrieu, saint George», puis en 1348, celui de la Jarretière. Jean II, en France, Jean MEVELLEC † Raymond LEBOSSE † François LE QUEMENER † président de l’Institut culturel de Bretagne crée en 1351 l’Ordre de l’Étoile. En 1430, c’est La Toison d’Or du duc En 1988 à Rennes En 1998 à Vitré En 2008 à Rennes ont le plaisir de vous inviter à la de Bourgogne suivi du Croissant fondé par René d’Anjou en 1448. Vefa de BELLAING † Goulc’han KERVELLA Roger ABJEAN † La fondation de l’Ordre de l’Hermine par Jean IV, duc de Bretagne Pierre-Roland GIOT † Henri MAHO † Gweltaz ar FUR Pierre LOQUET Yvonne BREILLY-LE CALVEZ Cérémonie de remise du Collier de l’Hermine affirme la prééminence ducale sur l’ensemble de la noblesse et une Polig MONJARRET † Henri QUEFFELEC † A. CORRE (N. ROZMOR) † Viviane HELIAS volonté d’unité autour du souverain. En 1999 à Nantes En 2009 à Ancenis L’ordre présente la particularité d’être ouvert aux femmes et aux En 1989 à Nantes le Samedi 17 Septembre, Bernard de PARADES † Jean-Bernard VIGHETTI Jean-Christophe CASSARD † Espace Glenmor, à Carhaix roturiers. -

Grands Noms Bretons Au Collège Bretoned Veur Er Skolaj
GRANDS NOMS BRETONS AU COLLÈGE BRETONED VEUR ER SKOLAJ YVES COPPENS A 14 ans, Denez a appris le kan-ha-diskan Yves Coppens, né le 9 août 1934 à Vannes, auprès d’Alain Leclère et deux ans plus tard est un paléoanthropologue français et ils chantaient dans les festoù-noz. éminent professeur au Collège de France. Il a remporté plusieurs prix : prix du kan-ha- Il a découvert Lucy : la première australo- diskan en 1987, prix du chant nouveau en pithèque qui a été découverte en Ethiopie, 1988 et prix du chant traditionnel en 1990. vieille de 3,2 millions d’années. Denez devient enseignant de breton à Ca- Durant son enfance, Yves Coppens était rhaix en 1988, activité qu’il abandonne 3 ans passionné de Préhistoire et d’archéologie, plus tard, en 1991, pour devenir chanteur par exemple il aimait beaucoup les menhirs professionnel. Entre 1988 et 1991, il chante de Carnac, non loin de son lieu de naissance. dans les manifestations de musique tradi- LEXIQUE Il a obtenu son bac au lycée Jules Simon à tionnelle comme « Les Tombées de la Nuit Geriaoueg Vannes et une licence de sciences-naturelles » ou le « Festival interceltique de Lorient ». à l’université de Rennes. La Ville de Rennes, jumelée en 1991 avec Al- Henzenoniour : En 1956, âgé seulement de 22 ans, il devient ma-Ata (la plus grande ville du Kazakhstan), paléoanthropologue chercheur au CNRS. lui propose d’aller chanter pour l’évènement Ragistor : préhistoire En 1961, il découvre le crâne d’un homo « Voice of Asia » qui y était organisée. -

Vendredi 1Er Août
La programmation 2008 Vendredi 1er Août 20h00 Cotriade avec Bagad, Toreth (Pays de Galles), La Virée (Acadie), Capstern (chants de marins) Repas traditionnel de poisson et musiques de la mer Port de Pêche 15 € (enfants de moins de 14 ans : 8 €) La Cotriade (du breton « kaoter », chaudron, et donc « kaoteriad », contenu du chaudron, chaudronnée) est le plat traditionnel des retours de pêche. Il faut nécessairement plusieurs poissons de toutes espèces : maquereau, lieu, congre, grondin, chinchard, vieille, vive, etc. Au débarquement, chaque marin recevait en sus de son salaire une part de la pêche : la «godaille» avec laquelle l’épouse préparait les recettes locales. On consomme d’abord l’exquise soupe de poissons puis, les poissons eux-mêmes… c’est l’occasion de se rencontrer au hasard des longues tablées où des milliers de convives fraternisent dans une ambiance de musiques et de chants marins. Toreth Fondé par Gareth Westacott et Guto Dafis en 2001 à l'occasion d'un festival, ce groupe de folk-traditionnel s'est créé une identité forte qui lui a valu de sillonner de nombreux festivals, et ce bien au delà du Pays de Galles. Leur album, sorti en 2003, proposant une musique dans la pure tradition Galloise, au son du violon et de l'accordéon, a été plébiscité par nombre de critiques. Déjà venu en terres bretonnes quelques années auparavant, Toreth revient nous faire danser à l'occasion de l'année du Pays de Toreth Galles. La Virée Depuis 2001, La Virée parcourt l’Acadie et la France pour vous faire swinguer. Les musiciens revisitent les airs québécois et acadiens, mais reprennent aussi ceux de Bretagne, le tout sous des thèmes contemporains. -

Les Femmes De Bretagne Viennent Faire Leur Show À Paris
A l'occasion de la Journée des droits des femmes Les femmes de Bretagne viennent faire leur show à Paris le 9 mars 2018 au Pan Piper à 20 h DOSSIER PRESSE VOIX DE FEMMES – DOSSIER de PRESSE 20/11/17 NOLWENN KORBELL 32, rue de la Vallée | 22190 PLERIN [email protected] 02.96.70.86.99 / 06.75.25.08.91 VOIX DE FEMMES – DOSSIER de PRESSE 20/11/17 Nolwenn Korbell a vu les fées se pencher sur son berceau avec un père, sonneur à Bourbriac et une mère, Andrea Ar Gouilh, grande voix féminine de ces quarante dernières années. Depuis ses études au Conservatoire d’Art Dramatique de Rennes, Nolwenn Korbell une belle carrière de chanteuse, comédienne, auteur et compositeur, ponctuée de nombreuses distinctions. Un beau et riche parcours d’artiste où alternent et s’entremêlent moments forts sur les planches avec le théâtre ou la télévision et les feux de la rampe avec la chanson. Aujourd’hui, après un nouvel album en collaboration avec Franck Darcel (Marquis de Sade, republik…), « Nolwenn Korbell’s band » qui sortira en février 2018, Nolwenn continue sa route d’auteur, compositeur dans sa langue, le breton, avec ce nouveau projet, présenté le 9 mars 2018, en création, sur la scène du Pan Piper. VOIX DE FEMMES – DOSSIER de PRESSE 20/11/17 Après avoir commencé le théâtre en amateur à Douarnenez à l’âge de 15 ans (cours à la MJC, lectures de poèmes, représentation de « L’enfant mort sur le trottoir » de Guy Foissy), Nolwenn Korbell a dès ses 16 ans un pied dans le milieu professionnel en doublant en breton les premières séries de dessins animés pour France 3 Bretagne. -

Gonzo 385-6.Pub
Subscribe to Gonzo Weekly http://eepurl.com/r-VTD Subscribe to Gonzo Daily http://eepurl.com/OvPez Gonzo Facebook Group https://www.facebook.com/groups/287744711294595/ Gonzo Weekly on Twitter https://twitter.com/gonzoweekly Gonzo Multimedia (UK) http://www.gonzomultimedia.co.uk/ Gonzo Multimedia (USA) http://www.gonzomultimedia.com/ Gonzo Daily Blog https://gonzo-multimedia.blogspot.com/ LEST WE FORGET John Brodie Good Dave McMann Mick Farren 3 only do we not know how long it’s going to last, but we have no real idea of how the world is going to look when we all eventually come out of isolation. A lot of the people that I ‘know’ on Twitter are still in a state of of utopian idealism, claiming that this is the final death knell for World Capitalism. Others are depicting the advent of a nasty Orwellian police state in which all of our civil liberties will go out the window, and the United Kingdom becomes something akin to Belarus. Me? I’m not going to make any predictions at all. We still have months of this lockdown to Dear friends, go, and – no doubt – the situation will change many times before we are finally allowed out Welcome to another issue of this ever to associate freely. peculiar magazine. I don’t need to tell you that everybody on this planet is currently However, I will just say that it is quite affected by the biggest crisis for at least a gratifying that the idea of anti-Capitalism, generation. For those of us in the UK, it is the which I have been espousing all my adult life, biggest crisis since the end of the Second has finally become part of a mainstream World War and quite possibly longer, and not agenda. -

Invitation Collier De L'hermine
L’Ordre de l’Hermine Norbert Métairie Créé en 1381, l’ordre de l’Hermine est un des plus anciens parmi les Maire de Lorient ordres militaires et honorifiques en Europe. Président de Lorient Agglomération En 1344, Édouard III d’Angleterre fonde l’ordre des «Chevaliers de Guy Gestin et Lisardo Lombardia saint George», puis en 1348, celui de la Jarretière. Jean II, en France, Président et Directeur du Festival interceltique crée en 1351 l’Ordre de l’Étoile. En 1430, c’est La Toison d’Or du duc de Bourgogne suivi du Croissant fondé par René d’Anjou en 1448. Patrick Malrieu, La fondation de l’Ordre de l’Hermine par Jean IV, duc de Bretagne Président de l’Institut culturel de Bretagne affirme la prééminence ducale sur l’ensemble de la noblesse et une volonté d’unité autour du souverain. ont le plaisir de vous inviter à la L’ordre présente la particularité d’être ouvert aux femmes et aux roturiers. La première chevaleresse est Jeanne de Navarre, suivie de Jeanne d’Albret, comtesse de Richemont, et en 1447, Isabeau Cérémonie de remise du Collier de l’Hermine d’Écosse, duchesse de Bretagne. Comme tous les ordres de chevalerie, l’ordre de l’Hermine fut aboli à le Samedi 11 août 2018, à 15 h. la Révolution française et détruit le dernier collier qui ornait la tombe Club K du stade du Moustoir de Jean IV dans la cathédrale de Nantes. rue Pierre Guergadig 56100, Lorient La renaissance de l’Hermine En 1972, lorsque le Sénateur Georges Lombard succéda à René Pléven à la tête du Celib, il eut, pour lui exprimer la reconnaissance Programme de toute la Bretagne, l’idée de remettre à l’honneur cette distinction 15 h. -
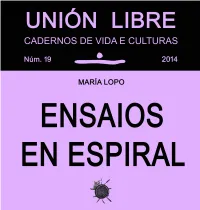
Ensaios En Espiral.Pdf
MARÍA LOPO ENSAIOS EN ESPIRAL Os dereitos de autor do presente número de Unión Libre están protexidos por unha licenza Creative Commons (CC-BY-NC-ND) Recoñecemento - Non Comercial - Non Derivada 2 ÍNDICE Páxina Baixo o signo da espiral 6 Espiral de espirais 8 O lugar (2002) 9 Bretoa 60 La littérature bretonne de langue française (2002) 61 A propósito do concepto de literatura bretoa en lingua francesa (1996) 109 O bardo. Mito político e literario na poesía bretoa contemporánea de lingua francesa (1997) 122 Guillevic. De terra e de auga (2004) 150 Céltica 174 Amor e celtismo. Da Materia de Bretaña aos amores libres (2005) 175 Mareas célticas (2002) 209 L'Imaginaire celtique en Galice (2010) 215 Fole e o celtismo (1997) 224 Galaicista 241 Yezh ha lennegezh Galiza (1997) 242 Entrée au domaine des chevaux (2000) 253 Gens de vie sur la Côte de la Mort (2002) 259 Lingüística 267 Camiñar nas linguas (1999) 268 Langue libre lieu (2001) 270 Literaria 282 Trobadoras de Occitania. A voz das damas (2009) 283 3 Tempo da palabra (Ánxel Fole) (2002) 313 No bosque mariño (2007) 314 Paroles dans le noir. L’aventure radiophonique de Samuel Beckett (2000) 323 Surrealista 331 “L’Union libre” de André Breton (1998) 332 Eugenio Fernández Granell (2004) 357 Eugenio Granell e o Surrealismo francés: Breton, Duchamp, Péret (2007) 365 Juego de islas. La correspondencia de André Breton y Eugenio Granell (2010) 403 Conta comigo (2012) 417 L'Éros heureux d'Eugenio Granell (2014) 418 Exiliada 429 Amparo Segarra. Alén dos Pireneos (2006) 430 O capitán galego de André Sernin (2004) 442 Fillos do exilio (2008) 460 Hispánica 463 Claude Henri Poullain: hispanismo sen fronteiras (1999) 464 Las lenguas de Francia en la poesía de José Ángel Valente (2008) 472 Valente e Lautréamont (2013) 488 Camusiana 498 Albert Camus.