Langues Et Cultures Dans Le Bassin Du Lac Tchad
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
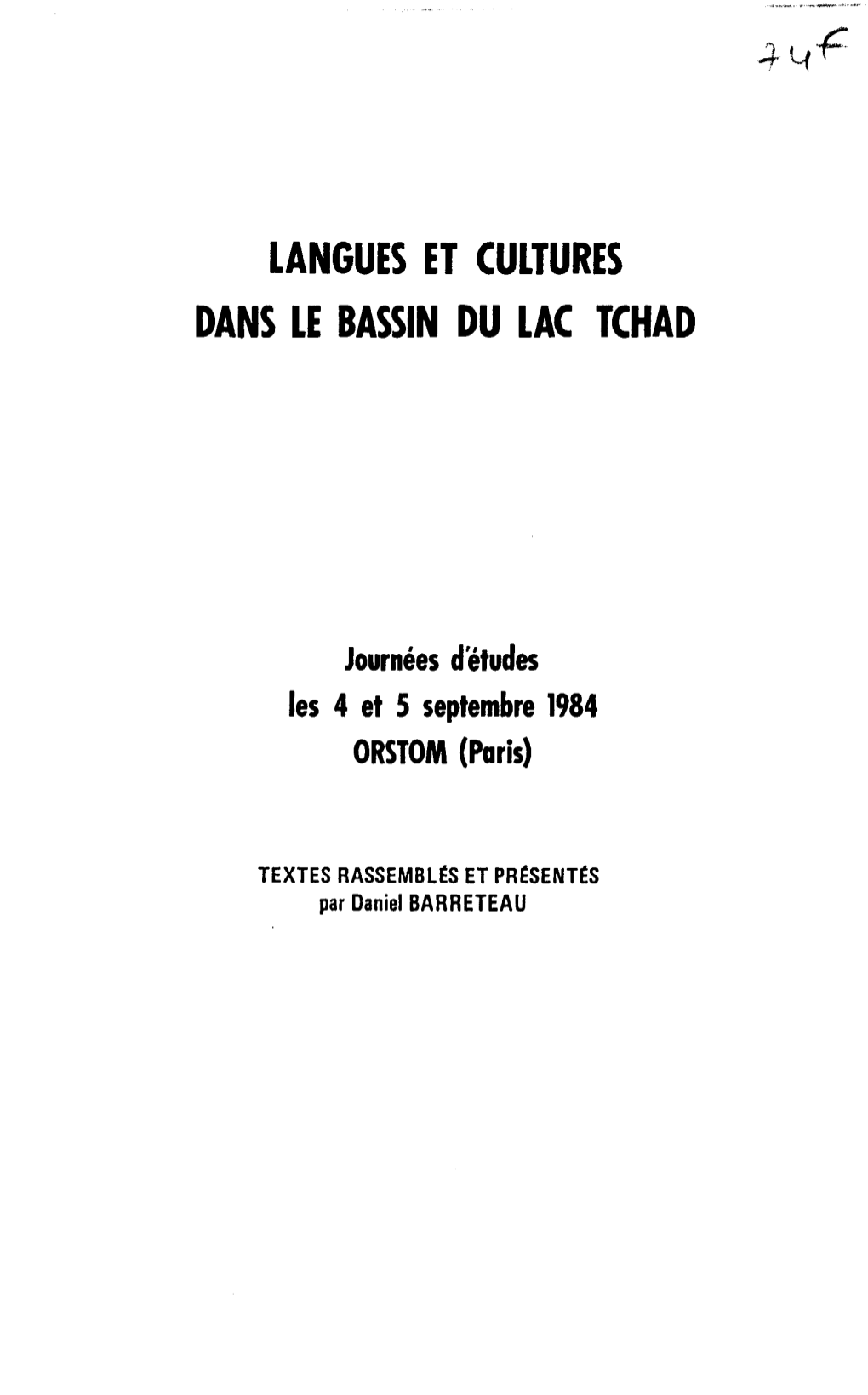
Load more
Recommended publications
-

5892 Cisco Category: Standards Track August 2010 ISSN: 2070-1721
Internet Engineering Task Force (IETF) P. Faltstrom, Ed. Request for Comments: 5892 Cisco Category: Standards Track August 2010 ISSN: 2070-1721 The Unicode Code Points and Internationalized Domain Names for Applications (IDNA) Abstract This document specifies rules for deciding whether a code point, considered in isolation or in context, is a candidate for inclusion in an Internationalized Domain Name (IDN). It is part of the specification of Internationalizing Domain Names in Applications 2008 (IDNA2008). Status of This Memo This is an Internet Standards Track document. This document is a product of the Internet Engineering Task Force (IETF). It represents the consensus of the IETF community. It has received public review and has been approved for publication by the Internet Engineering Steering Group (IESG). Further information on Internet Standards is available in Section 2 of RFC 5741. Information about the current status of this document, any errata, and how to provide feedback on it may be obtained at http://www.rfc-editor.org/info/rfc5892. Copyright Notice Copyright (c) 2010 IETF Trust and the persons identified as the document authors. All rights reserved. This document is subject to BCP 78 and the IETF Trust's Legal Provisions Relating to IETF Documents (http://trustee.ietf.org/license-info) in effect on the date of publication of this document. Please review these documents carefully, as they describe your rights and restrictions with respect to this document. Code Components extracted from this document must include Simplified BSD License text as described in Section 4.e of the Trust Legal Provisions and are provided without warranty as described in the Simplified BSD License. -

Kyrillische Schrift Für Den Computer
Hanna-Chris Gast Kyrillische Schrift für den Computer Benennung der Buchstaben, Vergleich der Transkriptionen in Bibliotheken und Standesämtern, Auflistung der Unicodes sowie Tastaturbelegung für Windows XP Inhalt Seite Vorwort ................................................................................................................................................ 2 1 Kyrillische Schriftzeichen mit Benennung................................................................................... 3 1.1 Die Buchstaben im Russischen mit Schreibschrift und Aussprache.................................. 3 1.2 Kyrillische Schriftzeichen anderer slawischer Sprachen.................................................... 9 1.3 Veraltete kyrillische Schriftzeichen .................................................................................... 10 1.4 Die gebräuchlichen Sonderzeichen ..................................................................................... 11 2 Transliterationen und Transkriptionen (Umschriften) .......................................................... 13 2.1 Begriffe zum Thema Transkription/Transliteration/Umschrift ...................................... 13 2.2 Normen und Vorschriften für Bibliotheken und Standesämter....................................... 15 2.3 Tabellarische Übersicht der Umschriften aus dem Russischen ....................................... 21 2.4 Transliterationen veralteter kyrillischer Buchstaben ....................................................... 25 2.5 Transliterationen bei anderen slawischen -

Federal Railroad Administration Fiscal Year 2012 Enforcement Report
Federal Railroad Fiscal Year 2012 Administration Enforcement Report Table of Contents I. Introduction II. Summary of Inspections and Audits Performed and of Enforcement Actions Recommended in FY 2012 A. Railroad Safety and Hazmat Compliance Inspections and Audits 1. All Railroads and Other Entities (e.g., Hazmat Shippers) Except Individuals 2. Railroads Only B. Summary of Railroad Safety Violations Cited by Inspectors, by Regulatory Oversight Discipline or Subdiscipline 1. Accident/Incident Reporting 2. Grade Crossing Signal System Safety 3. Hazardous Materials 4. Motive Power and Equipment 5. Railroad Operating Practices 6. Signal System Safety 7. Track C. FRA and State Inspections of Railroads, Sorted by Railroad Type 1. Class I Railroads 2. Probable Class II Railroads 3. Probable Class III Railroads D. Inspections and Recommended Enforcement Actions, Sorted by Individual Class I Railroad 1. BNSF Railway Company 2. Canadian National Railway/Grand Trunk Corporation 3. Canadian Pacific Railway/Soo Line Railroad Company 4. CSX Transportation, Inc. 5. The Kansas City Southern Railway Company 6. National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) 7. Norfolk Southern Railway Company 8. Union Pacific Railroad Company III. Civil Penalty Assessment and Settlement Summaries in FY 2012 A. In General B. Summary 1—Brief Summary, with Focus on Initial Assessments Transmitted C. Breakdown of Initial Assessments in Summary 1 1. For Each Class I Railroad Individually in FY 2012 2. For Probable Class II Railroads in Aggregate in FY 2012 3. For Probable Class III Railroads in Aggregate in FY 2012 4. For Hazmat Shippers in Aggregate in FY 2012 5. For Contractors in Aggregate in FY 2012 D. -
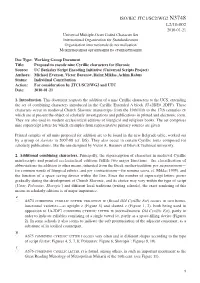
Iso/Iec Jtc1/Sc2/Wg2 N3748 L2/10-002
ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3748 L2/10-002 2010-01-21 Universal Multiple-Octet Coded Character Set International Organization for Standardization Organisation internationale de normalisation Международная организация по стандартизации Doc Type: Working Group Document Title: Proposal to encode nine Cyrillic characters for Slavonic Source: UC Berkeley Script Encoding Initiative (Universal Scripts Project) Authors: Michael Everson, Victor Baranov, Heinz Miklas, Achim Rabus Status: Individual Contribution Action: For consideration by JTC1/SC2/WG2 and UTC Date: 2010-01-21 1. Introduction. This document requests the addition of a nine Cyrillic characters to the UCS, extending the set of combining characters introduced in the Cyrillic Extended A block (U+2DE0..2DFF). These characters occur in medieval Church Slavonic manuscripts from the 10th/11th to the 17th centuries CE which are at present the object of scholarly investigations and publications in printed and electronic form. They are also used in modern ecclesiastical editions of liturgical and religious books. The set comprises nine superscript letters for which examples from representative primary sources are given. Printed samples of all units proposed for addition are to be found in the new Belgrade table, worked out by a group of slavists in 2007-08 (cf. BS). They also occur in certain Cyrillic fonts composed for scholarly publications, like the one designed by Victor A. Baranov at Izhevsk Technical university. 2. Additional combining characters. Principally, the superscription of characters in medieval Cyrillic manuscripts and printed ecclesiastical editions fulfils two major functions—the classification of abbreviations (in addition to other means, inherited from the Greek mother-tradition: per suspensionem— for common words of liturgical rubrics, and per contractionem—for nomina sacra, cf. -

Works of Russell G. Schuh
UCLA Works of Russell G. Schuh Title Schuhschrift: Papers in Honor of Russell Schuh Permalink https://escholarship.org/uc/item/7c42d7th ISBN 978-1-7338701-1-5 Publication Date 2019-09-05 Supplemental Material https://escholarship.org/uc/item/7c42d7th#supplemental Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Schuhschrift Margit Bowler, Philip T. Duncan, Travis Major, & Harold Torrence Schuhschrift Papers in Honor of Russell Schuh eScholarship Publishing, University of California Margit Bowler, Philip T. Duncan, Travis Major, & Harold Torrence (eds.). 2019. Schuhschrift: Papers in Honor of Russell Schuh. eScholarship Publishing. Copyright ©2019 the authors This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 Interna- tional License. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. ISBN: 978-1-7338701-1-5 (Digital) 978-1-7338701-0-8 (Paperback) Cover design: Allegra Baxter Typesetting: Andrew McKenzie, Zhongshi Xu, Meng Yang, Z. L. Zhou, & the editors Fonts: Gill Sans, Cardo Typesetting software: LATEX Published in the United States by eScholarship Publishing, University of California Contents Preface ix Harold Torrence 1 Reason questions in Ewe 1 Leston Chandler Buell 1.1 Introduction . 1 1.2 A morphological asymmetry . 2 1.3 Direct insertion of núkàtà in the left periphery . 6 1.3.1 Negation . 8 1.3.2 VP nominalization fronting . 10 1.4 Higher than focus . 12 1.5 Conclusion . 13 2 A case for “slow linguistics” 15 Bernard Caron 2.1 Introduction . -

ISO/IEC International Standard 10646-1
JTC1/SC2/WG2 N3381 ISO/IEC 10646:2003/Amd.4:2008 (E) Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) — AMENDMENT 4: Cham, Game Tiles, and other characters such as ISO/IEC 8824 and ISO/IEC 8825, the concept of Page 1, Clause 1 Scope implementation level may still be referenced as „Implementa- tion level 3‟. See annex N. In the note, update the Unicode Standard version from 5.0 to 5.1. Page 12, Sub-clause 16.1 Purpose and con- text of identification Page 1, Sub-clause 2.2 Conformance of in- formation interchange In first paragraph, remove „, the implementation level,‟. In second paragraph, remove „, and to an identified In second paragraph, remove „with an implementation implementation level chosen from clause 14‟. level‟. In fifth paragraph, remove „, the adopted implementa- Page 12, Sub-clause 16.2 Identification of tion level‟. UCS coded representation form with imple- mentation level Page 1, Sub-clause 2.3 Conformance of de- vices Rename sub-clause „Identification of UCS coded repre- sentation form‟. In second paragraph (after the note), remove „the adopted implementation level,‟. In first paragraph, remove „and an implementation level (see clause 14)‟. In fourth and fifth paragraph (b and c statements), re- move „and implementation level‟. Replace the 6-item list by the following 2-item list and note: Page 2, Clause 3 Normative references ESC 02/05 02/15 04/05 Update the reference to the Unicode Bidirectional Algo- UCS-2 rithm and the Unicode Normalization Forms as follows: ESC 02/05 02/15 04/06 Unicode Standard Annex, UAX#9, The Unicode Bidi- rectional Algorithm, Version 5.1.0, March 2008. -

Bedtime Routines W.Pdf
TIP SHEET Nbechgeng eshchigeng “Gawii nii nbaasii! Gaasknaabaagwe! Wiigwaamensing nii zhaa! Nzegis dbikak! Gii nondaa- naadik gwa maanda niibnanching, ensa naakshik. Aapji gwo znagzi binojiinh wii nbechgaazat. Aapchi gwo mskwiigde’endaagwat ensa naakshit binoojingh wii nbaadat, maage gmaapiitodbik kshwaasit ndowabmat mamaain maage bapaain.” Nsastamiing enji snagzit binoojiinh wii nbaat Weweni gwa nebaajik binoojiighik mnanendmwak, mnazhayaaok, miinwaa mnagnewak. Weweni gwa binoojiingh nwebit aapji wenpanzi wii kken- Njida gwa znagzii egaachiinhit binoojingh wii dang gego, miinwaa wii naanaagde’endang, wii nbechgaazat. Naangwadnang gwa aapjii memdage mnowaangwazit, miinwaa wii mnawiidokaazat. snagzi binoojiinh, memdage gwa giishpin znagen- N’dakenjgewin temgat iidik binoojiinghik, miin- dang, maage shkendang, maage aakzit. Naangwad- waa getchi piitzijik snagzit wii naagde’endmowat nang gwanaa zhwe’ebzi maanda binoojingh, aanin zhayaawin giishpin nondeset nwebwin. siigwa aabji zhwe’ebzi maanda binoojingh. Learning Together - Nbechgeng eshchigeng page 1 of 3 Nbechgeng eshchigeng Aapjii gwa znagzi binoogiinh wii bmagwebnin gnoonaa, miinwaa wii nengaajiikwa, biinish agizhep, miinwaa gwa daa mjizhwe-ebzi, daa ne’aab wii nbaat. miiskwiigde’endam, maage gwa nonde nbaa epiichi damnat, maage epiichi wiisnit. Daa nashkwegon 5. Aanin Miinwaa Genjii gshkitoosig binoojiinh gwa binoojiinh gegoo wii kkendan kinoomaawin, wii nbaat miinwaa wiidwakaazat giishpin zaam ekzit. • Gawii nistowendziin binoojiinh eksit • Yaa’abi agitziiman wii nbwaatchan Aapdek gwa wii nsastaajgaade enji snagzit bi- • Zaam gjide, ksinaa, waaseaa, gzigwaan noojiinh wii nbaat, jibwaa nadmowin weweni wii waabowan, maage zaam biigwe’e nwebit. Nsaastajgaadek gwa eshchigeng wii naad- • Binoojiinh znagendam mkwendang wii sk- mowin binoojiinh oonwit, wii gzhaaget, maanaadsenit gidzii- man, maage gegoo do znagendmigwan Wii mnangwaang da mnanaamowaa binoojiinh wii • Zaam giiwajipii nwebi epich giizhgak mnadendang miinwaa wii mnawaangwasit. -

Cyrillic # Version Number
############################################################### # # TLD: xn--j1aef # Script: Cyrillic # Version Number: 1.0 # Effective Date: July 1st, 2011 # Registry: Verisign, Inc. # Address: 12061 Bluemont Way, Reston VA 20190, USA # Telephone: +1 (703) 925-6999 # Email: [email protected] # URL: http://www.verisigninc.com # ############################################################### ############################################################### # # Codepoints allowed from the Cyrillic script. # ############################################################### U+0430 # CYRILLIC SMALL LETTER A U+0431 # CYRILLIC SMALL LETTER BE U+0432 # CYRILLIC SMALL LETTER VE U+0433 # CYRILLIC SMALL LETTER GE U+0434 # CYRILLIC SMALL LETTER DE U+0435 # CYRILLIC SMALL LETTER IE U+0436 # CYRILLIC SMALL LETTER ZHE U+0437 # CYRILLIC SMALL LETTER ZE U+0438 # CYRILLIC SMALL LETTER II U+0439 # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT II U+043A # CYRILLIC SMALL LETTER KA U+043B # CYRILLIC SMALL LETTER EL U+043C # CYRILLIC SMALL LETTER EM U+043D # CYRILLIC SMALL LETTER EN U+043E # CYRILLIC SMALL LETTER O U+043F # CYRILLIC SMALL LETTER PE U+0440 # CYRILLIC SMALL LETTER ER U+0441 # CYRILLIC SMALL LETTER ES U+0442 # CYRILLIC SMALL LETTER TE U+0443 # CYRILLIC SMALL LETTER U U+0444 # CYRILLIC SMALL LETTER EF U+0445 # CYRILLIC SMALL LETTER KHA U+0446 # CYRILLIC SMALL LETTER TSE U+0447 # CYRILLIC SMALL LETTER CHE U+0448 # CYRILLIC SMALL LETTER SHA U+0449 # CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA U+044A # CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN U+044B # CYRILLIC SMALL LETTER YERI U+044C # CYRILLIC -

The Vowel System of Moloko
The Vowel System of Moloko Catherine Bow (B.A.) A thesis submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts in the Department of Linguistics and Applied Linguistics, Faculty of Arts, University of Melbourne. November 1999 ACKNOWLEDGMENTS Firstly to the Moloko community, particularly Pastor Oumar Abraham and Molabai, as well as members of the Moloko Language Development Committee, the Moloko Translation Committee and the ACDM, for their patient assistance and support. To Alan and DeEtte Starr and their family for their ongoing work among the Moloko, and for their love and fellowship during our time together in Maroua. To the SIL community in Cameroon, the ones who are still over there doing the really hard, important work, and should be commended. I consider it a great privilege to have been part of what God is doing through SIL in Cameroon, and my memories of Africa are greatly enriched by the joyful sense of community in which I shared. Special thanks to my colleagues in the north: the Cheffys, the Gravinas, the Kinnairds, Marti & Elizabeth, for their invaluable input into my life and my research. And to my friends in Yaoundé, particularly Julia Baker, whose warmth and hospitality were always appreciated. To my supervisors in Cameroon, Drs Steven Bird, Keith Snider and Jim Roberts, for their assistance and technical advice. And to the noted Chadicists who freely gave of their time and wisdom – Ekkehard Wolff and Paul Newman. To my friends and colleagues at the South Pacific Summer Institute of Linguistics at Kangaroo Ground through whom I have been richly blessed by their fellowship, encouragement, love and support since my return from Africa. -

Drivers of Residual Estuarine Circulation in Tidally Energetic Estuaries: Straight and Irrotational Channels with Parabolic Cross Section
548 JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY VOLUME 41 Drivers of Residual Estuarine Circulation in Tidally Energetic Estuaries: Straight and Irrotational Channels with Parabolic Cross Section HANS BURCHARD Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemu¨nde, Rostock, Germany ROBERT D. HETLAND Department of Oceanography, Texas A&M University, College Station, Texas ELISABETH SCHULZ Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemu¨nde, Rostock, Germany HENK M. SCHUTTELAARS Delft Institute of Applied Mathematics, Delft University of Technology, Delft, Netherlands (Manuscript received 19 February 2010, in final form 5 November 2010) ABSTRACT The generation of residual circulation in a tidally energetic estuary with constant longitudinal salinity gradient and parabolic cross section is examined by means of a two-dimensional cross-sectional numerical model, neglecting river runoff and Stokes drift. It is shown how the longitudinal and lateral residual circu- lation can be decomposed into contributions from various processes such as tidal straining circulation, gravitational circulation, advectively driven circulation, and horizontal mixing circulation. The sensitivity of the residual circulation and its components from various processes to changes in forcing is investigated by varying the Simpson number (nondimensional longitudinal buoyancy gradient) and the unsteadiness pa- rameter (nondimensional tidal frequency), as well as the bed roughness and the width of the estuary. For relatively weak salinity gradient forcing, the tidal straining circulation dominates the residual exchange cir- culation in support of classical estuarine circulation (up-estuary flow near the bed and down-estuary flow near the surface). The strength of the longitudinal estuarine circulation clearly increases with increased salinity gradient forcing. However, when the Simpson number exceeds 0.15, the relative contributions of both gravitational circulation and advectively driven circulation to estuarine circulation increase substantially. -

Online Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics
Online Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics PAUL NEWMAN Online Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics compiled by PAUL NEWMAN 1. INTRODUCTION The Online Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics (OBCHL), henceforth the ‘biblio’, is an updated, expanded, and corrected edition of the bibliography published some fifteen years ago by Rüdiger Köppe Verlag (Newman 1996). That biblio was built on valuable earlier works including Hair (1967), Newman (1971), Baldi (1977), R. M. Newman (1979), Awde (1988), and Barreteau (1993). The ensuing years have witnessed an outpouring of new publications on Chadic and Hausa, written by scholars from around the globe, thereby creating the need for a new, up-to-date bibliography. Data gathered for this online edition, which was compiled using EndNote, an excellent and easy to use bibliographic database program, have come from my own library and internet searches as well as from a variety of published sources. Particularly valuable have been the reviews of the earlier bibliography, most notably the detailed review article by Baldi (1997), the Hausa and Chadic entries in the annual Bibliographie Linguistique, compiled over the past dozen years by Dr. Joe McIntyre, and the very useful list of publications found regularly in Méga-Tchad. The enormous capacity afforded by the internet to organize and update large-scale reference works such as bibliographies and dictionaries enables us to present this new online bibliography as a searchable, open access publication. This Version-02 is presented in PDF format only. A goal for the future is to make the biblio available in database format as well. 2. -

Iso/Iec Jtc1/Sc2/Wg2 N4199 L2/12-040
ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4199 L2/12-040 2012-01-31 Universal Multiple-Octet Coded Character Set International Organization for Standardization Organisation internationale de normalisation Международная организация по стандартизации Doc Type: Working Group Document Title: Proposal to encode four Cyrillic characters in the BMP of the UCS Source: Michael Everson and Soslan Khubulov Status: Individual Contribution Action: For consideration by JTC1/SC2/WG2 and UTC Date: 2012-01-31 1. Character additions. This document requests the addition of four new Cyrillic characters to the UCS. Two of these letters were introduced into the Ossetian alphabet in 1844 by Andreas Johan Sjögren. That alphabet was in use up to 1924 when the Latin script was adopted for Ossetian. There is a great deal of literature written during the 80 years when that orthography was in use. Both a capital and a small character are requested. Those same two letters and two more are attested in a Komi grammar from 1850. Thus the following four characters are requested: 052A Ԫ CYRILLIC CAPITAL LETTER DZZHE 052B ԫ CYRILLIC SMALL LETTER DZZHE • Ossetian, Komi 052C Ԭ CYRILLIC CAPITAL LETTER DCHE 052D ԭ CYRILLIC SMALL LETTER DCHE • Komi 2. Ordering. The relative position of these two letters (taking case pairing as read) is shown below. DZZHE follows immediately after ZHE and before ZHWE DCHE follows immediately after CHE and before TCHE 3. Unicode Character Properties. Character properties are proposed here. 052A;CYRILLIC CAPITAL LETTER DZZHE;Lu;0;L;;;;;N;;;;052B; 052B;CYRILLIC SMALL LETTER DZZHE;Ll;0;L;;;;;N;;;052A;;052A 052C;CYRILLIC CAPITAL LETTER DCHE;Lu;0;L;;;;;N;;;;052D; 052D;CYRILLIC SMALL LETTER DCHE;Ll;0;L;;;;;N;;;052C;;052C 1 Figures Figure 1.