Hitler Avant Hitler. Essai D'interprétation Psychanalytique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
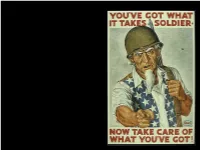
Mr. Booth World History 10 Introduction
World War II Mr. Booth World History 10 Introduction: • Most devastating war in human history • 55 million dead • 1 trillion dollars • Began in 1939 as strictly a European Conflict, ended in 1945. • Widened to include most of the world Great Depression Leads Towards Fascism • In 1929, the U.S. Stock Market crashed and sent shockwaves throughout the world. • Many democracies, including the U.S., Britain, and France, remained strong despite the economic crisis caused by the G.D. • Millions lost faith in government • As a result, a few countries turned towards an extreme government called fascism. 1.Germany Adolf Hitler, 2.Spain Francisco Franco 3. Soviet Union Joseph Stalin 4. Italy Benito Mussolini Fascism • Fascism: A political movement that promotes an extreme form of nationalism, a denial of individual rights, and a dictatorial one-party rule. • Emphasizes 1) loyalty to the state, and 2) obedience to its leader. • Fascists promised to revive the economy, punish those responsible for hard times, and restore national pride. The Rise of Benito Mussolini • Fascism’s rise in Italy due to: • Disappointment over failure to win land at the 1919 Treaty of Versailles. • Italy wanted a leader who could take action Mussolini Background • Was a newspaper editor and politician • Said he would rebuild the economy, the armed forces, and give Italy a strong leadership. • Mussolini was able to come to power by – publicly criticizing Italy’s government – Followers (black shirts) attacked communists and socialists on the streets. • In October 1922 • 30,000 followers marched to Rome and demanded that King Victor Emmanuel III put Mussolini in charge Il Duce Fist Pump 3 Decisions he made for complete control • Mussolini was Il Duce, or the leader. -
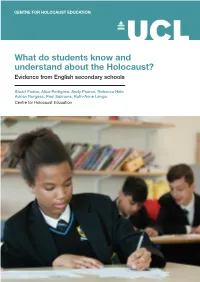
What Do Students Know and Understand About the Holocaust? Evidence from English Secondary Schools
CENTRE FOR HOLOCAUST EDUCATION What do students know and understand about the Holocaust? Evidence from English secondary schools Stuart Foster, Alice Pettigrew, Andy Pearce, Rebecca Hale Centre for Holocaust Education Centre Adrian Burgess, Paul Salmons, Ruth-Anne Lenga Centre for Holocaust Education What do students know and understand about the Holocaust? What do students know and understand about the Holocaust? Evidence from English secondary schools Cover image: Photo by Olivia Hemingway, 2014 What do students know and understand about the Holocaust? Evidence from English secondary schools Stuart Foster Alice Pettigrew Andy Pearce Rebecca Hale Adrian Burgess Paul Salmons Ruth-Anne Lenga ISBN: 978-0-9933711-0-3 [email protected] British Library Cataloguing-in-Publication Data A CIP record is available from the British Library All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism or review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permissions of the publisher. iii Contents About the UCL Centre for Holocaust Education iv Acknowledgements and authorship iv Glossary v Foreword by Sir Peter Bazalgette vi Foreword by Professor Yehuda Bauer viii Executive summary 1 Part I Introductions 5 1. Introduction 7 2. Methodology 23 Part II Conceptions and encounters 35 3. Collective conceptions of the Holocaust 37 4. Encountering representations of the Holocaust in classrooms and beyond 71 Part III Historical knowledge and understanding of the Holocaust 99 Preface 101 5. Who were the victims? 105 6. -

Spring Edition 2020-2021 5 New Ways to Stay Healthy in the Spring By: Ava G
O'Rourke Observer Spring Edition 2020-2021 5 New Ways to Stay Healthy in the Spring By: Ava G. Spring is a new season full of opportunities! As the snow slowly disappears, green grass appears! A new chance arises to get outside and get moving! Here are a few ways to stay healthy this spring. 1. As the weather gets warmer you can take a bike ride around your neighborhood or your house. Regular cycling has many benefits like increased cardiovascular fitness, increased flexibility and muscle strength, joint mobility improvement, stress level decline, posture and coordination improvement, strengthened bones, body fat level decline, disease management or prevention, and finally anxiety and depression reduction. 2. Go for a run. You can run around your house or your neighborhood. There are many health benefits to regular running (or jogging!) Some are improved muscle and bone strength, increased cardiovascular fitness, and it helps to preserve a healthy weight. 3. Go for a hike. Hiking is a great way to enjoy the outdoors and have a great workout at the same time! Hiking can reduce your risk of heart disease, enhance your blood sugar levels and your blood pressure, and it can boost your mood. Here are some great day hikes near Saratoga! You can hike Hadley Mountain, Spruce Mountain, the John Boyd Thacher State Park, Prospect Mountain, Buck Mountain, Shelving Rock Falls & Summit, Cat Mountain, Sleeping Beauty, Thomas Mountain, and Crane Mountain. I have hiked Cat Mountain before, and I loved it! When you reach the summit it has a great view of the ENTIRE Lake George. -

The Young Hitler I Knew -- August Kubizek
This material originally appeared at http://www.faem.com/books/ JR The Young Hitler I Knew -- August Kubizek Introduction -- H.R. Trevor-Roper Editor note: Roper was a jew reporter with close ties to British Intelligence. He came on the scene with his ridiculous claims about the "gas chambers" and "ovens" at Dachau. Thereafter, the British government stated that Dachau was not a "death camp" and no such facilities existed there. All the the so-called "extermination camps" curiously ended up in Soviet held territory. That should tell you something. This book deals with the darkest, perhaps the most formative, and therefore, in some sense, the most interesting period of Hitler's life. His public life is now fully-indeed oppressively-documented; his mature character, in its repellent fixity, is now fully known. But his crucial early years, the years between leaving school and joining the Bavarian army are, in the language of one of his biographers [Thomas Orr, Das War Hitler -- Revue, Munich, 1952, No. 42], "impenetrable." And yet those are the years in which that grim character, that unparalleled will power, that relentless systematic mind was formed. Any light on those undocumented years is welcome. The light shed by this book is more than that: it penetrates and reveals the character of the young Hitler as no other book has done. But before showing this let us examine the meagre framework of fact into which it is fitted. Hitler left school at Steyr in September 1905, and went to live with his widowed mother in Linz. He was then aged sixteen. -

Misconceptions
Misconceptions (from Illinois Holocaust Museum & Education Center) Norwegian non-Jews wore paper clips to express solidarity with Norwegian Jewry When the Germans occupied Norway in June 1940, between 1700 and 1800 Jews lived there – most of them in Oslo and all but 200 of them Norwegian citizens. Acceding to German demands, the collaborationist government immediately implemented anti-Jewish legislation. In November 1942, in response to further demands, the government rounded up more than 700 Jews, who were subsequently deported to Auschwitz where most were killed. Although the Norwegian resistance managed to smuggle the remaining Jews to neutral Sweden, the wearing of paper clips had nothing to do with demonstrating support for these efforts or solidarity with Norwegian Jewry. Rather, it represented one of many non-violent expressions of Norwegian nationalism and loyalty to King Haakon VII. These included listening secretly to foreign news broadcasts, printing and distributing underground newspapers and wearing pins fashioned from coins with the king’s head brightly polished, from various “flowers of loyalty,” from the symbol “H7” (for Haakon VII), and – for a time, after the latter were outlawed – from paper clips (also occasionally worn as bracelets). Why paper clips? Presumably – although some dispute this – because they were invented by a Norwegian named Johan Vaaler in 1899. Although, ironically, he had to patent the device in Germany because Norway had no patent law at the time. Vaaler did nothing more with his invention and, in subsequent years, paper clips would be manufactured and mass-marketed by firms in the United States and Great Britain (most notably, the Gem Company of Great Britain – originators of the familiar “double- U” slide-on clips, which the Norwegians may very well have worn.) The Germans used crushed Jewish bones to pave the Autobahn The Germans crushed Jewish bones in two specific contexts only. -

Der Adolf-Hitler-Code
Ralf G. Jahn Progenies Band 6 Der Adolf-Hitler-Code Hitlers größte Verunsicherung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d- nb.de/ abrufbar. Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsschutz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verla- ges. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Auswertungen durch Datenbanken und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. Impressum: Copyright © 2016 GRIN Verlag, Open Publishing GmbH ISBN: 9783668349445 Dieses Buch bei GRIN: http://www.grin.com/de/e-book/343571/der-adolf-hitler-code Ralf G. Jahn Progenies Band 6 Der Adolf-Hitler-Code Hitlers größte Verunsicherung GRIN Verlag GRIN - Your knowledge has value Der GRIN Verlag publiziert seit 1998 wissenschaftliche Arbeiten von Studenten, Hochschullehrern und anderen Akademikern als eBook und gedrucktes Buch. Die Verlagswebsite www.grin.com ist die ideale Plattform zur Veröffentlichung von Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, wissenschaftlichen Aufsätzen, Dissertationen und Fachbüchern. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.grin.com/ http://www.facebook.com/grincom http://www.twitter.com/grin_com |S e i t e n a n f a n g 1 Der Adolf-Hitler-Code Hitlers größte Verunsicherung von Dr. Ralf G. Jahn M.A. Wissenschaftlicher Berater und Protagonist von pre-tv bei der Fernsehdokumentation „Hitler – mein Großvater?“ Geldern 2016 2 Inhaltsverzeichnis VORWORT ....................................................................................................................................................... -

“The Bethlehem of the German Reich”
“THE BETHLEHEM OF THE GERMAN REICH” REMEMBERING, INVENTING, SELLING AND FORGETTING ADOLF HITLER’S BIRTH PLACE IN UPPER AUSTRIA, 1933-1955 By Constanze Jeitler Submitted to Central European University Department of History In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisor: Professor Andrea Pető Second Reader: Professor Constanin Iordachi CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2017 CEU eTD Collection STATEMENT OF COPYRIGHT “Copyright in the text of this thesis rests with the Author. Copies by any process, either in full or part, may be made only in accordance with the instructions given by the Author and lodged in the Central European Library. Details may be obtained from the librarian. This page must form a part of any such copies made. Further copies made in accordance with such instructions may not be made without the written permission of the Author.” CEU eTD Collection i CEU eTD Collection ii ABSTRACT This thesis is an investigation into the history of the house where Adolf Hitler was born in the Upper Austrian village Braunau am Inn. It examines the developments in the period between 1933 and 1955. During this time high-ranking Nazis, local residents, tourists and pilgrims appropriated the house for their purposes by creating various narratives about this space. As unimportant as the house might have been to Hitler himself from the point of view of sentimentality and childhood nostalgia, it had great propaganda value for promoting the image of the private Führer. Braunau itself was turned into a tourist destination and pilgrimage site during the Nazi period—and beyond. -

67 Why Her? Adolf Hitler's Attraction to Eva Braun Natalie Williamson
Why Her? Adolf Hitler’s Attraction to Eva Braun Natalie Williamson Adolf Hitler has been studied by a multitude of historians in hopes of understanding this charismatic figure who somehow seduced millions.1 The German populace, of course, saw Hitler as restoring their nation to its former glory. German women, in particular, saw in Hitler a softer side, even though Hitler ensured his private life remained concealed from the public. Indeed, only his closest associates actually knew the Führer. As a result, a series of important questions come to the fore when trying to understand Adolf Hitler, especially as they touch upon his relationship with his mistress and later wife, Eva Braun. Their relationship has largely been a mystery because he kept her locked away from the public for his own personal benefit. Braun herself, left a very small historical footprint, with almost no primary source information. Adolf Hitler’s childhood experiences shaped his personality. Understanding his likely psychopathology, along with his beliefs about the character, appropriate roles, and innate identities of women, allows one to make informed inferences about the dynamic of his relationship with Braun. Hitler was drawn to Braun and continued their relationship because she assuaged his insecurities, serving as a surrogate mother figure, filling the void left after the death of Hitler’s mother, Klara, and exhibiting unquestioning loyalty to him. Braun tolerated his unceasingly manipulative, conniving, and brutish behaviors, whether or not she actually recognized them as such. Her behavior and attitudes conformed almost entirely to his notions of what the ideal woman might be, and in return he gave her attention, but only when it suited him. -

Book Two the ARTIST
Chapter V – A Well Respected Man 159 Book Two THE ARTIST 160 Chapter V – A Well Respected Man Chapter V - A Well Respected Man 161 A WELL RESPECTED MAN The business of the Civil Service is the orderly management of decline. William Armstrong In the Year of the Lord 1889, the Austrian Emperor Francis Joseph celebrated his fifty-ninth birthday and forty-first anniversary of his reign over the vast Empire of Austria and Hungary; when he died, in 1916, he had ruled the state for sixty-eight years. The realm was huge - covering over 180,000 square miles or about 450,000 square kilometres. The emperor's domains stretched, in the east-west axis, from Czernowitz on the Dniester River in today's Ukraine to Vorarlberg on the Swiss border, and, in the north-south axis, from the lower Elbe River near Aussig to Ragusa in the Bosnian Hercegovina, two thirds down the eastern Adriatic coast. Ethnically and thus politically, however, these territories were hopelessly divided. The racial diversity of the Imperial population included Germans in Austria, Hungary and the Sudetenland; Czechs in Bohemia and Moravia; Slovaks to their east; Poles in western Galicia and Ruthenians, Catholic Ukrainians, in the eastern part of it; Magyars in Hungary and Transylvania interspersed with some more Germans and Romanians; Slovenes, Friaulians and Italians south of the Julian Alps; and finally Croats, Bosnians, Albanians, Montenegrinos and Serbs in and around the Balkan mountains. All these groups fought incessant but mostly inconclusive battles over appointments, representation and influence in the empire and its court, while a laborious civil administration struggled with the actual governance of the multitudes. -

Adolf Hitler 1 Adolf Hitler
Adolf Hitler 1 Adolf Hitler Adolf Hitler Hitler in 1937 Führer of Germany In office 2 August 1934 – 30 April 1945 Preceded by Paul von Hindenburg (as President) Succeeded by Karl Dönitz (as President) Chancellor of Germany In office 30 January 1933 – 30 April 1945 President Paul von Hindenburg Deputy • Franz von Papen • Position vacant Preceded by Kurt von Schleicher Succeeded by Joseph Goebbels Reichsstatthalter of Prussia In office 30 January 1933 – 30 January 1935 Prime Minister • Franz von Papen • Hermann Göring Preceded by Office created Succeeded by Office abolished Personal details Born 20 April 1889 Braunau am Inn, Austria–Hungary Died 30 April 1945 (aged 56) Berlin, Germany [1] Nationality • Austrian citizen until 7 April 1925 • German citizen after 25 February 1932 Political party National Socialist German Workers' Party (1921–1945) Adolf Hitler 2 Other political German Workers' Party (1920–1921) affiliations Spouse(s) Eva Braun (29–30 April 1945) Occupation Politician, soldier, artist, writer Religion See Adolf Hitler's religious views Signature Military service Allegiance German Empire Service/branch Reichsheer Years of service 1914–1918 Rank Gefreiter Unit 16th Bavarian Reserve Regiment Battles/wars World War I Awards • Iron Cross First Class • Iron Cross Second Class • Wound Badge Adolf Hitler German: [ˈadɔlf ˈhɪtlɐ] ( listen); (20 April 1889 – 30 April 1945) was an Austrian-born German politician and the leader of the National Socialist German Workers Party (German: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), commonly referred to as the Nazi Party). He was chancellor of Germany from 1933 to 1945 and dictator of Nazi Germany (as Führer und Reichskanzler) from 1934 to 1945. -

Notes and References
Notes and References 2 1933: THE LEGALITY OF HITLER'S ASSUMPTION OF POWER I. Purely Marxist interpretations apart see K. D. Bracher, Die AujfOsung der Weimarer Republik (Villingen, 1960), Chapter XI; K. D. Bracher, W. Sauer and G. Schulz, Die nationalso::;ialistische Machtergreifung (Cologne, 1960), Chapter I; A. Bullock, Hitler: a study in ryramry (London, 1962), p. 253 and, though devoid of scholarly value but still widely read, W. L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich (London, 1960), pp. 181ff. 2. See for example the 1928 SPD election film Was wiihlst Dul or Der Deutschen Volke held by Bundesarchiv Koblenz. 3. Protokoll. So::;ialdemokratischer Parteitag Magdeburg 1929 (Berlin, 1929), p. 67. 4. Ibid., p. 170. 5. See the call by Schulrat Runkel (DVP) and his call to put the nation before party political interests in Kolnische Zeitung, II March 1930. 6. See Heinrich Briining, Memoiren (Munich, 1972), p. 170; E. Forsthoff, Deutsche Veifassungsgeschichte der Neu::;eit (Stuttgart, 1961), p. 189; Reichtagsprotokolle, 16 July 1930, p.6407; H. Heiber, Die Republik von Weimar (Munich, 1966), p.225; W. Hubatsch, Hindenburg und der Staat (Gottingen, 1966), passim., see also Times Literary Supplement review of this work, 12 May 1966. 7. H. W. Koch, A Constitutional History of Germany in the 19th and 20th Centuries (London, 1984), p. 269. 8. Bundesarchiv Koblenz (BAKO) R4$/I No. 1870 Veifassungsrechtliches Gutachten von Prof Dr. Carl Schmitt uber die Frage, ob der Reichspriisident befugt ist, auf Grund von Art. 48, Abs. 2, RV finanzgeset::;vertretende Verordnungen ::;u erlassen, July 1930; Carl Schmitt, Die Diktatur des Reichspriisidenten nach Art. -

Aus Den Gemeinden Von Burgenland: Revisiting the Question of Adolf Hitler’S Paternal Grandfather
1 Aus den Gemeinden von Burgenland: Revisiting the question of Adolf Hitler’s paternal grandfather Abstract Hans Frank was Adolf Hitler’s personal attorney. In Frank’s memoir, published seven years after his execution in 1946 at the International Military Tribunal at Nuremberg, Frank claimed to have uncovered evidence in 1930 that Hitler’s paternal grandfather was a Jewish man living in Graz, Austria, in the household where Hitler’s grandmother was employed. Contemporary historians have largely dismissed Frank’s claim, primarily on the grounds that there were purportedly no Jews living in Graz in 1836, when Hitler’s father Alois Schicklgruber was conceived. This consensus can be traced to a single historian, Nikolaus von Preradovich, who claimed that “not a single Jew” (kein einziger Jude) was living in Graz prior to 1856. No independent scholarship has confirmed Preradovich’s conjecture. In this paper, evidence is presented that there was in fact eine kleine, nun angesiedelte Gemeinde – “a small, now settled community” – of Jews living in Graz before 1850. The contemporary consensus regarding Hitler’s paternal grandfather does not have a strong evidentiary basis. Other evidence, deriving from earlier sources, suggests that the contemporary consensus may be incorrect. Avenues for further research which might help to clarify the question are suggested. Keywords: Adolf Hitler; Austrian history; Burgenland; Jewish history; Nazi Germany 2 Hans Frank Hans Frank was Adolf Hitler’s personal attorney beginning in 1928 (Schenk, 2008: 60 – 61). He was appointed governor-general of Poland after its occupation by the Germans in 1939 and continuing until German defeat in 1945.