Cahiers Lituaniens N°6 – 2005
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
![[1] P. Evans, Virginia Access 3](https://docslib.b-cdn.net/cover/3816/1-p-evans-virginia-access-3-1183816.webp)
[1] P. Evans, Virginia Access 3
222 правила современного английского языка / [ сост . И.П.Масюченко ]. - Москва : БАО -ПРЕСС , 2001. - 446, [1] p. Evans, Virginia Access 3 : student's book / Virginia Evans, Jenny Dooley. - Newbury : Express Publishing, 2010. - 152 p. : iliustr. ; 30 cm. - ISBN 978-1-84679-791-0 LDK sakralin ė dail ė: atodangos ir naujieji kontekstai = Sacred art of Grand Duchy of Lithuania: discoveries and new contexts : [straipsni ų rinkinys / sudarytoja R ūta Janonien ė]. - Vilnius : Vilniaus dail ės akademijos leidykla, 2009 (Vilnius : Sapn ų sala). - 247, [1] p. Kuras, Algimantas (1940-) Algimantas Jonas Kuras : tapyba, piešiniai ir gyvenimo užrašai, asambliažai. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009 ([Vilnius] : Logotipas). - 239, [1] p. Macevi čius, Marius (1978-) Antoškos kartoškos = Goodbye, my love = Картошки Антошки : [pjes ė] / Marius Macevi čius ; [translation into English by Jayde Will, перевод на русский Марюса Мацявичюса ; knygoje panaudotos Mariaus Macevi čiaus nuotraukos]. - Kaunas : Kitos knygos, [2009] (Vilnius : Standart ų sp.). - 189, [2] p. Ricœur, Paul (1913-2005) (Ricoeuras, Paulis) Apie vertim ą / Paul Ricœur ; iš pranc ūzų kalbos vert ė Paulius Garba čiauskas. - Vilnius : Aidai, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). - 70, [1] p. Archivum Lithuanicum / Klaip ėdos universitetas, Lietuvi ų kalbos institutas, Šiauli ų universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ; redaktori ų kolegija: Giedrius Suba čius (vyriausiasis redaktorius). [T.] 11. - 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 470, [2] p. : iliustr., faks. - Str. liet., angl. - Santr. angl., vok. - Giedriaus Suba čiaus dovana (C19:1//10/1687). - Bibliogr. str. gale ir išnašose. - Tiražas 500 egz. Mizaras, Vytautas (1974-) Autori ų teis ė : monografija / Vytautas Mizaras. - Vilnius : Justitia, 2008-. - t. ; 22 cm. - ISBN 978-9955- 616-47-4 ( įr.) T. -

Politika Siekia Suskaldyti Baltijos Šalis
*********CAR--Rr-SORT*;* CR2924 SI P10 2-CL ČESLOVAS GRINCEVICIUS 2924 7132 S MOZART ST CHICAGO IL 60629-3029 UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 TELEFONAS (312) 585-9500 2ND CLASS MAIL TELEFAKSAS (312) 585-8284 Augusta, 1994 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY Vol. LXXXV Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 23, 1994 Nr. 163 Landsbergis: Rusijos Landsbergis: Priešininkai bando žlugdyti referendumą politika siekia V ii nius, rugpjūčio 22 d. (Elta) pasak opozicijos vado, priklauso suskaldyti Baltijos šalis — Referendumo šalininkų argu tie dvasininkai, kurie supranta mentai tampa vis dalykiškesni, žmonių rūpesčius ir nori būti su Vilnius, rugpjūčio 9 d. (LA) — mas priimti ultimatumą būtų o jo priešininkai griebiasi jais. Pastarieji kviečia atktyviai Komentuodamas naujus Rusijos buvęs kaip pateisinimas in primityvaus melo, pirmadienį dalyvauti referendume ir būti išpuolius prieš Baltijos šalis, Vy tervencijai. Bet Lietuvai pri spaudos konferencijoje teigė už siūlomo įstatymo nuostatų tautas Landsbergis spaudos ėmus ultimatumą, iškart pa Seimo opozicijos vadas Vytautas priėmimą. konferencijoje rugpjūčio 8 d. sakyta, kad vyriausybė bus su Landsbergis. Tai yra akivaizdus Referendumo agitacijos fone, pasakė: „Rusijos prezidento darinėjama Sovietų Sąjungos pastarųjų moralinio pralaimė pasak Vytauto Landsbergio, pa Bbris Jelcin 1994 m.'rugpjūčio pasiuntinybėjd, priminė opozi jimo požymis, sakė jis. Vieninte radoksalus yra Respublikos pre 4 d. rūstus pareiškimas prieš cijos vadas ir konstatavo, kad lis išsigelbėjimas, kurio tikisi zidento elgesys: šalies vadovas Latviją dėl jos pilietybės marionetinė Čečėnijos vyriausy referendumo priešininkai — jį pareiškė apskritai nedalyvau įstatymo liečia visas tris Bal bė jau sėdi Maskvoje, laukda sužlugdyti ir todėl visokiais bū siąs referendume. Bet juk prezi tijos valstybes. Priekaištai dėl ma, kol ją nuveš į Grozną. -

2012 Metų Bibliotekos Ataskaita
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA TRADICIJOS ATSAKOMYBĖ PARTNERYSTĖ ATVIRUMAS VERŽLUMAS 2012 UDK 027.7 (474.5) Vi-175 Pagal VU bibliotekos skyrių veiklos ataskaitas parengė: NERIJUS CIBULSKAS VINCAS GRIGAS VALENTINA KARPOVA IRENA KRIVIENĖ NIJOLĖ KLINGAITĖ-DASEVIČIENĖ ELONA MALAIŠKIENĖ JULIJA NIAURAITĖ MANTAS PELAKAUSKAS MARIJA PROKOPČIK ELONA VARNAUSKIENĖ INDRĖ ZALIESKIENĖ Teksto redaktorė NIJOLĖ GINIOTIENĖ Į anglų kalbą vertė KRISTINA GUDAVIČIENĖ Nuotraukos MANTO PELAKAUSKO Dailininkas maketuotojas TADAS BUJANAUSKAS Iliustracijų autorė MONIKA ULYTĖ VILNIAUS UNIVERSITETAS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA IN CORPORE 2012 TRADICIJOS ATSAK PARTNER ATVIRUMAS VERŽLUMAS 2013 VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA Bibliotekos vertybės ir kelrodė in corpore žvaigždė Vilniaus universiteto bibliotekai (toliau biblioteka) 2012 metai atnešė naujų veiklų, užgrūdinusių mus ir davusių visai kitokios patirties. Naujojo bibliotekos pastato Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (toliau MKIC) statybos darbų pabaiga ir jo apgyvendinimas bibliotekos darbuotojams reiškė dar didesnį susitelkimą, orientuotą į Europos struktūrinės paramos projekto galutinį tikslą – MKIC atidarymą bibliotekos paslaugų vartotojams 2013-aisiais. Modeliuodami moderniosios bibliotekos apibrėžtis priartėjome prie bibliotekos vertybių išgryninimo. Prieš pora metų pradėtos neformalios diskusijos apie bibliotekos filosofiją 2012-aisiais peraugo į išsamius svarstymus visoje organizacijoje, kuriuos apibendrino ir užbaigė bibliotekos strategijos formavimo grupė. Diskusijų maratone išryškėjo -

Vilniaus Dailės Akademija Aukštųjų Studijų Fakultetas Austėja Mikuckytė
Vilniaus dailės akademija Aukštųjų studijų fakultetas Dailės istorijos ir teorijos studijų programa, valstybinis kodas 6211NX005 Austėja Mikuckytė-Mateikienė STASIO BUDRIO GYVENIMAS IR MENOTYRINĖ VEIKLA 1957–1970 M. LIETUVOS DAILĖS KONTEKSTE Baigiamasis magistro darbas Vadovė: doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė Vilnius, 2018 Aš, Austėja Mikuckytė-Mateikienė, kandidatė menotyros magistro laipsniui gauti, pareiškiu, kad šis baigiamasis darbas paremtas mano pačios tyrimais ir remiasi tik tokia papildoma informacija, kuri nurodyta nuorodose, paaiškinimuose, šaltinių, literatūros bei iliustracijų sąrašuose. Pareiškiu, kad baigiamajame darbe nėra naudojamasi kitų darbais to nenurodant ir nė viena baigiamojo darbo dalis nepažeidžia jokių asmens ar institucijos autorinių teisių. Taip pat nė viena baigiamojo darbo dalis nebuvo pateikta jokiai kitai aukštojo mokslo institucijai kaip akademiniais atsiskaitymas ar siekiant gauti mokslo laipsnį. Vilnius, 2018-05-29 Parašas 2 Turinys ĮVADAS .............................................................................................................................................. 4 1. 1957–1970 M. VISUOMENINIS, SOCIALINIS IR MENINIS LIETUVOS KONTEKSTAI .... 10 1.1. Socialistinio realizmo metodas ir jo korektūros ..................................................................... 10 1.2. Kontrolės institucijų veikla dailėje po chruščiovinio atlydžio ................................................ 14 1.3. Literatūros cenzūra ................................................................................................................ -

Digesta) Teisingumas Yra Nuolatinis Ir Amžinas Noras Kiekvienam Užtikrinti Jo Teises UDK
Justitia est constans et perpetua voluntas cuique suum tribuendi (Digesta) Teisingumas yra nuolatinis ir amžinas noras kiekvienam užtikrinti jo teises UDK Sudarė: Vytautas BUDNIKAS „Pozicijos“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos(LŽTA) pirmininkas Konsultavo: Viktoras PETKUS Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos (LŽTA) Garbės pirmininkas ir Arimantas DUMČIUS medicinos profesorius, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos (LŽTGA) Garbės pirmininkas ISBN 978-9955-9972-2-1 Knygos dizainas ir maketas Rasos PREIDIENĖS Išleido Lietuvos žmogaus teisių asociacija LIETUVA IR žmoGAUS LietuvosTEisės žmogaus teisių asociacijų (LŽTA ir LŽTGA) veiklos apžvalga 1989–1999 metai I knyga 2008 Vilnius 4 LIETUVA IR žmoGAUS TEisės LŽTGA išplėstinio posėdžio protokolas Nr. 4 ........... 87 TURINYS: LŽTGA susitikimo su LR Generalinės prokuratūros darbuotojais protokolas Nr. 6 ......................................... 91 Pratarmė ......................................................................... 15 LŽTGA 1992 11 06 komiteto posėdžio nutarimas Nr. 1 ................................................................ 93 Vytautas Budnikas. BE IŠANKSTINĖS NUOSTATOS ................................................................... 17 LŽTGA 1992 11 06 komiteto posėdžio nutarimas Nr. 2 ................................................................ 93 Viktoras Petkus. TEISINGUMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE ............................ 26 LŽTGA komiteto posėdžio protokolas Nr. 9 .............. 94 Arimantas -

2005 Festivalio Organizatoriai: Pagrindiniai Rėmėjai Lietuvos Kompozitorių Sąjunga Ir Všį “Vilniaus Festivaliai” Festivalio Televizija
AKTUALIOS MUZIKOS FESTIVALIS GAIDAVilnius, spalio 12-28 2005 Festivalio organizatoriai: Pagrindiniai rėmėjai Lietuvos kompozitorių sąjunga ir VšĮ “Vilniaus festivaliai” Festivalio televizija Organized by the Lithuanian Composers’ Union and Public Enterprise “Vilnius Festivals” Didžiausias šalies dienraštis Festivalio dienraštis Didieji partneriai / Main partners: Festivalio viešbutis Jeigu įsiklausytume į miesto skambesį, suvoktume, kaip Informaciniai rėmėjai skirtingai skamba Vilnius keičiantis metų laikams. Jau penkiolika metų iš eilės rudens garsus papildo festivalis Partneriai / Partners: „Gaida“, kuris vilniečiams ir miesto svečiams pristato įspūdingą šiuolaikinės muzikos panoramą. Būtent tokie aukšto lygio kultūros įvykiai daro Vilnių ne tik Lietuvos, bet ir regiono centru, pasaulio miestu. Suomijos Respublikos ambasada Vilniuje Dėkoju festivalio „Gaida“ rengėjams už jų triūsą ir ištikimybę naujajai muzikai. Sveikinu visus dalyvius, The Foundation for the vilniečius ir miesto svečius su geros muzikos švente bei Promotion of Finnish Music Rėmėjai linkiu kuo geriausių įspūdžių! Festivalio repertuarinis komitetas / Repertoire Committee: Gražina Daunoravičienė, Rūta Gaidamavičiūtė, Rūta Goštautienė, Daiva Parulskienė, Vytautas Laurušas, Remigijus Merkelys, Šarūnas Nakas Organizacinė grupė / Executive Group: Remigijus Merkelys, Daiva Parulskienė, Živilė Stonytė, Paulius Jurgutis, Vytautas V. Jurgutis, Artūras Zuokas Vytautas Gailevičius, Linas Paulauskis Vilniaus miesto meras Bukleto sudarytoja ir redaktorė / Booklet compiler and editor -

Kultūros Barai
Kultūros ir meno žurnalas. Eina nuo 1965 m. KULTŪROS BARAI Vyriausioji redaktorė Rūpesčiai ir lūkesčiai Laima KANOPKIENĖ 8 652 32034 Almantas SAMALAVIČIUS. Pandemija ir tikėjimas / 2 Rengia Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ. Ties riba / 7 Problemos ir idėjos Almantas SAMALAVIČIUS Leon KRIER. Bendrojo gėrio kūrimas / 13 (kultūrologija, architektūra) 2 62 38 61 Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ Kalbą „užmigdo“ net perdėtas mandagumas. Su senosios škotų gėlų kalbos dėstytoju (muzika) 2 62 38 61 Deusanu BONDU kalbasi Mindaugas PELECKIS / 15 Monika MEILUTYTĖ Nuomonės apie nuomones (teatras) 8 614 12855 Tadas GINDRĖNAS Juozas BRAZAUSKAS. Intelektualų „klasės“ saulėlydis? / 18 (dizaineris) 2 61 05 38 Algimantas ČEKUOLIS. Rojus šaltoje žemėje / 20 Romena RAČKAITYTĖ-ČEPAITIENĖ Girėnas POVILIONIS. Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos, paskelbtos Rimanto (kompiuterininkė) 2 61 05 38 Asta DEKSNYTĖ Gučo straipsnyje (Kultūros barai, 2020 m. lapkritis) / 22 (korektorė) Ramūnas TRIMAKAS. Kimerika / 25 Irena ŽAGANEVIČIENĖ Kūryba ir kūrėjai (buhalterė) 2 62 31 04 Raminta JURĖNAITĖ. Autentiškas protesto liudijimas / 29 „Būti veiksmažodžiu“. Su menininke, menotyrininke, dailės pedagoge Malvina JELINSKAITE Redakcinė kolegija kalbasi Jūratė STAUSKAITĖ / 38 Alfredas BUMBLAUSKAS „Tikiuosi, žiūrovai mano spektakliuose jaučiasi saugūs“. Su režisiere Karolina ŽERNYTE Pietro U. DINI (Italija) kalbasi Dovilė ZAVEDSKAITĖ / 41 Stasys EIDRIGEVIČIUS Carl Henrik FREDRIKSSON (eurozine) Jurga MINČINAUSKIENĖ. Vytautas Valius – prisiekęs estetas, ištikimas pašaukimui / 46 Vita GRUODYTĖ (Prancūzija) Lietuvos žemųjų balsų dinastija. Vladimiro Prudnikovo ir jo mokinių kūrybos vakaras / 51 Algis MICKŪNAS (JAV) Stasys EIDRIGEVIČIUS. Erdvės kristalizacija pagal Ludwiką Ogorzelec / 57 Aušra Marija SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ Giedrius SUBAČIUS (JAV) „Subordinacija prieštarauja kūrybai“. Su šiuolaikinio meno kūrėju Tadu ČERNIAUSKU Antanas ŠILEIKA (Kanada) kalbasi Ugnė KAČKAUSKAITĖ / 60 Vygantas VAREIKIS Zecharia PLAVIN. Laisvė / 65 Kazys VARNELIS jr. (JAV) Romualdas LANKAUSKAS. Žmogus, kuris nebesišypso. -

Pilietiškumo, Tautiškumo Akivaruose
r Pilietiðkumo, tautiðkumo akivaruose Liudviko GIEDRAIÈIO interviu su Pilietinës visuomenës instituto direktoriumi, kultûros istoriku Dariumi KUOLIU Norëdamas bûti pavyzdingas etnokultûrinio þurnalo tokioms kurianèioms þmoniø grupëms: kà dabar daro „atstovas“, privalau paisyti tæstinumo. Prieð ðeðiolika me- entuziastai, reikëtø daug stipriau remti. Kitas dalykas – tø „Liaudies kultûros“ vyriausiosios redaktorës D. Raste- nesame ávertinæ to, kad mûsø uþdaras pasaulis labai grei- nienës pokalbis su Jumis baigësi pastaba apie „etninës tai atsivërë. Gyvename globalizacijos sàlygomis, turime kultûros þmoniø susivalstybinimo pavojø“ ir, kad „etni- matyti visus mûsø tapatumui kylanèius iððûkius. Lietu- nës kultûros studijos bûtinos aukðtojoje mokykloje, gal viai savo tapatybæ turëtø suprasti kaip kuriamà dalykà, ir vidurinëje“. Kaip Jûs visa tai matote, vertinate dabar? o ne tik paveldëtà ir saugojamà. Manau, kad per maþai Manyèiau, kad nereikëtø atskirti etninës kultûros nuo skiriame dëmesio savo lietuviðkajai tapatybei: turëtume visos tautos kultûros. Tada, atsimenu, buvo svarstoma, giliau apmàstyti, kokia ji turëtø bûti ðiandien, koks jos ar Lietuvos mokykla turëtø pabrëþtinai orientuotis tik á santykis su valstybe. Iki ðiol gyvename remdamiesi etni- liaudies, valstietiðkàjà, kultûrà, ar aprëpti visumà. Mano ne kultûrinës tapatybës samprata: gimtoji kalba, istorinë supratimas iðliko tas pats: labai svarbu neskaidyti Lietu- atmintis, paproèiai – ðtai ir viskas. Lieka nuoðaly ásipa- vos kultûros, tautai svarbi visa tradicija – ir bajoriðkoji reigojimai valstybei, politinës teisës, laisvës, Konstituci- dvarø, elito kultûra, kurta tø paèiø lietuviø senaisiais am- ja. O tai yra politiná gyvenimà gyvenanèios tautos tapa- þiais, ir valstietiðkoji, kurià kûrë þmonës, neturëjæ pilie- tybei labai svarbûs sandai. To mes dar neturim. Gyve- tiniø, politiniø teisiø. Ðiandien labai svarbu turëti vienti- nam laisvës sàlygomis, bet tik kaip etninë kultûrinë ben- sà poþiûrá á Lietuvos kultûriná palikimà, neskaidant jo á druomenë. -
Gnygos, Gautos 2021 M. II Ketv
Gnygos, gautos 2021 m. II ketv. Eil.Nr Knygos pavadinimas Egz.sk. 1 Žydinti taurė / Daiva Vaitkevičienė. - 2019. - 431, [1] p. UDK: 1 39(474.5)(091). 2 Vytautas Valius / Nijolė Tumėnienė. - 2020. - 150, [2] p. UDK: 1 7(474.5)(084)(092). 3 Vytautas Valius / Sudarytojai/Editors: Nijolė Tumėnienė, Eglė 1 Valiūtė, Saulius valius. - 2009 m. - 251, [1] p. UDK: 7(474.5)(084)(092). 4 Vytautas Valius / Sudarytojai/Editors: Nijolė Tumėnienė, Eglė 1 Valiūtė, Saulius Valius. - 2010. - 367, [1] p. UDK: 7(474.5)(084)(092). 5 Radvilos. Kn. 1 : Tarptautinės parodos katalogas / 1 Sudarytojai/Compilers Vydas Dolinskas, Gintarė Džiaugytė, Rita Lelekauskaitė. - 2020. - 653, [3] p. UDK: 929.5(474.5)(064). 6 Radvilos. Kn. 2 : Tarptautinės parodos katalogas / 1 Sudarytojos/Compilers: Gintarė Džiaugytė, Rita Lelekauskaitė. - 2020. - 813, [3] p. UDK: 929.5(474.5)(064). 7 Lithuania philatelic society journal; Filatelistų draugijos žurnalas 1 "Lietuva". 2020 No. 248. - 2020. - 25, [3] p. UDK: 656.835.9(73)(051). 8 Nemunas / redakcinė kolegija: A. Drilinga … [et al.]. 2021 m. 1 sausis, Nr. 1 (1030) : / Vyriausioji redaktorė - Erika Drungytė. - 2021. - 71, [1] p. UDK: 7(474.5)(051). 9 Nemunas / redakcinė kolegija: A. Drilinga … [et al.]. 2021 m. 1 vasaris, Nr. 2 (1031) : 2021 m. vasaris Nr. 2 (1031) / Vyriausioji redaktorė - Erika Drungytė. - 2021. - 71, [1] p. UDK: 7(474.5)(051). 10 Piękność twa widzę / kuratorzy: Osvaldas Daugelis, dr. Dariusz 5 Kacprzak. - 2020]. - Lankstinukas: [14] p. UDK: 15 vnt. 75(474.5)(064)(Čiurlionis). 11 Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė / Ona Voverienė. - 2-asis 1 papild. leid. - 2016. - 271, [1] p. -
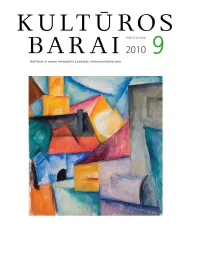
KB 2010 9 Pdf.Pdf
Kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Eina nuo 1965 m. KULTŪROS BARAI Vyriausioji redaktorė Problemos ir idėjos Laima KANOPKIENĖ 2 62 38 61 Vilius Bartninkas. Vita activa ir politikos nuosmukis / 2 Rūpesčiai ir lūkesčiai Rengia Marion von OSTEN. Bolonijos paradoksas / 7 Almantas SAMALAVIČIUS Richard MÜnch. Bolonija, arba Švietimo kapitalizavimas / 10 (kultūrologija, architektūra) 2 62 38 61 Europos istorijos Ramunė MARCINKEVIČIŪTĖ Herkus KunČius. Sutemų atspindžio muziejus / 15 (teatras) 2 62 38 61 Paveldas ir paminklai Kęstutis Šapoka Konstantinas Jakovlevas-Mateckis. Vilniaus Sereikiškių parkas: išlikimo drama / 19 (dailė) 2 62 38 61 Nuomonės apie nuomones Tadas GINDRĖNAS Stasys GOŠTAUTAS. Du požiūriai į 1941 m. Laikinosios vyriausybės vaidmenį / 30 (dailininkas) 2 61 05 38 Mantas Lesauskas. Tuščia estetika / 32 Kristina SABUKIENĖ Kūryba ir kūrėjai (kompiuterininkė) 2 61 05 38 Zecharia PLAVIN. Rigoletas. Tarno psichologijos atspindžiai / 35 Dalia MEČKAUSKAITĖ Gabrielė Labanauskaitė. Prisijaukinti ateities naratyvą. Įspūdžiai iš elektroninio meno (korektorė) simpoziumo ISEA 2010 / 39 Irena Žaganevičienė „Gražiausias pasaulio muziejus“. Su Folkwango muziejaus direktoriumi Hartwigu Fischeriu (buhalterė) 2 62 31 04 kalbasi Vytenė Muschik / 44 Redakcinė kolegija Kęstutis ŠAPOKA. Zugzwang – (ne)naudingi ėjimai. Jaunųjų Baltijos šalių menininkų kūrybos paroda buvusioje duonos kepykloje / 48 Vytautas BERENIS Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ. Kaukaitės era nesibaigė / 50 Endre BOJTÁR (Vengrija) Pažinti naujaip Alfredas Bumblauskas Tomas Kiauka. „Ilgesys plius nuodėmė lygu gyvenimas.“ Jurgos Ivanauskaitės kelionė Pietro U. DINI (Italija) Dievop / 52 Carl Henrik FREDRIKSSON (eurozine) Iš kultūros istorijos Vita GRUODYTĖ (Prancūzija) Kęstutis ŠAPOKA. Savas tarp svetimų, svetimas tarp savų. Paroda „Vytautas Kairiūkštis ir Rūta Stanevičiūtė jo aplinka“ NDG / 61 Tomas Kiauka Kęstutis ŠAPOKA. Laikas – lyg smiltys. Vytauto Valiaus (1930–2004) kūrybos paroda VDA Liana RuokytĖ (Skandinavija) „Titanike“ / 65 Vygantas VAREIKIS Kazys VARNELIS jr. -

In Memoriam Kazys Bradūnas (1917 02 11 – 2009 02 09)
IN MEMORIAM Kazys Bradūnas (1917 02 11 – 2009 02 09) Viktorija Skrupskelytė Išėjo mokytojas. Išėjo iš čia į Ten, su savimi nusinešdamas neišsakytų poetinių sumanymų pasaulį, o mums, ne vienai kartai į priekį palikda mas skaityti didelės jėgos ir didelio grožio eilėraščių, kuriuos mes jau kurį laiką esame įvardiję žemės poezijos vardu. Atsisveikinant su poetu, visuomenininku, knygų sudarytoju ir redak toriumi Kaziu Bradūnu, norisi prisiminti pirmuosius jo daug žadančius, kupinus džiaugsmo ir vilties eilėraščius, išspausdintus senajame „Židi nyje“ prieš maždaug septyniasdešimt metų. Tai buvo jo poetinės kelio nės pradžia, sąmoningai ar nesąmoningai užšifruota žemės ir amžiny bės, žemės ir kūrėjo nenutrūkstančios draugystės šifrais, – toji draugystė jau tada palaikė ir stiprino jauno rašytojo kūrybinį polėkį: „Žeme, žeme, žydėsi, žeme amžiais nedžiūsi. // Žeme, būkim drauge amžinai“ („Žeme, žydėkim“). Poetui iškeliavus į Amžinybę, noriu prisiminti ir paskutinio Bradūno kūrybos etapo eilėraščius – skaidrius, permatomus kaip diena, kiek lė tesnio tempo, dvelkiančius ramybe ir susitaikymo dvasia, išspausdintus jo 2001 m. „Sutelktinės“ užsklandos cikle. Jie gyvenimą ir poeziją susieja ne paraleliniu jaunystėje ištartu „gyvenkim drauge“ šauksmu, bet poeto atrasta, pajausta įžvalga, kad poezija vienu žingsniu atsilieka nuo to, kas išgyventa. Ji tarsi seka gyvenimą, rinkdama pėdsakus ir prisiminimus, įvardydama ir įamžindama poeto sąmonėje iškylančią paskutinių gyve Kazys Bradūnas. 1917–2009 nimo akimirkų nuojautą: „Išeinu... Kelionė ilga – / Minu smėliu barstytą taką... / Tik eilėraščio pabaiga / Mano pėdas dar seka“ („Kai jau viskas sudėta“). Pabai gos įspūdis čia perkeliamas iš egzistencinio lygmens į kūrybinį, suvokiame, kad kažkas išnyksta, kažkas dar turi įvykti, išnyksta vieno žmogaus gyvenimas, atsiranda kažkas kita – daugiau nei tuštuma ar praraja, daugiau nei nebūtis. Atsiranda buvimas kita forma, kita prasme, išreiškiama poetiniu vaizdiniu. -

Les Écrivains Et Poètes Lituaniens Traduits En Français
1 Summary in English > N°19 (2020) Juozas Lukša-Daumantas, a Figure of Anti-soviet Resistance through Letters to his Beloved Robin Sébille, essayist, association leader, Paris Youza, the Saga of Success Marielle Vitureau, press reporter, Vilnius An Artist from Alsace in Lithuania in 1991 René Weber, plastic artist, Murbach Vilnius Seen through the Work of Georges Simenon Pierre Vilvens, historian, University of Liège graduate in contemporary history Karl Trübner (1846-1907), Strasbourg Publisher of Works on Lithuanian Linguistics Philippe Edel, Alsace Lithuania History Circle, Strasbourg The Knowledge of Lithuanian Historical Phonetics in the Work of F. Bopp (1830) and A. Meillet (1922) Jean-Pierre Levet, professor emeritus of linguistics at the University of Limoges, Editor of Feuille de philologie comparée lituanienne et française A.F. Adamowicz, F. Jurewicz, C. Muyschel: L.H. Bojanus’ Students and Followers at Vilnius University Piotr Daszkiewicz, science historian, National Museum of Natural History, Paris and Philippe Edel, Alsace Lithuania History Circle, Strasbourg Introduction to Lithuanian fairy tales – The Silly Man – The Golden Boat Anonymous. Translated by Jean-Claude Lefebvre and Liudmila Edel-Matuolis > N°18 (2019) On Mikalojus Konstantintas Čiurlionis and Fairytale of Kings Danutė Gruzdienė, curator, National M.K. Čiurlionis Art Museum, Kaunas Hopeful Despite the Odds : Lithuanian Diplomatic Service (1940-1991) Asta Petraitytė-Briedienė, PhD in History, Lithuanian Diaspora Institute, Vytautas Magnus University, Kaunas Robert Redslob (1882-1962) and the « young, enthusiastic and profoundly sane spirituality » of the Balts Philippe Edel, Alsace-Lithuania History Circle, Strasbourg Plica polonica: from national plague to the death of the disease in the nineteenth century Vilnius Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė, Dalius Jatuzis, Saulius Kaubrys, Researchers, Vilnius University http://www.cahiers-lituaniens.org/summary.pdf 2 L.H.