Vers Une Nouvelle Typologie Des Langues Sinitiques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UC Berkeley Phonology Lab Annual Report (2009)
UC Berkeley Phonology Lab Annual Report (2009) The Phonology of Incomplete Tone Merger in Dalian1 Te-hsin Liu [email protected] 1. Introduction The thesis of tone merger in northern Chinese dialects was first proposed by Wang (1982), and further developed by Lien (1986), the migration of IIb (Yangshang) into III (Qu) being a common characteristic. The present work aims to provide an update on the current state of tone merger in northern Chinese, with a special focus on Dalian, which is a less well-known Mandarin dialect spoken in Liaoning province in Northeast China. According to Song (1963), four lexical tones are observed in citation form, i.e. 312, 34, 213 and 53 (henceforth Old Dalian). Our first-hand data obtained from a young female speaker of Dalian (henceforth Modern Dalian) suggests an inventory of three lexical tones, i.e. 51, 35 and 213. The lexical tone 312 in Old Dalian, derived from Ia (Yinping), is merging with 51, derived from III (Qu), in the modern system. This variation across decades is consistent with dialects spoken in the neighboring Shandong province, where a reduced tonal inventory of three tones is becoming more and more frequent. However, the tone merger in Modern Dalian is incomplete. A slight phonetic difference can be observed between these two falling contours: both of them have similar F0 values, but the falling contour derived from Ia (Yinping) has a longer duration compared with the falling contour derived from III (Qu). Nevertheless, the speaker judges the contours to be the same. Similar cases of near mergers, where speakers consistently report that two classes of sounds are “the same”, yet consistently differentiate them in production, are largely reported in the literature. -

Tone Sandhi in Jiaonan Dialect: an Optimality Theoretical Account
TAL 2012 ̶ Third International ISCA Archive Symposium on Tonal Aspects of http://www.isca-speech.org/archive Languages Nanjing, China, May 26-29, 2012 Tone Sandhi in Jiaonan Dialect: an Optimality Theoretical Account Zhao Cunhua 1, Zhai Honghua 2 1 College of Foreign Languages, Shandong University of Science and Technology, China 2 College of Foreign Languages, Shandong University of Science and Technology, China [email protected], [email protected] Abstract 2. Experimental Description Based on phonetic experiment, this paper aims at providing The raw phonetic data is gained through the acoustic records phonetic description on the tones and disyllabic tone sandhi in conducted in July 2009 and November 2010 respectively. Jiaonan dialect, and then illustrating the phonological Only one elder male’s and female’s sound were chosen from structures within the framework of Auto-segmental Phonology the six informants’ invited in 2009. The test words were from to conduct an OT analysis on the tone sandhi patterns of Fangyan Diaocha Zibiao and The Study of Shandong Dialect, Jiaonan dialect. including 160 monosyllabic words in citation forms and 130 Index Terms: Jiaonan dialect, phonetics, tone, tone sandhi, pairs in disyllabic sequences. Finally, 111 monosyllabic words OT in citation forms and 117 in disyllabic sequences are involved and taken for the next recording. The equipment used then 1. Introduction was SAMSUNG BR-1640 digital recorder. In 2011, 6 college Jiaonan, a county-level city of Qingdao, locates in the students from Jiaonan City were invited for audio recording. southeast of Shandong Peninsula. Jiaonan dialect (JND for Data recording was made by using a portable computer short hereafter) belongs to Jiao Liao Mandarin, a sub-dialect (Lenovo) and a microphone (Sennheiser PC 166) with the of the northern Mandarin family. -

Incomplete Tone Merger As Evidence for Lexical Diffusion in Dalian Te
Incomplete Tone Merger as Evidence for Lexical Diffusion in Dalian1 Te-hsin Liu National Taiwan Normal University The presence of near mergers has long been a puzzle for linguists due to the notions such as contrast, categorization as well as the postulated symmetry between production and perception (Labov 1994). The present research aims to provide a case study of tonal near merger in Dalian, a less well-known Mandarin dialect spoken in Northeast China. Using a case study of tonal near merger as a jumping off point, this paper draws on insights from the hypothesis of lexical diffusion (Wang 1969) to illustrate that sound change could indeed take a long period of time to complete its course. 1. Introduction The present research aims to provide a case study of tonal near merger in Dalian. According to Song (1963), four lexical tones are observed in citation form, i.e. 312, 34, 213 and 53 (henceforth Old Dalian)2. Our first-hand data obtained from a young female speaker of Dalian (henceforth Modern Dalian) suggests an inventory of three lexical tones, i.e. 51, 35 and 213. The lexical tone 312 in Old Dalian, derived from Ia (Yinping), is merging with 51, derived from III (Qu), in the modern system. However, the tone merger in Modern Dalian is incomplete. A slight phonetic difference can be observed between these two falling contours: both of them have similar F0 values, but the falling contour derived from Ia (Yinping) has a longer duration compared with the falling contour derived from III (Qu). Nevertheless, 1 This is a revised version of a longer paper to appear in Journal of Chinese Linguitics. -
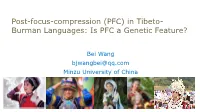
Post-Focus-Compression (PFC) in Tibeto- Burman Languages: Is PFC a Genetic Feature?
Post-focus-compression (PFC) in Tibeto- Burman Languages: Is PFC a Genetic Feature? Bei Wang [email protected] Minzu University of China Acknowledgement Yi Xu (University College London) Qifan Ding (Mandarin), Liu Lu (Bai), Qingyi Song (Tujia), Xueqiao Li (Bai), Yuanyuan Zhang (Wu, Gulin), Xiaxia Zhang (Lasha Tibetan, Qiang), Fanglan Li (Nanchang), Qian Wu (Li, Hainan Tsat), Baofeng Wang (Buyi), Shaobo Sun (Mogolian, Jing), Ling Wang (Deang, Wa, Ando Tibetan), Wei Lai (Shanghai), Miaomiao Yang (Hmong), Sisi Chen (4 Wu dialects), Qiaoyun Yin (Deang), Chao Wang (Xian), Qubi Erlian (Lolo), Erkbulan (Kazakhstan) National Social Science Foundation of China (18BYY079) National Natural Science Foundation of China (NSFC 60905062) Program for New Century Excellent Talents in University of Ministry of Education of China (NCET-12-0584) “111” Project of Minzu University Contents Post-focus-compression (PFC) in Beijing Mandarin and Taiwanese Worldwide Distribution of PFC Distribution of PFC in Tibeto-Burman Languages General Discussion on the origin of PFC Focus is to highlight part of a sentence against the rest of the sentence as motivated by a particular discourse situation. Focus can be realized prosodically. (Bolinger, 1958; Eady & Cooper, 1986; Ladd, 1996; Xu, 1999, 2005 among many others) Initial Focus Medial Focus Final Focus 250 Initial Focus: Who is stoking the kitten? ) 200z H Medial Focus: What is mom doing on the kitten? ( Neutral 0 Final Focus: What is mom stoking? 150F Neutral Focus: What do you see? 100 Ma Monol maingual Beimojing Mandarimaon mi 50 mother stoke kitten Normalized time Post-focus-compression (PFC): F0 and intensity is compressed in post-focal words. -

THE MEDIA's INFLUENCE on SUCCESS and FAILURE of DIALECTS: the CASE of CANTONESE and SHAAN'xi DIALECTS Yuhan Mao a Thesis Su
THE MEDIA’S INFLUENCE ON SUCCESS AND FAILURE OF DIALECTS: THE CASE OF CANTONESE AND SHAAN’XI DIALECTS Yuhan Mao A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (Language and Communication) School of Language and Communication National Institute of Development Administration 2013 ABSTRACT Title of Thesis The Media’s Influence on Success and Failure of Dialects: The Case of Cantonese and Shaan’xi Dialects Author Miss Yuhan Mao Degree Master of Arts in Language and Communication Year 2013 In this thesis the researcher addresses an important set of issues - how language maintenance (LM) between dominant and vernacular varieties of speech (also known as dialects) - are conditioned by increasingly globalized mass media industries. In particular, how the television and film industries (as an outgrowth of the mass media) related to social dialectology help maintain and promote one regional variety of speech over others is examined. These issues and data addressed in the current study have the potential to make a contribution to the current understanding of social dialectology literature - a sub-branch of sociolinguistics - particularly with respect to LM literature. The researcher adopts a multi-method approach (literature review, interviews and observations) to collect and analyze data. The researcher found support to confirm two positive correlations: the correlative relationship between the number of productions of dialectal television series (and films) and the distribution of the dialect in question, as well as the number of dialectal speakers and the maintenance of the dialect under investigation. ACKNOWLEDGMENTS The author would like to express sincere thanks to my advisors and all the people who gave me invaluable suggestions and help. -

Unified Language, Labor and Ideology*
Unified Language, Labor and Ideology* Yang You Harvard University Last Updated: Feb. 2018 Abstract Exploring an instance of nationwide language educational reform, the Chinese Pinyin Act Reform of 1958-1960, we estimate the effects of language unification using a difference-in-difference approach by interacting a birth cohort exposure dummy with the linguistic distances between local languages and Putonghua, modern standardized Mandarin. This paper presents five main findings: (1) Putonghua learning exhibits modest short-run negative but long-run positive effects on educational attainment; (2) Putonghua learning increases rural households’ non-agricultural employment; (3) Common language empowers workers to migrate across provinces and language regions; (4) Language unification fosters patriotism, a stronger national identity and a more positive subjective evaluation of China. One plausible channel is that the common language builds national identity by expanding exposure to vocal-based media, namely radio, cell phone and internet; and (5) The post-reform population shows more skepticism of democracy, better subjective evaluation of governance and more support for government intervention over economic liberalism. These changes in ideology and social preference are consistent with the political doctrine of the Communist Party of China. Keywords: Language, Education, Labor market, Ideology, Social Preference JEL Code: I25, I26, L82, N45, O15, Z13 * We thank Michael Kremer for outstanding guidance and support. We are grateful Alberto Alesina, Philipp Ager, Richard Freeman, Edward Glaeser, Lawrence Katz, Andrei Shleifer, Stefanie Stantcheva and seminar participants at the Harvard Development Economics lunch seminar, the Economic History lunch seminar, the Public/Labor lunch seminar, the China Economy Seminar and The Econometric Society Asian Meeting 2017, for their comments and helpful discussions. -

Language Translator Abkhaz (Аҧсуа Бызшәа) Каџьаиа М. Afenmai
Language Translator Abkhaz (аҧсуа бызшәа) Каџьаиа М. Afenmai (Afemai) | Etsako Imisioluwa Adetula Albanian (Shqip) Gentrita Bajrami Alsatian Maurice Bolla Amharic Sergi Moles Arabic Fuad Kastali / JCI Syria Armenian Marc Herrando Verdaguer Asante Twi Emmanuel Asamoah Assyrian Neo-Aramaic Issa Hanna Basque (Euskara) BFT Bavarian (Bayrisch) Armin Müller / Markus Spiess Bavarian (Bayrisch) | Lower Bavaria (Niederbayrisch) Martina Bubl-Porro Belarusian (Belaruski) Marc Herrando Verdaguer Bengali Shaiful Azam Bosnian (Bosanski) Marko Ignjátić Breton Jacques Arnal Bulgarian (Balgarski) Ana Nikolova Burgenland Croatia ((Hrvatsko | Gradiščanskohrvatsko) Thomas Novoszel Busa (Mande) |Bokobaru Fatima Halliru Catalan (Català) Oscar Hijosa i Milà Chinese | Yue Teresa Poon T.P. Chinese | Yue Hai T.P. Chinese | Standard Cantonese T.P. Chinese | Weitou T.P. Chinese | Dongguan T.P. Chinese | Qingyuan T.P. Chinese | Zhaoqing T.P. Chinese | Luo Gang T.P. Chinese | Xiguan T.P. Chinese | Siyi (Sei-yup) T.P. Chinese | Wuhua T.P. Chinese | Qinlian T.P. Chinese | Enping T.P. Chinese | Jiangmen T.P. Chinese | Kaiping T.P. Chinese | Taishan T.P. Chinese | Xinhui T.P. Chinese | Gaoyang T.P. Chinese | Yongxun T.P. Chinese | Goulou T.P. Chinese | Maoming T.P. Chinese | Yangjiang T.P. Chinese | Guinan T.P. Chinese | Beihai T.P. Chinese | Wuzhou T.P. Chinese | Tanka Yue T.P. Chinese | Shiqi T.P. Chinese | Jiujiang T.P. Chinese | Nanning dialect T.P. Chinese | Yongning dialect T.P. Chinese | Guiping dialect T.P. Chinese | Chongzuo dialect T.P. Chinese | Ningmin dialect T.P. Chinese | Hengxian dialect T.P. Chinese | Baise dialect T.P. Chinese | Guangzhou dialect T.P. Chinese | Macau dialect T.P. Chinese | Nanhai dialect T.P. -

Some Reflections on Chinese Dialect Island Research in the Post-Covid-19 Period
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by CSCanada.net: E-Journals (Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture,... ISSN 1712-8056[Print] Canadian Social Science ISSN 1923-6697[Online] Vol. 16, No. 10, 2020, pp. 1-4 www.cscanada.net DOI:10.3968/11892 www.cscanada.org Some Reflections on Chinese Dialect Island Research in the Post-Covid-19 Period WANG Wei[a],*; ZHOU Weihong[b] [a] Associate Professor, School of Interpreting and Translation, Beijing news report of People’s Daily, China will form a new International Studies University, Beijing, China. development pattern centered on “internal circulation,” [b] Lecturer, Department of College English Education, Beijing City University Beijing, China. (Lu & Li 2020) and speed up a “dual circulation” (ibid) *Corresponding author. growth model in which “internal circulation” (ibid) and “international circulation” (ibid) promote each other, said Received 24 July 2020; accepted 27 September 2020 the Political Bureau of the Communist Party of China Published online 26 October 2020 (CPC) Central Committee during a meeting convened on July 30. The meeting demanded the country to establish Abstract a medium- and long-term coordination mechanism for The topic of dialect island has been gradually recognized COVID-19 control and economic and social development, and studied by Chinese linguists in recent years. Due keep its strategies in restructuring, rely on technological to the impact of the pandemic of SARS-CoV-2, China innovation, improve cross-cyclical macro-control design has shifted her economic focus on domestic market. and regulations, and realize long-term balance between Therefore, dialect varieties shall not become obstacles for growth stability and risk control. -

Download Article (PDF)
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 490 Education, Language and Inter-cultural Communication (ELIC 2020) A New Study on Chinese Teaching of Donggan Students in Central Asia From the Perspective of Inheritance Theory Huan'gai Zhao1,* Heping Wu1 1College of International Cultural Exchange, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, China *Corresponding author. Email: [email protected] ABSTRACT In recent years, the teaching and acquisition of inheritance language has received more and more attention from academic circles. However, teaching research for Chinese learners of the Donggan nationality in Central Asia is rare. The article starts from the Chinese teaching practice of Donggan international students in Central Asia, and aims at the characteristics of the process of learning Chinese language elements for Donggan international students. At the same time it proposes the following teaching suggestions: standardization and regularization of pronunciation teaching, written vocabulary teaching, comparative grammar teaching and Chinese characters and reading teaching. Keywords: Donggan, inheritance language, teaching, acquisition Language refers to “the first language that the individual I. INTRODUCTION has not fully acquired due to the switch to another The inheritance theory believes that the acquisition of dominant language” [1]. inheritance language is unique from the acquisition of the Donggan Language, the mother tongue of Donggan first language and the second language. Therefore, students in Central Asia, is “a special variant of Central domestic and foreign academic circles have shown a Plains Mandarin and Lanyin Mandarin in northwest China strong interest in the teaching and acquisition of in Central Asia” [2], which is a cross-border product of inheritance language. -

Language Relations in Guangzhou in Relations Language Page Gamst Alexander
Alexander Gamst Page Alexander Gamst Page Gamst Alexander Language Relations in Guangzhou The Intimate and Official Dimension of Linguistic Codes in Urban China Master’s thesis Master’s Master’s thesis in Social Anthropology Language Relations in Guangzhou Trondheim, Spring 2011 NTNU Science and Technology Science Norwegian University of University Norwegian Faculty of Social Sciences of Social Sciences Faculty and Technology Management Management and Technology Department of Social Anthropology Figure 1: Map of downtown Guangzhou circa 1995, taken from Charlotte Ikels’ Map 2 in “Return of the God of Wealth (1996)” Abstract This thesis is based on fieldwork conducted in Guangzhou, one of China’s major urban areas. The city, as well as the Guangdong province of which Guangzhou is the capital, is associated with the dialect or language called Cantonese, made known in the west through Hong Kong cinema. The national language, Mandarin, is also widely spoken, and the disparity between these two languages are my major focus. Much of my time was spent at Karen’s Place, a souvenir shop near the American consulate on the island of Shamian. Here, and elsewhere in Guangzhou, I study how the use of the local and the national languages both affect and are affected by the situation wherein they occur. My argument, while anthropological at core, utilizes much research from sociolinguistics as well as the terminology thereof. There are nine major language groups in China, and while these are mutually unintelligible, they are nevertheless officially regarded as dialects of Beijing Mandarin. In Guangzhou most people speak both Mandarin and Cantonese, at least to a reasonable standard. -

The Household Structure Transition in China: 1982–2015
Demography (2020) 57:1369–1391 https://doi.org/10.1007/s13524-020-00891-7 The Household Structure Transition in China: 1982–2015 Ting Li1 & Wenting Fan2 & Jian Song1 Published online: 10 June 2020 # Population Association of America 2020 Abstract Chinese society has experienced a dramatic change over the past several decades, which has had a profound impact on its household system. Utilizing the Chinese national census and 1% population survey data from 1982 to 2015, this study demonstrates the transition of the Chinese household structure through typology analyses. Five typical regional house- hold structure types—large lineal, large nuclear, small nuclear, mixed lineal, and small and diverse—are identified. Our findings demonstrate that since the 1980s, the household system in almost all Chinese regions has evolved from a large unitary model to a small diversified one. However, this evolutionary path diverged after 2000 and formed two distinct household structure systems. There are also significant regional differences in the transition trajectory. Influenced by developmental, cultural, and demographic factors, the regions exhibit four distinct transition paths: lineal tradition, nuclear retardation, smooth transition, and fast transition. On the basis of these results, we discuss family modernization and other theories in explaining the transition of the Chinese household structure. Keywords Household structure transition . China . Regional difference . Typology analysis Introduction Over the past several decades, Chinese society has experienced dramatic changes. These changes have been intertwined with the modernization process, profoundly affecting social structure at the macro level and changing individuals’ behaviors, ideas, and daily life modes at the micro level. As a basic functional unit connecting society and individuals, the Chinese family has also suffered an unprecedented impact during this * Jian Song [email protected] 1 Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, No. -

UC Berkeley Phonology Lab Annual Report (2009)
UC Berkeley Phonology Lab Annual Report (2009) The Phonology of Incomplete Tone Merger in Dalian1 Te-hsin Liu [email protected] 1. Introduction The thesis of tone merger in northern Chinese dialects was first proposed by Wang (1982), and further developed by Lien (1986), the migration of IIb (Yangshang) into III (Qu) being a common characteristic. The present work aims to provide an update on the current state of tone merger in northern Chinese, with a special focus on Dalian, which is a less well-known Mandarin dialect spoken in Liaoning province in Northeast China. According to Song (1963), four lexical tones are observed in citation form, i.e. 312, 34, 213 and 53 (henceforth Old Dalian). Our first-hand data obtained from a young female speaker of Dalian (henceforth Modern Dalian) suggests an inventory of three lexical tones, i.e. 51, 35 and 213. The lexical tone 312 in Old Dalian, derived from Ia (Yinping), is merging with 51, derived from III (Qu), in the modern system. This variation across decades is consistent with dialects spoken in the neighboring Shandong province, where a reduced tonal inventory of three tones is becoming more and more frequent. However, the tone merger in Modern Dalian is incomplete. A slight phonetic difference can be observed between these two falling contours: both of them have similar F0 values, but the falling contour derived from Ia (Yinping) has a longer duration compared with the falling contour derived from III (Qu). Nevertheless, the speaker judges the contours to be the same. Similar cases of near mergers, where speakers consistently report that two classes of sounds are “the same”, yet consistently differentiate them in production, are largely reported in the literature.