Madagascar D’Un Décret Du 29 Septembre 1934
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Bank Document
Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469) Public Disclosure Authorized I. General 2. Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017 3. Date of General Procurement Notice: - 4. Period covered by this procurement plan: July 2016 to December 2017 II. Goods and Works and non-consulting services. 1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: [Thresholds for applicable Public Disclosure Authorized procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency’s capacity.] Type de contrats Montant contrat Méthode de passation de Contrat soumis à revue a en US$ (seuil) marchés priori de la banque 1. Travaux ≥ 5.000.000 AOI Tous les contrats < 5.000.000 AON Selon PPM < 500.000 Consultation des Selon PPM fournisseurs Public Disclosure Authorized Tout montant Entente directe Tous les contrats 2. Fournitures ≥ 500.000 AOI Tous les contrats < 500.000 AON Selon PPM < 200.000 Consultation des Selon PPM fournisseurs Tout montant Entente directe Tous les contrats Tout montant Marchés passes auprès Tous les contrats d’institutions de l’organisation des Nations Unies Public Disclosure Authorized 2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines. July 9, 2010 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: - 4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Manuel de procedures (execution – procedures administratives et financières – procedures de passation de marches): décembre 2016 – émis par l’Unite de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière) 5. -

Liste Candidatures Conseillers Alaotra Mangoro
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 RTM (Refondation Totale De Madagascar) RAKOTOZAFY Jean Marie Réné AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 MMM (Malagasy Miara-Miainga) ARIMAHANDRIZOA Raherinantenaina INDEPENDANT RANAIVOARISON HERINJIVA AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 RANAIVOARISON Herinjiva (Ranaivoarison Herinjiva) AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIARISON Célestin AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANDRIAMANARINA - INDEPENDANT RAZAKAMAMONJY HAJASOA AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 RAZAKAMAMONJY Hajasoa Mazarin MAZARIN (Razakamamonjy Hajasoa Mazarin) INDEPENDANT RAHARIJAONA ROJO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 RAHARIJAONA Rojo (Raharijaona Rojo) AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RATIANARIVO Jean Cyprien Roger AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RABEVASON Hajatiana Thierry Germain SUBURBAINE AMBATONDRAZAKA INDEPENDANT RANDRIANASOLO ROLLAND AMBATONDRAZAKA 1 RANDRIANASOLO Rolland SUBURBAINE (Randrianasolo Rolland) AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 MMM (Malagasy Miara-Miainga) RAKOTONDRASOA Emile SUBURBAINE AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANJAKASOA Albert SUBURBAINE INDEPENDANT RANDRIAMAHAZO FIDISOA AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA 1 HERINIAINA (Randriamahazo Fidisoa RANDRIAMAHAZO Fidisoa Heriniaina Heriniaina) AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIANANTOANDRO Gérard AMBATONDRAZAKA -

Tana Lsms Hh
This PDF generated by katharinakeck, 1/24/2017 10:08:32 AM Sections: 10, Sub-sections: 38, Questionnaire created by opm, 8/4/2016 10:22:56 AM Questions: 366. Last modified by katharinakeck, 1/24/2017 3:00:47 PM Questions with enabling conditions: 206 Questions with validation conditions: 30 Shared with: Rosters: 18 opm (last edited 10/19/2016 10:14:02 AM) Variables: 34 aarau (last edited 10/25/2016 9:18:23 AM) seanoleary (last edited 10/17/2016 4:20:41 PM) arinay (never edited) rharati (never edited) kirsten (never edited) andrianina (never edited) mmihary_r (never edited) sergiy (never edited) janaharb (last edited 10/21/2016 4:55:02 PM) opm (last edited 10/19/2016 10:14:02 AM) gabielte (never edited) TANA_LSMS_HH START Sub-sections: 4, No rosters, Questions: 23, Variables: 5. CONSENT FORM No sub-sections, No rosters, Questions: 1, Static texts: 2. ROSTER No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 5, Static texts: 2, Variables: 2. RESPONDENT SELECTION No sub-sections, No rosters, Questions: 7, Variables: 3. MAIN RESPONDENT Sub-sections: 22, Rosters: 10, Questions: 236, Static texts: 4, Variables: 5. CONSUMPTION Sub-sections: 6, Rosters: 5, Questions: 18, Static texts: 4, Variables: 13. HOUSEHOLD HEAD Sub-sections: 2, Rosters: 1, Questions: 18, Static texts: 1, Variables: 3. LABOUR Sub-sections: 4, Rosters: 1, Questions: 42, Variables: 3. OBSERVATIONS No sub-sections, No rosters, Questions: 12. RESULT No sub-sections, No rosters, Questions: 4. APPENDIX A — INSTRUCTIONS APPENDIX B — OPTIONS APPENDIX C — VARIABLES LEGEND 1 / 65 START EA ID NUMERIC: INTEGER ea_id SCOPE: PREFILLED DWELLING ID NUMERIC: INTEGER dwllid SCOPE: PREFILLED TYPE DWELLING ID AGAIN NUMERIC: INTEGER dwllid2 V1 self==dwllid M1 Dwelling ID does not match V2 ea_id*100+1<=self && self <=ea_id*100+30 M2 Dwelling ID and EA ID do not match VARIABLE DOUBLE dwlnum dwllid-100*ea_id THIS IS A REPLACEMENT DWELLING. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir
SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Madagascar Sahofika Hydropower Plant RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir Part Two: Abbreviated Resettlement Action Plan for the Linear Components of the Project Prepared by: Land Resources, Antananarivo, Madagascar With: Frédéric Giovannetti, Lyon, France Date: June 30, 2019 Version: C SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Eiffage Eranove HIER Themis Consortium Madagascar - Sahofika Hydropower Plant Resettlement Action Plan - Version C TRACEABILITY Version Date Reference Commented on Status by A 04/25/2019 Draft B 06/20/2019 Draft for publication C 07/05/2019 Version for submission to ONE ABBREVIATIONS AEC: Administrative Evaluation Commission AFD: French Development Agency AfDB: African Development Bank AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome ALC: Local Liaison Officer Art.: Article AWS Drinking Water Supply BD: Board of Directors Banky Fampadrosoana ny Varotra (Malagasy subsidiary of the BFV: Société Générale Group) BIF: Birao Ifoton'ny Fananan-tany (Communal Land Office) CASEF: Agricultural Growth and Land Security CIRTOPO: Topographic Constituency COBA: Grassroots Community CPAR: Short Resettlement Plan Framework CSB: Basic Health Center CTD: Decentralized Territorial Communities Inter-Regional Departments and Services for the Environment -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -
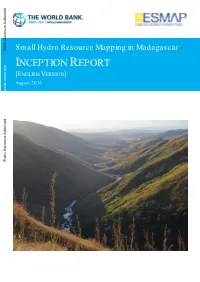
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Boissiera 71
Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

List of Medical Facilities/Practitioners in Madagascar
List of Medical Facilities/Practitioners in Madagascar Prepared by British Embassy Antananarivo www.gov.uk The following list of medical facilities/practitioners has been prepared by the British Embassy Antananarivo for the convenience of British Nationals who may require these services and assistance in Madagascar. It is provided on the understanding that we (the British Embassy) do not assume or undertake any legal responsibility, to you, or those affected, if you choose to take it into account when instructing a medical facility or practitioner. Further and alternatively, we cannot accept any liability to any person or company for any financial loss or damage arising from the use of this information or from any failure to give information. Our aim is to provide our customers with as much relevant information to enable them to make better informed decisions but our lists are not recommendations and should not be treated as such. List of medical facilities/practitioners in Madagascar Updated: December 2016 ANTANANARIVO Medical facilities Clinique et Maternité St.François d’Assise (Clinique des Sœurs) Lot VI 83 Ter Mandialaza Ankadifotsy Antananarivo 101 Telephone:+261 (0) 20 22 235 54/ +261 (0) 20 22 695 20/ +261 (0) 33 11 507 25 / +261 (0) 34 41 487 34 This company has told us the following things: They have some English speaking staff It’s a private facility They are affiliated to the Ministry of Health Specialisation in childbirth, minor surgery, general medicine They have experience of representing British nationals You will need to pay for treatment Staff speak Malagasy, French, some English Clinique Médicale Adventiste Soamanandrariny - Antananarivo 101 Dr. -

Résultats Détaillés Toamasina
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 5 TOAMASINA BV reçus: 249 sur 249 MAPAR FAHAIZ MIFANA MTS FIRAISA AREMA HVM TIM ANA SY SOA N-KINA FAHEN NO N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E DRENA HERY NO REGION 51 ALAOTRA-MANGORO BV reçus 87 sur 87 DISTRICT: 5101 AMBATONDRAZAKA BV reçus22 sur 22 01 AMBANDRIKA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 02 AMBATONDRAZAKA 0 0 14 12 0 12 0 0 5 0 0 0 4 3 03 AMBATONDRAZAKA S 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 2 0 04 AMBATOSORATRA 0 0 8 5 0 5 0 0 1 0 0 0 4 0 05 AMBOHIBOROMANGA 0 0 6 6 0 6 0 0 1 0 0 0 2 3 06 AMBOHIDAVA 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 07 AMBOHITSILAOZANA 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 08 AMPARIHINTSOKATRA 0 0 8 7 1 6 0 0 1 0 0 0 5 0 09 AMPITATSIMO 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 10 ANDILANATOBY 0 0 8 8 0 8 0 0 5 0 0 0 3 0 11 ANDROMBA 0 0 6 4 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 12 ANTANANDAVA 0 0 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 13 ANTSANGASANGA 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 14 BEJOFO 0 0 8 8 0 8 0 0 4 0 0 0 3 1 15 DIDY 0 0 8 7 0 7 0 0 5 0 0 0 2 0 16 FERAMANGA NORD 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 17 ILAFY 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 18 IMERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 19 MANAKAMBAHINY ES 0 0 8 8 0 8 0 0 2 0 0 0 6 0 20 MANAKAMBAHINY OU 0 0 8 7 0 7 1 0 2 0 0 0 4 0 21 SOALAZAINA 0 0 8 7 0 7 0 0 5 0 0 0 2 0 22 TANAMBAO BESAKAY 0 0 8 8 0 8 0 0 2 0 0 0 4 2 TOTAL DISTRICT 0 0 176 164 1 163 1 0 65 0 0 0 88 9 DISTRICT: 5102 AMPARAFARAVOLA BV reçus22 sur 22 01 AMBATOMAINTY 0 0 8 8 0 8 1 0 2 0 0 0 5 0 02 AMBOAVORY 0 0 8 8 0 8 1 0 2 0 0 0 1 4 03 AMBODIMANGA 0 0 6 6 0 6 0 0 2 0 0 0 3 1 04 AMBODIRANO 0 0 6 6 0 6 0 0 1 0 0 0 4 1 Page 1 sur -

The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of Tatom (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara)
Ministry of Regional Development, Building, Housing and Public Works (MAHTP) Government of the Republic of Madagascar The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Summary October 2019 Japan International Cooperation Agency (JICA) Oriental Consultants Global Co., Ltd. CTI Engineering International Co., Ltd. CTI Engineering Co., Ltd. EI JR 19-102 Ministry of Regional Development, Building, Housing and Public Works (MAHTP) Government of the Republic of Madagascar The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Summary October 2019 Japan International Cooperation Agency (JICA) Oriental Consultants Global Co., Ltd. CTI Engineering International Co., Ltd. CTI Engineering Co., Ltd. Currency Exchange Rates EUR 1.00 = JPY 127.145 EUR 1.00 = MGA 3,989.95 USD 1.00 = JPY 111.126 USD 1.00 = MGA 3,489.153 MGA 1.00 = JPY 0.0319 Average during the period between June 2018 and June 2019 Administrative Divisions of Madagascar The decentralised administrative divisions of Madagascar is divided into 22 regions which are further divided into 114 districts. The districts are further divided into communes and each communes into fokontany. Besides the decentralised administrative divisions, the country is subdivided into six provinces, divided into 24 prefectures. The prefectures are divided into 117 districts and further into arrondissements. The boundary of region and prefecture are same except for two prefectures Nosy