Prendre L'air
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hypervelocity Missiles for Defence
HYPERVELOCITY MISSILES FOR DEFENCE Presented by Faqir Minhas College of Engineering PAF-Karachi Institute of Economics & Technology April 6, 2005 Table of contents 1. Prologue 3 2. Piloted aircraft and tactical missiles (technical developments) 3 3. Summary of piloted aircraft 5 4. Ballistic and cruise missiles 7 5. Ballistic trajectories 10 6. Conclusions 18 7. Hypersonic propulsion 20 8. Test facilities: 26 9. References 33 Note: This 34-page paper is abridged description of the presentation. It is condensed from the original paper of 150 pages, which contains detailed information on propulsion systems and hypersonic aerodynamics. Copies of this paper or the original paper can be obtained the Royal Aeronautical Society, Pakistan Division on demand. 2 Abstract The paper reviews the history of technical development in the field of hypervelocity missiles. It highlights the fact that the development of anti-ballistic systems in USA, Russia, France, UK, Sweden, and Israel is moving toward the final deployment stage; that USA and Israel are trying to sell PAC 2 and Arrow 2 to India; and that India’s Agni and Prithvi missiles have improved their accuracy, with assistance from Russia. Consequently, the paper proposes enhanced effort for development in Pakistan of a basic hypersonic tactical missile, with 300 KM range, 500 KG payload, and multi-role capability. The author argues that a system, developed within the country, at the existing or upgraded facilities, will not violate MTCR restrictions, and would greatly enhance the country’s defense capability. Furthermore, it would provide high technology jobs to Pakistani citizens. The paper reinforces the idea by suggesting that evolution in the field of aviation and electronics favors the development of ballistic, cruise and guided missile technologies; and that flight time of short and intermediate range missiles is so short that its interception is virtually impossible. -

Prendre L'air
PRENDRE L’AIR Musée Saint-Chamas – Barillet des moteurs Atar 8 et 9 N°3 La revue de l’Association des Amis du Musée Safran Décembre 2019 Contact Rond Point René Ravaud 77550 Réau Tél : 01 60 59 72 58 Mail : [email protected] Sommaire Editorial 3 Jacques Daniel Le mot du Président 3 Jean Claude Dufloux L’avionnerie isséenne 4 Henri Couturier Mr René Farsy : pilote d’essais à la Snecma 9 Jacques Daniel Le Dassault Mirage III T : banc d’essais volant 18 Jacques Daniel Le projet de Caravelle à moteurs Atar 101 22 Jacques Daniel Junkers Jumo 004 et BMW 003 26 Pierre Mouton Débuts de l’électronique à Snecma 29 Pierre Mouton Vintage Motor Cycle Club (VMCC) Manx Rally 2019 - Mésaventures et mes aventures 31 Gérard Basselin Notes de lecture 32 Jacques Daniel Crédits Photographies : Henri Couturier, Jacques Daniel Les articles et illustrations publiées dans cette revue ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite préalable. 2 Editorial Pour ce troisième numéro, nous vous proposons un article sur l’industrie aéronautique d’Issy-les- Moulineaux du début du siècle dernier. A cette époque et jusqu’au milieu des années 1930, on utilisait plutôt le terme " avionnerie " pour désigner les constructeurs d’avions. Dans le domaine des turboréacteurs, la Snecma répondit, au début des années 1950, à un appel d’offre pour la motorisation du programme phare de l’aviation commerciale française : le SE-210 Caravelle. Entre 1951 et 1953, la société participa activement au projet en proposant des formules bi, tri et même quadriréacteurs basées sur le tout nouvel Atar 101. -

Aeromodeller November 1957
N O V E M B E R 1967 ACCESSORIES for all! In addition to a complete spares range for all Davies Charlton engines we also offer many useful accessories for the discriminat ing modeller. They are all built to the same exacting standards as our engines and the prices quoted include Purchase Tax. PROPELLERS Available in good quality beech in two sizes, for Free Flight and C/Line except the Bambi. Price 1/9. Rapier and Manxman 1 / 10- TEAM RACE TANKS neatly fabricated in tin plate. Class "A", 15 c.c., 3/4. Class "B” 30 c.c.. 3/7. ADJUSTABLE CONTROL LINE HANDLE. A well finished aluminium casting in red stove enamel with ground spike and provision for line adjustment. Price 5/1. EXTENDED COMPRESSION SCREWS for all D/C engines excepting the Bambi. I inch 2/5. 2 b inch 2/10. EXTENDED JET NEEDLE for all D/C engines except Bambi. 2/5. RADIAL MOUNTS for Dart and Mk. I Spitfire. 4/10. FLYWHEELS. Accurately turned in brass with sceel spigots available for Dart, Merlin, at 9/7 and Spitfire, Sabre, Rapier and Manxman at 12/-. ENGINE TEST STAND Fits any engine in the D/C range and most motors up to S c.c. Accommodates both beam and radial mounting and is scurdily built in cast aluminium. Price 12/7. COMBINED JET & CUT OUT. Fils any engine in the D/C range and several others besides. Accurately made in brass with positive cut off action. 9/7. ANGLED JET ASSEMBLY . To fit all D/C engines excluding the Bambi, 5/7. -

Safranin 2013
SAFRAN IN 2013 2013 REGISTRATION DOCUMENT SAFR_1402217_RA_2013_GB_CouvDocRef.indd 1 26/03/14 12:12 Contents GROUP PROFILE 1 1 PRESENTATION OF THE GROUP 8 5.3 Developing human potential 203 5.4 Aiming for excellence in health, 1.1 Overview 10 safety and environment 214 1.2 Group strategy 14 5.5 Involving our suppliers and partners 224 1.3 Group businesses 15 5.6 Investing through foundations 1.4 Competitive position 32 and corporate sponsorship 224 1.5 Research and development 32 5.7 CSR reporting methodology and Statutory 1.6 industrial investments 37 Auditors’ report 226 1.7 Sites and production plants 38 1.8 Safran Group purchasing strategy 43 6 CORPORATE GOVERNANCE 232 1.9 Safran quality performance and policy 43 6.1 Board of Directors and Executive 1.10 Safran+ progress initiative 44 Management 234 6.2 Executive Corporate Officer 2 REVIEW OF OPERATIONS IN 2013 compensation 263 AND OUTLOOK FOR 2014 46 6.3 Share transactions performed by Corporate Officers and other managers 272 2.1 Comments on the Group’s performance 6.4 Audit fees 274 in 2013 based on adjusted data 48 6.5 Report of the Chairman 2.2 Comments on the consolidated of the Board of Directors 276 financial statements 66 6.6 Statutory Auditors’ report 2.3 Comments on the parent company on the report prepared by the Chairman financial statements 69 of the Board of Directors 290 2.4 Outlook for 2014 71 2.5 Subsequent events 71 7 INFORMATION ABOUT THE COMPANY, 3 THE CAPITAL AND SHARE FINANCIAL STATEMENTS 72 OWNERSHIP 292 3.1 Consolidated financial statements 7.1 General information -

Rapport De Stage « Ouvrier » À SNECMA – Juillet 2011
Page de garde des rapports de stage Date du stage Stage d’expérience du 04/07/2011 Stage d’exécution au 29/07/2011 Stage élève – ingénieur Stage année de césure : 12 mois 1ersemestre 2èmesemestre Stage projet de fin d’études Année 2010/2011 Nom et Prénom du stagiaire : HOLY Loïck Spécialité : CGP ETI Confidentialité du rapport : OUI NON Titre du rapport en français : Rapport de stage « ouvrier » à SNECMA – Juillet 2011 Titre du rapport en anglais : Internship report as a « worker » at SNECMA – July 2011 Nom de l’entreprise / organisme : SNECMA Ville : Villaroche Pays : France Nom et Prénom du maître de stage : QUECHON Michel Fonction : Manager Remerciements Je tiens dans un premier temps à remercier mon tuteur de stage, Monsieur Michel QUECHON, qui a su m’apporter toute son expérience ainsi que de nombreux conseils tout au long de ce stage, tant du point de vue technique que sur sa fonction managériale. Je tiens également à remercier Monsieur Jérôme LANTENOIS qui m’a encadré durant deux semaines et qui a su m’éclairer sur le fonctionnement des moteurs réalisés { la SNECMA. Je remercie également Monsieur Patrice BARON qui m’a encadré le reste du stage et qui a su, comme Monsieur QUECHON, m’éclairer sur la notion de management. Enfin je tiens à remercier l’ensemble du personnel des deux magasins dans lesquels j’ai travaillé, pour l’aide et les conseils qu’ils m’ont apportés tout au long de ces quatre semaines ainsi que pour le suivi effectué des missions qui m’ont été confiées. Je leur suis reconnaissant de m’avoir rapidement intégré { leurs équipes et de la confiance qu’ils m’ont accordée. -

National Air & Space Museum Technical Reference Files: Propulsion
National Air & Space Museum Technical Reference Files: Propulsion NASM Staff 2017 National Air and Space Museum Archives 14390 Air & Space Museum Parkway Chantilly, VA 20151 [email protected] https://airandspace.si.edu/archives Table of Contents Collection Overview ........................................................................................................ 1 Scope and Contents........................................................................................................ 1 Accessories...................................................................................................................... 1 Engines............................................................................................................................ 1 Propellers ........................................................................................................................ 2 Space Propulsion ............................................................................................................ 2 Container Listing ............................................................................................................. 3 Series B3: Propulsion: Accessories, by Manufacturer............................................. 3 Series B4: Propulsion: Accessories, General........................................................ 47 Series B: Propulsion: Engines, by Manufacturer.................................................... 71 Series B2: Propulsion: Engines, General............................................................ -

Prendre L'air N°2 - Juin 2019 2
PRENDRE L’AIR Musée du Saint Chamas - Le Potez 631 C3 N°2 La revue de l’Association des Amis du Musée Safran Juin 2019 Contact Rond Point René Ravaud 77550 Réau Tél : 01 60 59 72 58 Mail : [email protected] Sommaire Editorial 3 Jacques Daniel Le mot du Président 4 Jean Claude Dufloux L’Association les Ailes Anciennes Toulouse 5 Jacques Daniel Histoire de l’usine Kellermann : Il y a 50 ans, la fin de Kellermann (Première partie) 9 Henri Couturier Marc Birkigt Paul-Louis Weiller : portraits croisés - Deux grands noms de l’aéronautique et de l’automobile 15 Henri Couturier Maquettes au Saint-Chamas : d’un canard à l’autre 20 Jacques Daniel Le train d'atterrissage automoteur du SA 330 "Puma" ZWWS n° 06 25 Jacques Daniel Racines françaises du turboréacteur 28 Pierre Mouton Le turbopropulseur Snecma TB-1000 : La restauration 31 Régis Ligonnet Le turbopropulseur Snecma TB-1000 : Le premier turbopropulseur français 35 Régis Ligonnet La Caravelle 193, banc d’essais volant des moteurs M53 et CFM56 43 Jacques Daniel Notes de lecture 48 Jacques Daniel Crédits Photographies : Henri Couturier, Jacques Daniel, Régis Ligonnet Les articles et illustrations publiées dans cette revue ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite préalable. Prendre l'air N°2 - Juin 2019 2 Editorial Une mission noble de l’AAMS, c’est d’éditer la revue "Prendre l’air". Dans ce second numéro de "Prendre l’Air", nous rendons hommage à l’Association des Ailes Anciennes Toulouse (AAT), l’une des plus dynamiques en France et avec laquelle l’AAMS a signé une convention depuis la fin de l’année 2018. -

Design and Testing of a Combustor for a Turbo-Ramjet for UAV and Missile Applications
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 2003-03 Design and testing of a combustor for a turbo-ramjet for UAV and missile applications Piper, Ross H. Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/1072 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL Monterey, California THESIS DESIGN AND TESTING OF A COMBUSTOR FOR A TURBO-RAMJET FOR UAV AND MISSILE APPLICATIONS by Ross H. Piper III March 2003 Thesis Advisor: Garth V. Hobson Second Reader: Raymond P. Shreeve Approved for public release; distribution is unlimited THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED March 2003 Master’s Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE: Design and Testing of a Combustor for a Turbo- 5. FUNDING NUMBERS ramjet Engine for UAV and Missile Applications 6. AUTHOR(S) Ross H. Piper III 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING Naval Postgraduate School ORGANIZATION REPORT Monterey, CA 93943-5000 NUMBER 9. -

Download File
Editorial Offices: 19 PARK LANE, LONDON, W.! TelepllOne: GROsvenor 1530 and 1382 Editor: FRANK HILLIER Advertisemellt jlfallager: Proprietors: Derek Merson 2 BREAMS BUILDINGS AIR LEAGUE OF TIlE BRITISH EMPIRE LONDON, E.C.4 LONDONDERRY HOUSE. 19 PARK LANE, LONDON, W.1. Telephone: HOLborn 5108 Vol. XVTII APRIL 1956 No. 4 Policy for Defence o ONE will envy the task of any of his immense natural resources, must be limits to what we can N British Government in evolving because his totalitarian regime makes attempt in the way of guided missiles a policy for defence. With our allies it possible for him to mobilise these and of other weapons. we are in the unenviable position of resources, including human resources, While these are some of the diffi being on the defensive. We have no to the building up of a huge indus culties that face any British Govern intention of attacking any other trial and war potential, because he is ment, we are far from believing-and country. The potential aggressor able to employ millions of slave we have said this before in these therefore holds all the cards and very labourers in concentration camps. It columns-that the country has been much of the initiative. is possible to imagine that only a well served in defence matters by From this it results that there are country of the size of the U.S.S.R. successive governments since the war. at least three kinds of war for which or of the United States can under There have been late starts in every we must prepare. -
Naissance D'un Geant
Naissance d’un géant Le musée de la Snecma, ancienne installation de Villaroche, 1987. (Cliché G. Hartmann). NAISSANCE D’UN GEANT par Gérard Hartmann 1 Naissance d’un géant MF), la valeur des titres en portefeuille à 652 La bonne surprise millions de francs (+ 385 MF), le portefeuille des commandes est évalué à 828 millions de francs (+ 67 MF), 769 millions de francs sont du 22 août 1944 en banque avec des réserves importantes. Même si les frais généraux sont en augmen- tation de 75 %, la vente des moteurs d’avion, Deux jours après que Pétain et Laval aient des motocyclettes et des produits des forges été arrêtés par la Gestapo, les membres du et fonderies a dégagé un chiffre d’affaires de conseil d’administration de la Société des près de trois milliards de francs en augmen- Moteurs Gnome & Rhône (SMGR) se réunis- tation de plus d’un milliard avec un bénéfice sent sous la présidence de Louis Verdier di- de 19 millions de francs, double de celui de recteur des usines pour faire le point sur 1942 et quadruple de celui de 1941. l’exercice 1943. On ne parle bien entendu au- tour de la table que du débarquement des alliés, des événements de la fin de la guerre sur le territoire français et de l’imminente li- bération de Paris. Usines de la SNCAC bombardées en mars 1943. (Archives munici- pales de Boulogne-Billancourt). Lors d’un second conseil d’administration, présidé le 6 septembre 1944, Louis Verdier salue le courage des troupes françaises et américaines qui ont permis la libération de Paris, indique que sa société a mis à la dis- L’usine Gnome & Rhône de Gennevilliers, détruite aux trois quarts position des forces de libération tous les vé- le 27 mai 1944 par les bombardements alliés, ici le parc à huiles. -

Improvement of the Performance of a Turbo-Ramjet Engine for UAV and Missile Applications
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 2003-12 Improvement of the performance of a turbo-ramjet engine for UAV and missile applications Krikellas, Dimitrios Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/6183 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF A TURBO- RAMJET ENGINE FOR UAV AND MISSILE APPLICATIONS by Dimitrios Krikellas December 2003 Thesis Advisor: Garth V. Hobson Second Reader: Kai E. Woehler Approved for public release; distribution is unlimited. THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK Form Approved OMB No. 0704- REPORT DOCUMENTATION PAGE 0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES (Leave blank) December 2003 COVERED Master’s Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE 5. FUNDING NUMBERS Improvement of the Performance of a Turbo-Ramjet Engine for UAV and Missile Applications 6. AUTHOR (S) Dimitrios Krikellas 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING Naval Postgraduate School ORGANIZATION REPORT Monterey, CA 93943-5000 NUMBER 9. SPONSORING / MONITORING AGENCY NAME(S) AND 10. -
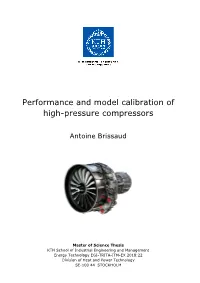
Performance and Model Calibration of High-Pressure Compressors
Performance and model calibration of high-pressure compressors Antoine Brissaud Master of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-TRITA-ITM-EX 2018:22 Division of Heat and Power Technology SE-100 44 STOCKHOLM Master of Science Thesis EGI TRITA-ITM-EX 2018:22 Performance and model calibration of high- pressure compressors Antoine Brissaud Approved Examiner Supervisor 2018/03/02 Paul Petrie-Repar Nenad Glodic Commissioner Contact person Abstract To fully determine the performances of high-pressure compressors (HPC), modeling and partial tests can be performed to characterize its different operating conditions. Nevertheless, there are still noticeable errors between the results of these models and the tests: deformations and differences can appear, and notably because of a modeling defect or the assumptions made during the analysis (measurement corrections for example). To model the closest to the tests, it is therefore necessary to include all the different elements impacting the performances of the compressor performance map to model the operating points correctly. The purpose of the thesis is to take in charge a new software that predicts the performances of high-pressure compressors, built in Python where a compressor can be decomposed in elementary axial and/or centrifugal compressors using their respective compressor performance map. By a stacking technique it is possible to characterize the operating point of the main compressor by knowing the inlet and the outlet conditions, and to include several deformation models such as Reynolds number effects, Variable Stator Vanes (VSV) effects, or tip clearance effects on the performances of the compressor. A calibration function also allows the development of new versions of the previous deformations models and it quantifies the unknowns and uncertainties between computed and tested results.