Lui Le Magazine De L'homme Moderne.Wps
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introduction Where the Story Begins 1 Hall of Mirrors
NOTES Introduction Where the Story Begins 1. The New York Times obituary of Sam Jaffe, founder and head of the Jaffe Agency from 1935 to 1959, states that the agency “suffered dur- ing the McCarthy era, when many of its clients were singled out by the House Un-American Activities Committee.” “Sam Jaffe, 98, Hollywood Agent” [obituary]. 2. Sigal began writing Going Away: A Report, a Memoir before he left the United States for Europe in 1956 and completed it in London. As a result of publication delays, it did not appear in print in the United States under the Houghton Mifflin imprint until 1962, the year after his later-written book, Weekend in Dinlock, was published in London by Secker and Warburg. 3. Zone of the Interior (New York: Crowell, 1976) was first published in Britain in 2005 (Hebden Bridge, West Yorkshire: Pomona Press, 2005). 4. In Lessing’s view, her mother let it be known virtually from her birth that she was “not wanted in the first place; that to have a girl was a disappointment that nearly did her in altogether, after that long labour; . that I was an impossibly difficult baby, and then a tire- some child, quite unlike my little brother Harry who was always so good. [M]y memories of her are all of antagonism, and fighting, and feeling shut out; of pain because the baby born two-and-a-half years after me was so much loved when I was not” (“Impertinent Daughters” 61). 1 Hall of Mirrors 1. See Introduction, p. 10, for a list of the eight books. -

Paylaşım 2018/1
2018/01 paylasımKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. KARA SOKAK EDEBİYATIN SÜFRAJET SABRIN SİNEMANIN ÜNLÜ SANATI DEV MÜZİSYENİ DEDEKTİFLERİ AFİŞLERİ KAĞIT DANTEL Paylaşım Endemik ve nadir türleriyle Yaşam Kültürü Dergisi Kartonsan Karton Sanayi A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanır ve ücretsizdir. Dergide yayımlanan yazı ve görseller izinsiz kullanılamaz. Anadolu'nun Çiçekleri Acılarını tuvale hapseden kadın Yayın Türü Yaygın Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Kartonsan A.Ş. adına Haluk İlber Frida Kahlo Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Atiye Tuğtekin Yönetim Yeri KARTONSAN Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Prof. Bülent Tarcan Caddesi Pak İş Merkezi No:5 Kat:3 Gayrettepe . İSTANBUL Tel: +90 (212) 273 20 00 Faks: +90 (212) 273 21 70 www.kartonsan.com.tr Baskı & Cilt Sabrın Sanatı ANKA Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mahallesi, 2. Cd. 1119. Sk. No:3, 34220 Esenler . İstanbul Tel: +90 (0212) 565 9033 Faks: +90 (0212) 565 9034 Kağıt www.ankamatbaa.com.tr Danteller İngiltere'de kadına seçme hakkı Yayıncı verilmesinin SYNERGY Bilişim ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Parşömenin keşfedildiği 100. yılında Mall of İstanbul Ofiice No:136 topraklar Başakşehir İSTANBUL Tel: +90 (212) 347 40 00 Faks: +90 (212) 347 40 04 www.kurumsalyayin.com Sufrajet Bergama Afişleri Moda ve tarihsel gelişimin izini süren Sinema Müziklerinin Dahi Çocuğu Çanta Müzesi Dany Elfman Paylaşım Yaşam Kültürü Dergisi, %100 geri dönüşümlü kağıt kullanılarak hazırlanmıştır. Kapakta Kartonsan ürünlerinden Lutriplex 350 gr. kağıt kullanılmıştır. Holmes'tan Poirot'ya Paylasim Life Style Magazine is printed on 100% recycled paper. Cover pages printed on Lutriplex 350 gr. paper produced by Kartonsan. Edebiyatın Ünlü Dedektifleri doğa Endemik türler nadir bulunmaları nedeniyle ülke ekonomisi için önemli bir değer oluşturma- nın tüm olumsuzlukları ile karşı karşıya kalıyor- lar. -

Dorothea Tanning
DOROTHEA TANNING Born 1910 in Galesburg, Illinois, US Died 2012 in New York, US SOLO EXHIBITIONS 2022 ‘Dorothea Tanning: Printmaker’, Farleys House & Gallery, Muddles Green, UK (forthcoming) 2020 ‘Dorothea Tanning: Worlds in Collision’, Alison Jacques Gallery, London, UK 2019 Tate Modern, London, UK ‘Collection Close-Up: The Graphic Work of Dorothea Tanning’, The Menil Collection, Houston, Texas, US 2018 ‘Behind the Door, Another Invisible Door’, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain 2017 ‘Dorothea Tanning: Night Shadows’, Alison Jacques Gallery, London, UK 2016 ‘Dorothea Tanning: Flower Paintings’, Alison Jacques Gallery, London, UK 2015 ‘Dorothea Tanning: Murmurs’, Marianne Boesky Gallery, New York, US 2014 ‘Dorothea Tanning: Web of Dreams’, Alison Jacques Gallery, London, UK 2013 ‘Dorothea Tanning: Run: Multiples – The Printed Oeuvre’, Gallery of Surrealism, New York, US ‘Unknown But Knowable States’, Gallery Wendi Norris, San Francisco, California, US ‘Chitra Ganesh and Dorothea Tanning’, Gallery Wendi Norris at The Armory Show, New York, US 2012 ‘Dorothea Tanning: Collages’, Alison Jacques Gallery, London, UK 2010 ‘Dorothea Tanning: Early Designs for the Stage’, The Drawing Center, New York, US ‘Happy Birthday, Dorothea Tanning!’, Maison Waldberg, Seillans, France ‘Zwischen dem Inneren Auge und der Anderen Seite der Tür: Dorothea Tanning Graphiken’, Max Ernst Museum Brühl des LVR, Brühl, Germany ‘Dorothea Tanning: 100 years – A Tribute’, Galerie Bel’Art, Stockholm, Sweden 2009 ‘Dorothea Tanning: Beyond the Esplanade -

CAHIERS DU CINÉMA El Ciclo Vital De Una Revista De Cine
03 Artículos 24/1/07 08:42 Página 66 ARTÍCULOS EMILIE BICKERTON ADIEU A LOS CAHIERS DU CINÉMA El ciclo vital de una revista de cine ¿Qué pasó con Cahiers du cinéma? Durante décadas la revista, cuya ma- queta remedaba las páginas de un cuaderno, publicó algunas de las crí- ticas más polémicas e influyentes que animaron el mundo del cine; de- sempeñó un papel crucial en la consolidación del cine en tanto que «séptimo arte». Fundada en 1951 con André Bazin como director, Cahiers no tardó en hacerse con los servicios de un grupo estelar de jóvenes crí- ticos –Truffaut, Godard, Chabrol– que aseguraron que la revista se con- virtiera en un icono y adquiriera un renombre internacional cuando, im- pulsados por sus propias palabras, sacaron sus cámaras a las calles de París y crearon la nouvelle vague. Generaciones posteriores de directo- res de la revista, entre los que han de incluirse Eric Rohmer, Jacques Ri- vette y un equipo inicial formado por Serge Daney y Serge Toubiana, in- trodujeron diferentes cambios de perspectiva y de prioridades –la filosofía o las barricadas; el esteticismo o las travesías por los distintos canales de televisión con un mando a distancia–, pero en todo momen- to conservaron el sentido de una vanguardia cinematográfica, tan apasio- nada como dispuesta a la intervención. Cahiers continúa publicándose mensualmente, ahora con un formato de revista de lujo indistinguible del grueso de guías de cine dirigidas al gran público. Películas de festival, ofertas comerciales, puntos de vista educativos, archivos: la bienintencionada cobertura es más extensa que nunca, el estilo amanerado, cuando no curiosamente aséptico; el efec- to de conjunto –tantas cosas para elegir, tan pocas que ofrezcan un ver- dadero interés– entumece la mente como sólo es capaz de hacerlo un informe de patrones de consumo de productos de lujo. -

The Rita Williams Popular Song Collection a Handlist
The Rita Williams Popular Song Collection A Handlist A wide-ranging collection of c. 4000 individual popular songs, dating from the 1920s to the 1970s and including songs from films and musicals. Originally the personal collection of the singer Rita Williams, with later additions, it includes songs in various European languages and some in Afrikaans. Rita Williams sang with the Billy Cotton Club, among other groups, and made numerous recordings in the 1940s and 1950s. The songs are arranged alphabetically by title. The Rita Williams Popular Song Collection is a closed access collection. Please ask at the enquiry desk if you would like to use it. Please note that all items are reference only and in most cases it is necessary to obtain permission from the relevant copyright holder before they can be photocopied. Box Title Artist/ Singer/ Popularized by... Lyricist Composer/ Artist Language Publisher Date No. of copies Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Dans met my Various Afrikaans Carstens- De Waal 1954-57 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Careless Love Hart Van Steen Afrikaans Dee Jay 1963 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Ruiter In Die Nag Anton De Waal Afrikaans Impala 1963 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Van Geluk Tot Verdriet Gideon Alberts/ Anton De Waal Afrikaans Impala 1970 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs Wye, Wye Vlaktes Martin Vorster/ Anton De Waal Afrikaans Impala 1970 1 Afrikaans, Czech, French, Italian, Swedish Songs My Skemer Rapsodie Duffy -

Aznavour, « Non, Je N'ai Rien Oublié »
Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert www.editionsarchipel.com Si vous souhaitez recevoir notre catalogue et être tenu au courant de nos publications, envoyez vos nom et adresse, en citant ce livre, aux Éditions de l’Archipel, 34, rue des Bourdonnais 75001 Paris. Et, pour le Canada, à Édipresse Inc., 945, avenue Beaumont, Montréal, Québec, H3N 1W3. 978-2-809-80764-6 Copyright © L’Archipel, 2011. Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert Sommaire Page de titre Page de Copyright Dédicace PRÉAMBULE 1 - « UN MILIEU DE CHANTEURS ET D’ARTISTES… » 2 - PARIS MISÈRE 3 - ROCHE ET AZNAVOUR 4 - VERS LE NOUVEAU MONDE 5 - « ME VOILÀ SEUL » : RETOUR EN FRANCE 6 - TOURNÉE MAROCAINE : DIX-SEPT RAPPELS ! 7 - « LE CRUCIFIÉ DU TRAVERSIN » 8 - CARRIÈRE INTERNATIONALE 9 - GEORGES GARVARENTZ : UNE FONTAINE À MÉLODIES 10 - CHEZ LES YÉ-YÉ 11 - PAUL MAURIAT, UN GRAND « COUTURIER MUSICAL » 12 - « JE VOUS PARLE D’UN TEMPS… » 13 - « AU NOM DE LA JEUNESSE… » 14 - « COMME ILS DISENT » 15 - « ILS SONT TOMBÉS » 16 - « POUR TOI, ARMÉNIE » 17 - LE ROI DES DUOS 18 - TOI ET MOI 19 - LYNDA LEMAY 20 - « THE LAST CHANTEUR » 21 - « AZNAVOUR 2000 » Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert 22 - « BON ANNIVERSAIRE, CHARLES ! » 23 - CUBA 24 - LE VIEUX SAGE ET LE JEUNE RAPPEUR 25 - THE CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA 26 - « L’HOMME EST UN SOLITAIRE QUI A BESOIN DES AUTRES » DISCOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIE Facebook : La culture ne s'hérite pas elle se conquiert À Colette, pour ses encouragements et son soutien. -

The 'Darkening Sky': French Popular Music of the 1960S and May 1968
The University of Maine DigitalCommons@UMaine Honors College Winter 12-2016 The ‘Darkening Sky’: French Popular Music of the 1960s and May 1968 Claire Fouchereaux University of Maine Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors Part of the History Commons Recommended Citation Fouchereaux, Claire, "The ‘Darkening Sky’: French Popular Music of the 1960s and May 1968" (2016). Honors College. 432. https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/432 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Honors College by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. THE ‘DARKENING SKY’: FRENCH POPULAR MUSIC OF THE 1960S AND MAY 1968 AN HONORS THESIS by Claire Fouchereaux A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for a Degree with Honors (History) The Honors College University of Maine December 2016 Advisory Committee: Frédéric Rondeau, Assistant Professor of French, Advisor François Amar, Professor of Chemistry and Dean, Honors College Nathan Godfried, Adelaide & Alan Bird Professor of History Jennifer Moxley, Professor of English Kathryn Slott, Associate Professor of French © 2016 Claire Fouchereaux All Rights Reserved ABSTRACT This thesis explores the relationship between ideas, attitudes, and sentiments found in popular French music of the 1960s and those that would later become important during the May 1968 protests in France. May 1968 has generated an enormous amount of literature and analyses of its events, yet there has been little previous work on popular music prior to May 1968 and the events of these protests and strikes that involved up to seven million people at its height. -

2019 Universal Registration Document CHAPTER 1 - Overview of the Group
UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT including the Annual Financial Report FISCAL YEAR 2019 ProfilE Created in 1992, Lagardère is an international group with operations in more than 40 countries worldwide. It employs over 30,000 people and generated revenue of €7,211 million in 2019. Under the impetus of the Group’s General and Managing Partner, Arnaud Lagardère, the Group launched a strategic refocusing around two priority divisions: Lagardère Publishing is the world’s third-largest Lagardère Travel Retail, is the world’s fourth book publisher for the general public and largest travel retail merchant, with operations educational markets, and the leader in France. in three segments of this very dynamic field: Alongside some 6,900 employees, it creates Travel Essentials, Duty Free & Fashion, and 17,000 original publications each year as well Foodservice. Lagardère Travel Retail has as contributing to their broader circulation 25,000 employees across an international by innovating with digital and mobile reading network of more than 4,800 points of sale formats. Lagardère Publishing’s activities also in around one thousand airports, mainline extend to adjacent businesses such as Mobile and urban train stations. Games and Board Games. The Group’s business scope also includes Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1, RFM, Virgin Radio and the Elle brand licence) together with Lagardère Live Entertainment. The Lagardère Studios unit is in the process of being sold. Through this strategic refocusing, the Lagardère group is investing in its two strategic divisions with the aim of creating global leaders over the long term. Lagardère shares are listed on Euronext Paris. -
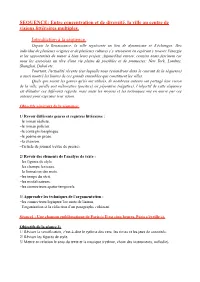
4Ème Dutronc
SEQUENCE: Entre concentration et de diversité, la ville au centre de visions littéraires multiples. Introduction à la séquence. Depuis la Renaissance, la ville représente un lieu de dynamisme et d’échanges. Des individus de plusieurs origines et de plusieurs cultures s’y retrouvent en espérant y trouver l'énergie et les opportunités de mener à bien leurs projets. Aujourd'hui encore, certains noms fascinent car nous les associons au rêve d'une vie pleine de possibles et de promesses: New York, Londres, Shanghai, Dubaï etc. Pourtant, l'actualité récente (sur laquelle nous reviendrons dans le courant de la séquence) a aussi montré les limites de ces grands ensembles que constituent les villes. Quels que soient les genres qu'ils ont utilisés, de nombreux auteurs ont partagé leur vision de la ville, qu'elle soit méliorative (positive) ou péjorative (négative). L'objectif de cette séquence est d'étudier ces différents regards, mais aussi les moyens et les techniques mis en œuvre par ces auteurs pour exprimer leur vision. Objectifs généraux de la séquence: 1/ Revoir différents genres et registres littéraires : –le roman réaliste. –le roman policier. –le conte philosophique. –le poème en prose. –la chanson. –l'article de journal (revue de presse). 2/ Revoir des éléments de l'analyse de texte : –les figures de style. –les champs lexicaux. –la formation des mots. –les temps du récit. –les modalisateurs. –les connecteurs spatio-temporels. 3/ Apprendre les techniques de l'argumentation : –les connecteurs logiques/ les mots de liaison. –l'organisation et la rédaction d'un paragraphe cohérent. Séance1 : Une chanson emblématique de Paris (« Il est cinq heures, Paris s’éveille »). -

Liste Melusine Mars 2010
LISTE MELUSINE MARS 2010 dimanche 7 mars 2010 21:16 semaine 10 Semaine 10 Mois Artaud Le cocktail Cocteau (exposition) Dada, surréalisme et alentours (journée d’études) Salvador Dalí sur les traces d’Eros (publication) Régis Debray Gontcharova (exposition) Ils se sont rencontrés à Paris (spectacle) Picasso en Russie Pleine Marge (exposition) Oeuvres complètes de Reverdy [Publication] Salvador Dalí: sur les traces d'éros Actes du colloque international de Cerisy Frédérique Joseph-Lowery (sous la direction de) Isabelle Roussel-Gillet (sous la direction de) Chez Dalí, le sexe est une force qui agit en permanence dans le laboratoire de l'oeuvre et qui détermine chez l'artiste, à partir des zones de turbulence les plus troubles de son imaginaire, un élan exploratoire tourné vers l'extase et la sublimation. Ce colloque autour de l'artiste catalan s'est proposé de recueillir les traces textuelles, reliques picturales, vestiges cinématographiques et restes pseudo-scientifiques jonchant l'oeuvre de ce surréaliste français que le pays où il naquit imaginairement rejette plus que jamais. Les actes qui en résultent sont présentés dans l'ordre du déroulement des journées et des interventions, tant il importait de rendre compte non seulement de la dimension intellectuelle des différentes approches, mais aussi de l'inscription dans le temps et dans l'espace (une semaine au château de Cerisy) de la présence même des participants, de leur parole, de leur corps: comment, en effet, méditer sur les traces d'éros chez Dalí en ignorant cette exigence de l'artiste qui attendait du «regardant» (et donc de la critique), dans la contemplation de ses oeuvres, le même engagement du corps sexuel que lui-même dans son acte créateur. -
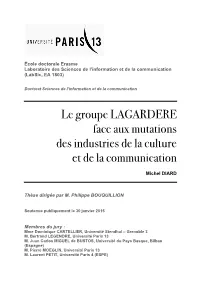
Lagardère SCA, Un Groupe Industriel Atypique
École doctorale Erasme Laboratoire des Sciences de l’information et de la communication (LabSic, EA 1803) Doctorat Sciences de l’information et de la communication Le groupe LAGARDERE face aux mutations des industries de la culture et de la communication Michel DIARD Thèse dirigée par M. Philippe BOUQUILLION Soutenue publiquement le 30 janvier 2015 Membres du jury : Mme Dominique CARTELLIER, Université Stendhal – Grenoble 3 M. Bertrand LEGENDRE, Université Paris 13 M. Juan Carlos MIGUEL de BUSTOS, Université du Pays Basque, Bilbao (Espagne) M. Pierre MOEGLIN, Université Paris 13 M. Laurent PETIT, Université Paris 4 (ESPE) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! « J’ai laissé plus de choses à dire que je n’en ai dites (…) peut-être la prolixité et l’adulation ne seront pas au nombre des défauts qu’on pourra me reprocher. » ! Denis DIDEROT, Encyclopédie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! à Marie-France et Jean-Michel ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! Remerciements ! ! ! Je remercie mon directeur Philippe BOUQUILLION pour ses conseils avisés, sa disponibilité et sa patience envers le doctorant aussi peu conventionnel que je fus. Je tiens aussi à associer à ces remerciements Pierre MOEGLIN et Yolande COMBES, qui, à chacune des séances du ‘’petit séminaire’’ du LabSic, m’ont permis d’approfondir mes questionnements à propos des industries culturelles. J’associerai à ces remerciements le directeur Du LabSic et du Labex ICCA, Bertrand LEGENDRE, pour m’avoir accueilli et invité à participer à l’université d’été du Labex ICCA me permettant de mieux appréhender le travail de recherche en sciences humaines. Merci aussi à tous les doctorants du LabSic pour les discussions passionnantes au sein du « petit séminaire ». Enfin, un grand merci à Marie-France, mon épouse, pour son soutien infaillible et sa très grande patience. -

LEONORA CARRINGTON CURRICULUM VITAE Born 1917 Clayton-Le-Woods, Lancashire, United Kingdom Died 2011 Mexico City, Mexico SOLO EX
LEONORA CARRINGTON CURRICULUM VITAE Born 1917 Clayton-le-Woods, Lancashire, United Kingdom Died 2011 Mexico City, Mexico SOLO EXHIBITIONS 2020 Leonora Carrington: tu país, Fundación Mapfre, Madrid Spain; Museo Picasso Malaga, Málaga, Spain 2019 Leonora Carrington: The Story of the Last Egg, Gallery Wendi Norris Offsite, New York, NY 2018 Leonora Carrington: Magical Tales, Museo de Arte Moderno, Mexico City, Mexico; Palacio de Bellas Artes, Mexico City, Mexico; Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, Mexico 2015 Leonora Carrington: Transgressing Discipline, Tate Liverpool, Liverpool, United Kingdom 2014 Leonora Carrington: The Celtic Surrealist, Gallery Wendi Norris, San Francisco, CA 2013 Leonora Carrington: The Celtic Surrealist, Irish Museum of Modern Art, Dublin, Ireland 2008 The Talismanic Lens, Frey Norris Contemporary and Modern, San Francisco, CA Leonora Carrington. La mariée du vent., Maison de L'Amérique Latine, Paris, France 2007 Leonora Carrington, What She Might Be, The Dallas Museum of Art, Dallas, TX 1997 Leonora Carrington, Tokyo Station Gallery, Tokyo, Japan; Daimaru Museum, Umeda-Osaka, Japan; Hida Takayama Museum of Art, Takayama, Japan; Mie Prefectual Art Museum, Tsu, Japan 1995 Leonora Carrington: una retrospectiva, Museo de Arte Moderno de México, Mexico City, Mexico; Instituto Nacional de Bellas Artes, Mexico City, Mexico 1994 Leonora Carrington: una retrospective, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, Mexico 1991 Aspectos del Surrealismo en México, Centro Cultural/Arte Contemporáneo,