Projet De Creation D'une Unite
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tana Lsms Hh
This PDF generated by katharinakeck, 1/24/2017 10:08:32 AM Sections: 10, Sub-sections: 38, Questionnaire created by opm, 8/4/2016 10:22:56 AM Questions: 366. Last modified by katharinakeck, 1/24/2017 3:00:47 PM Questions with enabling conditions: 206 Questions with validation conditions: 30 Shared with: Rosters: 18 opm (last edited 10/19/2016 10:14:02 AM) Variables: 34 aarau (last edited 10/25/2016 9:18:23 AM) seanoleary (last edited 10/17/2016 4:20:41 PM) arinay (never edited) rharati (never edited) kirsten (never edited) andrianina (never edited) mmihary_r (never edited) sergiy (never edited) janaharb (last edited 10/21/2016 4:55:02 PM) opm (last edited 10/19/2016 10:14:02 AM) gabielte (never edited) TANA_LSMS_HH START Sub-sections: 4, No rosters, Questions: 23, Variables: 5. CONSENT FORM No sub-sections, No rosters, Questions: 1, Static texts: 2. ROSTER No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 5, Static texts: 2, Variables: 2. RESPONDENT SELECTION No sub-sections, No rosters, Questions: 7, Variables: 3. MAIN RESPONDENT Sub-sections: 22, Rosters: 10, Questions: 236, Static texts: 4, Variables: 5. CONSUMPTION Sub-sections: 6, Rosters: 5, Questions: 18, Static texts: 4, Variables: 13. HOUSEHOLD HEAD Sub-sections: 2, Rosters: 1, Questions: 18, Static texts: 1, Variables: 3. LABOUR Sub-sections: 4, Rosters: 1, Questions: 42, Variables: 3. OBSERVATIONS No sub-sections, No rosters, Questions: 12. RESULT No sub-sections, No rosters, Questions: 4. APPENDIX A — INSTRUCTIONS APPENDIX B — OPTIONS APPENDIX C — VARIABLES LEGEND 1 / 65 START EA ID NUMERIC: INTEGER ea_id SCOPE: PREFILLED DWELLING ID NUMERIC: INTEGER dwllid SCOPE: PREFILLED TYPE DWELLING ID AGAIN NUMERIC: INTEGER dwllid2 V1 self==dwllid M1 Dwelling ID does not match V2 ea_id*100+1<=self && self <=ea_id*100+30 M2 Dwelling ID and EA ID do not match VARIABLE DOUBLE dwlnum dwllid-100*ea_id THIS IS A REPLACEMENT DWELLING. -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl
LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

LISTE DES AGEX ACT Post Cata PRESELECTIONNEES 2020 1
LISTE DES AGEX ACT Post cata PRESELECTIONNEES 2020 1 - ANTANANARIVO CODE - Association/ONG/Con RANG DERNIERE Dénomination sortium ADRESSE SIEGE COMMUNE DISTRICT CODIFICATION (Association/ONG) Lot OUI O 10 Ambohitrandriana ANTANANARIVO 1 AXPCT001 ONG MIASA ONG AmbohimalazaAntananarivo Avaradrano AMBOHIMALAZA AVARADRANO 103 ANTANANARIVO 2 AXPCT002 Association VINA Association Lot XO 10 Antehikady Ambohimalaza AMBOHIMALAZA AVARADRANO Lot 0209 D 0251 Mahatsinjo 401 3 AXPCT003 Association ADDM Association MAHAJANGA I MAHAJANGA I Mahajanga I LOT 41 CITE MANJARISOA -401 - 4 AXPCT004 Association MENDRIKA Association MAHAJANGA I MAHAJANGA I MAHAJANGA Association Tanora Lot 155 J Tsararano Ambony 401 5 AXPCT005 Association MAHAJANGA I MAHAJANGA I Miranga Mahajanga I ANTANANARIVO 6 AXPCT006 ASSOCIATION AJAH Association LOT II A 37 AMBAVAHADITOKANA ITAOSY ATSIMONDRANO 7 AXPCT007 SAF FJKM ONG Lot 0910-F-88 Mahafaly Antsirabe110 ANTSIRABE II ANTSIRABE II Lot VS Près 6 G Antsahamamy- 8 AXPCT008 AJIDE Association ANTANANARIVO TANA II Antananarivo Villa Mahatsinjony Maharidaza Carion 116 9 AXPCT009 YMCA CARION Association MANJAKANDRINA MANJAKANDRINA Manjakandriana Lot IIT4F Betongolo, Antananarivo, 10 AXPCT010 ONG EDEN ONG ANTANANARIVO TANA Madagascar lot ii -I 68 Y AMBONILOHA IVANDRY 11 AXPCT011 ASSOCIATION VONJY IV Association ANTANANARIVO ANTANANARIVO ANTANANARIVO I ASSOCIATION Lot II G 32 TR Bis Ambatomaro 12 AXPCT012 Association ANTANANARIVO TANA II NASANDRATRA Antananarivo 13 AXPCT013 ASSOCIATION HERY Association LOT II G 32 TR Bis Ambatomaro ANTANANARIVO -

RAKOTONJOHARY Mamy Andrianiaina SOCIO N°
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ------------------------ FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ------------------------------------------------- DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE -------------------------- Mémoire en DEA Séminaire : Espace financier et développement rural Appui technique et socio-organisationnel des paysans en matière de SRI et SRA : Cas de la Commune Ambohimanga Rova Présenté par : RAKOTONJOHARY Mamy Andrianiaina Encadreur : Mme RAMANDIMBIARISON Noëline, Professeur Juge : M. SOLOFOMIARANA Rapanoël Bruno Allain, Maître de conférences ANNEE UNIVERSITAIRE : 2008 – 2009 Date de soutenance : 29 juin 2009 Appui technique et socio-organisationnel des paysans en matière de SRI et SRA : Cas de la Commune Ambohimanga Rova REMERCIEMENTS Cet ouvrage n’aurait jamais vu le jour sans la clémence du Seigneur et la main forte que nous ont prêtée certaines personnes. - En pareille occurrence : « Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout en moi bénisse Son Saint Nom ! Mon âme, bénis l’Eternel ! Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » Psaumes103 :1-2 - Aussi, notre reconnaissance la plus profonde doit-elle aller : A Mme Noëline RAMANDIMBIARISON, notre encadreur, d’une part, pour son amabilité, ses conseils, ses critiques pour nous avoir beaucoup encouragé à approfondir ce mémoire et d’autre part, pour avoir assuré l’encadrement de ce travail de recherche jusqu’à la fin. - A Monsieur SOLOFOMIARANA Rapanoël Bruno Allain, de bien vouloir accepter de juger ce travail - A tous les enseignants du Département de sociologie qui nous ont formé - A M. l’adjoint au Maire de la Commune d’Ambohimanga pour sa collaboration - AM le directeur de l’OTIV Sabotsy Namehana - A toutes les personnes que nous avons enquêtées, par leur gentillesse et leur chaleureux accueil - Notre sympathie : A nos parents, nos sœurs, notre famille et à nos proches qui ont manifesté leur soutien moral et affectif - Nos pensées : A tous ceux dont les noms ne sont pas cités mais qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce mémoire. -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Cadre Politique De Réinstallation Des Populations (CPRP) Rapport Final
Octobre 2019 Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) Rapport final Accord-cadre pour le soutien des activités des services de conseil de la BEI à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE des 28 LOT 1: ENVIRONNEMENT Etude préparatoire du projet AEP Antananarivo TA 2017151MGIF3 Contrat CC10192 BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT MADAGASCAR ACCORD-CADRE POUR LE SOUTIEN DES ACTIVITES DES SERVICES DE CONSEIL DE LA BEI A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR DE L’UE DES 28 Lot 1 – Environnement TA 2017151MGIF3 Contrat CC10192 Etude préparatoire du projet AEP Antananarivo Cadre Politique de Réinstallation des Populations Rapport final Octobre 2019 Composition de l’équipe: Marie D’ARIFAT – Chef d’équipe Pascal DE GIUDICI – Expert environnemental et social Valérie AUDIBERT – Economiste Tiana RAKOTONDRAINIBE – Expert en aspects sociaux Aline MAGRA – Expert en santé et sécurité au travail Projet mis en œuvre par: ESPELIA & SEURECA « La présente opération d’assistance technique est financée dans le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou. Cet accord prévoit des aides non remboursables pour appuyer l’activité d’investissement que la BEI déploie dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. » « Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu du présent rapport. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’avis de l’Union Européenne ni celui de la Banque Européenne d’Investissement. » Accord-cadre pour le soutien des activités des services de conseil de la BEI à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE des 28 Etude préparatoire -

Pcd Ambohimalaza Miray
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION **** REGION ANALAMANGA **** DISTRICT D’ANTANANARIVO AVARANDRANO **** COMMUNE RURALE AMBOHIMALAZA MIRAY **** PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE LA COMMUNE RURALE D’AMBOHIMALAZA MIRAY 2017-2021 « La culture en tant que levier du développement » Avec le soutien de l’Organisation Gasy Data Consulting Internationale de la Francophonie JANVIER 2017 Table des matières Acronymes ................................................................................................................................ 5 Liste des tableaux .................................................................................................................... 5 Liste des cartes ......................................................................................................................... 6 Liste de figures ......................................................................................................................... 6 Avant-propos ............................................................................................................................ 7 INTRODUCTION .................................................................................................................... 8 I. MONOGRAPHIE ........................................................................................................... 10 I.1. HISTORIQUE ................................................................................................................... 10 I.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DELIMITATION ADMINISTRATIVE -
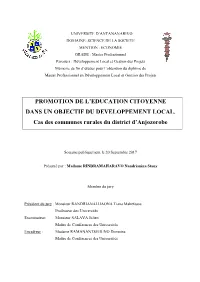
Promotion De L'education Citoyenne Dans Un Objectif
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO DOMAINE: SCIENCE DE LA SOCIETE MENTION : ECONOMIE GRADE : Master Professionnel Parcours : Développement Local et Gestion des Projets Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de Master Professionnel en Développement Local et Gestion des Projets PROMOTION DE L’EDUCATION CITOYENNE DANS UN OBJECTIF DU DEVELOPPEMENT LOCAL. Cas des communes rurales du district d’Anjozorobe Soutenu publiquement le 20 Septembre 2017 Présenté par : Madame RINDRAMAHARAVO Nandrianina Stany Membre du jury Président du jury : Monsieur RANDRIANALIJAONA Tiana Mahefasoa Professeur des Universités Examinateur: Monsieur SALAVA Julien Maître de Conférences des Universités Encadreur : Madame RAMANANTSEHENO Domoina Maître de Conférences des Universités REMERCIEMENTS Grâce à Dieu, ce grand mémoire a pu aboutir à son terme. Tout d’abord, je tiens vivement à adresser mes plus profondes reconnaissances et mes vifs remerciements à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la concrétisation de ce mémoire, et ce, particulièrement à : L’Université d’Antananarivo ; Monsieur RAKOTO David Olivaniaina, Maître de Conférences des Universités, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie ; Monsieur RAMAROMANANA ANDRIAMAHEFAZAFY Fanomezantsoa, Maître de Conférences des Universités, Chef de Département Economie ; Madame RAMANANTSEHENO Domoina, Maître de Conférences des Universités, mon encadreur pédagogique, toute ma profonde gratitude ; Tous les corps Enseignants et Administratifs du Département Economie ; A toute l’équipe de l’ONG Lalana pour l’accueil et les directives. Mes sincères remerciements ; A tous les adhérents, personnes enquêtées et paysans autochtones des communes rurales d’Anjozorobe sans quoi l’étude n’aurait eu lieu. Mes respects ; Enfin, je tiens à présenter toutes mes gratitudes à ma très chère famille et mes amis pour leurs soutiens et leurs encouragements tout au long de mes études. -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -
![Études Océan Indien, 42-43 | 2009, « Plantes Et Sociétés » [En Ligne], Mis En Ligne Le 24 Janvier 2012, Consulté Le 30 Juin 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/1122/%C3%A9tudes-oc%C3%A9an-indien-42-43-2009-%C2%AB-plantes-et-soci%C3%A9t%C3%A9s-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-24-janvier-2012-consult%C3%A9-le-30-juin-2021-1371122.webp)
Études Océan Indien, 42-43 | 2009, « Plantes Et Sociétés » [En Ligne], Mis En Ligne Le 24 Janvier 2012, Consulté Le 30 Juin 2021
Études océan Indien 42-43 | 2009 Plantes et Sociétés Gabriel Lefèvre (dir.) Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/oceanindien/61 DOI : 10.4000/oceanindien.61 ISSN : 2260-7730 Éditeur INALCO Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2009 ISBN : 978-2-85831-180-4 ISSN : 0246-0092 Référence électronique Gabriel Lefèvre (dir.), Études océan Indien, 42-43 | 2009, « Plantes et Sociétés » [En ligne], mis en ligne le 24 janvier 2012, consulté le 30 juin 2021. URL : https://journals.openedition.org/oceanindien/61 ; DOI : https://doi.org/10.4000/oceanindien.61 Ce document a été généré automatiquement le 30 juin 2021. Études océan Indien est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. 1 Le titre du cliché de la couverture aux Archives nationales d’Aix-en-Provence est « Tananarive. Marché du “Zoma” ; l’herboristerie en plein air. 1940 ». Il s’agit d’un cliché – consultable en ligne sur la base Ulysse – de G. Ramiandrisoa qui s’inscrit dans une série d’une quarantaine de photographies données au Ministère de la France d’Outre-Mer en 1946. Pourquoi les auteurs de ce numéro se sont-ils arrêtés à ce tableau si tananarivien ? N’auraient-ils pas pu s’accommoder d’autres clichés plus anciens ? Celui-ci a en effet quelque chose de contemporain, voire d’actuel, quand on sait la fascination qu’exercent médecine traditionnelle ou phytopraticiens. Cette « herboristerie » est à la croisée de deux mondes, ceux que P. Boiteau évoque en 1942, lors d’une exposition consacrée aux plantes médicinales, à Tsimbazaza. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005.