Scolarisations Lazaristes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
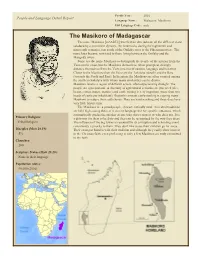
Expanded PDF Profile
Profile Year: 2001 People and Language Detail Report Language Name: Malagasy, Masikoro ISO Language Code: msh The Masikoro of Madagascar The name Masikoro [mASikUr] was first used to indicate all the different clans subdued by a prominent dynasty, the Andrevola, during the eighteenth and nineteenth centuries, just south of the Onilahy river to the Fiherenana river. The name later became restricted to those living between the Onilahy and the Mangoky rivers. Some use the name Masikoro to distinguish the people of the interior from the Vezo on the coast, but the Masikoro themselves, when prompted, strongly distance themselves from the Vezo in terms of custom, language and behavior. Closer to the Masikoro than the Vezo are the Tañalaña (South) and the Bara (towards the North and East). In literature the Masikoro are often counted among the southern Sakalava with whom many similarities can be drawn. Masikoro land is a region of difficult access, often experiencing drought. The people are agro-pastoral. A diversity of agricultural activities are practiced (rice, beans, cotton, maize, manioc) and cattle raising is very important (more than two heads of cattle per inhabitant). Recently rampant cattle-rustling is causing many Masikoro to reduce their cattle herds. They are hard-working and these days have very little leisure time. The Masikoro are a proud people, characteristically rural. Ancestral traditions are held high among them as is correct language use for specific situations, which automatically grades the speaker as one who shows respect or who does not. It is Primary Religion: a dishonor for them to be dirty and they can be recognized by the way they dress. -

Résultats Détaillés Toliary
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de juin 2014 (2014-D16) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Conditions éco-météorologiques : page 1 Situation acridienne : page 2 Situation antiacridienne : page 6 Annexes : page 10 CONDITIONS CONDITIONS ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUES ECO-METEOROLOGIQUES DURANT DURANT LA LA PREMIÈRE DEUXIEME DÉCADE DECADE DEDE JUIN JANVIER 2014 2014 Durant la 1ère décade, la pluviosité était nulle à très faible et donc hyper-déficitaire par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache dans toute la Grande-Île (figure 1). Les relevés (CNA) effectués dans l’Aire grégarigène montraient cependant que la plage optimale pluviométrique (annexe 1) était atteinte dans certaines localités des compartiments Centre et Sud de l’Aire de densation (11,5 mm à Efoetse, 38,0 mm à Beloha et 28,0 mm à Lavanono). Dans les zones à faible pluviosité, à l’exception de l’Aire d’invasion Est, les réserves hydriques des sols devenaient de plus en plus difficilement utilisables, le point de flétrissement permanent pouvant être atteint dans les biotopes les plus arides. Les strates herbeuses dans les différentes régions naturelles se desséchaient rapidement. En général, la hauteur des strates herbeuses variait de 10 à 80 cm selon les régions naturelles, les biotopes et les espèces graminéennes. Le taux de verdissement variait de 20 à 40 % dans l’Aire grégarigène et de 30 à 50 % dans l’Aire d’invasion. Les biotopes favorables au développement des acridiens se limitaient progressivement aux bas-fonds. Dans l’Aire grégarigène, le vent était de secteur Est tandis que, dans l’Aire d’invasion, les vents dominants soufflaient du Sud-Est vers le Nord- Ouest. -

Evaluation Des Impacts Du Cyclone Haruna Sur Les Moyens De Subsistance
1 EVALUATION DES IMPACTS DU CYCLONE HARUNA SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE, ET SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA VULNERABILITE DES POPULATONS AFFECTEES commune rurale de Sokobory, Tuléar Tuléar I Photo crédit : ACF Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance Avril 2013 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES CARTES..................................................................................................................................... 3 LISTE DES GRAPHIQUES ..................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 ACRONYMES ............................................................................................................................................................ 5 RESUME ........................................................................................................................................................ 6 1. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 8 2. OBJECTIFS ET METHODES ............................................................................................................. 11 2.1 OBJECTIFS ........................................................................................................................................... 11 2.2 METHODOLOGIE -
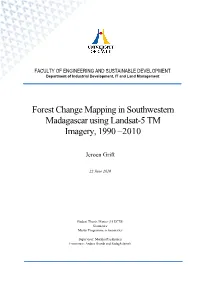
Forest Change Mapping in Southwestern Madagascar Using Landsat-5 TM Imagery, 1990 –2010
FACULTY OF ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Department of Industrial Development, IT and Land Management Forest Change Mapping in Southwestern Madagascar using Landsat-5 TM Imagery, 1990 –2010 Jeroen Grift 22 June 2016 Student Thesis, Master (15 ECTS) Geomatics Master Programme in Geomatics Supervisor: Markku Pyykkönen Examiners: Anders Brandt and Sadegh Jamali Abstract The main goal of this study was to map and measure forest change in the southwestern part of Madagascar near the city of Toliara in the period 1990-2010. Recent studies show that forest change in Madagascar on a regional scale does not only deal with forest loss, but also with forest growth However, it is unclear how the study area is dealing with these patterns. In order to select the right classification method, pixel-based classification was compared with object-based classification. The results of this study shows that the object-based classification method was the most suitable method for this landscape. However, the pixel-based approaches also resulted in accurate results. Furthermore, the study shows that in the period 1990–2010, 42% of the forest cover disappeared and was converted into bare soil and savannahs. Next to the change in forest, stable forest regions were fragmented. This has negative effects on the amount of suitable habitats for Malagasy fauna. Finally, the scaling structure in landscape patches was investigated. The study shows that the patch size distribution has long-tail properties and that these properties do not change in periods of deforestation. Keywords: Deforestation, pixel-based classification, object-based classification, landscape metrics, scaling structure II Table of Contents Abstract ................................................................................................................................................. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

EITI-Madagascar
Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar EITI-Madagascar Rapport de réconciliation 2018 Annexes Version finale Novembre 2019 Confidentiel – Tous droits réservés - Ernst & Young Madagascar Rapport final | 1 Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar Sommaire ANNEXES .......................................................................................................................................................... 3 Annexe 1 : Points de décision en matière de divulgation de la propriété réelle ........................................ 4 Annexe 2 : Tableau de correspondance entre flux de paiements et entités réceptrices ............................ 9 Annexe 3 : Données brutes pour sélectionner les compagnies ............................................................... 11 Annexe 4 : Identification des sociétés ..................................................................................................... 12 Annexe 5 : Arbres capitalistiques des sociétés ........................................................................................ 26 Annexe 6 : Présentation des flux de paiement ........................................................................................ 31 Annexe 7 : Matérialité des régies et des flux concernés par les taxes et revenus pour 2015 et 2016 (#4.1) 35 Annexe 8 : Cas Mpumalanga – Lettre du Ministre ................................................................................... 36 Annexe 9 : Cas Mpumalanga – Acte de rejet du BCMM ......................................................................... -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin N°16 Juin 2014 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale: page 1 Situation éco-météorologique: page 2 Situation acridienne: page 3 Situation agro-socio-économique: page Situation antiacridienne: page Annexes: page SITUATION GÉNÉRALE En juin 2014, l’installation de la saison sèche et fraîche se confirmait dans l'ensemble du pays. Les strates herbeuses devenaient de plus en plus sèches en raison de l’insuffisance des réserves hydriques des sols des biotopes xérophiles et mésophiles. Dans l'Aire grégarigène, les populations diffuses entamaient leur regroupement dans les biotopes hygrophiles ; l'humidité édaphique permettant le maintien d'une végétation verte. Dans les régions prospectées, le taux de verdissement des strates herbeuses variait de 10 à 40 %. Des essaims de taille petite à moyenne ont été observés dans les compartiments Centre et Nord de l’Aire grégarigène et de l’Aire d’invasion. Des taches et bandes larvaires ont également été observées dans le compartiment Centre de l’Aire grégarigène. Les larves étaient de stade L2 à L5 et de phase transiens à grégaire. Les essaims étaient composés d’ailés immatures grégaires. Cependant, des traitements intenses effectués au cours de ce mois ont permis de diminuer les effectifs des populations acridiennes groupées. Du 1er au 30 juin 2014, 39 866 ha ont été identifiés comme infestés et 38 870 ha ont été traités ou protégés. Le traitement des superficies infestées restantes est programmé pour le mois prochain (annexe 1). Depuis le début de la campagne 2013/2014 et jusqu’au 30 juin 2014, 1 204 660 ha ont été traités ou protégés. -

Bulletin D'information Du Cluster Nutrition Resultats De La Surveillance
© UNICEF/UNI209764/Ralaivita BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS DIX DISTRICTS DU SUD DE MADAGASCAR TROISIEME TRIMESTRE 2020 © UNICEF/UN0280943/Rakotobe BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS HUIT DISTRICTTS DU SUD DE MADAGASCAR | PAGE 2 I. APERÇU DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE Au cours du troisième trimestre 2020, dix districts du sud de Madagascar ont bénéficié des dépistages exhaustifs de la malnutrition aiguë. Cette activité a été mise en œuvre par les services déconcentrés du Gouvernement de Madagascar (Office National de Nutrition et Ministère de la Santé Publique) avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Sur l’ensemble des dix districts, 436.388 enfants ont été dépistés sur un total de 447.178 enfants âgés de 6 à 59 mois attendus (soit 98%). L’analyse des résultats révèle une : • Urgence nutritionnelle dans 13% des communes (26 communes sur 202) • Alerte nutritionnelle dans 14% des communes (29 communes sur 202) • Situation nutritionnelle « sous contrôle » dans 73% des communes (147 communes sur 202) © UNICEF/UNI209771/Ralaivita En 2018 et 2019, les districts de Tuléar 2 et Betroka ne faisaient pas partie des zones couvertes par le Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN). Ainsi, en excluant ces deux districts (afin de rendre la comparaison avec ces périodes possible), les résultats du dépistage du T3 2020 montrent que la situation nutritionnelle dans les communes des huit districts n’a pas vraiment changé par rapport à T3-2019 (14% en Urgence, 15% en Alerte et 71% « sous contrôle » dans 154 communes). Il en est de même par rapport à la situation du T3 2018. -

Analyse Des Limites De La Nouvelle Aire Protegee Pk 32 Ranobe : Contraintes Et Opportunites Pour La Gestion Durable Des Ecosystemes a Haute Valeur De Conservation
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION D’UN DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES EN FORESTERIE, DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT Promotion : HINTSY 2008-2009 ANALYSE DES LIMITES DE LA NOUVELLE AIRE PROTEGEE PK 32 RANOBE : CONTRAINTES ET OPPORTUNITES POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES A HAUTE VALEUR DE CONSERVATION Présenté par : RANDRIANARISON Feno Elisoa Le 11 Mars 2011 Devant les membres de Jury : Président : Professeur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Rapporteur : Docteur RAZAFY FARA Lala Examinateur : Professeur RAMAMONJISOA Bruno Salomon Examinateur : Monsieur RASOLONANDRASANA Bernardin ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION D’UN DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES EN FORESTERIE, DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT Promotion : HINTSY 2008-2009 ANALYSE DES LIMITES DE LA NOUVELLE AIRE PROTEGEE PK 32 RANOBE : CONTRAINTES ET OPPORTUNITES POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES A HAUTE VALEUR DE CONSERVATION Présenté par : RANDRIANARISON Feno Elisoa Le 11 Mars 2011 Devant les membres de Jury : Président : Professeur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Rapporteur : Docteur RAZAFY FARA Lala Examinateur : Professeur RAMAMONJISOA Bruno Salomon Examinateur : Monsieur RASOLONANDRASANA Bernardin Je dédie ce présent mémoire à tous ceux qui ont eu foi en moi Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur Devant les puissances du ciel Je veux te célébrer par mes chants Et m’incline face à ton sanctuaire O ! Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté Car tu as fait plus que tenir promesse Plus que l’on attendait de toi Quand je t’ai appelé, tu m’as répondu Tu m’as remplis de courage et de force Psaume 138-1,3 REMERCIEMENTS Nos remerciements s’adressent en premier lieu à Dieu sans qui rien n’a pu être accompli. -

Stakeholder Engagement
RANOBE MINE PROJECT, SOUTHWEST REGION, MADAGASCAR VOLUME 21: STAKEHOLDER ENGAGEMENT Prepared for: Prepared by: World Titanium Resources Ltd Coastal & Environmental Services 15 Lovegrove Close, P.O. Box 934, Mount Claremont Grahamstown, 6140 Western Australia South Africa 6010 Also in East London January 2013 Stakeholder Engagement – January 2013 COPYRIGHT INFORMATION This document contains intellectual property and propriety information that is protected by copyright in favour of Coastal & Environmental Services and the specialist consultants. The document may therefore not be reproduced, used or distributed to any third party without the prior written consent of Coastal & Environmental Services. This document is prepared exclusively for submission to Toliara Sands Ltd., and is subject to all confidentiality, copyright and trade secrets, rules intellectual property law and practices of Madagascar. Coastal & Environmental Services i Ranobe Mine Project Stakeholder Engagement – January 2013 TABLE OF CONTENTS 1. STAKEHOLDER ENGAGEMENT ACTIVITIES ...................................................................... 1 1.1 Stakeholder Engagement during the Original ESIA ............................................................. 1 1.2 Stakeholder Engagement during the Scoping Phase of the present ESIA .......................... 3 1.3 Stakeholder Engagement during the ESIA Phase of the present ESIA ............................. 78 LIST OF TABLES Table 1.1: Stakeholder Analysis .....................................................................................................