Gestion Des Catastrophes Cycloniques, Région V7V, Hubert 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ecosystem Profile Madagascar and Indian
ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -
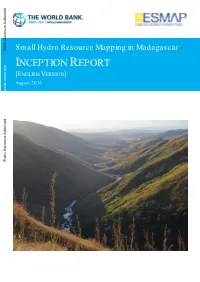
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Le Developpement Economique De La Region Vatovavy Fitovinany
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Année Universitaire : 2006-2007 Faculté de Droit, d’Economie, de Second Cycle – Promotion Sortante Gestion et de Sociologie Option : DEVELOPPEMENT DEPARTEMENT ECONOMIE « Promotion ANDRAINA » Mémoire de fin de Cycle LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION VATOVAVY FITOVINANY Encadré par : Monsieur Gédéon RAJAONSON Présenté par : MANIRISOA RAZAFIMARINTSARA Firmin Date de soutenance : 14 Décembre 2007 REMERCIEMENTS Pour commencer, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ma formation et à la réalisation de ce Grand Mémoire de fin d’études en Economie. J’adresse donc tout particulièrement mes vifs remerciement à : • DIEU TOUT PUISSANT • Mon encadreur Monsieur Gédéon RAJAONSON ; • Tous les enseignants et les Personnels administratifs du Département Economie de la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo ; • Monsieur Le Chef de Région de Vatovavy Fitovinany et ses équipes • Monsieur le Directeur Régional des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany • Ma famille pour leurs soutiens permanents. Veuillez accepter le témoignage de ma profonde gratitude. LISTE DES ABREVIATIONS ANGAP : Agence Nationale de la Gestion des Aires Protégés CEG : Collège d’Enseignement Général CHD 1 : Centre Hospitalier de District Niveau 1 CHD 2 : Centre Hospitalier de District Niveau 2 CISCO : Circonscription Scolaire CSB 1 : Centre de Santé de Base Niveau 1 CSB 2 : Centre de Santé de Base Niveau 2 DRDR : Direction Régionale du Développement Rural EPP : Ecole Primaire Public FCE : Fianarantsoa Côte Est FER : Fonds d’Entretien Routier FTM : Foibe Toantsritanin’i Madagasikara GU : Guichet Unique HIMO : Haute Intensité de Main d’œuvre INSTAT : Institut National de la Statistique M.A.E.P. -
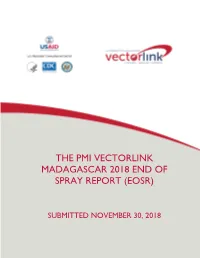
The Pmi Vectorlink Madagascar 2018 End of Spray Report (Eosr)
THE PMI VECTORLINK MADAGASCAR 2018 END OF SPRAY REPORT (EOSR) SUBMITTED NOVEMBER 30, 2018 Recommended Citation: The PMI VectorLink Project. November 2018. PMI VectorLink Madagascar 2018 End of Spray Report. Rockville, MD. The PMI VectorLink Project, Abt Associates Inc. Contract Number: AID-OAA-I-17-00008 Task Order Number: AID-OAA-TO-17-00027 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI The views expressed in this document do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. Abt Associates Inc. | 6130 Executive Boulevard | Rockville, MD 20852 | T. 301.347.5000 | F. 301.913.9061 | www.abtassociates.com THE PMI VECTORLINK MADAGASCAR 2018 END OF SPRAY REPORT (EOSR) Contents Acronyms…. ................................................................................................................................viii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction .......................................................................................................................... 11 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................................................. 11 1.2 2018 Campaign Objectives ............................................................................................................................. 12 2. Pre-Spray Activities ............................................................................................................ -
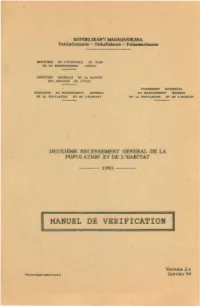
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Actions Eau Et Assainissement De La Coopération Décentralisée Et Non Gouvernementale Franco-Malgache À Madagascar
Madagascar s’est engagé à la fois dans un processus de décentralisation et un vaste programme d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Dans ce contexte en pleine évolution, les collectivités territoriales et associations notamment françaises sont de plus en plus nombreuses à développer des coopérations sur le thème de l’eau et de l’assainissement. Le CITE et pS-Eau, avec l’appui du Gret, ont initié le réseau Ran’Eau pour échanger et capitaliser expériences et problématiques entre l’ensemble des acteurs présents à Madagascar que ce soit les collectivités territoriales, les associations et ONG, les entreprises privées et les acteurs institutionnels. L’équipe de Ran’Eau a décidé de faire partager des expériences et initiatives concrètes menées aussi bien dans des localités urbaines que rurales sous la forme de ce recueil de fiches. Sont ainsi présentés divers modes de gestion de l’eau potable, des réhabilitations de réseaux, des réalisations de fosses septiques et autres équipements d’assainissement, divers mécanismes de développement durable d’adduction d’eau, des opérations d’hydraulique villageoise, etc. Toutes ces actions, aux résultats positifs ou parfois en Actions Eau demi-teinte, sont importantes à faire connaître aux futurs maîtres d’œuvre et d’ouvrage, pour qu’ils conçoivent et réalisent des opérations durables, bénéficiant au plus grand nombre. Chaque fiche est illustrée et présente en quelques pages le descriptif de l’action, ses objectifs et le contexte ainsi que et Assainissement les perspectives. Le recueil est évolutif -

Les Jumeaux De Mananjary
LesLes jumeauxjumeaux dede Mananjary Mananjary entre abandon et protection Gracy Fernandes Ignace Rakoto Nelly Ranaivo Rabetokotany 2010 Gracy Fernandes Ignace Rakoto Nelly Ranaivo Rabetokotany LesLes jumeauxjumeaux dede Mananjary Mananjary entre abandon et protection avec les photographies de Pierrot Men Gracy Fernandes Ignace Rakoto Nelly Ranaivo Rabetokotany LesLes jumeauxjumeaux dede Mananjary Mananjary entre abandon et protection avec les photographies de Pierrot Men 2010 Sommaire Avant-propos 5 Introduction 7 1. L’enfant et la famille 9 2. La gémellité, du symbole au tabou 13 3. Le tabou sur les jumeaux et la population antambahoaka 22 4. Les origines mythiques du tabou sur les jumeaux 26 5. Les valeurs ancestrales et la précarité économique au détriment des jumeaux 33 6. Rom-boay, la fausse situation consensuelle de l’interdit sur les jumeaux 36 7. Un aperçu statistique sur les jumeaux 40 8. Les centres d’accueil, une solution provisoire à l’abandon des jumeaux 44 9. Les violations des droits humains à l’endroit des enfants jumeaux 47 10. Les facteurs de protection des enfants jumeaux contre les pressions familiale et communautaire 51 11. Un plan d’actions prioritaires pour une levée progressive de l’interdit sur les jumeaux 55 12. Une prudente stratégie de communication 59 13. Fanivelona, un cas d’école 67 Glossaire 74 Indications bibliographiques 76 Annexes 78 Avant-propos L’étude du tabou sur les jumeaux a été menée pour comprendre le maintien jusqu’à nos jours d’une coutume ancestrale dans la communauté antambahoaka de la région de Mananjary – Madagascar. Plusieurs nuances sur les comportements des différents acteurs du tabou ont été identifiées à travers les témoignages recueillis auprès des jumeaux, enfants-adolescents-adultes, des familles biologiques et des personnes œuvrant à la protection des jumeaux. -

SISAV 27 Finalpub Vu Joh.Pub
Bulletin SISAV Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité dans les Régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Androy et Anosy (Amboasary Atsimo) Bulletin SISAV n°27 L’essentiel Période couverte: La période couverte correspond à la mise en place des cultures de grande saison pour les Régions Décembre 2016 couvertes. Sur le plan météorologique, les prévisions de retard de la saison des pluies ont été Janvier 2017 confirmées, et il a été constaté une faiblesse des précipitations par rapport à la normale. Cela a perturbé la saison agricole et plus particulièrement le début de la période de mise en culture. Malgré le retard des pluies, les spéculations profitent de bonnes conditions météorologiques (retour de Zone de couverture la pluie, atténuation des vents forts) dans le sud au cours des mois de décembre et janvier derniers et on a observé une augmentation des superficies emblavées. Si les perspectives de récoltes sont bonnes actuellement pour l’ensemble du Sud, les difficultés alimentaires y sont toujours d’actualité et la période de soudure s’intensifie. Le niveau de vulnérabilité des Communes a connu une baisse grâce aux conditions des cultures au cours de la période d’observation et aux bonnes perspectives de récoltes ainsi qu’aux activités d’urgences qui y sont entreprises actuellement. Cela a aurait entre autres contribué à inverser la tendance dans le District d’Amboasary Atsimo, mais les actions devraient être renforcées afin de maintenir la tendance actuelle. Pour les Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana, les conditions climatiques ne sont pas aussi bonnes pour l’agriculture. -

LOI N° 2021-012 Modifiant L'annexe N° 01 De La Loi N° 2014-020 Du 27
LOI n° 2021-012 modifiant l’annexe n° 01 de la Loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014, modifiée et complétée par la Loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes EXPOSE DES MOTIFS La présente loi apporte une modification à l’annexe de la Loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 en vue de la mise en place d’une vingt troisième Région dans la partie sud est de Madagascar par l’éclatement de l’actuelle Région Vatovavy Fitovinany. A cet effet, et dans le respect des dispositions de l’article 8 de la Loi organique n° 2014-018 d u 12 septembre 2014 qui dispose que « la création et la délimitation des Collectivités Territoriales Décentralisées doivent répondre à des critères d'homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle » : – la Région de Vatovavy est composé des Districts de Mananjary, Nosy Varika et Ifanadiana, – la Région Fitovinany est composé des Districts de Manakara, Ikongo et Vohipeno, – la Commune de Namorona du District de Mananjary sera rattachée au District de Manakara toujours dans ce souci du respect du principe de l’homogénéité géographique et culturelle citée ci-dessus. Dans tous les cas, le rattachement géographique des autres communes reste inchangé. Il en est de même des Fokontany. Tel est l’objet de la présente loi. 1 LOI n° 2021-012 modifiant l’annexe n° 01 de la Loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014, modifiée et complétée par la Loi n° 2018-011 -

Transfert De Subvention Par FDL Aux Communes : Réalisation 2017 Et Prévision 2018
2018 Transfert de subvention par FDL aux communes : Réalisation 2017 et prévision 2018 Fonds de Développement Local Rue, Pierre Stibbe Anosy Antananarivo. e-mail: [email protected] Tel: 0 34 05 522 75 Tel: 0 33 37 690 99 www.fdl.mg Page 1 23/04/2018 Sommaire RECAPITULATION DES TRANSFERTS ......................................................................................................................................................................................... 3 Récapitulation des transferts réalisation 2017 et prévision 2018 ...................................................................................................................................................... 4 REALISATION DE TRANSFERT DE SUBVENTION DES COMMUNES POUR 2017 ..................................................................................................................... 5 Ressource Propre Interne (RPI)......................................................................................................................................................................................................... 6 Fonds National de Péréquation (FNP) ............................................................................................................................................................................................ 8 Programme de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (PDCID) : Phase d'études : Conventions, APS, APD, Appels d'offres .................... 9 Projet d'Appui à la Réforme de la Sécurisation Foncière (ARSF) ................................................................................................................................................ -

Programme De Coopération Décentralisée Entre Le Finistère Et La
Grande Comore COMORES Iles Glorieuses Cap d'Ambre Moroni (France) (Tanjona Bobaomby) Anjouan Antsiranana (Diégo-Suarez) Mohéli Ambohitra Ambolobozokely Grande Comore 1475 COMORES Iles Glorieuses Cap d'Ambre Moroni (France) (Tanjona Bobaomby) Anjouan Antsiranana (Diégo-Suarez) Mohéli Ambohitra Ambolobozokely Bobasakoa 1475 Anivorano Avaratra Bobasakoa Anivorano Avaratra Ile Mitsio ANTSIRANANA Antsohimbondrona Mayotte (France) Daraina Nosy Be Ambilobe Betsiaka M a Andoany (Hell-Ville) h Aharana a v a (Vohemar) v Ile Mitsio y Fanambana Ambanja Antsaba 1785 du assif Marovato M Antsirabe Avaratra emarivo Maromokotro 2876 B Maromandia Amboahangibe Sambava 2262 ANTSIRANANA 2133 e Ile Lava Bealanana Marojezy M Analalava aev o u aran Andapa Antsambalahy q Antsahabe Antsohihy Matsoandakana Antsohimbondrona i 1438 Antalaha Baie de Maromandia b la Mahajamba Antsakabary Befandriana Ambohitralanana Mahajanga Mariarano Boriziny Avaratra Maroantsetra Cap Est m B (Port-Bergé) Sofia a (Tanjona i e 1105 d Angonsty) (Majunga) Rantabe ' Daraina A a Mayotte (France) n Tsinjomitondraka t Katsepy a o n Vinanivao n Marovato Mandritsara g i Ambilobe z i l Cap Masoala M Mitsinjo Mampikony an Cap St-André Soalala o B an Manambololosy (Tanjona Masoala) Betsiaka e ara m o (Tanjona Vilanandro) Marovoay B a Marotandrano Nosy Be Lac Kinkony riv Mananara Avaratra o g o Tsaramandroso Ile Chesterfield Ankasakasa n Ambinda o Madirovalo Sandrakatsy b Atanambre M M Ambato Boeny m Miarinarivo A Bekapaika 1301 Andranomavo Ambodiatafana Besalampy Sitampiky MAHAJANGA M Tsararanana