La Musique De Pierre Mercure À L'affiche De Spectacles De Danse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Opening Remarks
Opening Remarks Lawrence Adams was Amy Bowring’s revered mentor; his example has guided and encouraged her to tackle, with determination and purpose, assorted pursuits in dance. As Research Co-ordinator at Dance Collection Danse, Amy has been working with the organization, on contract, for five years. Many of you may know Amy through some of the projects in which she has been involved, and also as founder of the Society for Canadian Dance Studies which can boast a solid and active membership under her direction. First introduced to Dance Collection Danse in 1993 as a student undertaking research through York University’s dance programme, Amy’s passion for dance history triggered her interest in becoming seriously involved with DCD. After completing her BA in Fine Arts, Amy earned an MA in journalism from the University of Western Ontario. She is copy editor for The Dance Current magazine, has written various dance articles and encyclo- pedia entries, and is researching and writing a book on the 1948-1954 Canadian Ballet Festival phenomenon. And, to add more ingredients to the mix, she is a whiz at the computer! As Dance Collection Danse undergoes its planning process for upcoming and future activities, you can expect to see Amy’s involvement with DCD increase. To work with someone who is dedicated and skilled is a blessing, but to have someone on board who is also mindful and gracious is the best. The Editoral Committee and Board of Directors of Dance Collection Danse have dedicated this issue to Lawrence Adams, whose contribution to Canadian dance makes him deserving of .. -

Interiors by Coleman Lemieux & Compagnie
INTERIORS by Coleman Lemieux & Compagnie An NAC co-production STUDY GUIDE National Arts Centre, Dance 2008–2009 Season Cathy Levy Producer, Dance Programming This study guide was prepared by Coleman Lemieux & Compagnie, DanceWorks education consultant Laurence Siegel and NAC Outreach Coordinator Renata Soutter for the National Arts Centre Dance Department, October 2008. This document may be used for educational purposes only. INTERIORS STUDY GUIDE TABLE OF CONTENTS About the NAC ……………………………………………… 1 Dance at the NAC ……………………………………………... 2 Theatre Etiquette ………………………………………….…. 3 Interiors Artistic Team and Synopsis .……………………. 4 What students can expect ………………………………..…… 5 About the Company …………………………………….. 7 About the Artistic Directors …………………….………………. 8 About the Dancers …………………………………….. 9 An interview with Laurence Lemieux …………………….. 10 Appreciating Contemporary Dance …………………….. 12 How to watch a performance ……….………….… 13 Pre- and post-performance activities ……………….……. 14 Bibliography/internet sites of interest …………………..… 18 1 Canada’s National Arts Centre Officially opened on June 2, 1969, the National Arts Centre was one of the key institutions created by Prime Minister Lester B. Pearson as the principal centennial project of the federal government. Built in the shape of a hexagon, the design became the architectural leitmotif for Canada's premier performing arts centre. Situated in the heart of the nation's capital across Confederation Square from Parliament Hill, the National Arts Centre is among the largest performing arts complexes in Canada. It is unique as the only multidisciplinary, bilingual performing arts centre in North America and features one of the largest stages on the continent. Designed by Fred Lebensold (ARCOP Design), one of North America's foremost theatre designers, the building was widely praised as a twentieth century architectural landmark. -

GGPAA Gala Program 2015 English
NatioNal arts CeNtre, ottawa, May 30, 2015 The arts engage and inspire us A nation’s ovation. We didn’t invest a lifetime perfecting our craft. Or spend countless hours on the road between performances. But as a proud presenting sponsor of the Governor General’s Performing Arts Awards, we did put our energy into recognizing outstanding Canadian artists who enrich the fabric of our culture. When the energy you invest in life meets the energy we fuel it with, Arts Nation happens. ’ work a O r i Explore the laureates’’ work at iTunes.com/GGPAA The Governor General’s Performing Arts Awards The Governor General’s Performing Arts Recipients of the National arts Centre award , Awards are Canada’s most prestigious honour which recognizes work of an extraordinary in the performing arts. Created in 1992 by the nature in the previous performance year, are late Right Honourable Ramon John Hnatyshyn selected by a committee of senior programmer s (1934–2002), then Governor General of from the National Arts Centre (NAC). This Canada, and his wife Gerda, the Awards are Award comprises a commemorative medallion, the ultimate recognition from Canadians for a $25,000 cash prize provided by the NAC, and Canadians whose accomplishments have a commissioned work created by Canadian inspired and enriched the cultural life of ceramic artist Paula Murray. our country. All commemorative medallions are generously Laureates of the lifetime artistic achievement donated by the Royal Canadian Mint . award are selected from the fields of classical The Awards also feature a unique Mentorship music, dance, film, popular music, radio and Program designed to benefit a talented mid- television broadcasting, and theatre. -

20 Years of Inspiration
20 years of inspiration The arts engage and inspire us 20 years of inspiration National Arts Centre | Ottawa | May 5, 2012 20 years of inspiration Welcome to the 20th anniversary Governor General’s In 2007 the National Film Board of Canada (NFB) Performing Arts Awards Gala! joined the Awards Foundation as a creative partner, and agreed to produce a short film about each Award The Governor General’s Performing Arts Awards recipient (beginning with the 2008 laureates). After (GGPAA) were created in 1992 under the patronage of the late Right Honourable Ramon John Hnatyshyn premiering at the GGPAA Gala, these original and (1934–2002), 24th Governor General of Canada, engaging films are made available to all Canadians and his wife Gerda. on the Web and in a variety of digital formats. The idea for the GGPAA goes back to the late 2008 marked the launch of the GGPAA Mentorship 1980s and a discussion between Peter Herrndorf Program, a unique partnership between the Awards (now President and CEO of the National Arts Centre) Foundation and the National Arts Centre that pairs and entertainment industry executive Brian Robertson, a past award recipient with a talented artist in both of whom were involved at the time with the mid-career. (See page 34.) Toronto Arts Awards Foundation. When they “The Governor General’s Performing Arts Awards approached Governor General Hnatyshyn with are the highest tribute we can offer Canadian artists,” their proposal for a national performing arts awards said Judith LaRocque, former Deputy Minister of program, they received his enthusiastic support. Canadian Heritage and former Secretary to the “He became a tremendous fan of the artists receiving Governor General, in an interview on the occasion the awards each year, the perfect cheerleader in the of the 15th anniversary of the Awards. -

Françoise Sullivan, Pionnière De La Danse Moderne Au
FACULTÉ DES LETTRES MÉMOIRE Ai PRÉSENTÉ 5300 A L'ÉCOLE DES GRADUÉS UL- DE L'UNIVERSITÉ LAVAL |0gg POUR L’OBTENTION DU GRADE DE MAÎTRE ÈS ARTS (M.A.) PAR SYLVIE GAUVIN BACHELIÈRE ÈS ARTS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL FRANÇOISE SULLIVAN, PIONNIÈRE DE LA DANSE MODERNE AU QUÉBEC NOVEMBRE 1988 © Droits réservés de Sylvie Gauvin. RÉSUMÉ Lorsque l'on parle du mouvement automatiste, on pense surtout aux moyens d'expression artistique reliés à la peinture et à la littérature. La danse trop long temps oubliée par les historiens, tint pourtant une place importante dans l'univers automatiste. Françoise Sullivan, Françoise Riopelle et Jeanne Renaud, toutes trois si gnataires du Refus global, sont les noms que l'on associe à la danse dite automatiste. Ce mémoire traite de l'activité d'une de ces trois danseuses, Françoise Sul livan, qui fut l'une des pionnières de la danse moderne du Québec. Nous avons tenté de brosser un tableau de l'activité artistique, dans le do maine de la danse, de Françoise Sullivan entre 1940 et 1950. Cette reconstitution est fondée sur les témoignages recueillis auprès de Françoise Sullivan elle-même ainsi que sur ceux de Jeanne Renaud et de jeunes dan seurs qui ont interprété les oeuvres présentes et passées de l'artiste. Notre travail se divise en deux parties. La première traite du mouvement automatiste, et la deuxième de l'activité chorégraphique de Françoise Sullivan pen dant la période qui fait l'objet de notre étude. REMERCIEMENTS La rédaction de ce mémoire a été rendue possible grâce à l'appui et aux con seils de plusieurs personnes. -
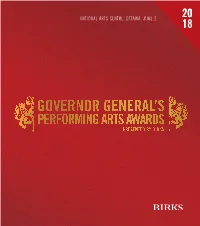
2018 Gala Program
NATIONAL ARTS CENTRE, OTTAWA, JUNE 2 THE ARTS ENGAGE AND INSPIRE US Congratulations to the Governor General’s Performing Arts Awards laureates Birks has been helping Canadians celebrate special moments since 1879. We are delighted to be the presenting sponsor of the Governor General’s Performing Arts Awards, which recognize the contributions of our nation’s top talent who enrich both our country and our lives. Bravo to all the laureates, both past and present! BIRKS_GGPAA_Program_Ad_Petale_15x8.5_V06_EN-FR.indd 1 2018-03-29 5:10 PM Congratulations to the Governor General’s Performing Arts Awards laureates Birks has been helping Canadians celebrate special moments since 1879. We are delighted to be the presenting sponsor of the Governor General’s Performing Arts Awards, which recognize the contributions of our nation’s top talent who enrich both our country and our lives. Bravo to all the laureates, both past and present! BIRKS_GGPAA_Program_Ad_Petale_15x8.5_V06_EN-FR.indd 1 2018-03-29 5:10 PM THE GOVERNOR GENERAL’S PERFORMING ARTS AWARDS The Governor General’s Performing Arts Awards the performing arts in Canada, receive are Canada’s most prestigious honour in the a commemorative medallion and a performing arts. In 1992, Peter Herrndorf and commissioned glass sculpture created by Brian Robertson approached then-Governor Canadian artist Naoko Takenouchi. General Ramon John Hnatyshyn (1934–2002) and his wife, Gerda, with their vision for the Recipients of the National Arts Centre Award, Awards. Since that time, the Awards have which recognizes work of an extraordinary established themselves as the ultimate nature in the previous performance year, recognition from Canadians for Canadians are selected by a committee of senior whose accomplishments have inspired and programmers from the National Arts Centre enriched the cultural life of our country. -

National Arts Centre, Ottawa, April 27 Centre National Des Arts, Ottawa, 27 Avril 27 Ottawa, Arts, Des National Centre
NATIONAL ARTS CENTRE, OTTAWA, APRIL 27 CENTRE NATIONAL DES ARTS, OTTAWA, 27 AVRIL 27 OTTAWA, ARTS, DES NATIONAL CENTRE THE ARTS ENGAGE AND INSPIRE US PREMIUM SERVICE THAT STRIKES A CHORD At Air Canada, we strive to perform at the highest level in everything we do. That’s why we’ve put so much care into our premium products and services. Book Air Canada Signature Class to enjoy a range of enhanced amenities and exclusive onboard products. Settle into a fully lie-fl at seat, while savouring a delicious meal by chef David Hawksworth and premium wine selection by sommelier Véronique Rivest. Air Canada Signature Service is available on select fl ights aboard our Boeing 787, 777 and 767 aircraft and our Airbus A330 aircraft. Learn more at aircanada.ca/signatureservice Air Canada is proud to be the Presenting Sponsor of the 2019 Governor General’s Performing Arts Awards and to recognize the outstanding Canadian talent contributing to culture in Canada and abroad. PREMIUM SERVICE THAT STRIKES A CHORD At Air Canada, we strive to perform at the highest level in everything we do. That’s why we’ve put so much care into our premium products and services. Book Air Canada Signature Class to enjoy a range of enhanced amenities and exclusive onboard products. Settle into a fully lie-fl at seat, while savouring a delicious meal by chef David Hawksworth and premium wine selection by sommelier Véronique Rivest. Air Canada Signature Service is available on select fl ights aboard our Boeing 787, 777 and 767 aircraft and our Airbus A330 aircraft. -

2011 Gala Program
2011 GOVERNOR GENERAL’S PERFORMING ARTS AWARDS GALA The arts engage and inspire us 2011 GOVERNOR GENERAL’S PERFORMING ARTS AWARDS GALA Presented by National Arts Centre Ottawa May 14, 2011 The Governor General’s Performing Arts Awards The Governor General’s Performing Arts Awards are Recipients of the National Arts Centre (NAC) Award, Canada’s most prestigious honour in the performing arts. which recognizes work of an extraordinary nature in the Created in 1992 by the late Right Honourable Ramon John previous performance year, are selected by a committee Hnatyshyn (1934–2002), then Governor General of Canada, of senior NAC programmers. This Award comprises a and his wife Gerda, the Awards are the ultimate recognition $25,000 cash prize provided by the NAC, a commissioned from Canadians for Canadians whose accomplishments work created by Canadian ceramic artist Paula Murray and have inspired and enriched the cultural life of our country. a commemorative medallion. Laureates of the Lifetime Artistic Achievement Award are All commemorative medallions are generously donated selected from the fields of broadcasting, classical music, by the Royal Canadian Mint. dance, film, popular music and theatre. Nominations for this Award and the Ramon John Hnatyshyn Award for The Awards also feature a unique Mentorship Program Voluntarism in the Performing Arts are open to the public designed to benefit a talented mid-career artist. and solicited from across the country. All nominations The Program brings together a past Lifetime Artistic are reviewed by juries of professionals in each discipline; Achievement Award recipient with a next-generation each jury submits a short list to the Board of Directors artist, helping them to develop their work, explore 2 of the Governor General’s Performing Arts Awards ideas and navigate career options. -

History of the Company
I am trying to develop dance that is anchored in everyday life, without losing its poetry. I want to concentrate on what is at the very heart of life in our society. HISTORY OF THE COMPANY “Since dance has such great evocative and expressive power, creating a new work always requires much reflection and a thorough development of ideas. As a form of expression, dance may have a long history—yet each performance is necessarily of the moment. It follows that dance must be constantly renewed. To meet this challenge, I enter into a dialogue with the body. The more it speaks to me, the more I understand the full scope of what it has to say. This is how a vocabulary of movement can be developed, and it is precisely what I love most about choreography: being able to develop a language that allows me to investigate the body and reveal some of its deepest secrets.” Sylvain Émard Sylvain Émard first distinguished himself as a dancer working with renowned choreographers such as Jean- Pierre Perreault, Jo Lechay, Jeanne Renaud, Louise Bédard and Daniel Léveillé before he formed his own company in 1990. Here his signature style soon emerged. Émard is recognized for his complex and refined choreographic vocabulary. His approach draws on the kinaesthetic power of dance by highlighting the inherent intelligence of the body. His repertoire now includes over thirty original pieces that have had a resounding impact all over the world. Since its foundation, Sylvain Émard Danse has continually evolved. During its first years, artistic director and choreographer Sylvain Émard created mainly solo works such as Ozone, Ozone (1987) and L’Imposture des sens (1988). -

1975-76-Annual-Report.Pdf
19th Annual Report The Canada Council 1975-1976 Honorable Hugh Faulkner Secretary of State of Canada Ottawa, Canada Sir, I have the honor to transmit herewith the Annual Report of the Canada Council, for submission to Parliament, as required by section 23 of the Canada Council Act (5-6 Elizabeth 11, 1957, Chap. 3) for the fiscal year ending March 31, 1976. I am, Sir, Yours very truly, Gertrude M. Laing, O.C ., Chairman June 1,1976 The Canada Council is a corporation created by an Act of This report is produced and distributed by Parliament in 1957 "to foster and promote the study and Information Services, enjoyment of, and the production of works in, the arts, The Canada Council, humanities and the social sciences." It offers a broad 151 Sparks Street, range of grants and provides certain services to individuals Ottawa, Ontario and organizations in these and related fields. It is also re- sponsible for maintaining the Canadian Commission for Postal address: Unesco. Box 1047, Ottawa, Ontario K1 P 5V8 The Council sets its own policies and makes its own deci- Telephone: sions within the terms of the Canada Council Act. It re- (613) 237-3400 ports to Parliament through the Secretary of State and appears before the Standing Committee on Broadcasting, Films and Assistance to the Arts. The Canada Council itself consists of a Chairman, a Vice- Chairman, and 19 other members, all of whom are ap- pointed by the Government of Canada. They meet four or five times a year, usually in Ottawa where the Council of- fices are located. -

Proquest Dissertations
THE STATE OF CANADIAN DANCE AND DANCING WITH THE STATE FROM 1967-1983 By Katherine Cornell, B.A., M.A. Toronto, Ontario, Canada, 2008 A dissertation presented to Ryerson University/York University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in the Program of Communication and Culture Toronto, Ontario, Canada, 2008 ©Katherine Cornell, 2008 Library and Bibliotheque et 1*1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-40489-8 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-40489-8 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Plntemet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

Rapport Annuel 2019-2020
RAPPORT ANNUEL 2019-2020 SOMMAIRE TABLE OF CONTENTS LES GRANDS BALLETS 4 LES GRANDS BALLETS MOT DU PRÉSIDENT 6 MESSAGE FROM THE PRESIDENT HISTORIQUE DES GRANDS BALLETS 8 HISTORY OF LES GRANDS BALLETS 2019-2020 EN UN COUP D'ŒIL 12 2019-2020 AT A GLANCE UN RETOUR SUR LA SAISON 16 A LOOK BACK AT THE SEASON LA COMPAGNIE DURANT LA PANDÉMIE 18 THE COMPANY DURING THE PANDEMIC TOURNÉES ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL 21 TOURS AND INTERNATIONAL IMPACT MUSIQUE ET CHANT 22 MUSIC AND SONG LA FAMILLE CASSE-NOISETTE 26 THE NUTCRACKER FAMILY CENTRE NATIONAL DE DANSE-THÉRAPIE 28 NATIONAL CENTRE FOR DANCE THERAPY LES STUDIOS 30 GALA ANNUEL 34 ANNUAL GALA LES JEUNES GOUVERNEURS 35 THE JEUNES GOUVERNEURS COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES 36 SPONSORS AND PARTNERS REMERCIEMENTS 37 SPECIAL THANKS Photo: Melika Dez • Danseuse/Dancer: Myriam Simon DANSEURS 43 DANCERS 3 LES GRANDS BALLETS Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets Canadiens sont une compagnie de création et de production internationale qui se consacre au développement de la danse sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la discipline du ballet classique. Les danseuses et danseurs des Grands Ballets, sous la direction artistique d’Ivan Cavallari, interprètent des chorégraphies de créateurs de référence et d’avant-garde. Établis au cœur du Quartier des spectacles à Montréal, Les Grands Ballets proposent des activités de loisirs avec ses STUDIOS et soutiennent le Centre national de danse-thérapie qui fait la promotion de tous les bienfaits que procure la danse. La vocation de la compagnie est également d’assurer un accès à l’art pour tous et c’est en ce sens qu’elle dote, entre autres, le Fonds Casse-Noisette qui permet à des milliers d'enfants d'être initiés au ballet chaque année.