Archives Orales Des Acteurs De La Justice Du Xxe Siècle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
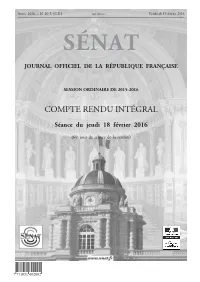
Compte Rendu Intégral
o Année 2016. – N 20 S. (C.R.) ISSN 0755-544X Vendredi 19 février 2016 SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 COMPTE RENDU INTÉGRAL Séance du jeudi 18 février 2016 (69e jour de séance de la session) 7 771051 602002 3046 SÉNAT – SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2016 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE MME FRANÇOISE CARTRON M. Guillaume Arnell Secrétaires : M. Alain Houpert MM. Serge Larcher, Jean-Pierre Leleux. 1. Procès-verbal (p. 3051) M. Christian Eckert, secrétaire d'État 2. Convention fiscale avec Singapour. – Adoption définitive Clôture de la discussion générale. d’un projet de loi dans le texte de la commission (p. 3051) Adoption définitive de l’article unique du projet de loi dans Discussion générale : le texte de la commission. M. Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre des Suspension et reprise de la séance (p. 3066) finances et des comptes publics, chargé du budget M. Éric Doligé, rapporteur de la commission des finances PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DEBRÉ Mme Nathalie Goulet M. Éric Bocquet 6. Communication d’avis sur deux projets de nomination (p. 3067) M. Richard Yung M. André Gattolin 7. Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle. – Discussion en procédure accélérée d’une M. Jean-Claude Requier proposition de loi organique et d’une proposition de loi dans les textes de la commission (p. 3067) Mme Jacky Deromedi Discussion générale commune : M. Christian Eckert, secrétaire d'État Clôture de la discussion générale. Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collecti- Adoption définitive de l’article unique du projet de loi dans vités territoriales, chargée des collectivités territoriales le texte de la commission. -

Téléchargement Du Programme Du Colloque
Jeudi 7 octobre Vendredi 8 octobre 13h00 : Accueil des participants 14h00 : Ouverture du colloque par M. FORTIER, Président de l'Université de Bourgogne Thème 2 - La répression des crimes et délits liés à l'argent Thème 3 - Les peines pécuniaires Mme DION, Doyen de l'UFR de Sciences Humaines Mme FORTUNET, Doyen de l'UFR de Droit Présidence : Michel PORRET, professeur U. Genève Présidence : Xavier ROUSSEAUX, professeur U. Louvain-la-Neuve 9h00 : Rapport de synthèse : Benoît GARNOT, professeur U. Dijon Thème 1 - Crimes et argent, conflits et argent 14h00 : Rapport de synthèse : Eric WENZEL, MC U. Avignon 9h30 : Xavier SOLDEVILA I TEMPORAL, doctorant U. Girona : " La poursuite judiciaire des Présidence : Pierre TRUCHE, Premier Président honoraire de la Cour de cassation insolvables dans la Catalogne médiévale " 14h30 : Jacqueline HOAREAU, MC U. Limoges : " Les amendes dans les lettres de rémission des Julie MAYADE-CLAUSTRE, MC U. Reims : " Le prisonnier pour dette et les officiers du rois de France à la fin du Moyen Age " 14h30 : Rapport de synthèse : Benoît GARNOT, professeur U. Dijon Châtelet (Paris, début du XVe siècle) " Stuart CARROLL, docteur U. York : " Acheter la grâce en France aux XVIe et XVIIe Eric WENZEL, MC U. Avignon : " Plaie d'argent est-elle mortelle ? Le problème du siècles " 15h00 : Bruno POTTIER, doctorant U. Paris-X : " Banditisme et circuits économiques dans péculat dans la doctrine juridique d'Ancien Régime " Jean-Pascal GAY, AMN U. Strasbourg II : " Réparation et restitution dans la théologie l'Empire romain " Françoise BAYARD, professeur émérite U. Lyon-II : " Les financiers français devant la morale au XVIIe siècle en France : l'autre prix du crime et du délit " Jean-Marie YANTE, professeur U. -

Journal Officiel De La République Française
ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 2 JUIN 1998 1 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ SANTINI Philippe Houillon, Gérard Gouzes, Serge Blisko. 1. Conseil supérieur de la magistrature. − Suite de la dis- cussion d’un projet de loi constitutionnelle (p. 2). Clôture de la discussion générale. DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 2) Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. M. Jean-Pierre Michel. DISCUSSION DES ARTICLES (p. 23) 2. Opposition à une demande d’examen selon la procédure d’examen simplifiée (p. 3). Articles 1er et 2. − Adoption (p. 23) 3. Conseil supérieur de la magistrature. − Reprise de la dis- Renvoi des explications de vote et du vote à la prochaine cussion d’un projet de loi constitutionnelle (p. 4). séance. DISCUSSION GÉNÉRALE (suite) (p. 4) 4. Dépôt de propositions de loi (p. 23). MM. Louis Mermaz, Jean-Louis Debré, Georges Hage, 5. Dépôt d’un rapport (p. 24). Pierre Albertini, Mme Christine Lazerges, MM. François Colcombet, 6. Ordre du jour des prochaines séances (p. 24). 2 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 2 JUIN 1998 COMPTE RENDU INTÉGRAL PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ SANTINI, Au demeurant, si une telle réforme est à l’ordre du vice-président jour, ce n’est pas tant parce que les plus hautes autorités de l’Etat l’ont réclamée, mais plutôt, disons-le très claire- ment, parce que les gouvernements successifs, de gauche M. le président. La séance est ouverte. comme de droite, sont intervenus dans des procédures (La séance est ouverte à dix-neuf heures.) particulières pour protéger des amis. Bien entendu, cela est inacceptable et a fait peser le soupçon sur l’ensemble du fonctionnement de l’institution judiciaire. -

Conseil Superieur De La Magistrature
RAP_ACTIV_07_Partie1.qxd:Rapport-Partie1 11/10/07 14:51 Page 1 CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Rapport annuel 2006 Conseil supérieur de la magistrature 15, quai Branly, 75007 Paris Tél. : 01 42 92 89 16 – télécopie : 01 42 92 89 17 – [email protected] www.conseil-superieur-magistrature.fr RAP_ACTIV_07_Partie1.qxd:Rapport-Partie1 11/10/07 14:51 Page 2 ISBN : 2-11-096404-9 RAP_ACTIV_07_Partie1.qxd:Rapport-Partie1 11/10/07 14:51 Page I CONSTITUTION TITRE VIII DE LʼAUTORITE JUDICIAIRE Article 64 Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. I RAP_ACTIV_07_Partie1.qxd:Rapport-Partie1 11/10/07 14:51 Page II RAP_ACTIV_07_Partie1.qxd:Rapport-Partie1 11/10/07 14:51 Page III SOMMAIRE Pages Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ................................................. VII Présidence de la réunion plénière et des formations ...................................................... IX Secrétariat administratif du Conseil ....................... IX AVANT-PROPOS ......................................................... XI PREMIÈRE PARTIE - LE RAPPORT DʼACTIVITE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 1 Chapitre I – Les évolutions de lʼorganisation, du fonctionnement et des moyens du Conseil 3 Section 1 – Un système administratif et financier inchangé ....................................... 5 A - L’évolution préconisée par le Conseil n’a pas encore été suivie d’effet .................. 5 B - Elle reste souhaitable.................................... 7 Section 2 – Un budget en diminution ................. 8 A - Les évolutions contrastées du budget dans la loi de finances pour 2007 ................ 8 B - Une adaptation des moyens du Conseil est indispensable .......................................... 10 III RAP_ACTIV_07_Partie1.qxd:Rapport-Partie1 11/10/07 14:51 Page IV Pages Chapitre II – La nomination des magistrats ........... -

Gardes Des Sceaux En France, D'hier Et D'aujourd'hui
GARDES DES SCEAUX EN FRANCE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI GARDES DESGARDES D’AUJOURD’HUI ET D’HIER EN FRANCE, SCEAUX GARDES DES SCEAUX EN FRANCE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ÉDITO Depuis près de 300 ans, sans interruption, la Chancellerie située place Vendôme, accueille les chanceliers de France, gardes des sceaux et ministres de la justice.Une fonction qui existe, elle, depuis 1545. Située sur l’une des plus prestigieuses places de Paris, la Chancellerie témoigne en ces lieux de la pérennité de l’État. Danton, d’Aguesseau, Cambacérès ... les noms de personnalités illustres résonnent dans l’hôtel de Bourvallais comme pour en scander l’histoire. Tous y ont laissé leur empreinte. Extension, embellissement de l’hôtel d’une part, affirmation de la fonction de ministre de la justice de l’autre, ainsi se sont entremêlés pendant près de trois siècles architecture, art et politique. GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME FRANÇOIS OLIVIER 28 avril 1545 - 22 mai 1551 Rois de France : François Ier et Henri II © Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 5 GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME JEAN DE BERTRAND 22 mai 1551- 10 juillet 1559 Roi de France : Henri II © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais/image château de Versailles 6 GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME FRANÇOIS OLIVIER 10 juillet 1559 - 2 janvier 1560 Roi de France : François II © Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 7 GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME JEAN DE MORVILLIER fin avril 1560 - 2 juin 1560 Roi de France : François II © Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 8 GARDES -

L'entraide 56 Page 1 Carnet Du Jour
L’ENTRAIDE Section du Rhône et de la Métropole de Lyon Honneur Patrie Solidarité COVID-69 EN VILLE ET À LA CAMPAGNE BUI VAN VU CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR N° 56 juin 2020 L'Entraide 56 Page 1 Carnet du jour Promotions Légion d’honneur : Officier : Madame Dominique Hervieu Promotion ordre national du Mérite : Officier : Monsieur André Peyronie éditorial Chers sociétaires Voici le numéro 56 de votre bulletin. Cette édition a été préparée dans des conditions particuliè- res, merci à l’imprimeur et au routeur qui nous ont permis de la réaliser. Nous sommes dans une période intermédiaire, nous ne sommes plus confinés, mais nous devons rester vigilants, car le CO- VID-19 rôde toujours dans les parages ! Durant cette période de confinement, j’ai essayé de vous relayer, via notre site internet, quelques informations importantes sur le déroulement de cette phase. Vous savez que le siège de notre société a mis en place un nouvel outil de gestion des sociétaires. Il monte en puissance, mais les deux derniers mois ont été difficiles ; nos correspondants du Siège ont continué, en télétravail, mais ce n’est pas chose facile, lorsque ce genre d’organisation doit être mise en place dans l’urgence. Alain Servel, Chargé de la communication de la Section. Un QR Code pour votre portable ou votre tablette Vous remarquerez que sur certains articles de votre bulletin apparaît un QR code. Cela vous permet de visualiser l’article correspondant sur notre site. Ont collaboré à ce bulletin En plus des articles signés : Gérard Bizet, Paul Grospiron, Paul Laffly, (merci à tous). -

N° 3505 Assemblée Nationale
N° 3505 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2006. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3393), tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, PAR M. GUY GEOFFROY, Député. —— — 159 — SOMMAIRE ___ Pages INTRODUCTION.............................................................................................................. 163 I. –– GARANTIR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS L’INTERET DE TOUS ........................................................................................................................... 166 A. ROMPRE AVEC LA SOLITUDE DU JUGE D’INSTRUCTION.................................... 166 1. L’instruction menée par un juge unique : une procédure critiquée................ 166 2. Supprimer le juge d’instruction : une fausse solution ..................................... 167 3. Rendre l’instruction plus objective en favorisant la collégialité ...................... 168 B. INSTRUIRE ET JUGER DANS DE MEILLEURS DÉLAIS .......................................... 170 1. La nécessaire célérité de la justice................................................................... 170 2. Lutter contre les recours dilatoires et les plaintes avec constitution de partie civile abusives ......................................................................................... 172 3. Une nouvelle organisation -

100 Families That Changed the World
JOSEP TÀPIES • ELENA SAN ROMÁN • ÁGUEDA GIL LÓPEZ 100 FAMILIES THAT CHANGED THE WORLD Family Businesses and Industrialization “If there is one quality that centenarian firms have in common, it is that they have known how to adapt to the many circumstances and challenges they have been faced with. Family businesses are usua- lly managed with a long-term vision, and there can be no doubt that the companies featured in this book provide a clear example of how to achieve this.” José María Serra, chairman of Grupo Catalana Occidente “This book is an effective tool for better understanding the manage- rial and industrial development of family businesses. This is undoub- tedly an objective approach that allows the reader to learn about the key factors that, in each case, have been fundamental to the suc- cess of centenarian companies. Moreover, it is a work of study and analysis that reveals the best practices of each company in an effort to keep its activity going throughout the years.” Tomás Osborne, chairman of the Osborne Group */3%04±0)%3s%,%.!3!.2/-£.s£'5%$!'),,0%: 'BNJMJFT5IBU$IBOHFEUIF8PSME 'BNJMZ#VTJOFTTFTBOE*OEVTUSJBMJ[BUJPO 100 Families That Changed the World Family Businesses and Industrialization Josep Tàpies, Elena San Román, Águeda Gil All rights reserved. Total or partial reproduction of this work by any means or process, including photocopying and computer processing, and distribution of copies released by rental or public lending is strictly prohibited without written permission from the copyright holders, under penalty of law. First edition: May 2014 © Josep Tàpies, Elena San Román, Águeda Gil, 2014 © Jesús Serra Foundation © Ediciones Universidad de Navarra, S.A. -

1958-1968. La Création Des Centres Hospitaliers Et Universitaires
LA GRANDE HISTOIRE DES CHU CHAPITRE 2 1958-1968. LA CRÉATION DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Le 31 mai 1958, Pierre Pflimlin, président du Conseil, démissionne. Le 1er juin, l’Assemblée nationale investit le gouvernement du général de Gaulle, qui est nommé prési- dent du Conseil, doté de pouvoirs spéciaux. La Constitution de la Ve République est approuvée par réfé- rendum le 28 septembre, et de Gaulle est élu président de la République le 21 décembre. Il reste chef du gouverne- ment et ne prend ses fonctions présidentielles que le 8 jan- vier 1959. Ce même jour, Michel Debré est nommé Premier ministre ; Georges Pompidou lui succédera, du 14 avril 1962 au 21 février 1968. Les trois ordonnances de décembre 1958 : une nouvelle politique hospitalière La création du CHU est précédée, sinon préparée, par trois ordonnances importantes. Celle du 11 décembre 1958, accompagnée du décret n° 58-1202, portant réforme hospi- 39 L E CHU, L ’ HÔPITAL DE TOUS LES DÉFIS LA GRANDE HISTOIRE DES CHU talière, fonde trois instances nationales ayant pour missions ORDONNANCE N° 58-1373 DU 30 DÉCEMBRE 1958 la conception de la nouvelle politique hospitalière et le contrôle de sa mise en œuvre : la Commission nationale de Art. 1er - Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facul- l’équipement hospitalier, le Conseil supérieur des hôpitaux tés mixtes de médecine et de pharmacie, ou d’écoles nationales et le Conseil supérieur de la fonction hospitalière. Les de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les cen- commissions administratives des hôpitaux voient leurs tres hospitaliers organisent conjointement l’ensemble de leurs membres passer de sept à neuf, dont trois représentant le services en centres de soins, d’enseignement et de recherche, conseil municipal. -

French Constitutionalism Elisabeth Zoller
Maurer School of Law: Indiana University Digital Repository @ Maurer Law Articles by Maurer Faculty Faculty Scholarship 2018 French Constitutionalism Elisabeth Zoller Follow this and additional works at: https://www.repository.law.indiana.edu/facpub Part of the Comparative and Foreign Law Commons, and the Constitutional Law Commons n° spécial | 2018 French Constitutionalism 2018 HENRI CAPITANT Law Review Revue de Droit HENRI CAPITANT n° spécial n° spécial | 2018 Founded in 2010, the Revue de droit Henri Capitant or Henri Capitant Law Review was designed as an online means of spreading the French Constitutionalism legal culture of civil law countries. Hence its bilingualism and its publication both in a digital and a paper format, all of which is made possible thanks to the support of the Civil Law Initiative Le constitutionnalisme français (Fondation pour le droit continental) and the commitment of the publishing house Lextenso. The Law Review has already contributed to foreign readers’ knowledge about a number of markers of French law and more broadly of continental law such as the unicity of patrimony, the primacy of execution in kind, the distinction between private law and public law, the organization of legal professions or the reserved portion or the estate (also called the hereditary reserve). Since 2014 the Review has been enhanced by valuable yearbooks of French law and, from now on, it will include special issues too. These special issues illustrate Law Review HENRI CAPITANT the willingness of the Association Henri Capitant to open up its columns to rich monographs that will enjoy the exceptionally large diffusion offered by a translation in English as well as an entire publication online with a free access (http://www.henricapitant. -

Jeudi 27 Mai 1971
** Année 1971. — N° 19 S. Le Numéro : 0,50 F Vendredi 28 Mai 1971 ** JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES SÉNAT COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES Abonnements à l'Edition des DEBATS DU SENAT : FRANCE ET OUTRE-MER : 16 F ; ETRANGER : 24 F (Compte chèque postal : 9063 - 13, Paris.) PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE aux renouvellements et réclamations 26, RUE DESAIX, PARIS 15° AJOUTER 0,20 F SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971 COMPTE RENDU INTEGRAL - 15° SEANCE Séance du Jeudi 27 Mai 1971. SOMMAIRE Art. 9 à 16 : adoption. PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ MÉRIC Art. 17 : Amendement n° 6 de la commission. — Adoption. 1. - Procès-verbal (p. 553). Adoption de l'article modifié. 2. — Conférence des présidents (p. 553). Art. additionnel 17 bis (amendement n° 4 de la commission) : 3. — Dépôt de propositions de loi (p. 554). adoption. 4. — Dépôt de rapports (p. 554). Art. 18 et 19 : adoption. 5. — Retrait d'une question orale avec débat (p. 554). Art. 19 bis : 6. — Dépôt d'une question orale avec débat (p. 554). Amendement n° 7 de la commission. — Adoption. Adoption de l'article modifié. Suspension et reprise de la séance. Art. 20 et 21 : adoption. 7. — Cour de discipline budgétaire. — Adoption d'un projet de Art. 21 bis : loi (p. 555). Amendement n° 8 de la commission. — Adoption. d'Etat au Discussion générale : MM. Jean Taittinger, secrétaire Adoption de budget ; Marcel Pellenc, rapporteur général de la commission des l'article modifié. finances. Art. 22 à 26 bis : adoption. -

La Constitution De 1958 À Nos Jours
PHILIPPE BLACHÈR JEAN GARRIGUES PRÉFACE DE JEAN-LOUIS DEBRÉ Fait à Paris, le 4 octobre 1958, René Coty. Le président du Conseil des ministres, Charles de Gaulle ; le ministre d’État, Guy Mollet ; le ministre d’État, Pierre Pflimlin ; le ministre d’État, Félix Houphouët- Boigny ; le ministre d’État, Louis Jacquinot ; le ministre délégué à la présidence du Conseil,4 André Malraux ; le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Michel Debré ; le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville ; le ministre de l’Intérieur, Émile Pelletier ; Reproduction des signatures apposées sur l’original de la Constitution de 1958. le ministre des Armées, Pierre Guillaumat ; le ministre des Finances et des Affaires économiques, Antoine Pinay ; le ministre de l’Éducation nationale, Jean Berthoin ; le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, Robert Buron ; le ministre de l’Industrie et du Commerce, Édouard Ramonet ; le ministre de l’Agriculture, Roger Houdet ; le ministre de la France d’Outre-mer, Bernard5 Cornut-Gentille ; le ministre du Travail, Paul Bacon ; le ministre de la Santé publique et de la Population, Bernard Chenot ; le ministre de la Construction, Pierre Sudreau ; le ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre, Edmond Michelet ; le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, Eugène Thomas ; le ministre du Sahara, Max Lejeune ; le ministre de l’Information, Jacques Soustelle ; le ministre délégué à la présidence du Conseil, André Boulloche. SOMMAIRE 11 PRÉFACE Jean-Louis Debré 15 AUX ORIGINES DE