Rapport D'information
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Societes Ultramarines Face Aux Risques De Montee Du Niveau Marin. Quelles Strategies D'adaptation?
Les societes ultramarines face aux risques de montee du niveau marin. quelles strategies d’adaptation ? : exemples des iles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou Sophie Bantos To cite this version: Sophie Bantos. Les societes ultramarines face aux risques de montee du niveau marin. quelles strate- gies d’adaptation ? : exemples des iles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou. Géographie. Université de la Sorbonne (Paris 4), 2011. Français. tel-01172166 HAL Id: tel-01172166 https://hal.ird.fr/tel-01172166 Submitted on 7 Jul 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université Paris 4 - Sorbonne Université de la Nouvelle Calédonie IRD, US ESPACE Thèse de Doctorat de Géographie Nouveau Régime intitulée : Les sociétés ultramarines face aux risques de montée du niveau marin. Quelles stratégies d’adaptation ? Exemples des îles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou. Présentée et soutenue publiquement le 17 janvier 2011 par : Sophie BANTOS Sous la direction de : Christian Huetz de Lemps, Professeur et Michel Allenbach, Maître de conférences-HDR Devant le jury composé de : Professeur Franck Dolique Professeur Richard Laganier Professeur Christian Huetz de Lemps Maître de conférences-HDR Michel Allenbach Professeur Jean-Paul Amat - Avant-propos - AVANT-PROPOS La thématique de l’adaptation à la montée des eaux dans les petites îles tropicales est abordée dans ce mémoire d’un point de vue sociétal. -

Contribution Au Diagnostic De L'assainissement Individuel Et De L
Stage 2ème année d’école d’ingénieurs Juin à Août 2014 Contribution au diagnostic de l’assainisseme nt individuel et de l’élevage de l’île d’Uvéa Initiation du schéma directeur d’assainissement LECABLE Mélissa Service Territorial de l’Environnement de Wallis et Futuna Encadrant entreprise : MALAU Atoloto BP 294 Mata’Utu 98 600 UVEA [email protected] Encadrant ENSIL : LEPRAT Patrick Spécialité Eau & Environnement REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier Patrick Leprat, directeur de L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges qui a fait en sorte que ce stage voit le jour, et ce dans les meilleures conditions possibles. Merci à l’ensemble des personnes qui œuvrent au sein du Service Territorial de l’Environnement pour m’avoir accueillie et en particulier à : Atotolo Malau, mon maître de stage pour ses conseils avisés, sa bonne humeur et pour m’avoir fait découvrir les îlots du Sud. Karine Brunet pour avoir bataillé fermement contre les aléas locaux afin que le travail se fasse. Julie Petit pour sa détermination et pour m’avoir fait comprendre dès la première semaine que « tout dépend du contexte ». Petelo Fiahau pour s’être cassé la tête à retrouver des données là où seule sa mémoire pouvait le faire et pour m’avoir fait bénéficier de ses connaissances du terrain. Falai Tuhimutu avec laquelle les enquêtes domiciliaires ont à la fois commencé dans son village à Falaleu et terminé à Gahi. Lolesio Toke qui m’a guidée sur le littoral à Alele. Petelo Sanele Tauvale qui a accepté que son foyer soit le premier à être visité et m’a également permis d’investiguer à Gahi. -

Inventaire Et Fouille Des Sites Archéologiques Et
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER CENTRE DE NOUMÉA SCIENCES HUMAINES O.FRIMIGACCI -JP.SIORAT -B. VIENNE MISSION ORSTOM-CNRS 1983 INVENTAIRE ET FOUILLE DES SITES ARCHEOLOGIQUES . ET ETHNOHISTORIQUES DE L'ILE D'UVEJ CENTRE ORSTOM - B.P. A 5 - NOUMËA NOUVELLE- CALËOONIE _. INVENTAIRE ET FOUILLE DES SITES ARCHEOLOGIQUES . ET ETHNOHISTORIQUES DE L'ILE D'UVEA \ \ 1 UVEA DANS L'ENSEMBLE PACIFIQUE SUD OUEST N t , TUVALU • TOKELAU. - 1 1 • SANTA CRUZ ~ 10° S 1 SAMOA FUTUNA Ôa "TI ; BANKS ~.. • , ..... ... 1 li --\ - 15°S ~$ .- -...~ FIDJI VANUATU ,. .--.- .. ", 1 • NIUE TONGA .' ~ 20 0 S NOUVELLE CALEDONIE ----~----TROPIQUE DU CAPRICORNE --- --~----- --~--- 1 1-- - -\- -- -- o 100 300 500 Km -1---_ !: •, ! ! \ E 1700 E 180° 1 170°'-N 3 INTRODUCTION Ceci est le deuxième rapport de mission sur l 'ethno-archéologie de l'île d'UVEA - territoire des îles Wallis et Futuna - entrepris en AoOt~ Septem bre et Octobre 1984. Ce travail de recherche sur le Passé d'UVEA a été réalisé à l'instigation de l'Association Socio-culturelle pour l'art Wallisien et Futunien. Sans l'aide des membres de cette association il aurait été impossible d'envisa ger une telle entreprise~ grâce à eux~ nous avons obtenu tous les accords et la confiance des plus hautes autorités coutumières. Tous les membres de la mission étaient hébergés au presbytère de MUA par le père Petelo FALELAVAKI~ nous tenons à le remercier tout particulièrement de son hospi talité bienveillante. Ce travail a été réalisé par B. VIENNE~ anthropologue de l 'ORSTOM~ D. FRIMIGACCI~ Préhistorien du CNRS et J.P. SIORAT, Conservateur adjoint du Musée Néo-Calédonien de Nouméa. -

LIVRET D'accueil Wallis Et Futuna
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA LIVRETLIVRET D'ACCUEILD'ACCUEIL WallisWallis etet FutunaFutuna 1 LELE MOTMOT DUDU PREFETPREFET L'archipel des îles Wallis et Futuna, à 20 000 km de la Métropole, au coeur du Pacifique Sud, est un jeune territoire français, qui a fêté ses 50 ans d'existence en 2011. L'organisation institutionnelle de cette collectivité d'outre-mer est atypique: l'Etat, le Territoire, les autorités coutumières et religieuses y exercent ensemble leurs responsabilités. Les fonctionnaires qui ont fait le choix de mettre leurs compétences au service de l'Etat et du Territoire à Wallis et Futuna doivent faire preuve de solides capacités d'adaptation. Mais ils vivront une expérience unique, dans ce monde polynésien qui a su conserver beaucoup de ses traditions, au sein d'un environnement remarquable. Ce livret d'accueil a vocation à vous présenter à grands traits ce territoire, et vous aider à préparer le voyage qui vous attend. Je remercie et félicite le Service des Ressources Humaines qui a pris l'initiative de réaliser ce document qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais s'efforce de donner à celles et ceux qui s'apprêtent à exercer leurs fonctions à Wallis et Futuna, des informations qui leur seront utiles. Michel JEANJEAN 2 LIVRET D'ACCUEIL ILES WALLIS ET FUTUNA SOMMAIRE: 1/ PRESENTATION GENERALE A/ Repères historiques B/ Géographie et démographie des îles C/ Coutumes et traditions 2/ LES SERVICES ADMINISTRATIFS A/ L'Administration Supérieure a- Organisation et fonctionnement b- Organigramme B/ -
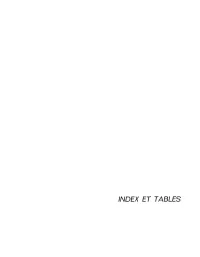
Index Et Tables Index
INDEX ET TABLES INDEX des principaux personnages, toponymes et thématiques narratives Les numéros renvoient à ceux du répertoire 1970-1971 en annexe. Les indications de pages qui font suite à la série des numéros se réfèrent à la pagination de cet ouvrage. Les noms de personnages, suivant la pratique adoptée, sont donnés en capitales, et leur signification entre parenthèses, de façon à les distinguer des toponymes et des noms communs. Les noms communs sont classés suivant l'ordre alphabétique des termes français, traduits en wallisien en caractères maigres. En se servant du lexique botanique et zoologique, il est facile, en partant du vocable wallisien, de retrouver le correspondant français. Les espèces difficilement identifiables sont regroupées sous les entrées : coquillages, crabes, oiseaux, plantes, poissons. Nous remercions M. Richard Rossille pour sa contribution à cet index partiel. Afrique, Afelika : n°s 108, 1.053, 1.185, 1.286 — pp. 19, 98, bananier, fusil : 403, 897, 946, 1.176, 1.207, 1.212, 1.249, 100, 155, 184. 1.271, 1.277 — pp. 66, 69, 72, 74, 75, 77, 177, 182, 183. AGO-MUA (Curcuma-premier) : 144, 177, (396) — p. 96. bêche-de-mer, loli : 580 — p. 141. Ahoa, village du district de Hahake : 826, 935, 987, 1.168, Belle au bois dormant, thématique : 753 — p. 138. 1.235, 1.241, SElvlTSI 1932-2 — pp. 18, 102. bénitier, gaegae : 13, 144, 195, 222, 304, 396, 402, 487, aigle, akuila : 244, 474, 736, 1.053, 1.185 — pp. 34, 115. 741, 895, 1.000, 1.094 — pp. 95 111, 161. ALAALAMAIPE (Réveille-toi) : 325 — p. -

W Allis-Et -Futuna 2017
2017 Wallis-et-Futuna INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER ÉDITION WALLIS-ET-FUTUNA 2017 2018 THÉMATIQUE DU RAPPORT 2017 POURQUOI LE TOURISME DURABLE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ? Comme chaque année, l’IEDOM et l’IEOM s’inspirent des thématiques célébrées par l’Organisation des Nations Unies pour illustrer leurs rapports annuels. Les années internationales proclamées par l’Assemblée générale des Nations unies sont dédiées, chaque année depuis les années 2000, à un ou plusieurs thèmes particuliers. L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2017 « Année internationale du tourisme durable pour le développement ». Cette décision fait suite à la reconnaissance par les dirigeants mondiaux, lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), qu’un « tourisme bien conçu et bien organisé » peut contribuer au développement durable dans ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale), à la création d’emplois et aux débouchés commerciaux. Photo de couverture : Catamaran sur lagon Le tourisme durable est l’un des objectifs de la Stratégie de développement du Territoire. Il s’accompagne de la promotion d’activités durables telles que les sports nautiques, respectueuses de l’environnement et du lagon, atout indéniable du Territoire. © Chloé Desmots INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL SIÈGE SOCIAL 115, rue Réaumur 75002 PARIS Wallis-et- Futuna Rapport annuel 2017 Les renseignements autres que monétaires publiés dans la présente étude ont été recueillis auprès de diverses sources extérieures à l’Institut d’émission et ne sauraient engager sa responsabilité. L’IEOM tient à remercier les diverses administrations publiques, les collectivités et les entreprises pour les nombreuses informations qu’elles lui ont communiquées. -

IMPO X4 LIFESTYLE #1 07/28/03 11:02 AM Page 1
DOC COUV XPRESS 07/31/03 4:01 PM Page 1 IMPO X4 LIFESTYLE #1 07/28/03 11:02 AM Page 1 Secretariat of the Pacific Community LIFESTYLE DISEASES IN PACIFIC COMMUNITIES by Terry Coyne edited by Robert Hughes and Sarah Langi i IMPO X4 LIFESTYLE #1 07/28/03 11:02 AM Page 2 © Secretariat of the Pacific Community, 2000 All rights for commercial / for profit reproduction or translation, in any form, reserved. The SPC authorises the partial reproduction or translation of this material for scientific, educational or research purposes, provided that the SPC and the source document are properly acknowledged. Permission to reproduce the document and / or translate in whole, in any form, whether for commercial / for profit or non-profit purposes, must be requested in writing. Original SPC artwork may not be altered or separately published without permission. Original edition: English Secretariat of the Pacific Community cataloguing-in-publication Coyne,Terry, Lifestyle diseases in Pacific communities / author:Terry Coyne, editors: Robert Hughes and Sarah Langi. (Technical paper / Secretariat of the Pacific Community; no. 219) 1. Public health--Oceania--Bibliography. 2. Diet--Oceania. 3. Cardiovascular system--Diseases--Oceania. 4. Diabetes--Oceania. 5. Cancer--Oceania. 6. Obesity--Oceania I. Coyne,Terry II. Hughes, Robert III. Langi, Sarah IV.Secretariat of the Pacific Community V. Title VI. Series 616.9800990 ISBN 982-203-793-7 AACR2 ISSN 0081-2862 Author 1. Terry Coyne, NCD Project Officer, Secretariat of the Pacific Community, BP D5, 98848 Noumea Cedex, New Caledonia Editors 1. Robert Hughes, Nutritionist/NCD Epidemiologist, Secretariat of the Pacific Community, BP D5, 98848 Noumea Cedex, New Caledonia 2. -

JOWF N° 502 Du 31 AOUT 2019.Pdf
N° 502 31 AOUT 2019 REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté – Egalité – Fraternité SS OO MM MM AA II RR EE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Page 19416 ANNONCES LÉGALES Page 19433 DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 19435 SOMMAIRE ANALYTIQUE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Arrêté n° 2019-770 du 20 août 2019 autorisant la Arrêté n° 2019-780 du 28 août 2019 fixant à nouveau prise en charge par le Territoire des frais le prix de vente au détail du gaz butane. – Page 19424 d’hébergement et de cantine des élèves du lycée, des collèges et CETAD, pensionnaires ou demi- pensionnaires à Lano et Sofala au titre des mois d’août à octobre 2019 (3 ème tranche). – Page 19416 DECISIONS Arrêté n° 2019-771 du 20 août 2019 rendant Décision n° 2019-1272 du 20 août 2019 effectuant le exécutoire la délibération n° 246/CP/2019 du 19 versement du premier acompte de la prime à juillet 2019 constatant la démission d’un membre de l’investissement au projet de menuiserie de Monsieur l’Assemblée Territoriale des Jeunes. – Page 19416 Soane KAFOA. – Page 19425 Arrêté n° 2019-772 du 20 août 2019 rendant Décision n° 2019-1273 du 20 août 2019 effectuant le exécutoire la délibération n° 247/CP/2019 du 19 versement du premier acompte de la prime à juillet 2019 portant nomination de M. MOLEANA l’investissement au projet de restauration rapide de Patrick comme membre de l’Assemblée Territoriale Monsieur Gérard POUSSIER. – Page 19425 des Jeunes. – Page 19417 Décision n° 2019-1274 du 20 août 2019 effectuant le Arrêté n° 2019-773 du 21 août 2019 portant versement du premier acompte de la prime à ouverture d’un concours pour le recrutement d’un l’investissement au projet d’assainissement VRD de agent permanent, un éducateur sportif dans les Monsieur Siolesio VAN-DAC. -

Livret D'accueil 2019
PRÉFET ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR CHEF DU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA LIVRETLIVRET D’ACCUEILD’ACCUEIL ADMINISTRATION SUPÉRIEURE – PRÉFECTURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA 20192019 Mis à jour le 30/04/2019 SOMMAIRE P a g e s Avant-propos : Le mot du Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna............................................. 3 CHAPITRE I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE A/ Repères historiques …........................................................................................................................................... 4 B/ Présentation Géographique ….............................................................................................................................. 4 C/ Le Climat à Wallis et Futuna ............................................................................................................................... 5 D/ Données Démographiques .................................................................................................................................... 5 E/ Cadre Institutionnel .............................................................................................................................................. 6 1) Le Statut de 1961 .......................................................................................................................................6 2) L’État …..................................................................................................................................................... 6 3) Le Territoire …...........................................................................................................................................6 -

Enquête Sur La Filariose À Wallis
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER 20. Rue Monsieur PARIS 7' ENQUÊTE SUR LA FILARIOSE À WALLIS par Jean RAGEAU avec la collaboration du Dr. J. ESTIENNE, • 1NSTITUT FRAN ÇAI S D'OCÉAN 1E NOUMÉA, Nouvelle,Calédonie OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER INSTITUT FRANÇAIS O/OCEANIE Laboratoire d'Entomologie médicale et vétérinaire ENQUÊTE SUR LA FILARIOSE À WALLIS par Jean RAGEAU avec la collaboration du Dr. J. ESTIENNE, Midecin-Chef du Service médical des Iles Wallis et Futuna Avril 1969 r- i ENQUETE SUR LA lILARIOSE A WALLIS • -:-:-:-:-:- • l.N.TI3:0DUC T!ON La. filariose humaine à. Wuc_hAre;r::ia bW.c:.rofti compte parmi les endémies majeures de l'1le Wallis. La lutGe contre cette très grave pa rasitose se limite acblellem~nt à. la di$tribution de Notézine aux malades souffrant de lymphangite filarie!J~e et à. quelques interventions chirurgi cales dans les cas op8rables diéléphantiasis. Ni la proph~rlaxie entomologique, ni la chimioprophylaxie n'ont été tentées, bien q~lun cinqui3me au moins de la pop·~tion ~~lli~ie!Jne renferme des microfilaires dans le sang et qu"un wallisien sur douze sou~ fre de manifestations filarie~~es. Notre enqu~te avait pour objectif principal l'étlme épidémie logique de la filariose àe~e Eancroft dans l'11e VAllie 8t elle nous a per mis de dresser un tableau. de la sitLo.ationsitLo.atio::l actuelle de cette IIl9.ladie. Lf8nqu~te hémuto1og5.que a été réalisée avec la collaboration du Dr. J. Esttep.nc, Médecin de l'île '-{allis, d'octobre 1958 à fé-rrier 1959 ainsi que l'étude sur la morpholoeie des microf..i.laires de W. -

An Unprecedented High Incidence of Leptospirosis in Futuna, South Pacific, 2004 – 2014, Evidenced by Retrospective Analysis of Surveillance Data
RESEARCH ARTICLE An Unprecedented High Incidence of Leptospirosis in Futuna, South Pacific, 2004 – 2014, Evidenced by Retrospective Analysis of Surveillance Data Denis Massenet1, Jean-François Yvon1,2, Clément Couteaux1, Cyrille Goarant3* 1 Agence de Santé des îles Wallis & Futuna, Laboratoire de biologie médicale/hôpital de SIA, BP 4G, 98 600 Mata'Utu, Wallis & Futuna, 2 Laboratoire de Ducos, BP 3931, 98846 Nouméa, New Caledonia, 3 Institut Pasteur in New Caledonia, Institut Pasteur International Network, Leptospirosis Research and Expertise Unit, 9–11 Avenue Paul Doumer, BP 61, 98 845 Noumea, New Caledonia * [email protected] OPEN ACCESS Abstract Citation: Massenet D, Yvon J-F, Couteaux C, Futuna is a small Polynesian island in the South Pacific with a population of 3,612 in 2013. Goarant C (2015) An Unprecedented High Incidence The first human leptospirosis case was confirmed in 1997. Active surveillance started in of Leptospirosis in Futuna, South Pacific, 2004 – 2004. Cases were confirmed by PCR or real time PCR, or by serology using MAT or a com- 2014, Evidenced by Retrospective Analysis of Surveillance Data. PLoS ONE 10(11): e0142063. bination of IgM-ELISA and MAT. A retrospective analysis of surveillance data shows that doi:10.1371/journal.pone.0142063 the disease was endemic with a mean annual incidence of 844 cases per 100,000 over an Editor: Kalimuthusamy Natarajaseenivasan, 11-year period from 2004 to 2014. An epidemic peak as high as 1,945 cases per 100,000 Bharathidasan University, INDIA occurred in 2008. Serogroup Australis was predominant until 2007, Icterohaemorrhagiae Received: September 15, 2015 was dominant afterwards. -

Les Transformations D'une Tradition Narrative Chapitre Iv
LES TRANSFORMATIONS D'UNE TRADITION NARRATIVE CHAPITRE IV VARIATIONS DIACHRONIQUES Passer d'une constatation de variations a une définition de variables implique que nous passions d'un niveau empirique à un niveau quasi-logique et que nous menions donc une enquête suivie sur des bases textuelles. C'est ce que nous nous proposons de faire sous les deux points de vue classiquement reconnus comme diachronique et synchronique. Nous avons conscience que les démarches diachronique et synchronique ne peuvent être absolutisées. Non seulement elles ne définissent pas deux moments antagonistes dans une analyse, mais surtout elles restent foncièrement relatives, relatives de l'une à l'autre et relatives à l'attitude méthodologique qu'elles instaurent. Il est évident, en effet, qu'un trait de récit — variant ou non — a indissociablement une dimension diachronique et une dimension synchronique. Métho- dologiquement, nous retenons ici cette distinction dans un but euristique, et nous employons d'ailleurs les deux termes dans leur sens général extra-textuel : celui de longitudinale et de transversale historiques. En pratique, l'anaiyse en diachronic ncus îera comparer des passages textuels entre différentes strates historiques et nous permettra surtout de circonscrire les variations occasionnées à une thématique dans sa course historique. A l'intérieur du champ diachronique ainsi caractérisé, nous concentrerons notre enquête sur quatre types de faits narratifs : 1. Personnages. 2. Toponymes. 3. Eléments structurels. 4. Modifications lexicales. Ces quatre types de faits narratifs ne sont certes pas homogènes entre eux ; mais dans les quatre cas, nous partons de la matérialité des récits et nous tâchons de suivre l'évolution des variations d'un trait de récit, au lieu de comparer vainement l'intégralité de récits entre eux.