CSE Annuaire 3E Edition
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport EV 2009 Cartes Rev-Mai 2011 Mb MF__Dsdsx
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi ---------- MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ---------- Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté (CSPLP) ---------- Projet d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP) Avec l’appui de l’union européenne ENQUETE VILLAGES DE 2009 SUR L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE Rapport final Dakar, Décembre 2009 SOMMAIRE I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS _____________________________________________ 3 II. OBJECTIF GLOBAL DE L’ENQUETE VILLAGES __________________________________ 3 III. ORGANISATION ET METHODOLOGIE ________________________________________ 5 III.1 Rationalité ______________________________________________________________ 5 III.2 Stratégie ________________________________________________________________ 5 III.3 Budget et ressources humaines _____________________________________________ 7 III.4 Calendrier des activités ____________________________________________________ 7 III.5 Calcul des indices et classement des communautés rurales _______________________ 9 IV. Analyse des premiers résultats de l’enquête _______________________________ 10 V. ACCES ET EXISTENCE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE _________________________ 11 VI. Accès et fonctionnalité des services sociaux de base ________________________ 14 VII. Disparités régionales et accès aux services sociaux de base __________________ 16 VII.1 Disparité régionale de l’accès à un lieu de commerce ___________________________ 16 VII.2 Disparité régionale de l’accès à un point d’eau potable _________________________ -
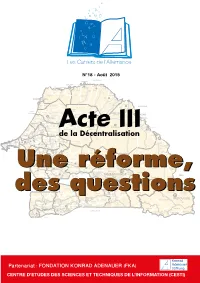
Acte III Une Réforme, Des Questions Une Réforme, Des Questions
N°18 - Août 2015 MAURITANIE PODOR DAGANA Gamadji Sarré Dodel Rosso Sénégal Ndiandane Richard Toll Thillé Boubakar Guédé Ndioum Village Ronkh Gaé Aéré Lao Cas Cas Ross Béthio Mbane Fanaye Ndiayène Mboumba Pendao Golléré SAINT-LOUIS Région de Madina Saldé Ndiatbé SAINT-LOUIS Pété Galoya Syer Thilogne Gandon Mpal Keur Momar Sar Région de Toucouleur MAURITANIE Tessekéré Forage SAINT-LOUIS Rao Agnam Civol Dabia Bokidiawé Sakal Région de Océan LOUGA Léona Nguène Sar Nguer Malal Gandé Mboula Labgar Oréfondé Nabbadji Civol Atlantique Niomré Région de Mbeuleukhé MATAM Pété Ouarack MATAM Kelle Yang-Yang Dodji Gueye Thieppe Bandègne KANEL LOUGA Lougré Thiolly Coki Ogo Ouolof Mbédiène Kamb Géoul Thiamène Diokoul Diawrigne Ndiagne Kanène Cayor Boulal Thiolom KEBEMER Ndiob Thiamène Djolof Ouakhokh Région de Fall Sinthiou Loro Touba Sam LOUGA Bamambé Ndande Sagata Ménina Yabal Dahra Ngandiouf Geth BarkedjiRégion de RANEROU Ndoyenne Orkadiéré Waoundé Sagatta Dioloff Mboro Darou Mbayène Darou LOUGA Khoudoss Semme Méouane Médina Pékesse Mamane Thiargny Dakhar MbadianeActe III Moudéry Taïba Pire Niakhène Thimakha Ndiaye Gourèye Koul Darou Mousty Déali Notto Gouye DiawaraBokiladji Diama Pambal TIVAOUANE de la DécentralisationRégion de Kayar Diender Mont Rolland Chérif Lô MATAM Guedj Vélingara Oudalaye Wourou Sidy Aouré Touba Région de Thiel Fandène Thiénaba Toul Région de Pout Région de DIOURBEL Région de Gassane khombole Région de Région de DAKAR DIOURBEL Keur Ngoundiane DIOURBEL LOUGA MATAM Gabou Moussa Notto Ndiayène THIES Sirah Région de Ballou Ndiass -
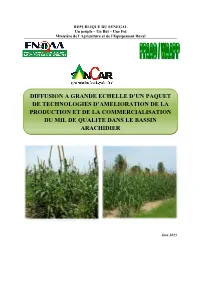
Diffusion a Grande Echelle D'un Paquet De
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural DIFFUSION A GRANDE ECHELLE D’UN PAQUET DE TECHNOLOGIES D’AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DU MIL DE QUALITE DANS LE BASSIN ARACHIDIER Juin 2013 SOMMAIRE PARTIE ANONYME ............................................................................................................................ 4 I. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET ............................................................... 6 1.1. Titre du projet ............................................................................................................................ 6 1.2. Résumé du projet : ..................................................................................................................... 6 1.3. Type de technologie à valoriser ................................................................................................. 6 1.4. Domaines concernés ................................................................................................................... 7 1.5. Provenance de la technologie ..................................................................................................... 7 1.6. Aire géographique ...................................................................................................................... 7 1.7. Cible da la grande diffusion : .................................................................................................... 7 1.8. Durée du projet .......................................................................................................................... -

SEN FRA REP2 1999.Pdf
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE Projet GCP/SEN/048/NET Recensement National de l’Agriculture et Système Permanent de Statistiques Agricoles RECENSEMENT NATIONAL DE L’AGRICULTURE 1998-99 Volume 2 Répertoire des villages d’après le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 Août 1999 ___________________________________________________________________________ ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) Sommaire Données récapitulatives par unité administrative ……………………………………….… 9 Données individuelles relatives à la région de Dakar …………………………………….. 35 Données individuelles relatives à la région de Diourbel …………………………………. 41 Données individuelles relatives à la région de Saint-Louis ………………………….….. 105 Données individuelles relatives à la région de Tambacounda …………………………... 157 Données individuelles relatives à la région de Kaolack …………………………………. 237 Données individuelles relatives à la région de Thiès ……………………………………. 347 Données individuelles relatives à la région de Louga …………………………………… 427 Données individuelles relatives à la région de Fatick …………………………………… 557 Données individuelles relatives à la région de Kolda …………………………………… 617 Carte administrative du Sénégal ………………………………………………………… 727 3 Avant-propos Ce volume 2 des publications sur le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 est consacré à la publication d’un répertoire des villages construit à partir des données issues des opérations de collecte du pré-recensement qui ont consisté en une opération de cartographie censitaire et en une enquête sur les ménages ruraux. Le répertoire des villages publié dans ce volume 2 est simplement la liste exhaustive des villages, avec pour chaque village, les valeurs de plusieurs paramètres de taille. A titre d’exemple, l’effectif des concessions rurales, l’effectif des ménages ruraux et l’effectif des ménages ruraux agricoles sont trois variables de taille du village dont les valeurs figurent dans ce répertoire des villages. -

Projections Démographiques
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Direction des Statistiques Démographiques et Sociales Division du Recensement et des Statistiques Démographiques Bureau Etat Civil et Projections Démographiques 2013-2063 ANSD-FEVRIER 2016 Projection de la population du Sénégal/MEFP/ANSD-Février 1 2016 INTRODUCTION Les présentes projections démographiques ont été élaborées par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie au cours d’un atelier tenu en mai 2015. Ces projections sont issues d’un large consensus. Elles ont été réalisées avec la participation de techniciens issus d’horizon divers (Ministères de l’Economie des Finances et du Plan, Emploi, Travail, Education, Famille, Agriculture, Elevage, Santé, Jeunes) et UNFPA. Les hypothèses ont été formulées par rapport à une évolution probable des différents facteurs de la dynamique de la population, notamment: La structure de la population, par sexe et par âge ; La structure de la population selon le milieu de résidence (urbaine ou rurale) ; L’Indice synthétique de fécondité comme indicateur de fécondité ; L’espérance de vie ; La structure de la mortalité (à travers l’emploi d’une table‐type de mortalité, celle de Coale & Demeny Nord) ; Le solde migratoire ; Le niveau d’urbanisation. Pour renseigner ces indicateurs, il a fallu recourir à différentes sources de données (RGP 1976 ; RGPH 1988 ; RGPH 2002 et RGPHAE 2013 ; EDS I ; II ; III ; IV et EDS‐MICS 2010‐11) et à des documents de référence en matière de planification sectorielle pour finaliser le travail. Les travaux ont été essentiellement réalisés à l’aide du logiciel SPECTRUM qui est un système de modélisation consolidant différentes composantes dont le modèle DemProj développé par « The Futures Group International ». -

Region De Dakar
Annexe à l’arrêté déterminant la carte électorale nationale pour les élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation REGION DE DAKAR DEPARTEMENT DE DAKAR COMMUNE OU LOCALITE LIEU DE VOTE BUREAU DE VOTE IEF ALMADIES YOFF LYCEE DE YOFF ECOLE JAPONAISE SATOEISAT 02 ECOLE DIAMALAYE YOFF ECOLE DEMBA NDOYE 02 LYCEE OUAKAM 02 NGOR -OUAKAM ECOLE MBAYE DIOP 02 LYCEE NGALANDOU DIOUF 01 MERMOZ SACRE-COEUR ECOLE MASS MASSAER DIOP 01 TOTAL : 08 LIEUX DE VOTE 10 BUREAUX DE VOTE IEF GRAND DAKAR CEM HANN 01 HANN BEL AIR EL HOUDOU MABTHIE 01 KAWABATA YASUNARI 01 HLM CEM DR SAMBA GUEYE 01 OUAGOU NIAYES 3/A 01 HLM 4 /B 01 CEM LIBERTE 6/C 01 DIEUPEUL SICAP / LIBERTE LIBERTE 6/A 01 DERKLE 2/A 01 CEM EL H BADARA MBAYE KABA 01 BSCUITERIE / GRAND - AMADOU DIAGNE WORE 01 DAKAR BSCUITERIE 01 TOTAL 11 lieux de vote 12 BUREAUX DE VOTE IEF PARCELLES ASSAINIES PA 1/ PA2 LYCEE PA U13 03 LYCEE SERGENT MALAMINE CAMARA 02 ECOLE ELEMENTAIRE PAC /U8 02 ECOLE ELEMENTAIRE PAC /U3 02 LYCEE TALIBOU DABO 02 ECOLE ELEMENTAIRE P.O. HLM 02 GRAND YOFF ECOLE ELEMENTAIRE SCAT URBAM 02 LYCEE PATTE D’OIE BUILDERS 02 PATTE DOIE / CAMBARENE ECOLE ELEMENTAIRE SOPRIM 01 TOTAL LIEUX DE VOTE : 09 18 BUREAUX DE VOTE IEF /DAKAR PLATEAU LYCEE BLAISE DIAGNE 03 LYCEE FADHILOU MBACKE 01 A AHMADOU BAMBA MBACKE DIOP 01 LYCEE JOHN FITZGERALD KENNEDY 03 LYCEE MIXTE MAURICE DELAFOSSE 05 B ECOLE ELEMENTAIRE COLOBANE 2 02 ECOLE MANGUIERS 2 01 ECOLE ELEMENTAIRE SACOURA BADIANE 02 LYCEE LAMINE GUEYE 02 LYCEE EL HADJI MALICK SY 01 C ECOLE ELEMENTAIRE MOUR -
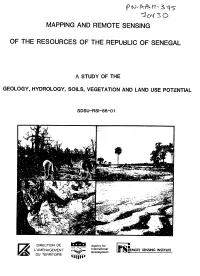
Mapping and Remote Sensing of the Resources of the Republic of Senegal
MAPPING AND REMOTE SENSING OF THE RESOURCES OF THE REPUBLIC OF SENEGAL A STUDY OF THE GEOLOGY, HYDROLOGY, SOILS, VEGETATION AND LAND USE POTENTIAL SDSU-RSI-86-O 1 -Al DIRECTION DE __ Agency for International REMOTE SENSING INSTITUTE L'AMENAGEMENT Development DU TERRITOIRE ..i..... MAPPING AND REMOTE SENSING OF THE RESOURCES OF THE REPUBLIC OF SENEGAL A STUDY OF THE GEOLOGY, HYDROLOGY, SOILS, VEGETATION AND LAND USE POTENTIAL For THE REPUBLIC OF SENEGAL LE MINISTERE DE L'INTERIEUP SECRETARIAT D'ETAT A LA DECENTRALISATION Prepared by THE REMOTE SENSING INSTITUTE SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY BROOKINGS, SOUTH DAKOTA 57007, USA Project Director - Victor I. Myers Chief of Party - Andrew S. Stancioff Authors Geology and Hydrology - Andrew Stancioff Soils/Land Capability - Marc Staljanssens Vegetation/Land Use - Gray Tappan Under Contract To THE UNITED STATED AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT MAPPING AND REMOTE SENSING PROJECT CONTRACT N0 -AID/afr-685-0233-C-00-2013-00 Cover Photographs Top Left: A pasture among baobabs on the Bargny Plateau. Top Right: Rice fields and swamp priairesof Basse Casamance. Bottom Left: A portion of a Landsat image of Basse Casamance taken on February 21, 1973 (dry season). Bottom Right: A low altitude, oblique aerial photograph of a series of niayes northeast of Fas Boye. Altitude: 700 m; Date: April 27, 1984. PREFACE Science's only hope of escaping a Tower of Babel calamity is the preparationfrom time to time of works which sumarize and which popularize the endless series of disconnected technical contributions. Carl L. Hubbs 1935 This report contains the results of a 1982-1985 survey of the resources of Senegal for the National Plan for Land Use and Development. -

Implantation Des Bureaux De Vote
Election présidentielle du 24 février 2019 ARRETE N°001228 du 23 janvier 2019 Implantation des bureaux de vote ! LIEU DE VOTE N° Electeurs Implantation CASE DES TOUT PETITS V.D.N. 01 591 CLASSE GRANDE SECTION CASE DES TOUT PETITS V.D.N. 02 592 CLASSE MOYENNE SECTION CASE DES TOUT PETITS V.D.N. 03 543 SALLE DE CLASSE ECOLE LIBERTE 5 01 561 CLASSE CM2 C ECOLE LIBERTE 5 02 561 CLASSE CM1 B ECOLE LIBERTE 5 03 563 CLASSE CP A ECOLE LIBERTE 5 04 561 CLASSE CP B ECOLE LIBERTE 5 05 560 CLASSE CE1 A ECOLE LIBERTE 5 06 561 CLASSE CE1 B ECOLE LIBERTE 5 07 563 CLASSE CM1 A ECOLE LIBERTE 5 08 562 CLASSE CM2 B ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 01 567 CLASSE CI A ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 02 569 CLASSE CE1 ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 03 571 CLASSE CE2 ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 04 569 CLASSE CM1 ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 05 569 CLASSE CM2 A ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 06 570 CLASSE CI B ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 07 572 CLASSE CP B ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 08 570 CLASSE CPA ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 09 491 SALLE DE CLASSE ECOLE NAFISSATOU NIANG 01 597 CLASSE CE1 A ECOLE NAFISSATOU NIANG 02 599 CLASSE CI A ECOLE NAFISSATOU NIANG 03 595 CLASSE CE2 A ECOLE NAFISSATOU NIANG 04 597 CLASSE CM1 A ECOLE NAFISSATOU NIANG 05 597 CLASSE CM2 B 1/1060 Election présidentielle du 24 février 2019 ARRETE N°001228 du 23 janvier 2019 Implantation des bureaux de vote ! LIEU DE VOTE N° Electeurs Implantation ECOLE NAFISSATOU NIANG 06 65 CLASSE CM -

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un but – Une Foi Ministère De L’Agriculture Et De L’Equipement Rural
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural DOSSIER DE SOUMISSION DE PROJET AU GUICHET III : « DIFFUSION A GRANDE ECHELLE D’UN MODELE DE TECHNOLOGIES D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET LA COMMERCIALISATION DU MAÏS, DU MIL ET DU SORGHO DE QUALITE DANS LA ZONE DU SENEGAL ORIENTAL ET HAUTE CASAMANCE » Avril : 2013 1 SOMMAIRE 1.TITRE DU PROJET : .................................................................................................................... 3 FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET ........................................................................................ 7 1.1. Description détaillée du type de technologies à valoriser ........................................ 9 1.2. Provenance de la technologie : ................................................................................ 9 1.3. Aire géographique de diffusion : ........................................................................... 10 1.4. Cible de la grande diffusion .............................................................................................. 10 1.5. Durée ...................................................................................................................... 11 BUDGET .................................................................................................................................. 12 2. OBJECTIFS DU PROJET ................................................................................................... 13 2.1. Objectif global : ................................................................................................................ -
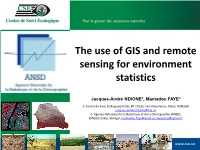
GIS and Remote Sensing for Environment Statistics
The use of GIS and remote sensing for environment statistics Jacques-André NDIONE1, Mamadou FAYE2 1- Centre de Suivi Ecologique (CSE), BP 15532, Fann Residence, Dakar, SENEGAL [email protected] 2- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), (ANSD), Dakar, Sénégal, [email protected], [email protected] Outline • Introduction • Concepts – Environment statistics – Remote sensing – GIS • Examples of using RS and GIS • Conclusion Climate change should be added… Ongoing dialogue between data demand and data supply… Environment statistics “Environment statistics are statistics that describe the state and trends of the environment, covering the media of the natural environment (air/climate, water, land/soil), the biota within the media, and human settlements.” UNSD. 1997. Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67 Environment statistics (2) Scope of Environment Stats Perception of major users and producers (UNECA) Socioeconomic and Specific to Ezigbalike environmental particular policies conditions Dozie : Courtesy Environment statistics (3) FDES The challenge of producing environment statistics (UNECA) Ezigbalike Dozie : Courtesy Remote sensing: definition • Remote sensing is the collection of information about an object without being in direct physical contact with the object. • Remote Sensing is a technology for sampling electromagnetic radiation to acquire and interpret non-immediate geospatial data from which to extract information about features, objects, and classes on the Earth's land surface, oceans, and atmosphere. (UNECA) - Dr. Nicholas Short Ezigbalike Dozie : 9 Courtesy Elements involved in Remote sensing 1. Energy Source or Illumination (A) 2. Radiation and the Atmosphere (B) 3. Interaction with the Object (C) 4. Recording of Energy by the Sensor (D) 5. -

Les Premiers Recensements Au Sénégal Et L'évolution Démographique
Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique Partie I : Présentation des documents Charles Becker et Victor Martin, CNRS Jean Schmitz et Monique Chastanet, ORSTOM Avec la collaboration de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, archivistes Ce document représente la mise en format électronique du document publié sous le même titre en 1983, qui est reproduit ici avec une pagination différente, mais en signa- lant les débuts des pages de la première version qui est à citer sour le titre : Charles Becker, Victor Martin, Jean Schmitz, Monique Chastanet, avec la collabora- tion de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, Les premiers recensements au Sé- négal et l’évolution démographique. Présentation de documents. Dakar, ORSTOM, 1983, 230 p. La présente version peut donc être citée soit selon la pagination de l’ouvrage originel, soit selon la pagination de cette version électronique, en mentionnant : Charles Becker, Victor Martin, Jean Schmitz, Monique Chastanet, avec la collabora- tion de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, Les premiers recensements au Sé- négal et l’évolution démographique. Présentation de documents. Dakar, 2008, 1 + 219 p. Dakar septembre 2008 Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique Partie I : Présentation des documents 1 Charles Becker et Victor Martin, CNRS Jean Schmitz et Monique Chastanet, ORSTOM Avec la collaboration de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, archivistes Kaolack - Dakar janvier 1983 1 La partie II (Commentaire des documents et étude sur l’évolution démographique) est en cours de préparation. Elle sera rédigée par les auteurs de cette première partie et par d’autres collaborateurs. Elle traitera surtout des données relatives aux effectifs de population et aux mouvements migratoires qui ont modifié profondément la configuration démographique du Sénégal depuis le milieu du 19ème siècle. -

Ressources Naturelles Du Sénégal
Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles du Sénégal République du Sénégal Un peuple, un but, une foi Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels Annuaire sur l’Environnement et les Ressources Naturelles du Sénégal Deuxième édition Mai 2009 Annuaire sur l'Environnement et les Ressources Naturelles du Sénégal Résumé exécutif Le Sénégal s'est engagé résolument dans une dynamique réelle d'élaboration et de mise en œuvre de politiques et programmes dont l'objectif ultime est d'améliorer durablement les conditions et le cadre de vie des populations. Ainsi, et successivement, le Sénégal a élaboré divers documents d'importance tels que le Plan National d'Actions pour l'Environnement (PNAE), le Programme d'Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD), la Stratégie de Conservation de la Biodiversité au Sénégal, la première Communication Nationale dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et le Document de Stratégie d’Orientation pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP II). La mise en oeuvre de ces plans et programmes doit reposer sur l'utilisation de données fiables, pertinentes, voire actuelles. En outre, la demande en informations sur l’environnement et les ressources naturelles est de plus en plus importante du fait, entre autres, des fortes pressions sur des ressources naturelles limitées et des enjeux des changements climatiques. C'est dans ce cadre que le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels, a décidé de l’élaboration d’un "Annuaire sur l'Environnement et les Ressources Naturelles du Sénégal" dont la mise à jour doit être périodique de manière à prendre en compte les changements intervenus afin de mettre à la disposition des utilisateurs une base de données actualisées sur l'état de l'environnement du pays.