Diffusion a Grande Echelle D'un Paquet De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
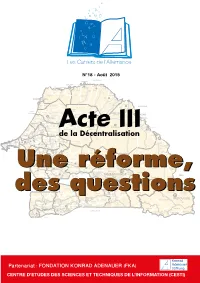
Acte III Une Réforme, Des Questions Une Réforme, Des Questions
N°18 - Août 2015 MAURITANIE PODOR DAGANA Gamadji Sarré Dodel Rosso Sénégal Ndiandane Richard Toll Thillé Boubakar Guédé Ndioum Village Ronkh Gaé Aéré Lao Cas Cas Ross Béthio Mbane Fanaye Ndiayène Mboumba Pendao Golléré SAINT-LOUIS Région de Madina Saldé Ndiatbé SAINT-LOUIS Pété Galoya Syer Thilogne Gandon Mpal Keur Momar Sar Région de Toucouleur MAURITANIE Tessekéré Forage SAINT-LOUIS Rao Agnam Civol Dabia Bokidiawé Sakal Région de Océan LOUGA Léona Nguène Sar Nguer Malal Gandé Mboula Labgar Oréfondé Nabbadji Civol Atlantique Niomré Région de Mbeuleukhé MATAM Pété Ouarack MATAM Kelle Yang-Yang Dodji Gueye Thieppe Bandègne KANEL LOUGA Lougré Thiolly Coki Ogo Ouolof Mbédiène Kamb Géoul Thiamène Diokoul Diawrigne Ndiagne Kanène Cayor Boulal Thiolom KEBEMER Ndiob Thiamène Djolof Ouakhokh Région de Fall Sinthiou Loro Touba Sam LOUGA Bamambé Ndande Sagata Ménina Yabal Dahra Ngandiouf Geth BarkedjiRégion de RANEROU Ndoyenne Orkadiéré Waoundé Sagatta Dioloff Mboro Darou Mbayène Darou LOUGA Khoudoss Semme Méouane Médina Pékesse Mamane Thiargny Dakhar MbadianeActe III Moudéry Taïba Pire Niakhène Thimakha Ndiaye Gourèye Koul Darou Mousty Déali Notto Gouye DiawaraBokiladji Diama Pambal TIVAOUANE de la DécentralisationRégion de Kayar Diender Mont Rolland Chérif Lô MATAM Guedj Vélingara Oudalaye Wourou Sidy Aouré Touba Région de Thiel Fandène Thiénaba Toul Région de Pout Région de DIOURBEL Région de Gassane khombole Région de Région de DAKAR DIOURBEL Keur Ngoundiane DIOURBEL LOUGA MATAM Gabou Moussa Notto Ndiayène THIES Sirah Région de Ballou Ndiass -

SEN FRA REP2 1999.Pdf
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE Projet GCP/SEN/048/NET Recensement National de l’Agriculture et Système Permanent de Statistiques Agricoles RECENSEMENT NATIONAL DE L’AGRICULTURE 1998-99 Volume 2 Répertoire des villages d’après le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 Août 1999 ___________________________________________________________________________ ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) Sommaire Données récapitulatives par unité administrative ……………………………………….… 9 Données individuelles relatives à la région de Dakar …………………………………….. 35 Données individuelles relatives à la région de Diourbel …………………………………. 41 Données individuelles relatives à la région de Saint-Louis ………………………….….. 105 Données individuelles relatives à la région de Tambacounda …………………………... 157 Données individuelles relatives à la région de Kaolack …………………………………. 237 Données individuelles relatives à la région de Thiès ……………………………………. 347 Données individuelles relatives à la région de Louga …………………………………… 427 Données individuelles relatives à la région de Fatick …………………………………… 557 Données individuelles relatives à la région de Kolda …………………………………… 617 Carte administrative du Sénégal ………………………………………………………… 727 3 Avant-propos Ce volume 2 des publications sur le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 est consacré à la publication d’un répertoire des villages construit à partir des données issues des opérations de collecte du pré-recensement qui ont consisté en une opération de cartographie censitaire et en une enquête sur les ménages ruraux. Le répertoire des villages publié dans ce volume 2 est simplement la liste exhaustive des villages, avec pour chaque village, les valeurs de plusieurs paramètres de taille. A titre d’exemple, l’effectif des concessions rurales, l’effectif des ménages ruraux et l’effectif des ménages ruraux agricoles sont trois variables de taille du village dont les valeurs figurent dans ce répertoire des villages. -

Region De Dakar
Annexe à l’arrêté déterminant la carte électorale nationale pour les élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation REGION DE DAKAR DEPARTEMENT DE DAKAR COMMUNE OU LOCALITE LIEU DE VOTE BUREAU DE VOTE IEF ALMADIES YOFF LYCEE DE YOFF ECOLE JAPONAISE SATOEISAT 02 ECOLE DIAMALAYE YOFF ECOLE DEMBA NDOYE 02 LYCEE OUAKAM 02 NGOR -OUAKAM ECOLE MBAYE DIOP 02 LYCEE NGALANDOU DIOUF 01 MERMOZ SACRE-COEUR ECOLE MASS MASSAER DIOP 01 TOTAL : 08 LIEUX DE VOTE 10 BUREAUX DE VOTE IEF GRAND DAKAR CEM HANN 01 HANN BEL AIR EL HOUDOU MABTHIE 01 KAWABATA YASUNARI 01 HLM CEM DR SAMBA GUEYE 01 OUAGOU NIAYES 3/A 01 HLM 4 /B 01 CEM LIBERTE 6/C 01 DIEUPEUL SICAP / LIBERTE LIBERTE 6/A 01 DERKLE 2/A 01 CEM EL H BADARA MBAYE KABA 01 BSCUITERIE / GRAND - AMADOU DIAGNE WORE 01 DAKAR BSCUITERIE 01 TOTAL 11 lieux de vote 12 BUREAUX DE VOTE IEF PARCELLES ASSAINIES PA 1/ PA2 LYCEE PA U13 03 LYCEE SERGENT MALAMINE CAMARA 02 ECOLE ELEMENTAIRE PAC /U8 02 ECOLE ELEMENTAIRE PAC /U3 02 LYCEE TALIBOU DABO 02 ECOLE ELEMENTAIRE P.O. HLM 02 GRAND YOFF ECOLE ELEMENTAIRE SCAT URBAM 02 LYCEE PATTE D’OIE BUILDERS 02 PATTE DOIE / CAMBARENE ECOLE ELEMENTAIRE SOPRIM 01 TOTAL LIEUX DE VOTE : 09 18 BUREAUX DE VOTE IEF /DAKAR PLATEAU LYCEE BLAISE DIAGNE 03 LYCEE FADHILOU MBACKE 01 A AHMADOU BAMBA MBACKE DIOP 01 LYCEE JOHN FITZGERALD KENNEDY 03 LYCEE MIXTE MAURICE DELAFOSSE 05 B ECOLE ELEMENTAIRE COLOBANE 2 02 ECOLE MANGUIERS 2 01 ECOLE ELEMENTAIRE SACOURA BADIANE 02 LYCEE LAMINE GUEYE 02 LYCEE EL HADJI MALICK SY 01 C ECOLE ELEMENTAIRE MOUR -
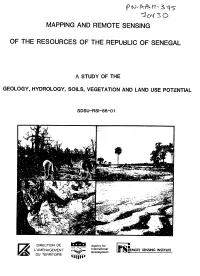
Mapping and Remote Sensing of the Resources of the Republic of Senegal
MAPPING AND REMOTE SENSING OF THE RESOURCES OF THE REPUBLIC OF SENEGAL A STUDY OF THE GEOLOGY, HYDROLOGY, SOILS, VEGETATION AND LAND USE POTENTIAL SDSU-RSI-86-O 1 -Al DIRECTION DE __ Agency for International REMOTE SENSING INSTITUTE L'AMENAGEMENT Development DU TERRITOIRE ..i..... MAPPING AND REMOTE SENSING OF THE RESOURCES OF THE REPUBLIC OF SENEGAL A STUDY OF THE GEOLOGY, HYDROLOGY, SOILS, VEGETATION AND LAND USE POTENTIAL For THE REPUBLIC OF SENEGAL LE MINISTERE DE L'INTERIEUP SECRETARIAT D'ETAT A LA DECENTRALISATION Prepared by THE REMOTE SENSING INSTITUTE SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY BROOKINGS, SOUTH DAKOTA 57007, USA Project Director - Victor I. Myers Chief of Party - Andrew S. Stancioff Authors Geology and Hydrology - Andrew Stancioff Soils/Land Capability - Marc Staljanssens Vegetation/Land Use - Gray Tappan Under Contract To THE UNITED STATED AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT MAPPING AND REMOTE SENSING PROJECT CONTRACT N0 -AID/afr-685-0233-C-00-2013-00 Cover Photographs Top Left: A pasture among baobabs on the Bargny Plateau. Top Right: Rice fields and swamp priairesof Basse Casamance. Bottom Left: A portion of a Landsat image of Basse Casamance taken on February 21, 1973 (dry season). Bottom Right: A low altitude, oblique aerial photograph of a series of niayes northeast of Fas Boye. Altitude: 700 m; Date: April 27, 1984. PREFACE Science's only hope of escaping a Tower of Babel calamity is the preparationfrom time to time of works which sumarize and which popularize the endless series of disconnected technical contributions. Carl L. Hubbs 1935 This report contains the results of a 1982-1985 survey of the resources of Senegal for the National Plan for Land Use and Development. -

Implantation Des Bureaux De Vote
Election présidentielle du 24 février 2019 ARRETE N°001228 du 23 janvier 2019 Implantation des bureaux de vote ! LIEU DE VOTE N° Electeurs Implantation CASE DES TOUT PETITS V.D.N. 01 591 CLASSE GRANDE SECTION CASE DES TOUT PETITS V.D.N. 02 592 CLASSE MOYENNE SECTION CASE DES TOUT PETITS V.D.N. 03 543 SALLE DE CLASSE ECOLE LIBERTE 5 01 561 CLASSE CM2 C ECOLE LIBERTE 5 02 561 CLASSE CM1 B ECOLE LIBERTE 5 03 563 CLASSE CP A ECOLE LIBERTE 5 04 561 CLASSE CP B ECOLE LIBERTE 5 05 560 CLASSE CE1 A ECOLE LIBERTE 5 06 561 CLASSE CE1 B ECOLE LIBERTE 5 07 563 CLASSE CM1 A ECOLE LIBERTE 5 08 562 CLASSE CM2 B ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 01 567 CLASSE CI A ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 02 569 CLASSE CE1 ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 03 571 CLASSE CE2 ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 04 569 CLASSE CM1 ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 05 569 CLASSE CM2 A ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 06 570 CLASSE CI B ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 07 572 CLASSE CP B ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 08 570 CLASSE CPA ECOLE MASSE MASSAER NIANE1 (BAOBAB) 09 491 SALLE DE CLASSE ECOLE NAFISSATOU NIANG 01 597 CLASSE CE1 A ECOLE NAFISSATOU NIANG 02 599 CLASSE CI A ECOLE NAFISSATOU NIANG 03 595 CLASSE CE2 A ECOLE NAFISSATOU NIANG 04 597 CLASSE CM1 A ECOLE NAFISSATOU NIANG 05 597 CLASSE CM2 B 1/1060 Election présidentielle du 24 février 2019 ARRETE N°001228 du 23 janvier 2019 Implantation des bureaux de vote ! LIEU DE VOTE N° Electeurs Implantation ECOLE NAFISSATOU NIANG 06 65 CLASSE CM -

Les Premiers Recensements Au Sénégal Et L'évolution Démographique
Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique Partie I : Présentation des documents Charles Becker et Victor Martin, CNRS Jean Schmitz et Monique Chastanet, ORSTOM Avec la collaboration de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, archivistes Ce document représente la mise en format électronique du document publié sous le même titre en 1983, qui est reproduit ici avec une pagination différente, mais en signa- lant les débuts des pages de la première version qui est à citer sour le titre : Charles Becker, Victor Martin, Jean Schmitz, Monique Chastanet, avec la collabora- tion de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, Les premiers recensements au Sé- négal et l’évolution démographique. Présentation de documents. Dakar, ORSTOM, 1983, 230 p. La présente version peut donc être citée soit selon la pagination de l’ouvrage originel, soit selon la pagination de cette version électronique, en mentionnant : Charles Becker, Victor Martin, Jean Schmitz, Monique Chastanet, avec la collabora- tion de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, Les premiers recensements au Sé- négal et l’évolution démographique. Présentation de documents. Dakar, 2008, 1 + 219 p. Dakar septembre 2008 Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique Partie I : Présentation des documents 1 Charles Becker et Victor Martin, CNRS Jean Schmitz et Monique Chastanet, ORSTOM Avec la collaboration de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, archivistes Kaolack - Dakar janvier 1983 1 La partie II (Commentaire des documents et étude sur l’évolution démographique) est en cours de préparation. Elle sera rédigée par les auteurs de cette première partie et par d’autres collaborateurs. Elle traitera surtout des données relatives aux effectifs de population et aux mouvements migratoires qui ont modifié profondément la configuration démographique du Sénégal depuis le milieu du 19ème siècle. -

Ressources Naturelles Du Sénégal
Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles du Sénégal République du Sénégal Un peuple, un but, une foi Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels Annuaire sur l’Environnement et les Ressources Naturelles du Sénégal Deuxième édition Mai 2009 Annuaire sur l'Environnement et les Ressources Naturelles du Sénégal Résumé exécutif Le Sénégal s'est engagé résolument dans une dynamique réelle d'élaboration et de mise en œuvre de politiques et programmes dont l'objectif ultime est d'améliorer durablement les conditions et le cadre de vie des populations. Ainsi, et successivement, le Sénégal a élaboré divers documents d'importance tels que le Plan National d'Actions pour l'Environnement (PNAE), le Programme d'Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD), la Stratégie de Conservation de la Biodiversité au Sénégal, la première Communication Nationale dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et le Document de Stratégie d’Orientation pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP II). La mise en oeuvre de ces plans et programmes doit reposer sur l'utilisation de données fiables, pertinentes, voire actuelles. En outre, la demande en informations sur l’environnement et les ressources naturelles est de plus en plus importante du fait, entre autres, des fortes pressions sur des ressources naturelles limitées et des enjeux des changements climatiques. C'est dans ce cadre que le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels, a décidé de l’élaboration d’un "Annuaire sur l'Environnement et les Ressources Naturelles du Sénégal" dont la mise à jour doit être périodique de manière à prendre en compte les changements intervenus afin de mettre à la disposition des utilisateurs une base de données actualisées sur l'état de l'environnement du pays. -

Estimating the Burden of Malaria in Senegal: Bayesian Zero-Inflated Binomial Geostatistical Modeling of the MIS 2008 Data
Estimating the Burden of Malaria in Senegal: Bayesian Zero-Inflated Binomial Geostatistical Modeling of the MIS 2008 Data Federica Giardina1,2, Laura Gosoniu1,2, Lassana Konate3, Mame Birame Diouf4, Robert Perry5, Oumar Gaye6, Ousmane Faye3, Penelope Vounatsou1,2* 1 Department of Epidemiology and Public Health, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland, 2 University of Basel, Basel, Switzerland, 3 Faculte´ des Sciences et Techniques, UCAD Dakar, Se´ne´gal, 4 National Malaria Control Programme, Dakar, Se´ne´gal, 5 Center for Global Health, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, United States of America, 6 Faculte´ de Me´decine, Pharmacie et Odontologie, UCAD Dakar, Se´ne´gal Abstract The Research Center for Human Development in Dakar (CRDH) with the technical assistance of ICF Macro and the National Malaria Control Programme (NMCP) conducted in 2008/2009 the Senegal Malaria Indicator Survey (SMIS), the first nationally representative household survey collecting parasitological data and malaria-related indicators. In this paper, we present spatially explicit parasitaemia risk estimates and number of infected children below 5 years. Geostatistical Zero-Inflated Binomial models (ZIB) were developed to take into account the large number of zero-prevalence survey locations (70%) in the data. Bayesian variable selection methods were incorporated within a geostatistical framework in order to choose the best set of environmental and climatic covariates associated with the parasitaemia risk. Model validation confirmed that the ZIB model had a better predictive ability than the standard Binomial analogue. Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods were used for inference. Several insecticide treated nets (ITN) coverage indicators were calculated to assess the effectiveness of interventions. -
NOTES TECHNIQUES February 2017 TECHNICAL REPORTS No
NOTES TECHNIQUES February 2017 TECHNICAL REPORTS No. 25 Socio-physical Vulnerability to Flooding in Senegal An Exploratory Analysis with New Data & Google Earth Engine Authors Bessie SCHWARZ, Beth TELLMAN, Jonathan SULLIVAN, Catherine KUHN, Richa MAHTTA, Bhartendu PANDEY, Laura HAMMETT (Cloud To Street), Gabriel PESTRE (Data-Pop Alliance) Coordination Thomas ROCA (AFD) Country Senegal Key words Data-science, Flood, Machine Learning, Satellite, Vulnerability AFD, 5 rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, France ̶ +33 1 53 44 31 31 ̶ +33 1 53 44 39 57 [email protected] ̶ http://librairie.afd.fr AUTHORS AUTHORS Bessie SCHWARZ, Beth TELLMAN, Jonathan SULLIVAN, Catherine KUHN, Richa MAHTTA, Bhartendu PANDEY, Laura HAMMETT (Cloud to Street), Gabriel PESTRE (Data-Pop Alliance) ORIGINAL LANGUAGE English ISSN 2492-2838 COPYRIGHT 1st quarter 2017 DISCLAIMER The analyses and conclusions in this document in no way reflect the views of the Agence Française de Développement or its supervisory bodies. All Technical Reports can be downloaded on AFD’s publications website: http://librairie.afd.fr 1 | TECHNICAL REPORT – N°24 – FEBRUARY 2017 Contents Contents AUTHORS ............................................................................................................................................................... 1 CONTENTS .............................................................................................................................................................. 2 ABSTRACT ............................................................................................................................................................. -

Project for Urban Master Plan of Dakar and Neighboring Area for 2035 Final Report Volume. I
No. Ministry of Urban Renewal, Japan International Cooperation Housing and Living Environment Agency (JICA) Republic of Senegal Project for Urban Master Plan of Dakar and Neighboring Area for 2035 Final Report Volume. I January 2016 Implemented by: RECS International Inc. Oriental Consultants Global Co., Ltd. PACET Corp. CTI Engineering International Co., Ltd. Asia Air Survey Co., Ltd. EI JR 16-002 Ministry of Urban Renewal, Japan International Cooperation Housing and Living Environment Agency (JICA) Republic of Senegal Project for Urban Master Plan of Dakar and Neighboring Area for 2035 Final Report Volume. I January 2016 Implemented by: RECS International Inc. Oriental Consultants Global Co., Ltd. PACET Corp. CTI Engineering International Co., Ltd. Asia Air Survey Co., Ltd. Currency Equivalents (average Interbank rates between May and July, 2015) US$1.00= FCFA 594.04 €1.00= FCFA 659.95 Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) Rate Project for Urban Master Plan of Dakar and Neighboring Area for 2035 Final Report: Volume. I Table of Contents Volume. I EXECUTIVE SUMMARY CHAPTER 1 INTRODUCTION ...................................................................................................... 1-1 1.1 Background ........................................................................................................................... 1-1 1.2 Objectives ............................................................................................................................. 1-3 1.3 Study Area ............................................................................................................................ -

20-Tableaux-Annexes 2005.Pdf
Situation Economique et Sociale du Sénégal Edition 2005 Directeur Général, Directeur de Publication : Babakar FALL Directeur des Statistiques Economiques et de la Alhousseynou SARR Comptabilité Nationale : Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales : Ibrahime SARR Directeur du Management du Système Mamadou NIANG d’Information Statistique : Coordonnateur de la Cellule de Programmation E.Hadji Malick DIAME d’Harmonisation, de Coordination et de Coopération Internationale : COMITE DE LECTURE : Abdou Salam Thiam -- Hamidou Bâ -- Mamadou Ndao – Sitapha Diamé – Momar Ballé Sylla – Mme Aîssatou Guèye Thiam -- Mbacké Bâ -- Bakary Djiba AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE Rue de Diourbel X Rue de Saint Louis Point E Dakar. B.P. 116 Dakar R.P -- Tél. : (221) 824 03 01 (221) 825 33 32 (221) 825 00 50 Fax : 824 90 01 Site Internet : www.ansd.org e-mail :[email protected] Distribution : Division de la Diffusion de la Documentation et des Relations avec les Usagers 2 Situation Economique et Sociale du Sénégal Edition 2005 COMITE DE REDACTION CHAPITRES REDACTEURS Coordination: E.H. MALICK DIAME – 0. PRESENTATION DU PAYS MORY DIOUSS 1. DEMOGRAPHIE Mme Vénus Sarr Thiaw 2. EDUCATION Atoumane Ndiaye 3. EMPLOI M. Papa Ibrahima Sylmang Sène 4. SANTE Binta Mbow 5. ASSISTANCE Mme Salimata Diallo Seck 6. AGRICULTURE Ousseynou SARR / Issa Wade 7. ENVIRONNEMENT Mam Siga Dia 8. ELEVAGE Ousseynou SARR / Mamadou Cissé 9. PECHE MARITIME SENEGALAISE MME Astou Ndiaye 10. TRANSPORT Papa Seyni THIAM / Sylvain Pierre Ndione 11. TOURISME Papa Seyni THIAM / Mme Rama Fall Gaye 12. JUSTICE Mme Fatou Faye Mbessane 13. BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS Amadou Bamba DIOP 14. -

En 2016 Un Extrait Des Projections Démographiques Du RGPHAE 2013
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Direction des Statistiques Démographiques et Sociales Division du Recensement et des Statistiques Démographiques Bureau Etat Civil et Projections Démographiques La population du Sénégal en 2016 Un extrait des projections démographiques du RGPHAE 2013. ANSD-DECEMBRE 2016 1 Population du Sénégal en 2016/MEFP/ANSD- décembre 2016 COMITE DE DIRECTION Directeur Général Aboubacar Sédikh BEYE Directeur Général Adjoint Babacar NDIR Directeur des Statistiques Démographiques et Papa Ibrahima Sylmang SENE Sociales Chef de la Division des Statistiques Samba NDIAYE Démographiques et Sociales Chef du Bureau Etat Civil et Projections Démographiques Mahmouth DIOUF Experts Mory DIOUSS, Maguette SARR, Boubacar BA Pour tout renseignement, veuillez contacter l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD),Tel: (221) 33 869 21 39. Fax: (221) 33 824 36 15, Internet: www.ansd.sn BP 116, Dakar, Sénégal 2 Population du Sénégal en 2016/MEFP/ANSD- décembre 2016 PRESENTATION Les questions de populations sont cruciales pour le développement et l’avenir d’un pays. Le défi des pays en développement repose sur la maitrise de la démographie. Pour cela, le Sénégal qui s’est engagé dans la dynamique de l’émergence se doit de maîtriser systématiquement ses paramètres démographiques. Les tendances démographiques ne sont pas inévitables, la plupart étant influencées par des politiques. La démographie a un impact sur le développement économique, sur l'environnement et sur les ressources de la terre qui sont limitées. Dans cette dynamique, il s’avère indispensable de disposer d’informations statistiques fiables sur l’état de la population pour accompagner les politiques de développement économique et social du pays.