Cahiers D'asie Centrale, 19-20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
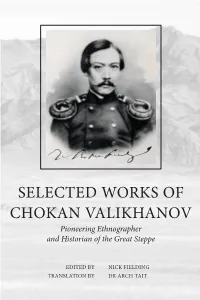
Selected Works of Chokan Valikhanov Selected Works of Chokan Valikhanov
SELECTED WORKS OF CHOKAN VALIKHANOV CHOKAN OF WORKS SELECTED SELECTED WORKS OF CHOKAN VALIKHANOV Pioneering Ethnographer and Historian of the Great Steppe When Chokan Valikhanov died of tuberculosis in 1865, aged only 29, the Russian academician Nikolai Veselovsky described his short life as ‘a meteor flashing across the field of oriental studies’. Set against his remarkable output of official reports, articles and research into the history, culture and ethnology of Central Asia, and more important, his Kazakh people, it remains an entirely appropriate accolade. Born in 1835 into a wealthy and powerful Kazakh clan, he was one of the first ‘people of the steppe’ to receive a Russian education and military training. Soon after graduating from Siberian Cadet Corps at Omsk, he was taking part in reconnaissance missions deep into regions of Central Asia that had seldom been visited by outsiders. His famous mission to Kashgar in Chinese Turkestan, which began in June 1858 and lasted for more than a year, saw him in disguise as a Tashkent mer- chant, risking his life to gather vital information not just on current events, but also on the ethnic make-up, geography, flora and fauna of this unknown region. Journeys to Kuldzha, to Issyk-Kol and to other remote and unmapped places quickly established his reputation, even though he al- ways remained inorodets – an outsider to the Russian establishment. Nonetheless, he was elected to membership of the Imperial Russian Geographical Society and spent time in St Petersburg, where he was given a private audience by the Tsar. Wherever he went he made his mark, striking up strong and lasting friendships with the likes of the great Russian explorer and geographer Pyotr Petrovich Semyonov-Tian-Shansky and the writer Fyodor Dostoyevsky. -

Central Asia's Affairs №3
CONTENTS CONTENTS 3/2020 Issued Quarterly Since 2003 Editor-in-Chief Zarema Shaukenova ASSEL NAZARBetoVA Fighting the Covid-19 Pandemic: Head of the Department of International Studies of KazISS Kazakhstan’s Experience, Approaches, Measures, and Solutions ........................................................ 7 Editor AnastassIYa ReSHetnyaK Senior Research Fellow of KazISS Nabizhan Muhametkhanuly Amanzhan Arzykulov Responsible for publication: Almas Arzikulov Development of the Cooperation between Layout: Valeriy Glukhov Kazakhstan and China on Production Capacity ................... 15 LLC «Delta Consulting Group» Translation by Aidana Akessina Address: Kazakhstan Institute Kazakhstan’s Border Policy as a Basis for Strategic Studies under the President for Ensuring Inter-Ethnic Harmony ..................................... 23 of the Republic of Kazakhstan 4, Beybitshilik St. Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan Beate Eschment Phone: (7172) 75 20 20 Kazakh and/or Kazakhstani? Fax: (7172) 75 20 21 E-mail: [email protected] The National Identity of the Republic www.kisi.kz of Kazakhstan and its Citizens ............................................ 30 This Journal was registered with the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan Rustem Kadyrzhanov on January 24, 2003. Registration certificate No. 3529-zh. On the Influence of Post-Soviet Ethnodemographic ISSN 2414-570X Dynamics on the Cultural Integration None of the articles shall be of Ethnoses in Kazakhstan .................................................. -

Birth of Tajikistan : National Identity and the Origins of the Republic
THE BIRTH OF TAJIKISTAN i THE BIRTH OF TAJIKISTAN ii THE BIRTH OF TAJIKISTAN For Suzanne Published in 2007 by I.B.Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 www.ibtauris.com In the United States of America and Canada distributed by Palgrave Macmillan a division of St. Martin's Press, 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 Copyright © Paul Bergne The right of Paul Bergne to be identified as the author of this work has been asserted by the author in accordance with the Copyright, Designs and Patent Act 1988. All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or any part thereof, may not be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. International Library of Central Asian Studies 1 ISBN: 978 1 84511 283 7 A full CIP record for this book is available from the British Library A full CIP record is available from the Library of Congress Library of Congress Catalog Card Number: available Printed and bound in India by Replika Press Pvt. Ltd From camera-ready copy edited and supplied by the author THE BIRTH OF TAJIKISTAN v CONTENTS Abbreviations vii Transliteration ix Acknowledgements xi Maps. Central Asia c 1929 xii Central Asia c 1919 xiv Introduction 1 1. Central Asian Identities before 1917 3 2. The Turkic Ascendancy 15 3. The Revolution and After 20 4. The Road to Soviet Power 28 5. -

ARTICLE FUNCTIONAL-SEMANTICMUTUAL SUBSTITUTION of CASES in the TURKIC-SPEAKING LITERARY MONUMENTS of the GOLDEN HORDE PERIOD Gulnara R
ISSN: 0976-3104 ISSUE: Multidisciplinary Social Science & Management ARTICLE FUNCTIONAL-SEMANTICMUTUAL SUBSTITUTION OF CASES IN THE TURKIC-SPEAKING LITERARY MONUMENTS OF THE GOLDEN HORDE PERIOD Gulnara R. Shakirova*, Gulnaz F. Gaynullina, Liliya M. Giniyatullina, Muslima M. Shakurova, Department of General Management, Kazan Federal University, Leo Tolstoy Institute of Philology and Intercultural Communication, Kazan, RUSSIA ABSTRACT The XIIIth – XIVth centuries were played the most important role of the development of the history and culture of Turkic nations and in the formation of the medieval Tatar ethnos. This period in the history of the Turkic literary language is marked, on the one hand, the beginning of kypchakizatsiya language monuments; on the other hand, Tatar literary language of a later period (XV – XVIII centuries) in its traditions goes directly to the literary language of the Golden Horde period that is to the written literary language of XIII – XIV centuries and Turkic-speaking monuments of this period are of direct relevance to the history of the Tatar language. This article attempts to analyze the functional-semantic mutual substitution cases in the Turkiс-speaking literary monuments of the Golden Horde period. And the Turkic-speaking monuments of this period are directly related to the history of the Tatar language. Turkological science has achieved significant success in the linguistic study of Turkish written monuments, which has the great importance both for tracing the evolution of the cultural and historical process of individual nations, and for recreating the history of Turkic languages. Despite this, written monuments of the history of the Tartar literary language of the earlier period (XIII – XIV centuries) have not been studied sufficiently. -

Tschinag Book Review
Journal of Central and Inner Asian Dialogue (Winter 2015) In Recognition of Uzbekistan’s Declaration of 2015 as the “Year of Respect for the Elders,” and Dedicated to Elders Everywhere www.jciadinfo.org Print ISSN: 2330-6602. Online ISSN: 2330-6610. www.jciadinfo.org (Winter 2015) SENIOR EDITOR Dr. Dmitry Funk, Moscow State University (Moscow) ASSISTANT EDITOR Alva Robinson, International Ataturk-Alatoo University (Bishkek) ADVISORY BOARD Muhammad Ali Akhmedov, Writers’ Union of Uzbekistan (Tashkent) Dr. Tynchtykbek Chorotegin, Kyrgyz National University (Bishkek) Dr. Arienne Dwyer, University of Kansas (Lawrence, KS) Dr. Ilse Laude-Cirtautas, University of Washington (Seattle, WA) EDITORIAL BOARD Dr. Alisher Abidjanov, National University of Uzbekistan (Tashkent) Dr. Charles Carlson, Kyrgyz – Turkish Manas University (Bishkek) Dr. Victoria Clement, Naval Postgraduate School (Monterey, CA) Dr. Kunduz Dzhusupekova, International Ataturk-Alatoo University (Bishkek) Dr. Ulan Erkinbaev, Suleyman Demirel University (Almaty) Dr. Gulnara Jamasheva, National Academy of Sciences of Kyrgyzstan (Bishkek) Dr. Alma Kunanbaeva, Stanford University (Stanford, CA) Dr. Ashirbek Muminov, Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan (Almaty) Jamiyan Sanjanov, Ph.D. Candidate, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude) Ilyas Tashtemirov, Ph.D. Candidate, International Ataturk-Alatoo University (Bishkek) Jonathan Washington, Ph.D. Candidate, Indiana University (Bloomington) Dr. Simon Wickham-Smith, National University of Mongolia (Ulan Baator) EDITOR’S ASSISTANT Azamat Sadykov (Seattle) The Journal of Central and Inner Asian Dialogue (JCIAD) is an annual online peer-reviewed academic journal. Founded in 2011, JCIAD is the only academic journal outside of Central and Inner Asia with emphasis on the important fields of culture, languages and literature. -

Zhanat Kundakbayeva the HISTORY of KAZAKHSTAN FROM
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN THE AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY Zhanat Kundakbayeva THE HISTORY OF KAZAKHSTAN FROM EARLIEST PERIOD TO PRESENT TIME VOLUME I FROM EARLIEST PERIOD TO 1991 Almaty "Кazakh University" 2016 ББК 63.2 (3) К 88 Recommended for publication by Academic Council of the al-Faraby Kazakh National University’s History, Ethnology and Archeology Faculty and the decision of the Editorial-Publishing Council R e v i e w e r s: doctor of historical sciences, professor G.Habizhanova, doctor of historical sciences, B. Zhanguttin, doctor of historical sciences, professor K. Alimgazinov Kundakbayeva Zh. K 88 The History of Kazakhstan from the Earliest Period to Present time. Volume I: from Earliest period to 1991. Textbook. – Almaty: "Кazakh University", 2016. - &&&& p. ISBN 978-601-247-347-6 In first volume of the History of Kazakhstan for the students of non-historical specialties has been provided extensive materials on the history of present-day territory of Kazakhstan from the earliest period to 1991. Here found their reflection both recent developments on Kazakhstan history studies, primary sources evidences, teaching materials, control questions that help students understand better the course. Many of the disputable issues of the times are given in the historiographical view. The textbook is designed for students, teachers, undergraduates, and all, who are interested in the history of the Kazakhstan. ББК 63.3(5Каз)я72 ISBN 978-601-247-347-6 © Kundakbayeva Zhanat, 2016 © al-Faraby KazNU, 2016 INTRODUCTION Данное учебное пособие is intended to be a generally understandable and clearly organized outline of historical processes taken place on the present day territory of Kazakhstan since pre-historic time. -

ALPAMYSH Central Asian Identity Under Russian Rule
ALPAMYSH Central Asian Identity under Russian Rule BY H. B. PAKSOY Association for the Advancement of Central Asian Research Monograph Series Hartford, Connecticut First AACAR Edition, 1989 --------- ALPAMYSH: Central Asian Identity under Russian Rule COPYRIGHT 1979, 1989 by H. B. PAKSOY All Rights Reserved Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Paksoy, H. B., 1948- ALPAMYSH: central Asian identity under Russian rule. (Association for the Advancement of Central Asian Research monograph series) Includes bibliographical references (p. ) Includes index. 1. Soviet Central Asia--History--Sources. 2. Alpamish. 3. Epic Literature, Turkic. 4. Soviet Central Asia--Politics and Government. I. Title. II. Series. DK847.P35 1989 958.4 89-81416 ISBN: 0-9621379-9-5 ISBN: 0-9621379-0-1 (pbk.) AACAR (Association for the Advancement of Central Asian Research) Monograph Series Editorial Board: Thomas Allsen (TRENTON STATE COLLEGE) (Secretary of the Board); Peter Golden (RUTGERS UNIVERSITY); Omeljan Pritsak (HARVARD UNIVERSITY); Thomas Noonan (UNIVERSITY OF MINNESOTA). AACAR is a non-profit, tax-exempt, publicly supported organization, as defined under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, incorporated in Hartford, Connecticut, headquartered at the Department of History, CCSU, 1615 Stanley Street, New Britain, CT 06050. The Institutional Members of AACAR are: School of Arts and Sciences, CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITY; Nationality and Siberian Studies Program, The W. Averell Harriman Institute for the Advanced Study of the Soviet Union, COLUMBIA UNIVERSITY; Mir Ali Shir Navai Seminar for Central Asian Languages and Cultures, UCLA; Program for Turkish Studies, UCLA; THE CENTRAL ASIAN FOUNDATION, WISCONSIN; Committee on Inner Asian and Altaistic Studies, HARVARD UNIVERSITY; Research Institute for Inner Asian Studies, INDIANA UNIVERSITY; Department of Russian and East European Studies, UNIVERSITY OF MINNESOTA; THE NATIONAL COUNCIL FOR SOVIET AND EAST EUROPEAN RESEARCH, WASHINGTON D.C. -

2. Historical Overview: Social Order in Mā Warāʾ Al-Nahr
2. Historical Overview: Social Order in Mā Warāʾ al-Nahr With the beginning of Uzbek dominance in southern Central Asia around the year 1500, a fresh wave of Turkic nomads was brought in and added a new element to the populace of the region.1 Initially the establishment of Uzbek rule took the form of a nomadic conquest aiming to gain access to the irrigated and urban areas of Transoxania. The following sedentarization of the Uzbek newcomers was a long-term process that took three and perhaps even more centuries. In the course of time, the conquerors mixed with those Turkic groups that had already been settled in the Oxus region for hundreds of years, and, of course, with parts of the sedentary Persian-speaking population.2 Based on the secondary literature, this chapter is devoted to the most important historical developments in Mā Warāʾ al-Nahr since the beginning of the sixteenth century. By recapitulating the milestones of Uzbek rule, I want to give a brief overview of the historical background for those who are not familiar with Central Asian history. I will explore the most significant elements of the local social order at the highest level of social integration: the rulers and ruling clans. In doing so, I will spotlight the political dynamics resulting from the dialectics of cognitive patterns and institutions that make up local worldviews and their impact on the process of institutionalizing Abū’l-Khairid authority. The major focus will be on patronage. As the current state of knowledge shows, this institution was one of the cornerstones of the social order in the wider region until the Mongol invasion. -

Tonyukuk and Turkic State Ideology “Mangilik
THE TONYUKUK AND AN ANCIENT TURK’S STATE IDEOLOGY OF “MANGILIK EL” PJAEE, 17 (6) (2020) THE TONYUKUK AND AN ANCIENT TURK’S STATE IDEOLOGY OF “MANGILIK EL” Nurtas B. SMAGULOV, PhD student of the of the Department of Kazakhstan History, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan, [email protected] Aray K. ZHUNDIBAYEVA, PhD, Head of the Department of Kazakh literature, accociate professor of the Department of Kazakh literature, Shakarim state University of Semey (SSUS), (State University named after Shakarim of city Semey), Kazakhstan, [email protected] Satay M. SIZDIKOV, Doctor of historical science, professor of the Department of Turkology, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan, [email protected] Arap S. YESPENBETOV, Doctor of philological science, professor of the Department of Kazakh literature, Shakarim state University of Semey (SSUS), (State University named after Shakarim of city Semey), Kazakhstan, [email protected] Ardak K. KAPYSHEV, Candidate of historical science, accociate professor of the Department of International Relations, History and Social Work, Abay Myrzkhmetov Kokshetau University, Kazakhstan, [email protected] Nurtas B. SMAGULOV, Aray K. ZHUNDIBAYEVA, Satay M. SIZDIKOV, Arap S. YESPENBETOV, Ardak K. KAPYSHEV: The Tonyukuk And An Ancient Turk’s State Ideology Of “Mangilik El” -- Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17(6). ISSN 1567-214x ABSTRACT Purpose of the study. Studying and evaluating the activities of Tonykuk, who was the state adviser to the Second Turkic Kaganate, the main ideologist responsible for the ideological activities of the Kaganate from 682 to 745, is an urgent problem of historical science. In the years 646-725 he worked as an adviser on political and cultural issues of the three Kagan. -

Social Change and Marriage Patterns Among Koryo Saram in Kazakhstan, 1937–1965*
Social Change and Marriage Patterns among Koryo Saram in Kazakhstan, 1937–1965* Natalya Yem and Stephen J. Epstein This article considers social forces set in motion when ethnic Koreans of the former Soviet Union (Koryo saram) were deported from the Soviet Far East to Central Asia under Stalin, treating these emerging phenomena as a context for understanding the community’s marriage patterns. Drawing on archival records from 1937 to1965 in Kazakhstan, we show how choice of marriage partner reflects changes in socioeconomic status, places of residence, gender roles and language use. Demographic data about interethnic marriages in Kazakhstan, we argue, serves as a useful tool for exploring relations between Koryo saram and the larger host society; these evolving trends in marriage patterns offer a window into the Korean diaspora experience locally and more broadly. Keywords: Korean diaspora, Koryo saram, interethnic marriage, census, Kazakhstan In recent years, scholars have turned increasing attention to the history of Koreans in the diaspora, outlining distinctive histories and patterns of settlement among Korean-Americans, Korean-Chinese (Joseonjok), Korean- Japanese (Zainichi), and Koreans of the former Soviet Union (Koryo saram) among others.1 With the collapse of the Soviet Union and the establishment of * This work was supported in part by the Korea Foundation for Advanced Studies International Scholar Exchange Fellowship for the 2011–2012 academic year. 1. Important book-length studies in English on different segments of the Korean diaspora include, for example: Wayne Patterson, The Korean Frontier in America: Immigration to Hawaii 1896– 1910 (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1988); Nancy Abelmann and John Lie, Blue Natalya Yem ([email protected]) is Head of the Department of Korean and Japanese Studies, Faculty of Oriental Studies at al-Farabi Kazakh National University; Stephen J. -

Central Asia's New Dastans
CENTRAL ASIA'S NEW DASTANS H. B. Paksoy, D. Phil. Give me a chance, my rebellious dreams My father has erected his statue in my memory May years and winds be rendered powerless May his legacy not be erased from my conscience Give me a chance, my rebellious dreams Grant my father a holy DASTAN May years and winds be rendered powerless May his remembrance never be allowed to fade (Muhbir, November 1982 [Tashkent]) The dastan is ornate oral history and an important part of the Turkic literature of Central Asia. Traditionally, dastans have been repositories of ethnic identity and history, and some constitute nearly complete value systems for the peoples they embrace. The primary, or "mother," dastans are those composed to commemorate specific liberation struggles. [1] Set mostly in verse by an ozan, [2] more than 50 mother dastans are recited by Central Asians from the Eastern Altai to the Western Ural Mountains and as far south as Bend-e Turkestan in Afghanistan. Most dastans commemorate the struggles of different Turkic peoples against external aggressors, such as the Kalmuks and Chinese. The central figure of the dastan is the alp, [3] who leads his people against the enemy, be they from afar or from within his own tribe. The alp endures many trials and tribulations, which ultimately are shared by a supporting cast. His problems are nearly always aggravated by one or more traitors, who although a problem for the alp, can never stop his ineluctable progress toward victory. His success is celebrated by a toy, or lavish feast. -

Turkic Toponyms of Eurasia BUDAG BUDAGOV
BUDAG BUDAGOV Turkic Toponyms of Eurasia BUDAG BUDAGOV Turkic Toponyms of Eurasia © “Elm” Publishing House, 1997 Sponsored by VELIYEV RUSTAM SALEH oglu T ranslated by ZAHID MAHAMMAD oglu AHMADOV Edited by FARHAD MAHAMMAD oglu MUSTAFAYEV Budagov B.A. Turkic Toponyms of Eurasia. - Baku “Elm”, 1997, -1 7 4 p. ISBN 5-8066-0757-7 The geographical toponyms preserved in the immense territories of Turkic nations are considered in this work. The author speaks about the parallels, twins of Azerbaijani toponyms distributed in Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Altay, the Ural, Western Si beria, Armenia, Iran, Turkey, the Crimea, Chinese Turkistan, etc. Be sides, the geographical names concerned to other Turkic language nations are elucidated in this book. 4602000000-533 В ------------------------- 655(07)-97 © “Elm” Publishing House, 1997 A NOTED SCIENTIST Budag Abdulali oglu Budagov was bom in 1928 at the village o f Chobankere, Zangibasar district (now Masis), Armenia. He graduated from the Yerevan Pedagogical School in 1947, the Azerbaijan State Pedagogical Institute (Baku) in 1951. In 1955 he was awarded his candidate and in 1967 doctor’s degree. In 1976 he was elected the corresponding-member and in 1989 full-member o f the Azerbaijan Academy o f Sciences. Budag Abdulali oglu is the author o f more than 500 scientific articles and 30 books. Researches on a number o f problems o f the geographical science such as geomorphology, toponymies, history o f geography, school geography, conservation o f nature, ecology have been carried out by academician B.A.Budagov. He makes a valuable contribution for popularization o f science.