Le Cinéma Américain (2)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Who's Who at Metro-Goldwyn-Mayer (1939)
W H LU * ★ M T R 0 G 0 L D W Y N LU ★ ★ M A Y R MyiWL- * METRO GOLDWYN ■ MAYER INDEX... UJluii STARS ... FEATURED PLAYERS DIRECTORS Astaire. Fred .... 12 Lynn, Leni. 66 Barrymore. Lionel . 13 Massey, Ilona .67 Beery Wallace 14 McPhail, Douglas 68 Cantor, Eddie . 15 Morgan, Frank 69 Crawford, Joan . 16 Morriss, Ann 70 Donat, Robert . 17 Murphy, George 71 Eddy, Nelson ... 18 Neal, Tom. 72 Gable, Clark . 19 O'Keefe, Dennis 73 Garbo, Greta . 20 O'Sullivan, Maureen 74 Garland, Judy. 21 Owen, Reginald 75 Garson, Greer. .... 22 Parker, Cecilia. 76 Lamarr, Hedy .... 23 Pendleton, Nat. 77 Loy, Myrna . 24 Pidgeon, Walter 78 MacDonald, Jeanette 25 Preisser, June 79 Marx Bros. —. 26 Reynolds, Gene. 80 Montgomery, Robert .... 27 Rice, Florence . 81 Powell, Eleanor . 28 Rutherford, Ann ... 82 Powell, William .... 29 Sothern, Ann. 83 Rainer Luise. .... 30 Stone, Lewis. 84 Rooney, Mickey . 31 Turner, Lana 85 Russell, Rosalind .... 32 Weidler, Virginia. 86 Shearer, Norma . 33 Weissmuller, John 87 Stewart, James .... 34 Young, Robert. 88 Sullavan, Margaret .... 35 Yule, Joe.. 89 Taylor, Robert . 36 Berkeley, Busby . 92 Tracy, Spencer . 37 Bucquet, Harold S. 93 Ayres, Lew. 40 Borzage, Frank 94 Bowman, Lee . 41 Brown, Clarence 95 Bruce, Virginia . 42 Buzzell, Eddie 96 Burke, Billie 43 Conway, Jack 97 Carroll, John 44 Cukor, George. 98 Carver, Lynne 45 Fenton, Leslie 99 Castle, Don 46 Fleming, Victor .100 Curtis, Alan 47 LeRoy, Mervyn 101 Day, Laraine 48 Lubitsch, Ernst.102 Douglas, Melvyn 49 McLeod, Norman Z. 103 Frants, Dalies . 50 Marin, Edwin L. .104 George, Florence 51 Potter, H. -

XLI Mostra Internazionale Del Cinema Libero Fondazione Cineteca Di Bologna
XLI Mostra Internazionale del Cinema Libero Fondazione Cineteca di Bologna “Il cinema è l’istituzione più democratica e più internazionale... Apre spazio alla fantasia creativa degli spettatori [...] costretti e autorizzati a dare loro stessi un’anima a quei corpi in movimento; detto altrimenti: a scriversi il proprio testo per il film” “Cinema is the most democratic and most international of institutions... Provides space for the viewer’s creative imagination [...] compelled and enabled to give a soul to those moving bodies – or, to put it more simply, to write their own text for the pictures” Viktor Klemperer, 1912 “Procediamo con disordine. Il disordine dà qualche speranza, l’ordine nessuna” “Let’s start with disorder. Disorder gives you some hope, order none” Marcello Marchesi, 1963 Promosso da / Promoted by: FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA Coordinator: Sara Mastrodomenico Fondazione Cineteca di Bologna Presidente / President: Carlo Mazzacurati Coordinamento Cinema Lumière 1 / Cinema Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero Direttore / Director: Gian Luca Farinelli Lumière 1 coordinator: Andrea Peraro Consiglio di amministrazione / Board of Coordinamento Cinema Lumière 2 / Cinema Con il sostegno di / With the support of: Directors: Carlo Mazzacurati (Presidente), Lumière 2 coordinator: Nicola Di Battista Comune di Bologna Alina Marazzi, Valerio De Paolis Coordinamento Piazza Maggiore / Piazza Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Maggiore coordinator: Silvia Fessia con Direzione Generale per il Cinema Ente Mostra Internazionale -

Papéis Normativos E Práticas Sociais
Agnes Ayres (1898-194): Rodolfo Valentino e Agnes Ayres em “The Sheik” (1921) The Donovan Affair (1929) The Affairs of Anatol (1921) The Rubaiyat of a Scotch Highball Broken Hearted (1929) Cappy Ricks (1921) (1918) Bye, Bye, Buddy (1929) Too Much Speed (1921) Their Godson (1918) Into the Night (1928) The Love Special (1921) Sweets of the Sour (1918) The Lady of Victories (1928) Forbidden Fruit (1921) Coals for the Fire (1918) Eve's Love Letters (1927) The Furnace (1920) Their Anniversary Feast (1918) The Son of the Sheik (1926) Held by the Enemy (1920) A Four Cornered Triangle (1918) Morals for Men (1925) Go and Get It (1920) Seeking an Oversoul (1918) The Awful Truth (1925) The Inner Voice (1920) A Little Ouija Work (1918) Her Market Value (1925) A Modern Salome (1920) The Purple Dress (1918) Tomorrow's Love (1925) The Ghost of a Chance (1919) His Wife's Hero (1917) Worldly Goods (1924) Sacred Silence (1919) His Wife Got All the Credit (1917) The Story Without a Name (1924) The Gamblers (1919) He Had to Camouflage (1917) Detained (1924) In Honor's Web (1919) Paging Page Two (1917) The Guilty One (1924) The Buried Treasure (1919) A Family Flivver (1917) Bluff (1924) The Guardian of the Accolade (1919) The Renaissance at Charleroi (1917) When a Girl Loves (1924) A Stitch in Time (1919) The Bottom of the Well (1917) Don't Call It Love (1923) Shocks of Doom (1919) The Furnished Room (1917) The Ten Commandments (1923) The Girl Problem (1919) The Defeat of the City (1917) The Marriage Maker (1923) Transients in Arcadia (1918) Richard the Brazen (1917) Racing Hearts (1923) A Bird of Bagdad (1918) The Dazzling Miss Davison (1917) The Heart Raider (1923) Springtime à la Carte (1918) The Mirror (1917) A Daughter of Luxury (1922) Mammon and the Archer (1918) Hedda Gabler (1917) Clarence (1922) One Thousand Dollars (1918) The Debt (1917) Borderland (1922) The Girl and the Graft (1918) Mrs. -

LAST NAME FIRST NAME TITLE PUBLISHER PRICE CONDITION ? ? the Life of Fancis Covell E
LAST NAME FIRST NAME TITLE PUBLISHER PRICE CONDITION ? ? The Life of Fancis Covell E. Wilmshurst, Blackheath $15 poor to fair ? ? Good Housekeeping's Book of Meals Good Housekeepind $23 poor ? ? A Supreme Book for Girls Dean & Son $10 good ? ? Personal Hygiene for Every Man and Boy A Social Guidance Enterprises $13 fair Abbey J. Biggles in Spain Oxford University Press $13 good with d/c Abbot Willis The Nations at War Leslie-Judge Co. $35 fair to good Abbott Jacob Mary Queen of Scots Makers of History $12 good Adler Renata Gone Simon & Schuster $20 Excellent with d/c Ainsworth William The Tower of London W. Foulsham $20 fair Ainsworth W. H. Windsor Castle Collins $8 fair to good Ainsworth W. H. Old St. Paul's Collins $10 good Ainsworth William Rookwood George Routledge and Sons $13 good to excellent Ainsworth W. H. The Tower of London Collins $5 good to excellent Alcott Louisa May Little Men Whitman Publishing Company $10 good Alcott Louisa May Little Women Goldsmith $22 good Alcott Louisa May Eight Cousins Whitman Publishing Company $7 fair to good Alcott Louisa Rose in Bloom Whitman Publishing Company $15 poor Alcott Lousia Little Women Juvenile Productions $5 fair to good with d/c Alcott Louisa An Old-Fashion Girl Donohue $10 poor to fair Alcott Louisa Little Women Saalfield $18 fair Alger Horatio In a New World M. A. Donohue $12 fair Allen Hervey Anthony Adverse Farrar and Rinehart Inc. $115 fair to good Angel Henry Practical Plane and Solid Geomerty William Collins, Sons $5 fair Appleton Victor Tom Swift and His Giant Robot Grosset & Dunlap $5 good Aquith & Bigland C. -

Frwmwwk 1 1 Tom Brown Inrl
PAGE 4 THE INDIANAPOLIS TIMES .TAN. 25, 1936 CANTOR TURNS FROM MOUSE TO MAN IN 'STRIKE ME PINK' Screen Enjoy WHERE, WHAT, WHEN While We Freeze, Ladies of the Picnic APOLLO ie's "The Widow Prom Monfe Carlo." Edd Battles With Racketeers with Del Rio and Warren Lead Donkey Dolores Head William, at 11:06. 12 55. 2:44. 4 33. 6:22. 8:11 and 10 00. CIRCLE 'Pane and Claw." with Prank Him and Parkyakarkus Through Hectic Mask Worn Buck, at 11. 1:50. 4 40. 7:30 and 10 20. Also. “Another Face.' with Brian Donlevy and PhvlliT Brooks, at 12:40. 3:30 6:20 and 9 10. INDIANA Scenes; Fewer Less Singing by • Captain Blood." with Errol Flvnn 'Bottom' Rath- 'Beauties/ Olivia De HaviUand and Basil bone. at 11:42. 2:10 4 40 . 7:10 and 9:40. — LOEW’S Charlie Chan Still Is Alive THE MOVIES ‘Widow From Monte Carlo’ Mr. Cagney Uses Headgear "Strike Me Pink." with Eddie Can- tor. Parkvakarkas Sallv Ellers and APOLLO — The Widow From Ethel Merman, at 11:28. 1 35. 3 42. Playing at Lyric in at Apollo—Circle Has in Film, ‘A Midsummer and 10:03 Monte Carlo.” Dolores Del Rio . a fl a- vk' . 5.49. 7:56 m LYRIC and Warren William caper Mystery Film. ‘Another Face.’ Night’s Dream.’ "Charlie Chan's Secret.” with through a jolly intrigue story Warner Oland. on the screen at JOHN W. THOMPSON with Louise Fazenda doing her several 11:26. 2:14. 5.02. 7:50 and 10 29 On BY daring feats. -

Hollywood Goes to Tokyo: American Cultural Expansion and Imperial Japan, 1918–1941
HOLLYWOOD GOES TO TOKYO: AMERICAN CULTURAL EXPANSION AND IMPERIAL JAPAN, 1918–1941 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Yuji Tosaka, M.A. * * * * * The Ohio State University 2003 Dissertation Committee: Approved by Dr. Michael J. Hogan, Adviser Dr. Peter L. Hahn __________________________ Advisor Dr. Mansel G. Blackford Department of History ABSTRACT After World War I, the American film industry achieved international domi- nance and became a principal promoter of American cultural expansion, projecting images of America to the rest of the world. Japan was one of the few countries in which Hollywood lost its market control to the local industry, but its cultural exports were subjected to intense domestic debates over the meaning of Americanization. This dis- sertation examines the interplay of economics, culture, and power in U.S.-Japanese film trade before the Pacific War. Hollywood’s commercial expansion overseas was marked by internal disarray and weak industry-state relationships. Its vision of enlightened cooperation became doomed as American film companies hesitated to share information with one another and the U.S. government, while its trade association and local managers tended to see U.S. officials as potential rivals threatening their positions in foreign fields. The lack of cooperation also was a major trade problem in the Japanese film market. In general, American companies failed to defend or enhance their market position by joining forces with one another and cooperating with U.S. officials until they were forced to withdraw from Japan in December 1941. -

TOWNSHIP with the SUBURBAN NEWSPAPER LARGEST in GUARANTEED THIS AREA CIRCULATION "The Voice of the Raritan Bay District" VOL
SJMaa»ti»BgjCTiiigpa"ia»iap-rfi-jratjS'^ &&&?Wj&.&&zswtt&*?in^--\'i/'-'*v-*?^-tt*-xx'& RARITAN MOST PROGRESSIVE TOWNSHIP WITH THE SUBURBAN NEWSPAPER LARGEST IN GUARANTEED THIS AREA CIRCULATION "The Voice of the Raritan Bay District" VOL. IV. — NO. 12. FORDS AND RARITAN TOWNSHIP FRIDAY MORNING, MAY 19, 1939. PRICE THREE CENTS JULIUS ENGEL BIDS FAREWELL TO HAROLD BERRUE Can This Be Called A 'Death Trap'? SZALLAR NAMED Rumoured COMMISSION AFTER LONG SERVICE POST TO ERECT TO FORCE AFTER Election RARITAN TOWNSHIP.—Sev-'re-election .since his work prohib- enteen years of brilliant and un- f ited their activities. He was the on MEMORIAL ROCK LONG 'POW-WOW Post Mortems ... tiring public service to the resi- ly Democratic member of the The commissioners of Raritan Township are still get- dents of the township was con- commission and the only original TO BE PLACED ON FRONT BERGEN, ALEXANDER VOTE ting lots and lots of congratulatory messages from the cluded here last week when member of the body since its orig- 'NO' FOR FAILURE TO happy taxpayers of the township who worked for their;sheriff Julius c- Engel- a member in. LAWN OF NEW TOWN Engel took his first public office CONSULT THEM election eleven days ago . Dr. Edward K. Hanson, of[ as tax collector in 1922 and has HALL. NOV. 11 Clara Barton section, general chairman of the successful' been active in township affairs WOODBRIDGE.—After months Administration Ticket, also continues to receive hundreds! ever since. In 1927, when the town PISCATAWAYTOWN. — A me- of controversy on the part of the of letters of praise for his brilliant work in guiding his can- ship voted to abolish the township morial stone, which will serve as Republican big whigs, Frank Szal- committee and establish the com- a lasting tribute to veterans of all lar, 35, of Fords, was named pa- didates to victory . -

The Victor Black Label Discography
The Victor Black Label Discography Victor 25000, 26000, 27000 Series John R. Bolig ISBN 978-1-7351787-3-8 ii The Victor Black Label Discography Victor 25000, 26000, 27000 Series John R. Bolig American Discography Project UC Santa Barbara Library © 2017 John R. Bolig. All rights reserved. ii The Victor Discography Series By John R. Bolig The advent of this online discography is a continuation of record descriptions that were compiled by me and published in book form by Allan Sutton, the publisher and owner of Mainspring Press. When undertaking our work, Allan and I were aware of the work started by Ted Fa- gan and Bill Moran, in which they intended to account for every recording made by the Victor Talking Machine Company. We decided to take on what we believed was a more practical approach, one that best met the needs of record collectors. Simply stat- ed, Fagan and Moran were describing recordings that were not necessarily published; I believed record collectors were interested in records that were actually available. We decided to account for records found in Victor catalogs, ones that were purchased and found in homes after 1901 as 78rpm discs, many of which have become highly sought- after collector’s items. The following Victor discographies by John R. Bolig have been published by Main- spring Press: Caruso Records ‐ A History and Discography GEMS – The Victor Light Opera Company Discography The Victor Black Label Discography – 16000 and 17000 Series The Victor Black Label Discography – 18000 and 19000 Series The Victor Black -
![The American Legion Monthly [Volume 4, No. 2 (February 1928)]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8002/the-american-legion-monthly-volume-4-no-2-february-1928-848002.webp)
The American Legion Monthly [Volume 4, No. 2 (February 1928)]
qhMERICAN EGION JOHN ERSKINE - ROBERT W. CHAMBERS HUGH WALPOLE + PERCEVAL GIBBON - HUGH WILEY "Submarine sighted—position 45 BATTLE PLANES leap into action — bined ,180,000 horse power to the propellers springing from a five-acre deck — —enough to drive the ship at 39 miles an sure of a landing place on their return, hour— enough to furnish light and power though a thousand miles from shore. for a city of half a million people. This marvel of national de- And in the familiar occupa- fense was accomplished — and tions of daily life, electricity is duplicated— when the airplane working wonders just as great carrier, U. S.S.Saratoga, and her —improving industrial produc- sister ship, U. S. S. Lexington, tion, lifting the burden of labor, The General Electric Com- were completely electrified. pany has developed pow- speeding transportation, and erful marine equipment, as In each, four General Electric well as electric apparatus multiplying the comforts of for every purpose of public turbine-generators deliver, com- advantage and personal ser- home. vice. Its products are iden- tified by the initials G-E. GENERAL ELECTRIC — ££> Electricity le In Chicago, the electrical center of the world. 2* At a great, practical school* 3. A national institution for 29 years. 4* By actual jobs on a mammoth outlay of eleo trical apparatus. 5. All practical training on actual electrical machinery, 6. No advanced education necessary. 7. Endorsed by many leading electrical concerns. YouLearn byDoing— notReading— at COYNE in 90 Day! Only by actual practical training on every kind of electric apparatus can you become a real Practical Electrician capable of commanding a real salary With such practical training as given at COYNE, you become a real Practical Electrician in 90 days. -

Quentin Tarantino Retro
ISSUE 59 AFI SILVER THEATRE AND CULTURAL CENTER FEBRUARY 1– APRIL 18, 2013 ISSUE 60 Reel Estate: The American Home on Film Loretta Young Centennial Environmental Film Festival in the Nation's Capital New African Films Festival Korean Film Festival DC Mr. & Mrs. Hitchcock Screen Valentines: Great Movie Romances Howard Hawks, Part 1 QUENTIN TARANTINO RETRO The Roots of Django AFI.com/Silver Contents Howard Hawks, Part 1 Howard Hawks, Part 1 ..............................2 February 1—April 18 Screen Valentines: Great Movie Romances ...5 Howard Hawks was one of Hollywood’s most consistently entertaining directors, and one of Quentin Tarantino Retro .............................6 the most versatile, directing exemplary comedies, melodramas, war pictures, gangster films, The Roots of Django ...................................7 films noir, Westerns, sci-fi thrillers and musicals, with several being landmark films in their genre. Reel Estate: The American Home on Film .....8 Korean Film Festival DC ............................9 Hawks never won an Oscar—in fact, he was nominated only once, as Best Director for 1941’s SERGEANT YORK (both he and Orson Welles lost to John Ford that year)—but his Mr. and Mrs. Hitchcock ..........................10 critical stature grew over the 1960s and '70s, even as his career was winding down, and in 1975 the Academy awarded him an honorary Oscar, declaring Hawks “a giant of the Environmental Film Festival ....................11 American cinema whose pictures, taken as a whole, represent one of the most consistent, Loretta Young Centennial .......................12 vivid and varied bodies of work in world cinema.” Howard Hawks, Part 2 continues in April. Special Engagements ....................13, 14 Courtesy of Everett Collection Calendar ...............................................15 “I consider Howard Hawks to be the greatest American director. -
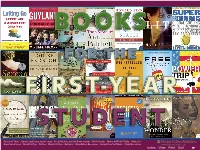
Harpercollins Books for the First-Year Student
S t u d e n t Featured Titles • American History and Society • Food, Health, and the Environment • World Issues • Memoir/World Views • Memoir/ American Voices • World Fiction • Fiction • Classic Fiction • Religion • Orientation Resources • Inspiration/Self-Help • Study Resources www.HarperAcademic.com Index View Print Exit Books for t H e f i r s t - Y e A r s t u d e n t • • 1 FEATURED TITLES The Boy Who Harnessed A Pearl In the Storm the Wind How i found My Heart in tHe Middle of tHe Ocean Creating Currents of eleCtriCity and Hope tori Murden McClure William kamkwamba & Bryan Mealer During June 1998, Tori Murden McClure set out to William Kamkwamba was born in Malawi, Africa, a row across the Atlantic Ocean by herself in a twenty- country plagued by AIDS and poverty. When, in three-foot plywood boat with no motor or sail. 2002, Malawi experienced their worst famine in 50 Within days she lost all communication with shore, years, fourteen-year-old William was forced to drop ultimately losing updates on the location of the Gulf out of school because his family could not afford the Stream and on the weather. In deep solitude and $80-a-year-tuition. However, he continued to think, perilous conditions, she was nonetheless learn, and dream. Armed with curiosity, determined to prove what one person with a mission determination, and a few old science textbooks he could do. When she was finally brought to her knees discovered in a nearby library, he embarked on a by a series of violent storms that nearly killed her, daring plan to build a windmill that could bring his she had to signal for help and go home in what felt family the electricity only two percent of Malawians like complete disgrace. -

Bvformation to Users
BVFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the tect directly fix>m the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter free, while others may be from any type o f computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from 1 ^ to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back o f the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Ifigher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell & Howell Information Compaiqr 300 North Zeeb Road, Ann Arbor MI 4S106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE HACKING AWAY WITH AN AX; HENRY MILLER AND MODERNITY A Dissertation SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy By STEPHEN L STARCK Norman, Oklahoma 1999 UMI Number: 9918759 UMI Microform 9918759 Copyright 1999, by UMI Company.