Download PDF 200.83 KB
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
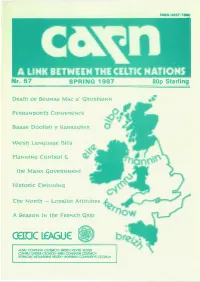
Irish Language in Meals Will Also Be Available on Reservation
ISSN 0257-7860 Nr. 57 SPRING 1987 80p Sterling D eatp o f S gum äs Mac a’ QpobpaiNN PGRRaNpORtb CONfGRGNCC Baase Doolisl) y KaRRaqpeR Welsb LaNquaqc Bills PlaNNiNQ CONtROl Q tpc MaNX QOVGRNMCNt HistORic OwiNNiNG TTpe NoRtp — Loyalist Attituöes A ScaSON iN tl7G FRGNCb CgRip Q0DC l£AGU€ -4LBA: COVIUNN CEIUWCH * BREIZH: KEl/RE KEU1EK Cy/VIRU: UNDEB CELMIDO *ElRE:CONR4DH CfllTHCH KERN O W KE SU NW NS KELTEK • /VWNNIN1COV1MEEY5 CELM GH ALBA striipag bha turadh ann. Dh'fhäs am boireannach na b'lheärr. Sgtiir a deöir. AN DIOGHALTAS AICE "Gun teagamh. fliuair sibh droch naidheachd an diugh. Pheigi." arsa Murchadh Thormaid, "mur eil sibh deönach mise doras na garaids a chäradh innsibh dhomh agus di- 'Seinn iribh o. hiüraibh o. hiigaibh o hi. chuimhnichidh mi c. Theid mi air eeann- Seo agaibh an obair bheir togail fo m'chridh. gnothaich (job) eite. Bhi stiuradh nio chasan do m'dhachaidh bhig fhin. "O cäraichidh sinn doras na garaids. Ma Air criochnacbadh saothair an lä dhomh." tha sibh deiseil tägaidh sinn an drasda agus seallaidh mi dhuibh doras na garaids. Tha Sin mar a sheinn Murchadh Thormaid chitheadh duine gun robh Murchadh 'na turadh ann." "nuair a thill e dhachaidh. "Nuair a bha c dhuine deannta 'na shcacaid dhubh-ghorm Agus leis a sin choisich an triuir a-mach a' stiiiireadh a’ chäir dhachaidh. bha eagail agus na dhungairidhe (dungarees), Bha baga dhan gharaids, an saor ’na shcacaid dhubh- air nach maircadh an ehr bochd air an rarhad uainc aige le chuid inncaian saoir. Bha e mu gorm is dungairidhc , . -

Roparz Hemon Collection of Breton Manuscripts, (GB 0210 ROPMON)
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Cymorth chwilio | Finding Aid - Roparz Hemon Collection of Breton Manuscripts, (GB 0210 ROPMON) Cynhyrchir gan Access to Memory (AtoM) 2.3.0 Generated by Access to Memory (AtoM) 2.3.0 Argraffwyd: Mai 06, 2017 Printed: May 06, 2017 Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH Description follows ANW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH https://archifau.llyfrgell.cymru/index.php/roparz-hemon-collection-of-breton- manuscripts-2 archives.library .wales/index.php/roparz-hemon-collection-of-breton-manuscripts-2 Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Allt Penglais Aberystwyth Ceredigion United Kingdom SY23 3BU 01970 632 800 01970 615 709 [email protected] www.llgc.org.uk Roparz Hemon Collection of Breton Manuscripts, Tabl cynnwys | Table of contents Gwybodaeth grynodeb | Summary information .............................................................................................. 3 Hanes gweinyddol / Braslun bywgraffyddol | Administrative history | Biographical sketch ......................... 3 Natur a chynnwys | Scope and content .......................................................................................................... 4 Trefniant | Arrangement .................................................................................................................................. 5 Nodiadau | Notes ............................................................................................................................................ -

& Autres Terres Celtiques
BRETAGNE & autres Terres celtiques Jean-Louis Pressensé, libraire Catalogue 48 Décembre 2013 1 Jean-Louis Pressensé, libraire Catalogue 48 Généralités, macédoines, etc. BRETAGNE & 1. (Celtomanes , Antiquaires & Bretonistes) Académie celti- que. Collectif. Mémoires de l'Académie celtique, ou Re- AUTRES TERRES cherches sur les Antiquités celtiques, gauloises et françaises. I/V. P., Dubray. 1807-08-09-09-10. 4 vol. in-8°, sobres rel. 1/2 bas. + 1 vol. in-8° débroché (sous couv. fact.), de CELTIQUES (3)+20+440pp & 6 pl. h-t., (6)+474pp & 7 pl. h-t dt 1 dépl., 504pp & 3 dépl. h-t, 508pp & 5 pl. dt 3 dépl., 520pp & 5 pl. dépl. h-t. ; Généralités 001-056 mouill. passim, ensemble disparate mais rarissime, surtout Nos ancêtres les Mégalithiques 057-074 complet de ses vingt-six planches gravées 900 € Indo-Européens et Celtes 075-233 A partir du t. III le titre devient : Mémoires de l'Acad. Celtique, ou Bretagne & Bretons 234-482 Mémoires d'antiquités celtiques… Dont : Moyen Age 407-457 Brittany 483-507 2. (Celtomanes , Antiquaires & Bretonistes) Académie celti- Vieille langue de nos Pères 508-631 que. Collectif. Mémoires de l'Académie celtique [ou Mé- Les Celtes parlent aux Celtes 632-664 moires d'antiquités celtiques, gauloises et françaises]. Tome Chrétientés celtiques (médiévales) 665-722 III complet en 3 livraisons. P., Dubray. 1809. 3 fasc. in-8° Cymru, Pays de Galles 723-756 brochés, couv. impr., de 504pp (pagin. continu), 3 pl. gravées h.- Kernow, Cornouailles 757-764 t., index ; beaux ex. ; contrib. Johanneau, Lenoir, Legonidec, Erin, Irlande 765-841 Mangourit, Baudouin (de Maisonblanche), Rallier, Pictet… 150 € Alba, Ecosse 842-892 Linguistique, philologie 893-941 3. -

Press Pack Bretagne
2021 PRESS PACK BRETAGNE brittanytourism.com | CONTENTS Editorial p. 03 Slow down Take your foot off the pedal p. 04 Live Experience the here and now p. 12 Meet Immerse yourself in local culture p. 18 Share Together. That’s all ! p. 24 Practical information p. 29 EDITORIAL Bon voyage 2020 has been an unsettling and air and the wide open spaces. Embracing with the unexpected. A concentration of challenging year and we know that many the sea. Enjoying time with loved ones. the essential, and that’s why we love it! It of you have had to postpone your trip to Trying something new. Giving meaning to invites you to slow down, to enjoy life, to Brittany. These unusual times have been our daily lives. Meeting passionate locals. meet and to share: it delivers its promise a true emotional rollercoaster. They Sharing moments and laughs. Creating of uniqueness. So set sail, go for it, relax have also sharpened our awareness and memories for the years to come. and enjoy it as it comes. Let the eyes do redesigned our desires. We’re holding on to Let’s go for an outing to the Breton the talking and design your next holiday our loved ones, and the positive thoughts peninsula. A close, reassuring destination using these pages. of a brighter future. We appreciate even just across the Channel that we think we We wish you a wonderful trip. more the simple good things in life and know, but one that takes us far away, on the importance of seizing the moment. -

Al Liamm Dastumadenn Sevenadurel Daouviziek Kerzu2002
Al Liamm Dastumadenn sevenadurel daouviziek Kerzu2002 Nedeleg laouen ha Bloavezh mat d’an holl Niverenn 3355 57vet bloavezh Postel [email protected] www.alliamm.com Pep skrivagner zo kiriek d’e skridoù TAOLENN BARZHONEGOÙ : Kroashent , gant Youenn Gwernig . .3 Maenhir, gant Jean-Yves Broudic . .4 O terriñ kleuz , gant Jakez Konan . .5 DANEVELLOÙ : Un endervezhiad hir, gant Ronan Huon . .7 N’eo ket mat ar gontadenn, gant Dominique Allain . .15 Breur ha c’hoar, gant Maguy Kerisit . .28 STUDIADENNOÙ : E koun Richard Jenkin, gant Per Denez . .55 Francesco Redi hag ar ganadur diwar netra, gant Yann gerven . .63 Soñjomp ervat : ur sell ouzh embannadurioù Buhez ar Sent, gant Jacqueline Gibson . .68 Renan hag a brezhoneg, gant Reun ar C’halan . .83 2 BEAJ : Un devezh e Gernevez, gant Per ar Bihan . .90 LEVRIOÙ, gant Eflamm gKervilio . .95 NOTENNOÙ : . .103 Youenn GWERNIG Kroashent Daou Hon-daou War hentoù hor bro Ker kalet o mein A gave din, Met e c’hoarzh va c’heneil E teuze o c’hrizder Un tammig. Daou Hon daou Ha tizhet ganeomp kalon ar c’hroashent. Steredenn o skignañ bannoù diniver War ar bed, Mont a reas va c’heneil hep kimiadiñ Gant ur seizhenn n’helle ket heuliañ 3 Marteze gant aon leskiñ e dreid, Mont a reas va c’heneil hag e c’hoarzh... Ha me, neuze, a raio Gant ur seizhenn n’hellen ket heuliañ kennebeut, Marteze gant aon koll an hent Ar c’hleuz, ar c’harzh hag Ar brouskoad pelloc’h – E ouiemp mat – (Ha soñj ‘peus, va c’heneil, va breur ? E oa eno soudarded kozh o c’hedal c’hoazh). -

ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DE DONATIEN LAURENT (Établie Par Armel Morgant)
ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DE DONATIEN LAURENT (établie par Armel Morgant) TRAVAUX UNIVERSITAIRES Le cycle de la vie à Plozévet, DGRST, 1963. La Villemarqué collecteur de chants populaires. Étude des sources du premier Barzaz-Breiz à partir des originaux de collecte (1833-1840), thèse d’État inédite sous la direction d’André Leroi-Gourhan, Paris/Brest, 1974, 5 vol., 739 + 160 p. LIVRES Récits et contes populaires de Bretagne réunis par Donatien Laurent dans le pays de Pontivy, Gallimard, 1978, 189 p. Aux sources du Barzaz-Breiz — La mémoire d’un peuple, Douarnenez, ArMen, 1989, 336 p. La nuit celtique (en collaboration avec Michel Treguer), Rennes, Terre de Brume, 1996, 236 p. Parcours d’un ethnologue en Bretagne, t. 1, Brest, Emgleo Breiz, 2012, 326 p. Locronan, la troménie et les peintres (en collaboration avec Fañch Le Henaff et Armel Morgant), Locus Solus, Lopérec, 2013, 161 p. CATALOGUES D’EXPOSITION Poésie orale bretonne : les collecteurs de chants populaires au xıxe siècle, Bibliothèque de la Ville de Brest, juillet-août 1977, texte de présentation par Donatien Laurent. Donatien Laurent, Fañch Postic et Pierre Prat, La littérature orale en Bretagne — Les passeurs de mémoire, Association du manoir de Kernault, 1996. ARTICLES ET TEXTES PARUS EN REVUE ET EN RECUEILS COLLECTIFS « La gwerz de Louis Le Ravallec », Arts et traditions populaires, année 15, n° 1, Paris, janvier-mars 1967, p. 19- 79. « Une chantefable de Noël en pays pourlet : la “tragélie” », Arts et traditions populaires, année 16, n° 2, avril-juin 1968, p. 153-172. « Un exemple d’art verbal : La gwerz de Louis Le Ravallec », Bretagne Dimanche, 18 août 1968. -

L'ordre De L'hermine Titulaires Contemporains Christian Troadec, Maire De Carhaix Et Conseiller Départemental Et Patrick Ma
L’Ordre de l’Hermine Titulaires contemporains Créé en 1381, l’ordre de l’Hermine est un des plus anciens parmi les ordres militaires et honorifiques en Europe. En 1972 à Pontivy En 1997 à Quintin En 2007 à Saint-Brieuc Christian Troadec, René PLEVEN † Jean-Jacques HENAFF Rhisiart HINCKS maire de Carhaix et conseiller départemental En 1973 à Rome et Rennes Jean L’HELGOUACH † Martial PEZENNEC † En 1344, Édouard III d’Angleterre fonde l’ordre des «Chevaliers de Gabriele PESCATORE Dodik JEGOU Job an IRIEN et Patrick Malrieu, saint George», puis en 1348, celui de la Jarretière. Jean II, en France, Jean MEVELLEC † Raymond LEBOSSE † François LE QUEMENER † président de l’Institut culturel de Bretagne crée en 1351 l’Ordre de l’Étoile. En 1430, c’est La Toison d’Or du duc En 1988 à Rennes En 1998 à Vitré En 2008 à Rennes ont le plaisir de vous inviter à la de Bourgogne suivi du Croissant fondé par René d’Anjou en 1448. Vefa de BELLAING † Goulc’han KERVELLA Roger ABJEAN † La fondation de l’Ordre de l’Hermine par Jean IV, duc de Bretagne Pierre-Roland GIOT † Henri MAHO † Gweltaz ar FUR Pierre LOQUET Yvonne BREILLY-LE CALVEZ Cérémonie de remise du Collier de l’Hermine affirme la prééminence ducale sur l’ensemble de la noblesse et une Polig MONJARRET † Henri QUEFFELEC † A. CORRE (N. ROZMOR) † Viviane HELIAS volonté d’unité autour du souverain. En 1999 à Nantes En 2009 à Ancenis L’ordre présente la particularité d’être ouvert aux femmes et aux En 1989 à Nantes le Samedi 17 Septembre, Bernard de PARADES † Jean-Bernard VIGHETTI Jean-Christophe CASSARD † Espace Glenmor, à Carhaix roturiers. -

Pdf Shop 'Celtic Gold' in Peel
No. 129 Spring 2004/5 €3.00 Stg£2.50 • SNP Election Campaign • ‘Property Fever’ on Breizh • The Declarationof the Bro Gymraeg • Istor ar C ’herneveg • Irish Language News • Strategy for Cornish • Police Bug Scandal in Mann • EU Constitution - Vote No! ALBA: COM.ANN CEILTFACH * BREIZH: KFVTCF KELT1EK * CYMRU: UNDEB CELTA DD * EIRE: CON RAD H GEILTE AC H * KERNOW: KtBUNYANS KELTEK * MANNIN: COMlVbtYS CELTIAGH tre na Gàidhlig gus an robh e no I a’ dol don sgoil.. An sin bhiodh a’ huile teasgag tre na Gàidhlig air son gach pàiste ann an Alba- Mur eil sinn fhaighinn sin bidh am Alba Bile Gàidhlig gun fheum. Thuig Iain Trevisa gun robh e feumail sin a dhèanamh. Seo mar a sgrìohh e sa bhli adhna 1365, “...dh’atharraich Iain à Còm, maighstir gramair, ionnsachadh is tuigsinn gramair sna sgoiltean o’n Fhraingis gu TEACASG TRE NA GÀIDHLIG Beurla agus dh’ionnsaich Richard Pencrych an aon scòrsa theagaisg agus Abajr gun robh sinn toilichte cluinntinn Inbhirnis/Inverness B IVI 1DR... fon feadhainn eile à Pencrych; leis a sin, sa gun bidh faclan Gaidhlig ar na ceadan- 01463-225 469 e-mail [email protected] bhliadhna don Thjgheama Againn” 1385, siubhail no passports again nuair a thig ... tha cobhair is fiosrachadh ri fhaighinn a an naodhamh bliadhna do’n Righ Richard ceann na bliadhna seo no a dh’ aithgheor thaobh cluich sa Gàidhlig ro aois dol do an dèidh a’Cheannsachaidh anns a h-uile 2000. Direach mar a tha sinn a’ dol thairis sgoil, Bithidh an t-ughdar is ionadail no sgoil gràmair feadh Sasunn, tha na leana- air Caulas na Frainge le bata no le trean -

Download PDF 98.26 KB
L’ EMSAV DANS LA LITTÉRATURE BRETONNE CONTEMPORAINE Il est impossible de parler de la littérature bretonne sans que la politique fasse immédiatement intrusion, et politique, dans ce cas, signifie avant tout le rapport au mouvement nationaliste breton, à l’Emsav . Le simple fait d’écrire en breton constitue déjà, pour la plupart des écrivains bretons, une option politique fondamentale. Beaucoup d’entre eux se considèrent comme des partisans livrant un combat désespéré contre une puissance étrangère vouée à la totale annihilation de leur identité ethnique. Leurs efforts, au cours du siècle qui touche à sa fin, ont souffert des erreurs commises, dans la perpective du devenir historique, par certains de leurs prédécesseurs. A la fin des années trente, la direction du Parti National Breton (P.N.B.), communément appelé aussi Breiz Atao [Bretagne toujours], du nom de son journal, était passée dans les mains d’hommes prêts à employer n’importe quels moyens pour réaliser leur but”: une Bretagne totalement indépendante, totalement coupée du joug de la France. A l’exemple des rebelles irlandais de 1916 (et l’exemple de la victoire irlandaise fut un motif déterminant dans leur choix), ils s’étaient tournés vers l’Allemagne. Après la défaite française de 1940, les espoirs qu’ils avaient placés dans une victoire allemande furent vite déçus. L’Allemagne victorieuse trouva plus expédient de traiter avec le gouvernement de Vichy, qui ne demandait qu’à collaborer avec elle. A la fin de 1940, le P.N.B. était coupé en deux factions. La majorité, sous la conduite des leaders les plus modérés, tenta d’abord de négocier avec Vichy, puis, lorsque la victoire des Alliés apparut certaine, avec les Anglo-américains. -

Réécriture De L'histoire En Bretagne
RÉÉCRITURE DE L’HISTOIRE EN BRETAGNE Dossier rédigé par Marie-Madeleine Flambard, André Hélard, Françoise Morvan et la section de Rennes de la Ligue des Droits de l’Homme Décembre 2000 Le dossier qui suit a été constitué afin de faire part de nos inquiétudes face à un certain nombre de faits dont la conjonction nous semble de nature à faire évoluer la situation en Bretagne dans un sens difficilement compatible avec les idéaux démocratiques qui sont les nôtres. Les quelques cas que nous donnons pour exemple montrent que, loin de concerner une minorité de militants, les faits que nous mettons en lumière impliquent des institutions, le monde de l’entreprise et de nombreuses personnalités . Pourquoi l’affirmation d’une “identité bretonne” devrait-elle se doubler de l’occultation de la vérité historique et de la négation de valeurs universelles ? Les procès Barbie, Touvier, Papon, ont eu une valeur pédagogique et une dimension éthique ; la lecture de notre passé commun devrait valoir pour ce qui s’est passé en Bretagne comme pour ce qui s’est passé ailleurs. Or, il est clair que certains aspects de la période de l’occupation sont systématiquement occultés en Bretagne comme pour préserver l’image du “mouvement breton” qui s’est alors coupé de la population par une collaboration résolue avec l’occupant. Mais pourquoi les dérives nationalistes ne devraient-elles pas apparaître sous le jour qui est le leur ? Nous pensons que la volonté délibérée de minimiser des événements, de tronquer des faits ou de les passer sous silence relève d’une politique qu’il importe d’analyser. -

Les Gîtes De Penn Ar Pont Presbital Kozh Maison Éclusière Du Gwaker
gites Le Fest Jazz vous propose une sélection de gîtes à proximité du festival. D’autres gites sont proposés par l’Office du Tourisme. Les Gîtes de Penn Ar Pont Les Gîtes de Penn Ar Pont – Au bord du Canal – 29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU Tel : 02.98.81.81.25 E-mail : [email protected] Sites : www.pennarpont.com ou http://village-de-gites.locenfrance.com Presbital Kozh Vaste demeure de caractère du XVème, centre bourg de Landeleau, proximité commerces. Situé sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, à 1,5 km du canal de Nantes à Brest, à michemin entre Carhaix (festival des Vieilles Charrues) et Châteauneuf-du-Faou. Accueil randonneurs et groupes 24 lits / 6 chambres Association Oaled Landelo, le Vieux Presbytère 29530 LANDELEAU 02 98 93 93 08 / 07 82 78 24 37 Mail : [email protected] Site : www.gite-presbitalkozh-landeleau.bzh Maison éclusière du Gwaker Labellisée Handi-sport et Gîte de France. Capacité d’accueil : 27 pers. / 13 ch. Ulamir Aulne, Rue du Gledig 29520 Châteauneuf du Faou. 02 98 73 20 76 Mail : [email protected] Site : www.ulamir-aulne.fr Centre Ti Forn Adapté aux jeunes publics (scolaires). Capacité d’accueil 42 pers. / 13 ch. Ulamir Aulne, Rue du Gledig 29520 Châteauneuf du Faou 02.98.73.20.76 Mail : [email protected] Site : www.ulamir-aulne.fr Maison éclusière du Moustoir Capacité d’accueil 15 pers. M Riquier Dominique 20, rue Paul Sérusier 29520 Châteauneuf du Faou 02 98 73 24 59 /06 08 62 64 99 Mail : [email protected] Châteauneuf-du-Faou, Lanmeur Maison ancienne entièrement rénovée, située en campagne à 5 km du centre ville, à 800m du canal. -

Les Femmes De Bretagne Viennent Faire Leur Show À Paris
A l'occasion de la Journée des droits des femmes Les femmes de Bretagne viennent faire leur show à Paris le 9 mars 2018 au Pan Piper à 20 h DOSSIER PRESSE VOIX DE FEMMES – DOSSIER de PRESSE 20/11/17 NOLWENN KORBELL 32, rue de la Vallée | 22190 PLERIN [email protected] 02.96.70.86.99 / 06.75.25.08.91 VOIX DE FEMMES – DOSSIER de PRESSE 20/11/17 Nolwenn Korbell a vu les fées se pencher sur son berceau avec un père, sonneur à Bourbriac et une mère, Andrea Ar Gouilh, grande voix féminine de ces quarante dernières années. Depuis ses études au Conservatoire d’Art Dramatique de Rennes, Nolwenn Korbell une belle carrière de chanteuse, comédienne, auteur et compositeur, ponctuée de nombreuses distinctions. Un beau et riche parcours d’artiste où alternent et s’entremêlent moments forts sur les planches avec le théâtre ou la télévision et les feux de la rampe avec la chanson. Aujourd’hui, après un nouvel album en collaboration avec Franck Darcel (Marquis de Sade, republik…), « Nolwenn Korbell’s band » qui sortira en février 2018, Nolwenn continue sa route d’auteur, compositeur dans sa langue, le breton, avec ce nouveau projet, présenté le 9 mars 2018, en création, sur la scène du Pan Piper. VOIX DE FEMMES – DOSSIER de PRESSE 20/11/17 Après avoir commencé le théâtre en amateur à Douarnenez à l’âge de 15 ans (cours à la MJC, lectures de poèmes, représentation de « L’enfant mort sur le trottoir » de Guy Foissy), Nolwenn Korbell a dès ses 16 ans un pied dans le milieu professionnel en doublant en breton les premières séries de dessins animés pour France 3 Bretagne.