Lessons in Conservation Issue No
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
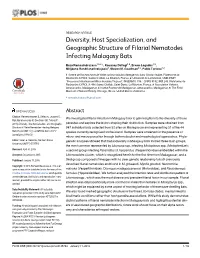
Diversity, Host Specialization, and Geographic Structure of Filarial Nematodes Infecting Malagasy Bats
RESEARCH ARTICLE Diversity, Host Specialization, and Geographic Structure of Filarial Nematodes Infecting Malagasy Bats Beza Ramasindrazana1,2,3*, Koussay Dellagi1,2, Erwan Lagadec1,2, Milijaona Randrianarivelojosia4, Steven M. Goodman3,5, Pablo Tortosa1,2 1 Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes dans l’Océan Indien, Plateforme de Recherche CYROI, Sainte Clotilde, La Réunion, France, 2 Université de La Réunion, UMR PIMIT "Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical", INSERM U 1187, CNRS 9192, IRD 249. Plateforme de Recherche CYROI, 97490 Sainte Clotilde, Saint-Denis, La Réunion, France, 3 Association Vahatra, Antananarivo, Madagascar, 4 Institut Pasteur de Madagascar, Antananarivo, Madagascar, 5 The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, United States of America * [email protected] OPEN ACCESS Abstract Citation: Ramasindrazana B, Dellagi K, Lagadec E, We investigated filarial infection in Malagasy bats to gain insights into the diversity of these Randrianarivelojosia M, Goodman SM, Tortosa P (2016) Diversity, Host Specialization, and Geographic parasites and explore the factors shaping their distribution. Samples were obtained from Structure of Filarial Nematodes Infecting Malagasy 947 individual bats collected from 52 sites on Madagascar and representing 31 of the 44 Bats. PLoS ONE 11(1): e0145709. doi:10.1371/ species currently recognized on the island. Samples were screened for the presence of journal.pone.0145709 micro- and macro-parasites through both molecular and morphological approaches. Phylo- Editor: Karen E. Samonds, Northern Illinois genetic analyses showed that filarial diversity in Malagasy bats formed three main groups, University, UNITED STATES the most common represented by Litomosa spp. infecting Miniopterus spp. (Miniopteridae); Received: April 30, 2015 a second group infecting Pipistrellus cf. -

Liste Candidatures Conseillers Alaotra Mangoro
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 RTM (Refondation Totale De Madagascar) RAKOTOZAFY Jean Marie Réné AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 MMM (Malagasy Miara-Miainga) ARIMAHANDRIZOA Raherinantenaina INDEPENDANT RANAIVOARISON HERINJIVA AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 RANAIVOARISON Herinjiva (Ranaivoarison Herinjiva) AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIARISON Célestin AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANDRIAMANARINA - INDEPENDANT RAZAKAMAMONJY HAJASOA AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 RAZAKAMAMONJY Hajasoa Mazarin MAZARIN (Razakamamonjy Hajasoa Mazarin) INDEPENDANT RAHARIJAONA ROJO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 RAHARIJAONA Rojo (Raharijaona Rojo) AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RATIANARIVO Jean Cyprien Roger AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RABEVASON Hajatiana Thierry Germain SUBURBAINE AMBATONDRAZAKA INDEPENDANT RANDRIANASOLO ROLLAND AMBATONDRAZAKA 1 RANDRIANASOLO Rolland SUBURBAINE (Randrianasolo Rolland) AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 MMM (Malagasy Miara-Miainga) RAKOTONDRASOA Emile SUBURBAINE AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANJAKASOA Albert SUBURBAINE INDEPENDANT RANDRIAMAHAZO FIDISOA AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA 1 HERINIAINA (Randriamahazo Fidisoa RANDRIAMAHAZO Fidisoa Heriniaina Heriniaina) AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIANANTOANDRO Gérard AMBATONDRAZAKA -

Chapitre 3 Conditions Socio-Economiques Et Problematique De La Zone D’Etude
CHAPITRE 3 CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET PROBLEMATIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 3.1 Conditions socio-économiques actuelles 3.1.1 Système administratif, zone de démarcation et population La zone de l’étude, à savoir les 2 districts, 9 communes et 52 villages, comme indiqué dans le tableau suivant, est administrativement sous la juridiction de la région d’Alaotra-Mangoro. Géographiquemnt, la zone de l’étude comprend le bassin versant de la rivière Sahabe, lesbassin versant de la rivière Sahamilahy, les bassins de 4 petits et moyens cours d’eau, et la zone du PC 23. La délimitation administrative est illustrée à la Fig. 3.1. Tableau 3.1.1 Unités et zones administratives dans la zone de l’étude Nombre Région District Commune de Zone villages Ampasikely 4 4 petits et moyens bassins fluviaux Andrebakely 6 4 petits et moyens bassins Sud fluviaux 4 petits et moyens bassins Ambatomainty 9 Amparafaravola fluviaux, zone du PC 23 Bassin de la rivière Sahamilahy, Alaotra- Morarano bassin de la rivière Sahabe, 4 27 Mangoro Chrome petits et moyens bassins fluviaux, zone du PC23 Ranomanity 6 Bassin de la rivière Sahabe Bejofo 2 Bassin de la rivière Sahabe Soalazaina 5 Bassin de la rivière Sahabe Ambatondrazaka Tanambao 6 Bassin de la rivière Sahabe Besakay Andilanatoby 6 Bassin de la rivière Sahabe Source: Bureau regional d’Alaotra-Mangoro D’après une étude supplémentaire par le biais d’interviews menée en 2006, le total de la population dans tous les villages de la zone de l’étude est de 118.194 personnes, le nombre de foyers de 20.631, et la taille d’une famille moyenne de 5,7 personnes. -

Ecosystem Profile Madagascar and Indian
ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

Hypertension, a Neglected Disease in Rural and Urban Areas In
Hypertension, a Neglected Disease in Rural and Urban Areas in Moramanga, Madagascar Rila Ratovoson, Ony Rabarisoa Rasetarinera, Ionimalala Andrianantenaina, Christophe Rogier, Patrice Piola, Pierre Pacaud To cite this version: Rila Ratovoson, Ony Rabarisoa Rasetarinera, Ionimalala Andrianantenaina, Christophe Rogier, Patrice Piola, et al.. Hypertension, a Neglected Disease in Rural and Urban Areas in Moramanga, Madagascar. PLoS ONE, Public Library of Science, 2015, pp.1-14. 10.1371/journal.pone.0137408. hal-01292073 HAL Id: hal-01292073 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01292073 Submitted on 5 Apr 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. RESEARCH ARTICLE Hypertension, a Neglected Disease in Rural and Urban Areas in Moramanga, Madagascar Rila Ratovoson1*, Ony Rabarisoa Rasetarinera2, Ionimalala Andrianantenaina1, Christophe Rogier1,3,4, Patrice Piola1, Pierre Pacaud5 1 Pasteur Institute of Madagascar, PO Box: 1274 Ambatofotsikely, Antananarivo, Madagascar, 2 Faculty of Medicine, Antananarivo University, Antananarivo, Madagascar, 3 Unité -

Madagascar Country Office Covid-19 Response
COVID-19 Situation Report, Madagascar | July 29th, 2020 Madagascar Country Office Covid-19 response July 29th 2020 Situation in Numbers 10432 cases across 19 regions 93 deaths 101 RECOVERED July 29th 2020 Highlights Funding status th th From May 17 to July 29 2020, the positive COVID-19 cases growth curve fund decupled exponentially from 304 to 10,432 cases with 0.89% of fatality rate received in 19 out of 22 affected regions (all except Androy, Atsimo Atsinanana and $1.19 Melaky). funding gap The epicenter remains the capital Antananarivo with very high community $3.45 transmission. The hospitalization capacity was reached in central hospitals which led to care decentralization for asymptomatic and pauci- symptomatic patients whilst hospitalization is offered in priority for carry forward moderate, severe and critical patients. $2.35 UNICEF supports moderate, severe and critical patients’ care by supplying oxygen (O2) to central hospitals, helping saving lives of most severe patients. Thus far, 240,000 families have received a cash transfer of 100,000 Ariary (26 USD) to meet their basic needs. In collaboration with the Government and through the Cash Working Group, UNICEF coordinates the second wave of emergency social assistance in the most affected urban and peri- urban areas. However, UNICEF’s appeal for emergency social protection support, remains unfunded. Around 300,000 children received self-study booklets while distribution to another 300,000 children is being organized. UNICEF is monitoring the promoted health measures to be put in place prior the tentative examination dates for grade, 7, 3 and Terminal. Funding 600,000 Overview people in most affected cities benefitted from a subsidized access to water, via Avo-Traina programme while more than 20,000 taxi were disinfected and supported with hydroalcoholic gel and masks in Antananarivo. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir
SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Madagascar Sahofika Hydropower Plant RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir Part Two: Abbreviated Resettlement Action Plan for the Linear Components of the Project Prepared by: Land Resources, Antananarivo, Madagascar With: Frédéric Giovannetti, Lyon, France Date: June 30, 2019 Version: C SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Eiffage Eranove HIER Themis Consortium Madagascar - Sahofika Hydropower Plant Resettlement Action Plan - Version C TRACEABILITY Version Date Reference Commented on Status by A 04/25/2019 Draft B 06/20/2019 Draft for publication C 07/05/2019 Version for submission to ONE ABBREVIATIONS AEC: Administrative Evaluation Commission AFD: French Development Agency AfDB: African Development Bank AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome ALC: Local Liaison Officer Art.: Article AWS Drinking Water Supply BD: Board of Directors Banky Fampadrosoana ny Varotra (Malagasy subsidiary of the BFV: Société Générale Group) BIF: Birao Ifoton'ny Fananan-tany (Communal Land Office) CASEF: Agricultural Growth and Land Security CIRTOPO: Topographic Constituency COBA: Grassroots Community CPAR: Short Resettlement Plan Framework CSB: Basic Health Center CTD: Decentralized Territorial Communities Inter-Regional Departments and Services for the Environment -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

Diversity, Host Specialization, and Geographic Structure of Filarial Nematodes Infecting Malagasy Bats
RESEARCH ARTICLE Diversity, Host Specialization, and Geographic Structure of Filarial Nematodes Infecting Malagasy Bats Beza Ramasindrazana1,2,3*, Koussay Dellagi1,2, Erwan Lagadec1,2, Milijaona Randrianarivelojosia4, Steven M. Goodman3,5, Pablo Tortosa1,2 1 Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes dans l’Océan Indien, Plateforme de Recherche CYROI, Sainte Clotilde, La Réunion, France, 2 Université de La Réunion, UMR PIMIT "Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical", INSERM U 1187, CNRS 9192, IRD 249. Plateforme de Recherche CYROI, 97490 Sainte Clotilde, Saint-Denis, La Réunion, France, 3 Association Vahatra, Antananarivo, Madagascar, 4 Institut Pasteur de Madagascar, Antananarivo, Madagascar, 5 The Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, United States of America * [email protected] OPEN ACCESS Abstract Citation: Ramasindrazana B, Dellagi K, Lagadec E, We investigated filarial infection in Malagasy bats to gain insights into the diversity of these Randrianarivelojosia M, Goodman SM, Tortosa P (2016) Diversity, Host Specialization, and Geographic parasites and explore the factors shaping their distribution. Samples were obtained from Structure of Filarial Nematodes Infecting Malagasy 947 individual bats collected from 52 sites on Madagascar and representing 31 of the 44 Bats. PLoS ONE 11(1): e0145709. doi:10.1371/ species currently recognized on the island. Samples were screened for the presence of journal.pone.0145709 micro- and macro-parasites through both molecular and morphological approaches. Phylo- Editor: Karen E. Samonds, Northern Illinois genetic analyses showed that filarial diversity in Malagasy bats formed three main groups, University, UNITED STATES the most common represented by Litomosa spp. infecting Miniopterus spp. (Miniopteridae); Received: April 30, 2015 a second group infecting Pipistrellus cf. -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

A New Species of Scotophilus (Chiroptera: Vespertilionidae) from Western Madagascar
Acta Chiropterologica, 8(1): 21–37, 2006 PL ISSN 1508-1109 © Museum and Institute of Zoology PAS A new species of Scotophilus (Chiroptera: Vespertilionidae) from western Madagascar STEVEN M. GOODMAN1, 2, FANJA H. RATRIMOMANARIVO2, 3, and FÉLICIEN H. RANDRIANANDRIANINA3, 4 1Field Museum of Natural History, 1400 South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60605, USA E-mail: [email protected] 2WWF, B.P. 738, Antananarivo (101), Madagascar 3Département de Biologie Animale, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, B.P. 906, Antananarivo (101), Madagascar 4Madagasikara Voakajy, B.P. 5181, Antananarivo (101), Madagascar We describe a new species of Scotophilus (Vespertilionidae) from western Madagascar. This bat differs from the other members of this genus known from the island, Africa, and Asia based on its notably diminutive size, pelage coloration, and tragus shape and length. Scotophilus sp. nov. is known from seven different specimens taken at three different sites in the central western portion of the island, in zones with anthropogenic savanna dominated by palms (Bismarckia nobilis) and dry deciduous forest. The holotype was collected in the palm leaf roof of a thatched dwelling, which is the first evidence of the synanthropic occurrence of a member of this genus on Madagascar. Four species of Scotophilus are now known to occur on Madagascar of which three are endemic. Key words: Scotophilus, Vespertilionidae, new species, western Madagascar INTRODUCTION The Old World genus Scotophilus com- prises 13 species (Goodman et al., 2005a; On going biological inventories of Mad- Simmons, 2005) found from the Philip- agascar continue to reveal new information pines, across portions of Asia, to the Middle on the island’s chiropteran fauna, including East, La Réunion, Madagascar, and much species previously unknown to science of Africa.