Notes Sur Le Cid De Sacchini Et Son Contexte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Parte Il Celeberrimo ‘A Solo’ «Le Perfide Renaud Me Fuit»
La Scena e l’Ombra 13 Collana diretta da Paola Cosentino Comitato scientifico: Alberto Beniscelli Bianca Concolino Silvia Contarini Giuseppe Crimi Teresa Megale Lisa Sampson Elisabetta Selmi Stefano Verdino DOMENICO CHIODO ARMIDA DA TASSO A ROSSINI VECCHIARELLI EDITORE Pubblicato con il contributo dell’Università di Torino Dipartimento di Studi Umanistici © Vecchiarelli Editore S.r.l. – 2018 Piazza dell’Olmo, 27 00066 Manziana (Roma) Tel. e fax 06.99674591 [email protected] www.vecchiarellieditore.com ISBN 978-88-8247-419-5 Indice Armida nella Gerusalemme liberata 7 Le prime riscritture secentesche 25 La seconda metà del secolo 59 Il paradosso haendeliano e le Armide rococò 91 Ritorno a Parigi (passando per Vienna) 111 Ritorno a Napoli 123 La magia è il teatro 135 Bibliografia 145 Indice dei nomi 151 ARMIDA NELLA GERUSALEMME LIBERATA Per decenni, ma forse ancora oggi, tra i libri di testo in uso nella scuola secondaria per l’insegnamento letterario ha fatto la parte del leone il manuale intitolato Il materiale e l’immaginario: se lo si consulta alle pa- gine dedicate alla Gerusalemme liberata si può leggere che del poema «l’argomento è la conquista di Gerusalemme da parte dei crociati nel 1099» e che «Tasso scelse un argomento con caratteri non eruditi ma di attualità e a forte carica ideologica. Lo scontro fra l’Occidente cri- stiano e l’Islam - il tema della crociata - si rinnovava infatti per la mi- naccia dell’espansionismo turco in Europa e nel Mediterraneo». Tale immagine del poema consegnata alle attuali generazioni può conser- varsi soltanto a patto, come di fatto è, che non ne sia proprio prevista la lettura e viene da chiedersi che cosa avrebbero pensato di tali af- fermazioni gli europei dei secoli XVII e XVIII, ovvero dei secoli in cui la Liberata era lettura immancabile per qualunque europeo mediamen- te colto. -

Iphigénie En Tauride
Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Tauride CONDUCTOR Tragedy in four acts Patrick Summers Libretto by Nicolas-François Guillard, after a work by Guymond de la Touche, itself based PRODUCTION Stephen Wadsworth on Euripides SET DESIGNER Saturday, February 26, 2011, 1:00–3:25 pm Thomas Lynch COSTUME DESIGNER Martin Pakledinaz LIGHTING DESIGNER Neil Peter Jampolis CHOREOGRAPHER The production of Iphigénie en Tauride was Daniel Pelzig made possible by a generous gift from Mr. and Mrs. Howard Solomon. Additional funding for this production was provided by Bertita and Guillermo L. Martinez and Barbara Augusta Teichert. The revival of this production was made possible by a GENERAL MANAGER gift from Barbara Augusta Teichert. Peter Gelb MUSIC DIRECTOR James Levine Iphigénie en Tauride is a co-production with Seattle Opera. 2010–11 Season The 17th Metropolitan Opera performance of Christoph Willibald Gluck’s Iphigénie en This performance is being broadcast Tauride live over The Toll Brothers– Metropolitan Conductor Opera Patrick Summers International Radio Network, in order of vocal appearance sponsored by Toll Brothers, Iphigénie America’s luxury Susan Graham homebuilder®, with generous First Priestess long-term Lei Xu* support from Second Priestess The Annenberg Cecelia Hall Foundation, the Vincent A. Stabile Thoas Endowment for Gordon Hawkins Broadcast Media, A Scythian Minister and contributions David Won** from listeners worldwide. Oreste Plácido Domingo This performance is Pylade also being broadcast Clytemnestre Paul Groves** Jacqueline Antaramian live on Metropolitan Opera Radio on Diane Agamemnon SIRIUS channel 78 Julie Boulianne Rob Besserer and XM channel 79. Saturday, February 26, 2011, 1:00–3:25 pm This afternoon’s performance is being transmitted live in high definition to movie theaters worldwide. -

3149028132861.Pdf
1 HAYDN ET RAGUÉ Enregistré par Little Tribeca à l’Auditorium du Louvre (Paris) en octobre 2018 Direction artistique, montage et mastering : Maximilien Ciup Prise de son : Maximilien Ciup et Gaëtan Juge SACCHINI, GLUCK, LEMOYNE, VOGEL ET GRÉTRY Enregistré par Little Tribeca au Conservatoire Jean-Baptiste Lully (Puteaux) en mars 2019 Direction artistique, montage et mastering : Maximilien Ciup Prise de son : Maximilien Ciup, assisté de Hugo Scremin Production exécutive : Little Tribeca et Les Idées Heureuses Traduction anglaise par Charles Johnston Textes édités en français par Claire Boisteau Photo © Franck Juery · Design © 440.media Sophie Karthäuser participe à cet enregistrement avec l’aimable autorisation d’harmonia mundi. En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles pour les éditions des partitions de Grétry et Vogel AP210 Little Tribeca · Les Idées Heureuses ℗ & © 2019 [LC] 83780 1 rue Paul-Bert, 93500 Pantin, France apartemusic.com 2 LE CONCERT DE LA LOGE JULIEN CHAUVIN violon et direction SOPHIE KARTHÄUSER soprano 1-4. JOSEPH HAYDN (1732-1809), Symphonie no 87 en la majeur « L’Impatiente », Hob.I:87 Symphony no.87 in A major ‘The Impatient’ I. Vivace 6’31 II. Adagio 6’13 III. Menuet – Trio 3’48 IV. Finale. Vivace 4’14 5. ANTONIO SACCHINI (1730-1786), « C’est votre bonté que j’implore » extrait de/from Chimène ou Le Cid (Chimène) 3’49 6. CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714-1787), « Fortune ennemie » extrait de/from Orphée et Eurydice (Eurydice) 4’58 7. JEAN-BAPTISTE LEMOYNE (1751-1796), « Il va venir » extrait de/from Phèdre (Phèdre) 3’06 8. JOHANN CHRISTOPH VOGEL (1756-1788), « Âge d’or, ô bel âge » extrait de/from Démophon (Dircée) 4’44 9. -

Armide 1778 Gens Van Mechelen Christoyannis Santon Jeffery Watson Martin Wilder
LULLY ARMIDE 1778 GENS VAN MECHELEN CHRISTOYANNIS SANTON JEFFERY WATSON MARTIN WILDER LE CONCERT SPIRITUEL HERVÉ NIQUET SOMMAIRE | CONTENTS | INHALT ARMIDE, D’UN SIÈCLE À L’AUTRE PAR BENOÎT DRATWICKI p. 8 ARMIDE, FROM ONE CENTURY TO THE NEXT BY BENOÎT DRATWICKI p. 14 ARMIDE IM WANDEL DER JAHRHUNDERTE VON BENOÎT DRATWICKI p. 18 SYNOPSIS EN FRANÇAIS p. 28 SYNOPSIS IN ENGLISH p. 32 INHALTSANGABE p. 36 BIOGRAPHIES EN FRANÇAIS p. 40 BIOGRAPHIES IN ENGLISH p. 44 BIOGRAPHIEN p. 46 LIBRETTO p. 50 CRÉDITS, CREDITS, BEZETZUNG p. 77 6 7 LULLY ARMIDE TRAGÉDIE LYRIQUE EN UN PROLOGUE ET CINQ ACTES, CRÉÉE À L’ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE À PARIS LE 15 FÉVRIER 1686, VERSION RÉVISÉE EN 1778 PAR LOUIS-JOSEPH FRANCŒUR MUSIQUE DE JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) ET LOUIS-JOSEPH FRANCŒUR (1738-1804) LIVRET DE PHILIPPE QUINAULT (1635-1688) VÉRONIQUE GENS ARMIDE REINOUD VAN MECHELEN RENAUD TASSIS CHRISTOYANNIS HIDRAOT, LA HAINE CHANTAL SANTON JEFFERY PHÉNICE, LUCINDE KATHERINE WATSON SIDONIE, UNE NAÏADE, UN PLAISIR PHILIPPE-NICOLAS MARTIN ARONTE, ARTÉMIDORE, UBALDE ZACHARY WILDER LE CHEVALIER DANOIS LE CONCERT SPIRITUEL CHŒUR ET ORCHESTRE HERVÉ NIQUET DIRECTION COPRODUCTION CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES, LE CONCERT SPIRITUEL PARTITION RÉALISÉE ET ÉDITÉE PAR LE CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES (JULIEN DUBRUQUE) LULLY ARMIDE CD1 CD2 ACTE I ACTE III 1 OUVERTURE 5’19 1 « Ah ! si la liberté me doit être ravie » ARMIDE 3’12 2 « Dans un jour de triomphe, au milieu des plaisirs » PHÉNICE, SIDONIE 2’45 2 « Que ne peut point votre art ? La force en est -
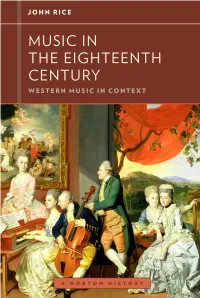
MUSIC in the EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor
MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY John Rice n W. W. NORTON AND COMPANY NEW YORK ē LONDON W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program— trade books and college texts—were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: JoAnn Simony Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics—Fairfield, PA Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rice, John A. -

The Recorded Examples Les Illustrations Sonores
The recorded examples The eight CDs that accompany this treatise follow its argument closely. Lengthy works or those on a large scale are represented by a few well-chosen excerpts; we have also chosen to refer the listener to certain complete recordings that are easily available through normal commercial channels. The greatest performers of our time have devoted their talents to making these works live again; some of these works have also enjoyed stage revivals, as was the case with Lully’s Atys, conducted by William Christie and directed by Jean-Marie Villégier in 1987 in a staging that has since become legendary. More recently, the young conductor Sébastien Daucé has presented the first reconstruction of aballet de cour, the Ballet royal de la Nuit. Les illustrations sonores Les huit disques qui accompagnent cet ouvrage suivent pas à pas le cours de ce récit. En ce qui concerne les œuvres de grande envergure, elles ne sont illustrées ici que par quelques extraits représentatifs. Il convient évidemment de se référer aux quelques enregistrements complets qui sont disponibles sur le marché du disque. Les plus grands interprètes de notre époque ont apporté tout leur talent à faire revivre ces ouvrages, bénéficiant parfois aussi de la possibilité d’une représentation scénique, comme ce fut le cas pour Atys de Lully, dont le spectacle dirigé par William Christie pour la musique et par Jean-Marie Villégier pour la mise en scène fut, en 1987, un événement mémorable. Tout récemment, c’est le jeune chef Sébastien Daucé qui a proposé la première reconstitution d’un ballet de cour, Le Ballet royal de la Nuit… 140 CD I AIRS DE COUR & BALLETS DE COUR 1. -

LULLY, J.: Armide (Opera Lafayette, 2007) Naxos 8.66020910 Jeanbaptiste Lully (1632 1687) Armide Tragé
LULLY, J.: Armide (Opera Lafayette, 2007) Naxos 8.66020910 JeanBaptiste Lully (1632 1687) Armide Tragédie en musique Libretto by Philippe Quinault, based on Torquato Tasso's La Gerusalemme liberata (Jerusalem Delivered), transcribed and adapted from Le théâtre de Mr Quinault, contenant ses tragédies, comédies et opéras (Paris: Pierre Ribou, 1715), vol. 5, pp. 389428. ACTE I ACT I Le théâtre représente une grande place ornée d’un arc de The scene represents a public place decorated with a Triumphal triomphe Arch. SCÈNE I SCENE I ARMIDE, PHÉNICE, SIDONIE ARMIDE, PHENICE, SIDONIE PHÉNICE PHENICE Dans un jour de triomphe, au milieu des plaisirs, On a day of victory, amid its pleasures, Qui peut vous inspirer une sombre tristesse? Who can inspire such dark sadness in you? La gloire, la grandeur, la beauté, la jeunesse, Glory, greatness, beauty, youth, Tous les biens comblent vos désirs. All these bounties fulfill your desires. SIDONIE SIDONIE Vous allumez une fatale flamme You spark a fatal flame Que vous ne ressentez jamais ; That you never feel: L’amour n’ose troubler la paix Love does not dare trouble the peace Qui règne dans votre âme. That reigns in your soul. ARMIDE, PHÉNICE et SIDONIE ensemble ARMIDE, PHENICE & SIDONIE together Quel sort a plus d’appâts? What fate is more desirable? Et qui peut être heureux si vous ne l’êtes pas? And who can be happy if you are not? PHÉNICE PHENICE Si la guerre aujourd’hui fait craindre ses ravages, If today war threatens its ravages, C’est aux bords du Jourdain qu’ils doivent s’arrêter. -

METASTASIO COLLECTION at WESTERN UNIVERSITY Works Intended for Musical Setting Scores, Editions, Librettos, and Translations In
METASTASIO COLLECTION AT WESTERN UNIVERSITY Works Intended for Musical Setting Scores, Editions, Librettos, and Translations in the Holdings of the Music Library, Western University [London, Ontario] ABOS, Girolamo Alessandro nell’Indie (Ancona 1747) (Eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) (From London: British Library [Add. Ms. 14183]) Aria: “Se amore a questo petto” (Alessandro [v.1] Act 1, Sc.15) [P.S.M. Ital. Mus. Ms. Sec.A, Pt.1, reel 8] ABOS, Girolamo Artaserse (Venice 1746) (Mid-eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) (From London: British Library [Add. Ms. 31655]) Aria: “Mi credi spietata?” (Mandane, Act 3, Sc.5) [P.S.M. Ital. Mus. Ms. Sec.C, Pt.2, reel 27] ADOLFATI, Andrea Didone abbandonata (with puppets – Venice 1747) (Venice 1747) – (Venice: Luigi Pavini, 1747) – (Libretto) [W.U. Schatz 57, reel 2] AGRICOLA, Johann Friedrich Achille in Sciro (Berlin 1765) (Berlin 1765) – (Berlin: Haude e Spener, 1765) – (Libretto) (With German rendition as Achilles in Scirus) [W.U. Schatz 66, reel 2] AGRICOLA, Johann Friedrich Alessandro nell’Indie (as Cleofide – Berlin 1754) (Berlin 1754) – (Berlin: Haude e Spener, [1754]) – (Libretto) (With German rendition as Cleofide) [W.U. Schatz 67, reel 2] ALBERTI, Domenico L’olimpiade (no full setting) (Eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) (From London: British Library [R.M.23.e.2 (1)]) Aria: “Che non mi disse un dì!” (Argene, Act 2, Sc.4) [P.S.M. Ital. Mus. Ms. Sec.B, Pt.4, reel 73] ALBERTI, Domenico Temistocle (no full setting) (Eighteenth century) – (Microfilm of Ms. Score) 2 (From London: British Library [R.M.23.c.19]) Aria: “Ah! frenate il pianto imbelle” (Temistocle, Act 3, Sc.3) [P.S.M. -

Passacaille of Armide
The ‘Passacaille of Armide’ Revisited: Rhetorical Aspects of Quinault’s / Lully’s tragédie en musique Kimiko Okamoto The tragédie en musique is a dramatic genre invented by for the effective deliverance of ideas. Oratory can strengthen Philippe Quinault and Jean-Baptiste Lully in the tradition of its impact by elaborating the usage of words, and to this end, French musical theatre; Armide was the last collaboration of techniques of word arrangement were systematised into those creators, and was first staged in 1686. The arch-shaped ‘figures’ and ‘tropes’; the former was absorbed into German (palindromic) symmetry of the verbal, musical and dramatic music theory, and named Figurenlehre. According to the structures of this genre has been pointed out by a number of Figurenlehre, musical motifs are manoeuvred in the same scholars,1 whereas few have discussed its rhetorical order, manner as words in oratory. Although dance treatises never another structural feature of seventeenth and early eight- mention rhetorical figures, the ways steps are arranged in the eenth-century compositions. Judith Schwartz was one of the notated choreographies bear a striking resemblance to these few to analyse the choreography of the ‘Passacaille’ from Act figures. A short sequence of steps often forms a choreo- V of Armide with reference to rhetorical structure.2 Notwith- graphic motif, which functions as a building block of a phrase standing, she applied the theory exclusively to choreogra- through repetition, enlargement, diminution and inversion – phy, leaving the music outside the rhetorical framework, just as the manipulation of words in speech and the manoeu- which Schwartz regarded as ‘asymmetry at odds with the vre of motifs in music. -

NOTES on GLUCK's ARMIDE by CARL VAN VECHTEN ICHARD WAGNER, Like Many Another Great Man, Took
NOTES ON GLUCK'S ARMIDE By CARL VAN VECHTEN ICHARD WAGNER, like many another great man, took what he wanted where he found it. Everyone has heard Downloaded from R the story of his remark to his father-in-law when that august musician first listened to Die WalkHre: "You will recognize this theme, Papa Liszt?" The motto in question occurs when Sieglinde sings: Kehrte der Voder nun heim. Liszt had used the tune at the beginning of his Faust symphony. Not long ago, in http://mq.oxfordjournals.org/ playing over Schumann's Kinderscenen, I discovered Brunnhilde's magic slumber music, exactly as it appears in the music drama, in the piece pertinently called Kind im Einschlummern. When Weber's Euryanihe was revived recently at the Metropolitan Opera House it had the appearance of an old friend, although comparatively few in the first night audience had heard the opera before. One recognized tunes, characters, and scenes, because Wagner had found them all good enough to use in Tannh&user at University of Toronto Library on July 15, 2015 and Lohengrin. 'But, at least, you will object, he invented the music drama. That, I am inclined to believe, is just what he did not do, as anyone may see for himself who will take the trouble to glance over the scores of the Chevalier Gluck and to read the preface to Alceste. Gluck's reform of the opera was gradual; Orphie (in its French version), Alceste, and IphigSnie en Aulide, all of which antedate Armide, are replete with indications of what was to come; but Armide, it seems to me, is, in intention at least, almost the music drama, as we use the term to-day. -

The Mezzo-Soprano Onstage and Offstage: a Cultural History of the Voice-Type, Singers and Roles in the French Third Republic (1870–1918)
The mezzo-soprano onstage and offstage: a cultural history of the voice-type, singers and roles in the French Third Republic (1870–1918) Emma Higgins Dissertation submitted to Maynooth University in fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy Maynooth University Music Department October 2015 Head of Department: Professor Christopher Morris Supervisor: Dr Laura Watson 1 TABLE OF CONTENTS Page number SUMMARY 3 ACKNOWLEDGEMENTS 4 LIST OF FIGURES 5 LIST OF TABLES 5 INTRODUCTION 6 CHAPTER ONE: THE MEZZO-SOPRANO AS A THIRD- 19 REPUBLIC PROFESSIONAL MUSICIAN 1.1: Techniques and training 19 1.2: Professional life in the Opéra and the Opéra-Comique 59 CHAPTER TWO: THE MEZZO-SOPRANO ROLE AND ITS 99 RELATIONSHIP WITH THIRD-REPUBLIC SOCIETY 2.1: Bizet’s Carmen and Third-Republic mores 102 2.2: Saint-Saëns’ Samson et Dalila, exoticism, Catholicism and patriotism 132 2.3: Massenet’s Werther, infidelity and maternity 160 CHAPTER THREE: THE MEZZO-SOPRANO AS MUSE 188 3.1: Introduction: the muse/musician concept 188 3.2: Célestine Galli-Marié and Georges Bizet 194 3.3: Marie Delna and Benjamin Godard 221 3.3.1: La Vivandière’s conception and premieres: 1893–95 221 3.3.2: La Vivandière in peace and war: 1895–2013 240 3.4: Lucy Arbell and Jules Massenet 252 3.4.1: Arbell the self-constructed Muse 252 3.4.2: Le procès de Mlle Lucy Arbell – the fight for Cléopâtre and Amadis 268 CONCLUSION 280 BIBLIOGRAPHY 287 APPENDICES 305 2 SUMMARY This dissertation discusses the mezzo-soprano singer and her repertoire in the Parisian Opéra and Opéra-Comique companies between 1870 and 1918. -

Journal Electronique 16/01/2017 13:25
Journal Electronique 16/01/2017 13:25 article suivant 17 janvier 2017 A Lanzarote, invitation à une plongée... A l'opéra, Chimène gagne sur tous les tableaux Une œuvre d'Antonio Sacchini a été exhumée avec succès, le 14 janvier, à Saint-Quentin-en-Yvelines, avant une tournée française la fin des années 1770, le goût français en matière de tragédie lyrique connaît A un dilemme cornélien. Valider la " réforme " de l'Autrichien Christoph Willibald Gluck pour endiguer les développements pyrotechniques du chant et mieux servir la poésie du livret ou consacrer le règne d'une expression fleurie, à l'italienne, magnifiée par Niccolo Piccinni ? Gluck vieillissant et ayant quitté la scène parisienne, qui trouve-t-on pour représenter son camp et s'opposer à Piccinni ? Antonio Sacchini, ami de ce dernier et jadis son allié. Corneille n'aurait pas trouvé meilleure intrigue, d'autant que Le Cid constitue la base de l'opéra commandé à Sacchini pour se mesurer à Piccinni et à son Didon lors du duel de compositeurs organisé au château de Fontainebleau en 1783. Créé le 18 novembre, Chimène ou le Cid ravit les adeptes du recentrage gluckiste sur l'expression dramatique, au premier rang desquels figure la reine Marie-Antoinette, dont Gluck avait été le professeur à Vienne. Repris avec succès l'année suivante à Paris (57 exécutions à l'Académie royale de musique), l'opéra de Sacchini tombera ensuite dans l'oubli. L'Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, l'exhume aujourd'hui " en recréation ". Découverte, le 14 janvier, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines avant une tournée qui passera en mars par Massy (Essonne) et Herblay (Val-d'Oise), cette production adopte le parti d'un rapprochement sur le plateau de tous les(f) acteursde l'œuvre : chanteurs et instrumentistes.