Le Livre Decadent: Editer, Illustrer, Lire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 Tese LBT Capa JOHN 20090619 Romano Layout
Universidade de Aveiro Departamento de Línguas e Culturas 2009 Maria Lúcia da Silva Representações de leitura(s) na obra de Bandeira Alphonse Daudet Représentations de lecture(s) dans l’œuvre daudétienne Universidade de Aveiro Departamento de Línguas e Culturas 2009 Maria Lúcia da Silva Representações de leitura(s) na obra de Bandeira Alphonse Daudet Représentations de lecture(s) dans l’œuvre daudétienne Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisi tos necessários à obtenção do grau de Doutor em Literatura, realizada sob a orientação científica da Dra. Maria Hermínia Deulonder Correia Amado Laurel , Professora Catedrática do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro II Aos meus Pais Ao meu filho Emanuel Ao Shing Kwan III o júri presidente Doutor José Carlos Esteves Duarte Pedro , Professor Catedrático da Universidade de Aveiro. vogais Doutora Maria Hermínia Deulonder Correia Amado Laurel , Professora Catedrática da Universidade de Aveiro. (Orientadora) Professora Maria do Nascimento Oliveira Carneiro , Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Doutor Luís Carlos Pimenta Gonçalves , Professor Auxiliar da Universidade Aberta. Doutora Maria Eugénia Tav ares Pereira , Professora Auxiliar da Universidade de Aveiro. Doutora Maria de Jesus Quintas Reis Cabral , Professora Auxiliar Convidada da Universidade Aberta. IV Agradecimentos Agradeço a todos os meus professores a dedicação no ensino do encantamento da palavra escrita, dita e sonhada. V palavras -chave Texto, livro, leitura, leitor, citação, biblioteca, salão de leitura, ficção, autobiografia, editores, jornais, publicações, recepção, res umo O século XIX testemunhou uma produção literária inegualável, registando vidas e obras de autores, títulos de obras, jornais e revistas. -

Daudet Maître Des Tendresses
Marie-Thérèse JOUVEAU ALPHONSE DAUDET, maître des tendresse Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc 3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang http://www.lpl.univ-aix.fr/guests/ciel/ En relisant ton Jack , ô maître des tendresses… Paul Mariéton AVANT-PROPOS Alphonse Daudet ! Cher et pauvre Alphonse ! Cher, car aimé de tant de millions de gens qui sont venus et viennent encore, chaque jour, visiter son moulin, faire le pèlerinage obligé à Fontvieille, à ce moulin, héros des fameuses L e t t re s dans lesquelles tant d’enfants, Français, certes, mais plus encore étrangers, ont appris à lire. Qui ne connaît La Chèvre de M. Seguin, Le Secret de Maître Cornille, L’Elixir du R é v é rend Père Gaucher, Les Trois Messes Basses, La Mule du Pape et bien d’autres encore, dont la si émouvante D e r n i è re Classe, des Contes du Lundi.. Et que dire de L’Arlésienne, si connue qu’elle est devenue une expression, « jouer l’Arlésienne », que l’on entend à la radio ou que l’on trouve dans l’un ou l’autre des journaux chaque jour de l’année ? Des centaines d’éditions, du format de poche aux éditions de luxe richement illustrées, des centaines de traductions, dans toutes les langues, des thèses, des diplômes, des livres sur Daudet et sur son œuvre, le cinéma aussi, avec Marcel Pagnol, grand admirateur de celui qu’il considérait comme un maître, ont popularisé l’homme, et, plus encore, l’œuvre. Oui, l’œuvre de Daudet est connue, est familière à tous ceux qui ont une certaine connaissance de notre langue à travers le monde et elle est aimée aussi par eux. -

4 Saisons Impressionnistes À Swann Et Saël, Qui Sont Le Printemps De Ma Vie 4 Saisons Impressionnistes
4 saisons impressionnistes À Swann et Saël, qui sont le printemps de ma vie 4 saisons impressionnistes En couverture, de gauche à droite : Laurent Manœuvre Camille Pissarro Matin, Printemps, Temps Gris, Éragny, 1900 Huile sur toile, 65,4 x 81 cm Collection particulière Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images Vincent van Gogh Le Semeur, 1888 Huile sur toile, 64,2 x 80,3 cm Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo © Bridgeman Images Auguste Renoir La Mare aux canards, 1873 Huile sur toile, 50,2 x 61 cm, Museum of Art, Dallas © Dallas Museum of Art Claude Monet La Pie, hiver 1868-1869 Huile sur toile 89 x 130 cm Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images © Editions des Falaises, 2020 16, avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 102, rue de Grenelle - 75007 Paris www.editionsdesfalaises.fr Sommaire P résentation 7 Le baromètre de l’âme 9 U ne tradition séculaire 23 Le temps des saisons 29 Mois, jours et heures 45 Les saisons à Paris 59 V ariations 67 L es couleurs des saisons 77 A u rythme des saisons 89 Les travaux et les jours 91 Les saisons des plaisirs 111 L ’éternel été 177 A l’épreuve du monde moderne 179 Le temps suspendu 185 Bibliographie 191 Vision d’Hildegarde de Bingen Liber Divinorum Operum ou Llvre des œuvres divines © Werner Forman Archive / Bridgeman Images Présentation Le changement perpétuel, en art, n’a pas plus d’importance que la constante immobilité. Teodor de Wyzewa es impressionnistes n’ont qu’exceptionnellement représenté les quatre saisons L sous forme d’un ensemble concerté. -

Masochism and Decadent Literature: Jean Lorrain and Joséphin Péladan
Masochism and Decadent Literature Jean Lorrain and Joséphin Péladan by Kanshi Hiroko Sato A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of French Studies School of Languages, Culture, Art History and Music The University of Birmingham March 2009 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This study explores the masochistic aspects of Decadent literature, which to date have been relatively neglected, or have received only sporadic attention as merely the passive forms of sadism, or sadomasochism (Mario Praz). As Jennifer Birkett suggests, Decadent sensibility and sexuality have arguably less affinity with Sade than Sacher-Masoch. Following Birkett, and utilising Gilles Deleuze‘s idea of the independence of masochism from sadism and description of the distinctive aesthetic features of masochistic texts, I investigate masochistic formations in French Decadent texts; the work of Jean Lorrain and of Joséphin Péladan. This study also involves a review of relevant writings by Freud and post-Freudian psychoanalysts (Leo Bersani and Kaja Silverman); an engagement with current literary-critical scholarship in Decadence (Emily Apter, Charles Bernheimer, Bram Dijkstra and Rita Felski), and in Sacher-Masoch (Nick Mansfield, John K. -

Catalogue, Tels Que Les Textes, Les Images Et Leur Disposition, Sont La Propriété D’Artoria S.A., Et Sont Protégés Par Les Lois Internationales Sur Le Droit D’Auteur
Affiches Autographes Livres © 2018, Artoria S.A. Tous droits réservés Tous les contenus de ce catalogue, tels que les textes, les images et leur disposition, sont la propriété d’Artoria S.A., et sont protégés par les lois internationales sur le droit d’auteur. Les objets figurant dans ce catalogue sont présentés avec l’autorisation expresse de leurs propriétaires. Images de couverture : Lot 134 Design et mise en page: Alex Porter (David Feldman S.A., Genève) Le catalogue tient lieu d’invitation Photographies non contractuelles Affiches Autographes Livres 1ère Vente aux Enchères Genève, 27 Novembre 2018 Exposition des lots Dans les locaux de la société David Feldman S.A. 26 novembre 2018 Route de Chancy 59, bâtiment D, 3ème étage 10h30-18h00 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse Avant le 26 novembre les lots sont visibles uniquement sur rendez-vous. Vente aux enchères En association avec David Feldman S.A. 27 novembre 2018 Route de Chancy 59, bâtiment D, 3ème étage 14h00 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse Contact Olivier Jean Directeur Vente aux enchères (locaux de David Feldman S.A.) : Spécialiste Autographes et Manuscrits Ludovic Miran Spécialiste Livres Anciens et Modernes Jacques Denis Relations Clientèle Estelle Leclère Communication et Marketing Romain Kohn Services Informatiques Artoria S.A. Adresse postale: Rue du Jeu de l’Arc 15 Case postale 731 1207 Genève, Suisse 1213 Petit-Lancy 1 Tél. : +41 (0) 22 727 0799 Genève - Suisse Email : [email protected] www.artoria.ch Introduction A beginning is a very delicate time S’agissant des premières lignes d’une première vente, la formule de Frank Herbert s’applique doublement. -

Três Cartas De Marcel Proust – O Autor Responde a Seus Críticos
Três cartas de Marcel Proust – o autor responde a seus críticos Alexandre Bebiano de Almeida Samuel Beckett não fazia questão de ler a vasta correspondência do autor de Em busca do tempo perdido. Ele abria sua monografia sobre o romance dizendo que não haveria ali “nenhuma alusão à vida e à morte legendárias de Marcel Proust, nem à viúva tagarela das Cartas”.1 Em outro ensaio, Beckett podia che- gar a imaginar as páginas de um diário, onde um virtual professor universitário registraria suas impressões de leitura: Acabo de ler uma carta de Proust, endereçada a não sei mais quem, uma (ou deveria dizer: um) dessas Albertines-Jupiens decerto, e onde explica por quais razões não pode mais, mas de maneira alguma, assoar o nariz domingo de manhã antes das seis horas. O microcosmo de sua tese, preci- pitando-se pelas alturas de um pagode invertido de tergiversações teleoló- gicas, termina esmagando a nossa sensibilidade como um bólido vitorioso.2 Sugerindo que ela seria um manancial de fórmulas decadentes, essas ironias podem afastar mais de um da correspondência de Proust, o que seria um equí- voco. Com efeito, descontando o caráter homofóbico da paráfrase (“a viúva taga- rela das Cartas”), assim como a irreverência para com o estilo pernóstico do pro- fessor universitário (sempre bem-vinda), a ironia de Beckett ressalta alguns dos elementos mais importantes da expressão proustiana: de um lado, as exageradas e infinitas complicações do “eu” (“não, não posso mais, mas de maneira alguma, assoar o nariz no domingo de manhã, antes das seis horas!”); e de outro, a tor- tuosa sintaxe, criada para suportar todas as complicações sentidas (ou inventadas) por esse “eu” ampliado pelos caprichos da imaginação, desejoso de abraçar, em um só movimento, em uma só oração, as tramas intrincadas vigentes em nosso 1 BECKETT, Samuel. -

The Novels, Romances and Writings of Alphonse Daudet
fyxmll Uttivmitg ptavg BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT OF Stletirg W. Sage X891 4,.4ifcy4j.i iirnliL The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924088382761 Alphonse Daudet and his Secretary. THE NOVELS, ROMANCES AND WRITINGS OF ALPHONSE DAUDET THIRTY YEARS IN PARIS ULTIMA • NEW YORK THE ATHENAEUM SOCIETY Copyright, 1899, 1900, By Little, Brown, and Company. AU righis reserved. CONTENTS. P»BB INTRODUCTORY NOTE ii Pages from My Life and My Books; I. The Arrival t II. Villemessant . 15 III. My First Coat 29 IV. History of My Books. — " Little What's-His- Name" 42 V. The Literary Salons 57 VI. My Drummer 74 VII. History of My Books. — Tartarin of Tarascon . 90 VIII. History of My Books. — Letters From My Mill . 103 IX. My First Play 117 X. Henri Rochefort 125 XI. Henry Monnier 143 XII. The End of a Mountebank and of Murger's Bohemia 149 XIII. History of My Books. — Jack 165 XIV. lie des Moineaux. — A Meeting on the Seine . 186 XV. History of My Books. — Fromont and Risler . 192 XVI. Turg^nieff 207 Ultima. Ultima ^^3 INTRODUCTORY NOTE. When this volume of fugitive articles, mainly reminiscent, was given to the public, in 1888, almost exactly thirty years had passed since the epoch-marking incident in Daudet's life to which the opening article is devoted. Ernest Daudet fixes for us the time of his brother's arrival in Paris as the early part of November 1857, when he ^ was about seventeen and a half years old ; and his first appearance in print — the publication of Les Amoureuses, the volume of verses many of which he had brought with him from the provinces — did not take place until the following year. -
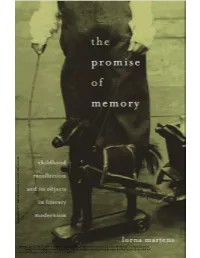
Martens, Lorna. the Promise of Memory : Childhood Recollection and Its Objects in Literary Modernism, Harvard University Press, 2011
Copyright © 2011. Harvard University Press. All rights reserved. Press. All Harvard University © 2011. Copyright Martens, Lorna. The Promise of Memory : Childhood Recollection and Its Objects in Literary Modernism, Harvard University Press, 2011. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/upenn-ebooks/detail.action?docID=3300992. Created from upenn-ebooks on 2020-11-15 15:09:33. T!" P#$%&'" $( M"%$#) Copyright © 2011. Harvard University Press. All rights reserved. Press. All rights Harvard University © 2011. Copyright Martens, Lorna. The Promise of Memory : Childhood Recollection and Its Objects in Literary Modernism, Harvard University Press, 2011. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/upenn-ebooks/detail.action?docID=3300992. Created from upenn-ebooks on 2020-11-15 15:09:33. Copyright © 2011. Harvard University Press. All rights reserved. Press. All rights Harvard University © 2011. Copyright Martens, Lorna. The Promise of Memory : Childhood Recollection and Its Objects in Literary Modernism, Harvard University Press, 2011. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/upenn-ebooks/detail.action?docID=3300992. Created from upenn-ebooks on 2020-11-15 15:09:33. T!" P#$%&'" $( M"%$#) Childhood Recollection and Its Objects in Literary Modernism L$#*+ M+#,"*' -+#.+#/ 0*&."#'&,) 1#"'' Cambridge, Massachusetts, and London, England 2344 Copyright © 2011. Harvard University Press. All rights reserved. Press. All rights Harvard University © 2011. Copyright Martens, Lorna. The Promise of Memory -

Alphonse Daudet Et L'italie
Transalpina Études italiennes 21 | 2018 Entre France et Italie : échanges et réseaux intellectuels au XIXe siècle Alphonse Daudet et l’Italie (1875-1897) De quelques éléments biographiques, relationnels et médiatiques Gabrielle Melison-Hirchwald Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/transalpina/305 DOI : 10.4000/transalpina.305 ISSN : 2534-5184 Éditeur Presses universitaires de Caen Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 2018 Pagination : 117-134 ISBN : 978-2-84133-900-6 ISSN : 1278-334X Référence électronique Gabrielle Melison-Hirchwald, « Alphonse Daudet et l’Italie (1875-1897) », Transalpina [En ligne], 21 | 2018, mis en ligne le 19 décembre 2019, consulté le 19 novembre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/transalpina/305 ; DOI : https://doi.org/10.4000/transalpina.305 Transalpina. Études italiennes ALPHONSE DAUDET ET L’ITALIe (1875-1897) De quelques éléments biographiques, relationnels et médiatiques Résumé : Attiré par les pays latins, Daudet eut l’occasion de se rendre avec sa famille en Italie, en 1875, puis en 1896. Ces brefs séjours, s’ils ont été peu exploités d’un point de vue littéraire et à peine relayés par la presse tant française qu’italienne, montrent un romancier très observateur de son environnement. Ses liens transalpins furent aussi développés grâce à l’amitié qu’il noua avec des personnalités aussi différentes que celles d’Edmondo De Amicis, de Joseph Primoli ou du peintre Giuseppe De Nittis. Dans la presse italienne, les quelques journaux dépouillés montrent l’intérêt pour l’œuvre et la carrière de Daudet, mettant en avant la diversité de sa production, à travers une comparaison fréquente avec le chef du mouvement naturaliste, Zola. -

Pre-Text Text Context
PRE-TEXT TEXT CONTEXT Essays on Nineteenth-Century French Literature Edited by Robert L. Mitchell OHIO STATE UNIVERSITY PRESS : COLUMBUS Copyright © 1980 by the Ohio State University Press All Rights Reserved Library of Congress Cataloging in Publication Data Main entry under title: Pre-text, text, context. Includes index. 1. French literature—19th century—History and criticism—Addresses, essays, lectures. I. Mitchell, Robert L., 1944- PQ282.P87 840'.9 80-11801 ISBN 0-8142-0305-1 CONTENTS Preface ix Editor's Note xi PART ONE : PRE-TEXT SUZANNE NASH Transfiguring Disfiguration in L'Homme qui rit: A Study of Hugo's Use of the Grotesque 3 BETTINA L. KNAPP La Fee aux miettes: An Alchemical Hieros Gamos 15 WILL L. McLENDON The Grotesque in Jean Lorrain's New Byzantium: Le Vice errant 25 CATHERINE LOWE The Roman tragique and the Discourse of Nervalian Mad ness 37 ANDREW J. McKENNA Baudelaire and Nietzsche: Squaring the Circle of Madness 53 NANCY K. MILLER "Tristes Triangles": Le Lys dans la vallee and Its Intertext 67 GODELIEVE MERCKEN-SPAAS Death and the Romantic Heroine: Chateaubriand and de Stael 79 vi Contents MARTHA N. MOSS Don Juan and His Fallen Angel: Images of Women in the Literature of the 1830s 89 PART TWO : TEXT ALBERT SONNENFELD Ruminations on Stendhal's Epigraphs 99 PAULINE WAHL Stendhal's Lamiel: Observations on Pygmalionism 113 ENID RHODES PESCHEL Love, the Intoxicating Mirage: Baudelaire's Quest for Com munion in "Le Vin des amants," "La Chevelure," and "Har monie du soir" 121 NATHANIEL WING The Danaides' Vessel: On Reading Baudelaire's Allegories 135 ROSS CHAMBERS Seeing and Saying in Baudelaire's "Les Aveugles" 147 LAURENCE M. -

Jean Lorrain, L'illusionniste Interférences Entre Monde(S) Et Fiction
Jean Lorrain, l’illusionniste : interférences entre monde(s) et fiction Élodie Dufour To cite this version: Élodie Dufour. Jean Lorrain, l’illusionniste : interférences entre monde(s) et fiction. Littératures. 2009. dumas-00399866 HAL Id: dumas-00399866 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00399866 Submitted on 29 Jun 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université Stendhal (Grenoble III) UFR de Lettres et arts Département de Littératures Jean Lorrain, l'illusionniste Interférences entre monde(s) et fiction Mémoire de recherche pour Master Littératures 1ère année Parcours « Écritures et représentations (XIXe-XXIe siècles) » 30 crédits Présenté par: Directeur de recherche: Élodie DUFOUR Bertrand VIBERT Professeur Année universitaire 2008-2009 1 Remerciements Non seulement pour sa patiente assistance tout au long de l'année, mais encore pour les courts stimulants dispensés en licence, et qui sont sans doute à l'origine de ce mémoire, merci à M. Vibert, qui m'a apporté ses lumières avec une grande disponibilité ainsi qu'une grande générosité. Par avance, merci également au deuxième membre du jury, qui a fort aimablement accepté de me lire et de m'offrir ses critiques. -

Mirbeau Et Daudet
MIRBEAU ET DAUDET Dans le numéro 21 des Grimaces, « pamphlet hebdomadaire », antigouvernemental, antiparlementaire et antisémite dont Mirbeau est le rédacteur en chef entre juillet 1883 et janvier 1884, on trouve un article intitulé « Coquelin, Daudet et Cie » dans lequel Mirbeau s’en prend violemment à l’auteur des Rois en exil dont l’adaptation vient d’être mise en scène au théâtre du Vaudeville : « La pièce est tombée, non avec fracas, […] mais sous l’ennui et le dégoût universels. Il y a bien eu quelques sifflets, mais ces sifflets ne me disent rien, car ils sifflaient les sentiments politiques de la pièce, et non sa littérature. […] Moi, c’est le talent que je siffle. »1 Au mois de juillet 1888, Alphonse Daudet publie L’Immortel et O. Mirbeau profite immédiatement de l’occasion (en réalité il l’attendait depuis quelque temps) pour lui écrire depuis sa retraite de Kérisper près d’Auray ; c’est d’ailleurs la première fois qu’il lui adresse directement un courrier. Que lui dit-il alors ? « Mon bien cher maître, Je suis ébloui, ravi, conquis dans toutes mes fibres et dans toutes mes pensées, par ce terrible et superbe Immortel. De vos œuvres pourtant si belles, c’est peut-être la plus belle et la plus puissante. Livre d’un art supérieur, d’une admirable bravoure et d’un haut dégoût […]. »2 C’est peu dire que le retournement est saisissant, et beaucoup des détracteurs de Mirbeau s’en empareront pour lui reprocher son inconstance, ses contradictions et ses palinodies ; d’autant que Mirbeau est familier de ces revirements comme peuvent en témoigner également ses relations avec Catulle Mendès, Paul Bourget ou Zola.