15 Décembre 09 Rhr Devoir Définitif
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cadre De Politique De Reinstallation Du Projet De
Cadre de Politique de Réinstallation du projet de réhabilitation des routes tertiaires– Sous-composante du Projet PACT 2019 ____________________________________________________________________________ Public Disclosure Authorized ________________ Projet d’Appui à la Connectivité des Transports (PACT) _________________ Public Disclosure Authorized CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DU PROJET Public Disclosure Authorized DE REHABILITITATION DES ROUTES TERTIAIRES _________________ Septembre 2019 RAPPORT Final Public Disclosure Authorized Page 1 sur 166 Cadre de Politique de Réinstallation du projet de réhabilitation des routes tertiaires– Sous-composante du Projet PACT 2019 ____________________________________________________________________________ Le présent Cadre de Politique de Réinstallation a été développé suivant les directives des Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale, particulièrement la Politique Opérationnelle 4.12 et l’Annexe A de la PO 4.12. Page 2 sur 166 Cadre de Politique de Réinstallation du projet de réhabilitation des routes tertiaires– Sous-composante du Projet PACT 2019 ____________________________________________________________________________ TABLE DES MATIERES 1 INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET 23 1.1 Introduction 23 1.2 Description du projet PACT et du projet d’aménagement des routes tertiaires – sous composantes du projet PACT 23 1.3 Justification de l’élaboration du Cadre de politique de réinstallation (CPR) 25 1.4 Démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration du CPR 26 1.5 Objet du CPR 28 2 -
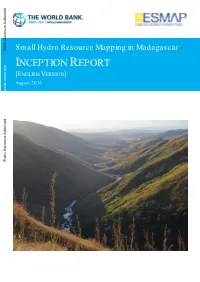
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Liste Candidatures Maires Atsimo Atsinanana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS BEFOTAKA ATSIMO ANTANINARENINA 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) TSIOTSITSY BEFOTAKA ATSIMO ANTANINARENINA 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) MILA Jean Veltô BEFOTAKA ATSIMO ANTANINARENINA 1 AFIMA (Afima) NATOMBOVOTSY BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) TSIMIRIA BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) TIAVA Boniface BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 AFIMA (Antoky Ny Fivoaran'ny Malagasy) RATONGALAHY Jumi BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 AFIMA (Antoky Ny Fivoaran'ny Malagasy) TSIBO Havamana BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) FAHEZA BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) LEUGENE Jean Paul INDEPENDANT FANDROSOANA (Indepandant BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 RAINIBAO Alexandre Fandrosoana) BEFOTAKA ATSIMO BEHARENA 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) TSAVE BEFOTAKA ATSIMO BEHARENA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) BRUNOT BEFOTAKA ATSIMO BEHARENA 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) PHILBERT Fanamby BEFOTAKA ATSIMO BEKOFAFA SUD 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) NIRINARISONY Ludget INDEPENDANT FIRAISANKINA (Independant BEFOTAKA ATSIMO BEKOFAFA SUD 1 RANDRIASON Lebec Randriason Lebec) BEFOTAKA ATSIMO BEKOFAFA SUD 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) MANAZONY INDEPENDANT MANDROSO (Independant BEFOTAKA ATSIMO MAROVITSIKA SUD 1 TSIKIVY Mandroso) INDEPENDANT FIRAISANKINA (Independant BEFOTAKA ATSIMO MAROVITSIKA SUD 1 MAHATENO Désiré Firaisankina ) BEFOTAKA ATSIMO MAROVITSIKA SUD 1 AHI (Antoko Hiaraka -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

EITI-Madagascar
Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar EITI-Madagascar Rapport de réconciliation 2018 Annexes Version finale Novembre 2019 Confidentiel – Tous droits réservés - Ernst & Young Madagascar Rapport final | 1 Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar Sommaire ANNEXES .......................................................................................................................................................... 3 Annexe 1 : Points de décision en matière de divulgation de la propriété réelle ........................................ 4 Annexe 2 : Tableau de correspondance entre flux de paiements et entités réceptrices ............................ 9 Annexe 3 : Données brutes pour sélectionner les compagnies ............................................................... 11 Annexe 4 : Identification des sociétés ..................................................................................................... 12 Annexe 5 : Arbres capitalistiques des sociétés ........................................................................................ 26 Annexe 6 : Présentation des flux de paiement ........................................................................................ 31 Annexe 7 : Matérialité des régies et des flux concernés par les taxes et revenus pour 2015 et 2016 (#4.1) 35 Annexe 8 : Cas Mpumalanga – Lettre du Ministre ................................................................................... 36 Annexe 9 : Cas Mpumalanga – Acte de rejet du BCMM ......................................................................... -

Le Chef De District Pointé Du Doigt
Le chef de district pointé du doigt Extrait du Madagascar-Tribune.com http://www.madagascar-tribune.com/Le-chef-de-district-pointe-du,3735.html Fraudes électorales à Vangaindrano Le chef de district pointé du doigt - Politique - Date de mise en ligne : mercredi 26 décembre 2007 Madagascar-Tribune.com Copyright © Madagascar-Tribune.com Page 1/3 Le chef de district pointé du doigt Le renversement des résultats se généralise dans toute l'Ile. Après, Sambaina, Ambohidrapeto, Ambohimandroso, on vient de nous signaler que dans le district de Vangaindrano, les résultats ont été falsifiés. Le sénateur Constance Razafimily a accusé le chef de district local comme chef d'orchestre de cette opération. Des plaintes ont été déposées. Le ton monte dans plusieurs localités de l'île après la proclamation officielle des résultats des dernières élections communales. En clair, des candidats, des partis politiques ainsi que des simples électeurs ont farouchement contesté des fraudes perpétrées par des représentants de l'Etat et l'inversion des résultats par le tribunal administratif. Dans le district de Vangaindrano, le sénateur Constance Razafimily a vivement critiqué les responsables gouvernementaux en charge des opérations de recensements des matériels de vote. Cet élu a pointé du doigt les délégués administratifs et surtout le chef de district de Vangaindrano comme le chef de file des opérations de fraudes électorales. Bien avant le dépôt de candidature, les éventuels candidats potentiels ont reçu des menaces et des intimidations de la part de ce représentant de l'Etat, a dénoncé M. Razafimily. Pire, ce chef de district, responsable de la collecte des procès-verbaux électoraux, a carrément falsifié ou changé les résultats en provenance des bureaux de vote, devait indiquer ce membre de la Chambre haute. -

EUROPEAN COMMISSION Emergency Humanitarian Aid Decision F9 (FED9) Title: Humanitarian Aid for People Affected by Food Shortage
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR HUMANITARIAN AID - ECHO Emergency Humanitarian Aid Decision F9 (FED9) Title: Humanitarian aid for people affected by food shortages and malnutrition in Madagascar Location of operation: MADAGASCAR Amount of Decision: EUR 500,000 Decision reference number: ECHO/MDG/EDF/2005/01000 Explanatory Memorandum 1 Rationale, needs and target population 1.1. Rationale: Madagascar is a poor country with frequent exposure to natural disasters. It has a population of 17,3 million, growing at a rate of 2,6 annually, in an area of 587 thousand sq. km. Its Gross National Income per capita is estimated to be US$300. The life expectancy at birth is 55,7 years.1 The 2005 Human Development Index ranks Madagascar 146th out of 177 countries. Madagascar is classified as 61st out of 139 countries (score 2, with 1 for natural disasters and 3 for child mortality) on DG ECHO’s own Global Needs Assessment (GINA) scale. The southern part of Madagascar suffers from chronic food insecurity. This year a fragile situation became an emergency, when repeated floods in the first half of 2005 were followed by insect infestation and drought in the second half. On 18 November 2005 a joint mission, including representatives of the ONN (Office National pour la Nutrition or National Office for Nutrition), SIRSA (Système d’Information Rurale et de Sécurité Alimentaire or Rural Food Security Information System), UNICEF, German Agro Action and the European Commission, confirmed the food security emergency reported by local authorities and ascertained by the nutrition survey of 07/11/05. The latter was undertaken by SIRSA, UNICEF and its implementing partners, WFP, CNS (Conseil National de Secours or National Relief Council), ONN and the Ministries of Health, Population, and Agriculture. -

SISAV 27 Finalpub Vu Joh.Pub
Bulletin SISAV Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité dans les Régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Androy et Anosy (Amboasary Atsimo) Bulletin SISAV n°27 L’essentiel Période couverte: La période couverte correspond à la mise en place des cultures de grande saison pour les Régions Décembre 2016 couvertes. Sur le plan météorologique, les prévisions de retard de la saison des pluies ont été Janvier 2017 confirmées, et il a été constaté une faiblesse des précipitations par rapport à la normale. Cela a perturbé la saison agricole et plus particulièrement le début de la période de mise en culture. Malgré le retard des pluies, les spéculations profitent de bonnes conditions météorologiques (retour de Zone de couverture la pluie, atténuation des vents forts) dans le sud au cours des mois de décembre et janvier derniers et on a observé une augmentation des superficies emblavées. Si les perspectives de récoltes sont bonnes actuellement pour l’ensemble du Sud, les difficultés alimentaires y sont toujours d’actualité et la période de soudure s’intensifie. Le niveau de vulnérabilité des Communes a connu une baisse grâce aux conditions des cultures au cours de la période d’observation et aux bonnes perspectives de récoltes ainsi qu’aux activités d’urgences qui y sont entreprises actuellement. Cela a aurait entre autres contribué à inverser la tendance dans le District d’Amboasary Atsimo, mais les actions devraient être renforcées afin de maintenir la tendance actuelle. Pour les Régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana, les conditions climatiques ne sont pas aussi bonnes pour l’agriculture. -

Bulletin Spécial N°2 Février 2013 Finale.Pdf
Bulletin spécial du SISAV Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité dans le Grand Sud-est Bulletin spécial n°2 - période cyclonique couverte: février 2013- publication mars 2013 Période d’observation Passage du cyclone HARUNA dans le Sud-Ouest de Madagascar février 2013 L M M J V S D Du 21 au 23 février 2013, le cyclone HARUNA a traversé le Sud de Madagascar affectant principalement les zones du Sud-Ouest où les interventions d’urgence affluent 1 2 3 actuellement. Dans le Grand Sud-Est, l’avis d’avertissement pour Midongy, 4 5 6 7 8 9 10 Vangaindrano et Befotaka a été annoncé le 19 février. Le cyclone HARUNA se trouvait 11 12 13 14 15 16 17 alors à 235km au Nord-Ouest de Morombe. Le 23 février, HARUNA se trouvait à 185 km au Sud Est de Taolagnaro, s’éloignant petit à petit de la grande île. La région Atsimo 18 19 20 21 22 23 24 Atsinanana a été couverte de fortes pluies entraînant des dégâts localisés non 25 26 27 28 généralisables pour l'ensemble des communes. Comparé à FELLENG qui est passé à proximité de la côte Est de Madagascar, HARUNA y a toutefois causé un peu plus de dégâts. Carte 1. Rappel de la trajectoire de la Perturbation Tropicale « HARUNA » Glossaire des termes techniques et expressions en langue Malagasy utilisés dans ce bulletin 1. Vulnérabilité :caractéristiqu es et circonstances d’une communauté qui la rendent susceptible de subir les effets d’insécurité alimentaire ou de sous- Source : Météorologie Malagasy, 23 février 2013. -

EITI Madagascar Rapport De Réconciliation Exercice 2011 Rapport De Réconciliation EITI Exercice 2011 Résumé Exécutif
EITI Madagascar Rapport de réconciliation Exercice 2011 Rapport de réconciliation EITI Exercice 2011 Résumé exécutif Contexte et objectifs du rapport Le présent document, intitulé « Rapport EITI Madagascar – Exercice 2011 », constitue le troisième rapport officiel de réconciliation de Madagascar, commandé par le Comité National de l’EITI. Son premier objectif est la réconciliation des flux financiers entre l’État et les principales industries extractives (compagnies minières et pétrolières amont) à Madagascar pour l’année fiscale 2011. Le rapport reflète également les recommandations préconisées par le Board of Directors international de l’EITI, notamment : ► L’état des dons remis par les entreprises extractives à la collectivité ; ► La mise en exergue des informations concernant les collectivités décentralisées (régions et communes) ; ► L’utilisation des fonds reçus des entreprises extractives par les communes pratiquant le budget participatif ; ► La divulgation de la production exportée au cours de l’année considérée ; ► La contribution fiscale et économique du secteur extractif dans l’économie malgache ; ► L’état des procédures d’octroi de permis en 2011 ; ► L’état de la transparence des titres extractifs disponible dans le domaine public. Etendue et approche La mission du Réconciliateur est régie par la norme internationale ISRS 4400 relative aux « Missions de procédure convenue relatives à des informations financières ». L’approche adoptée suit les étapes principales suivantes : ► La réalisation de l’étude de matérialité incluant -

Contribution À L'étude Des Migrations Antesaka
C O'N TRI B li T 1 0 li AL' ET li DE DES M1 G RAT ION SAN TES AKA Office de la Recherche SCientifique et Technique Outre-Her 20, rue Monsieur ~~..u-2-:..:Œ 1 959 des Rech~rches Sociologt~u~s Outr~~ OONTRIBUTIon A LIETUDE DES NIGRATIONS .LETESAKA par S. Vli~NES Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 2.0 , rue Tilonsieur PAR r S- 7° 1 9 5 9 CONTRIBUTION A L'ETUDE DES }'IIGRATI ONS ANTESAKA ~-------------------------------------------------- SOMM1IRE. PREMIERE· PARTIE : DESCRIPl'ION DE LA MIGRATION Chapitre l : Introduction .••...•••••••..••..•.•..••........••.•..•• p. 1 Historique ........................•.•.........•.••••••• p. 1 L'enquête.et les documents •••.••••••••.•..•.•••.•.•••• p. 2 Ampleur du mouvement migratoire .••..•.•..•.•.•.•.••••• P. 4 Interprétation des résultats •••••.•.•.••..•••••••••••• p. 5 Chapitre II: Les modalités du départ ••••.•••••••••.•••••••••••••••• p. 7 Les engagés •• ~ •••••••• ~ •••.••••••••••••••••••••••••• •• p. 8 Fréquence des départs sur contrat .••.••••••.•••••••••• p. Il Destination et condition des départs ••••.•••.•••.••••• p. 13 Chapitre III:Les modalités du dép81't (suite) ••••••••..•••...•..•••• p. 17 Les travailleurs libres ............................... p. 17 Les districts d1émigration .••••••••.•••.•.••••.••••••• p. 17 Manakara : étude des immigrés •.•••••••••••.••••••••••• p. 19 Les isolés: fonctionnaires et militaires ••••••••••••• p. 24 , : . ; . Les' 11 jamais partis" .••••.••.•••••••••••••••••.•.••_•••• p. 26 C~'pi.~e ,IV,: ~e re,tour. ~u IJay~ .••-•• a. ••••••••••••••••••••••••••••• -

Liste Candidatures Conseillers Atsimo Atsinanana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS BEFOTAKA ATSIMO ANTANINARENINA 1 AFIMA (Afima) TSIMINDRAMANA BEFOTAKA ATSIMO ANTANINARENINA 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) BETSAOVY BEFOTAKA ATSIMO ANTANINARENINA 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika ) RAZANABOAHARIMANANA Rémi BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) TOMBOMAHAIMILA INDEPENDANT MAHATIA (Indépendant BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 MAHATIA Andrianaivoson Hajasoa Mahatia ) BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 ANTOKO MAINTO (Antoko Maintso) RAZAFINDRAVELO Velosambatra BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) JEAN Joseph BEFOTAKA ATSIMO ANTONDAMBE 1 AFIMA (Antoky Ny Fivoaran'ny Malagasy) RANDRIANANTENAINA Martin BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) JOSEPH BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) TRAMALO Marcel Grégoire INDEPENDANT FANDROSOANA (Independant BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 RABEMALAMPIZAFITSALAMA Karl Nini Fandrosoana ) BEFOTAKA ATSIMO BEFOTAKA SUD 1 AFIMA (Antoky Ny Fivoaran'ny Malagasy) THEOPHILE BEFOTAKA ATSIMO BEHARENA 1 GROUPEMENT DE P.P IRK (Isika Rehetra) RAMAROSON Mamala BEFOTAKA ATSIMO BEHARENA 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) REMANA BEFOTAKA ATSIMO BEHARENA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RAZANAZATOVO Delors BEFOTAKA ATSIMO BEKOFAFA SUD 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RAZANAKA Berthin Gezé BEFOTAKA ATSIMO BEKOFAFA SUD 1 AHI (Antoko Hiaraka Isika) RAKOTO Philippe Mahatombo INDEPENDANT FIRAISANKINA (Independant BEFOTAKA ATSIMO BEKOFAFA SUD 1 NASTA FIRAISANKINA NASTA) BEFOTAKA