Madagascar: Une Sortie De Crise Superficielle?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Cosmetic End to Madagascar's Crisis?
A Cosmetic End to Madagascar’s Crisis? Africa Report N°218 | 19 May 2014 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i Recommendations..................................................................................................................... iii I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. From Deadlock to Elections ............................................................................................. 3 A. Postponed Elections................................................................................................... 3 B. Proxy Battles .............................................................................................................. 4 C. A Contested but Valid Election .................................................................................. 5 III. Old Wine, New Bottles ..................................................................................................... 7 A. Political Divides, Old and New .................................................................................. 7 1. Rivalry between Rajoelina and Rajaonarimampianina ....................................... 7 2. Parliamentary battles and the nomination of a prime minister ......................... -

Legislative and Second Round of Presidential Elections in Madagascar Final Report
ELECTION REPORT ✩ Legislative and Second Round of Presidential Elections in Madagascar Final Report December 2013 The Carter Center strives to relieve suffering by advancing peace and health worldwide; it seeks to prevent and resolve conflicts, enhance freedom and democracy, and protect and promote human rights worldwide. ELECTION REPORT ✩ Legislative and Second Round of Presidential Elections in Madagascar Final Report December 2013 One Copenhill 453 Freedom Parkway Atlanta, GA 30307 (404) 420-5100 www.cartercenter.org Contents Foreword..................................... 4 Candidates, Parties, and Campaigns ......... 28 Executive Summary........................... 6 Campaign Finance ......................... 30 Key Findings and Recommendations ......... 7 Participation of Women, Minorities, and Marginalized Groups ....................... 30 The Carter Center in Madagascar ............. 11 The Media ................................ 31 Deployment of Observers for the Civil Society ............................... 32 Dec. 20 Elections .......................... 11 Election Day ................................. 34 Historical and Political Background........... 14 Opening and Polling ....................... 34 Overview ................................. 14 Voting Process ............................ 34 Single-Party Dominance and a Close Relationship With France (1960–1975) ....... 14 Postelection Developments .................. 38 Single-Party Dominance and the Transfer of Results to District Transmission Red Admiral’s Break With France ........... -

Andry Rajoelina
Andry Rajoelina Andry Rajoelina ([ˈandʐʲ radzˈwelna]), né le 30 mai 1974 à Antsirabe, est un homme d'État malgache, Andry Rajoelina président de la République de Madagascar depuis le 18 janvier 2019. Chef d’entreprise, il est élu maire d'Antananarivo en 2007. Il mène le mouvement de contestation aboutissant à la crise politique de 2009 et au renversement du président Marc Ravalomanana. À la suite de ces événements, considérés comme une arrivée au pouvoir anti-constitutionnelle par plusieurs pays, il devient président de la Haute autorité de la transition et chef de l'État de facto. Il quitte le pouvoir en 2014, après avoir accepté de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord politique. Il se présente à l'élection présidentielle de 2018, qu’il remporte au second tour face à Marc Ravalomanana. Sommaire Andry Rajoelina en 2013. Biographie Fonctions Origines et vie familiale Président de la République de Carrière professionnelle (avant 2007) Madagascar Maire d'Antananarivo (2007-2009) En fonction depuis le 18 janvier 2019 Président de la Haute Autorité de transition (2 ans, 1 mois et 9 jours) (2009-2014) Élection 19 décembre 2018 Élection présidentielle de 2018 Premier ministre Christian Ntsay Président de la République (depuis 2019) Prédécesseur Rivo Rakotovao Publication (intérim) Prix et récompenses Hery Rajaonarimampianina Notes et références Président de la Haute Autorité de Voir aussi transition de Madagascar Articles connexes (chef de l'État) Liens externes 17 mars 2009 – 25 janvier 2014 (4 ans, 10 mois et 8 jours) Premier ministre Roindefo Monja Biographie Eugène Mangalaza Cécile Manorohanta (intérim) Origines et vie familiale Albert-Camille Vital Jean-Omer Beriziky Prédécesseur Hyppolite Ramaroson (intérim, de facto) Andry Nirina Rajoelina est né au sein de l'ethnie merina des Marc Ravalomanana Hauts-Plateaux de Madagascar. -

The Executive Survey General Information and Guidelines
The Executive Survey General Information and Guidelines Dear Country Expert, In this section, we distinguish between the head of state (HOS) and the head of government (HOG). • The Head of State (HOS) is an individual or collective body that serves as the chief public representative of the country; his or her function could be purely ceremonial. • The Head of Government (HOG) is the chief officer(s) of the executive branch of government; the HOG may also be HOS, in which case the executive survey only pertains to the HOS. • The executive survey applies to the person who effectively holds these positions in practice. • The HOS/HOG pair will always include the effective ruler of the country, even if for a period this is the commander of foreign occupying forces. • The HOS and/or HOG must rule over a significant part of the country’s territory. • The HOS and/or HOG must be a resident of the country — governments in exile are not listed. • By implication, if you are considering a semi-sovereign territory, such as a colony or an annexed territory, the HOS and/or HOG will be a person located in the territory in question, not in the capital of the colonizing/annexing country. • Only HOSs and/or HOGs who stay in power for 100 consecutive days or more will be included in the surveys. • A country may go without a HOG but there will be no period listed with only a HOG and no HOS. • If a HOG also becomes HOS (interim or full), s/he is moved to the HOS list and removed from the HOG list for the duration of their tenure. -
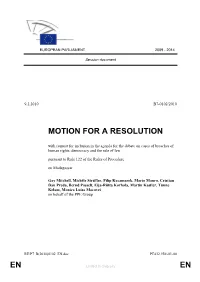
En En Motion for a Resolution
EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014 Session document 9.2.2010 B7-0102/2010 MOTION FOR A RESOLUTION with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law pursuant to Rule 122 of the Rules of Procedure on Madagascar Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei on behalf of the PPE Group RE\P7_B(2010)0102_EN.doc PE432.956v01-00 EN United in diversityEN B7-0102/2010 European Parliament resolution on Madagascar The European Parliament, – having regard to its previous resolutions on the Malagasy situation, in particular, the resolution adopted on 7 May 2009, – having regard to the ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000 and currently under second review, – having regard to the work by the International Contact Group on Madagascar, and in particular the Maputo and Addis Ababa agreements concluded on 9 August 2009 and 6 November 2009 respectively, – having regard to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly resolution adopted in Luanda (Angola) on 3 December 2009, – having regard to the Communique of the SADC Summit held in Maputo- Mozambique on 14 January 2010, – having regard to the 14th African Union Summit held in Addis Ababa- Ethiopia, 31 January to 2 February 2010, – having regard to Rule 122(5) of its Rules of Procedure, A. whereas Mr Andry Rajoelina, the mayor of the capital Antananarivo, became the head of the High Transitional Authority on 17 March 2009, when the military handed over the executive power that it had seized from former President Marc Ravalomanana, who was forced to resign and go into exile, B. -

Madagascar : Sortir Du Cycle De Crises
MADAGASCAR : SORTIR DU CYCLE DE CRISES Rapport Afrique N°156 – 18 mars 2010 TABLE OF CONTENTS SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS ............................................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. LA CRISE DE 2009 ........................................................................................................... 2 A. COMMENT MOBILISER LA FOULE : LES ELEMENTS DECLENCHEURS ............................................... 2 B. LES VIOLENCES DE JANVIER-MARS ............................................................................................... 4 1. Manifestations et répression ........................................................................................................ 4 2. Le rôle de l’armée ........................................................................................................................ 5 3. La passation de pouvoir ............................................................................................................... 6 C. ECHECS INITIAUX DE MEDIATION ................................................................................................. 7 1. Manque de consensus et de crédibilité de l’initiative des Eglises .............................................. 7 2. Manque de coordination de la communauté internationale ........................................................ 8 D. LA HAT : UN AN AU POUVOIR ..................................................................................................... -

Madagascar's Political Crisis
Madagascar’s Political Crisis Lauren Ploch Analyst in African Affairs Nicolas Cook Specialist in African Affairs June 18, 2012 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R40448 CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress Madagascar’s Political Crisis Summary Madagascar, an Indian Ocean island country, ranks among the world’s poorest countries, is the world’s fourth largest island and is extremely biologically diverse, with thousands of unique species of flora and fauna. It has experienced political instability since early 2009, initiated by tensions between the country’s last elected president, Marc Ravalomanana, and an opposition movement led by Andry Rajoelina, then the mayor of the capital city, Antananarivo. Mass protests in early 2009 and eventual military support for the ouster of President Ravalomanana culminated in his forced resignation from office. Rajoelina then seized power and, with other leaders, formed an interim self-declared transitional government, the High Transitional Authority (HAT, after its French acronym). Ravalomanana now lives in exile in South Africa. Periodic protests by Ravalomanana supporters after the takeover led to violent clashes with security forces. Negotiations between the parties led to the signing of an agreement in 2009 in Maputo, Mozambique to establish an inclusive, transitional government, but Rajoelina subsequently appointed a cabinet seen to be primarily composed of his own supporters. Southern African leaders and Madagascar’s opposition parties rejected the proposed government, and negotiations resumed. Two later agreements also failed to result in a unified transitional process. The unconstitutional change of power and resulting political impasse have negatively affected economic growth and development efforts and strained Madagascar’s relations with international donors. -
Des Femmes En Quête De Voix
DES FEMMES EN QUÊTE DE VOIX Bilan de la participation des femmes au Gouvernement et au Parlement de 2002 à 2013 Publié par Eisa 14 Park Road Richmond, Johannesburg Afrique du Sud P. O .Box 74 0 Auckland Park 2006 Afrique du Sud Tél : +27 11 4825 495 Fax: +27 11 482 6163 email: [email protected] site web: www.eisa.org.za © EISA 2014 1 Préface Je suis ravi que le Canada, à travers le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), ait pu collaborer avec l’Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) pour accroître le rôle des femmes dans la prise de décision et la promotion des droits des femmes et des filles à Madagascar. L’une des meilleures façons d’améliorer la condition et le bien-être des femmes est d’assurer leur participation pleine, égale et véritable à la prise de décision à tous les échelons de la vie politique, économique et sociale. Cette approche favorise et protège les droits des femmes tout en permettant à la société de tirer parti des expériences, des talents et des capacités de tous ses membres. Depuis près de trente ans, le Canada, par l’entremise du FCIL, finance des projets de petite envergure d’aide au développement dans les pays en voie de développement. À travers le FCIL, le Canada travaille au niveau de la communauté pour répondre aux besoins locaux. L’accent est mis sur des projets responsables et durables qui encouragent le renforcement des capacités, le développement communautaire et l’autonomisation. Au fil des années, le FCIL a non seulement grandement aidé les populations des pays en voie de développement, mais il a également aidé le Canada à tisser des liens avec ces populations, leurs sociétés civiles et leurs institutions. -

Situation Sociodémographique
Situation sociodémographique Population féminine plus jeune La population Malagasy compte plus de 24 millions d’habitants dont 49,9% sont des femmes. Elles constituent plus de la moitié de la population urbaine (51,9%). 51,9 Repartition de la population par milieu et par sexe (%) 50,5 50,1 49,5 49,9 48,1 Femme Homme URBAIN RURAL ENSEMBLE Les femmes sont plus représentées dans la Région Betsiboka (54,8% contre 45,2% des hommes). La Région Ihorombe a la plus faible représentativité (46,4% contre 53,6% des hommes). L’âge moyen de la population féminine est de 23,2 ans (population masculine : 23,3 ans) et les femmes sont plus représentées dans la tranche d’âge de 15 à 39 ans. Les femmes vivent plus longtemps avec une espérance de vie à la naissance de 67,1 ans contre 64 ans pour les hommes. Répartition de la population par âge et par sexe (%) 43,1 43,8 36,4 34,4 17,2 18,6 3,4 3,1 0-14 15-39 40-64 65 et + Femme Homme A noter que : Un ménage sur cinq est dirigé par une femme et les femmes chefs de ménages sont plus nombreuses en milieu urbain qu’en milieu rural. La population rurale continue d’augmenter en raison d’une croissance rapide de la population. L’indice synthétique de fécondité est de 5,2 enfants par femme à la campagne contre 2,7 en ville. Faible fréquentation scolaire L’Education Pour Tous prévoit comme objectif de scolariser 100% des enfants Malagasy. -

The Rosewood Chronicles
The rosewood chronicles Author: Hery Randriamalala This text outlines the daily events concerning the traffic of illegally- sourced rosewood from protected areas of Madagascar. Some paragraphs were written by direct observers, which accounts for the diversity of style in the text. Names of observers and of witnesses have been changed for their safety sake. The latest developments are at the end of the text. 26 January 2009 Activation of the “Black Monday” Plan at national level. 1/ 2 pm, Sambava: five hundred rioters from villages surrounding Sambava gathered in front of the store MAGRO. They stormed the shop, looted it, set fire to it and destroyed it along with the radio station MBS; two other shops and a vanilla factory connected with President Ravalomanana. Four of the perpetrators died in the blaze. 2/ 4 pm, Sambava: three empty 4x4s arrived from Antalaha, sent by wealthy residents of this town. Their aim: to collect the people who ransacked MAGRO and transport them to Antalaha to attack the local branch of TIKO. 3/ 6 pm, Antalaha: the population, supervised by the perpetrators, attacked and looted TIKO store. While the police and army officers remained in their barracks and police stations, those backing the attack sent their employees to steal the cache of timber seized by the Water and Forests Department of Antalaha, whose premises were deserted. Within minutes, hundreds of “bolabola” (logs of rosewood) disappeared, transported in trucks to private lots belonging to traffickers. Looters spent all night ransacking the offices of the Water and Forest Dept for the District of Antalaha. -

Chapter 5 CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
Chapter 5 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 5.1 Conclusion This thesis has described the role of AU in conflict resolution in Madagascar during the political conflict in 2009-2014. The research question is “What role did African Union play in resolving political conflict in Madagascar in 2009-2014?”.From the researches made in this memory, it has been proved that the African Union played a key role in the resolution of the political conflict in Madagascar in 2009, they played as an arena for the conflict resolution but they were also the main actors during the peace process due to the fact that they are the mediators. This thesis used theory of Institutional Liberalism which encompasses the concept of International Organization, and Conflict Resolution. This thesis discovers several findings. The first finding concerned the lesson that can be learned from the conflict resolution in Madagascar in 2009-2014. The peace processes adopted on the basis of economic and financial sanctions for a country dependent on external aid such as Madagascar cannot bring about a lasting peace. Four years after the 2014 elections, a new crisis and popular uprising took place in Madagascar. The second findings is about the contribution of this thesis to the Study of international relations. It highlighted than even if sometimes the role of an 110 international organization is not effectively accepted by the people of the country in non-armed conflict, international organization has the full right to get involved in the conflict resolution. This research contributes then to demonstrate the essence of the role of international organization in a non- armed conflict. -

Madagascar : Sortir Du Cycle De Crises
MADAGASCAR : SORTIR DU CYCLE DE CRISES Rapport Afrique N°156 – 18 mars 2010 TABLE OF CONTENTS SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS ............................................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. LA CRISE DE 2009 ........................................................................................................... 2 A. COMMENT MOBILISER LA FOULE : LES ELEMENTS DECLENCHEURS ............................................... 2 B. LES VIOLENCES DE JANVIER-MARS ............................................................................................... 4 1. Manifestations et répression ........................................................................................................ 4 2. Le rôle de l’armée ........................................................................................................................ 5 3. La passation de pouvoir ............................................................................................................... 6 C. ECHECS INITIAUX DE MEDIATION ................................................................................................. 7 1. Manque de consensus et de crédibilité de l’initiative des Eglises .............................................. 7 2. Manque de coordination de la communauté internationale ........................................................ 8 D. LA HAT : UN AN AU POUVOIR .....................................................................................................