Des Femmes En Quête De Voix
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Crise Malgache
Actuelle de l’Ifri L’Afrique en questions 5 : Crise malgache Sylvain Touati Mathieu Pellerin Février 2009 1 © Ifri Crise malgache L'ampleur des violences qui frappent Madagascar ont peu surpris les observateurs. Les signes avant-coureurs de la crise sont apparus sur l'île depuis plusieurs mois dans un contexte social et politique tendu. Cette crise trouve ses racines dans un mouvement de contestation à l'encontre de la gestion du gouvernement du président Ravalomanana des questions économiques, politiques et sociales. Les parallèles avec la crise politique de 2002 sont nombreux mais restent toutefois insuffisants pour expliquer la situation actuelle. Mathieu Pellerin, journaliste et consultant, commente la crise en détaillant les fractures politiques, sociales, économiques qui tiraillent la société malgache et les rivalités personnelles qui aujourd'hui opposent le président malgache et le maire de la capitale, Antananarivo. 2 © Ifri Sylvain Touati ; Mathieu Pellerin / Crise malgache Sylvain Touati : Où en est la situation aujourd'hui à Madagascar ? Mathieu Pellerin : Andry Rajoelina1 et Marc Ravalomanana2 se sont enfin rencontrés ce samedi 21 février grâce à la médiation dirigée par le FFKM3 (Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar). Les deux parties sont parvenues à un consensus sur des préalables à l'ouverture de négociation : arrêter toute incitation à la violence, cesser les provocations et les dénigrements médiatiques, les manifestations et troubles à l'ordre public, les poursuites et arrestations d'ordre politique. Jusqu'à maintenant, ces préalables ont été respectés, et les deux camps se sont de nouveau retrouvés le lundi 23 février. Ces préalables réunis, l'heure est aujourd'hui à l'établissement de conditions pour que les négociations puissent aboutir à une solution de sortie de crise. -

A Cosmetic End to Madagascar's Crisis?
A Cosmetic End to Madagascar’s Crisis? Africa Report N°218 | 19 May 2014 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i Recommendations..................................................................................................................... iii I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. From Deadlock to Elections ............................................................................................. 3 A. Postponed Elections................................................................................................... 3 B. Proxy Battles .............................................................................................................. 4 C. A Contested but Valid Election .................................................................................. 5 III. Old Wine, New Bottles ..................................................................................................... 7 A. Political Divides, Old and New .................................................................................. 7 1. Rivalry between Rajoelina and Rajaonarimampianina ....................................... 7 2. Parliamentary battles and the nomination of a prime minister ......................... -

Legislative and Second Round of Presidential Elections in Madagascar Final Report
ELECTION REPORT ✩ Legislative and Second Round of Presidential Elections in Madagascar Final Report December 2013 The Carter Center strives to relieve suffering by advancing peace and health worldwide; it seeks to prevent and resolve conflicts, enhance freedom and democracy, and protect and promote human rights worldwide. ELECTION REPORT ✩ Legislative and Second Round of Presidential Elections in Madagascar Final Report December 2013 One Copenhill 453 Freedom Parkway Atlanta, GA 30307 (404) 420-5100 www.cartercenter.org Contents Foreword..................................... 4 Candidates, Parties, and Campaigns ......... 28 Executive Summary........................... 6 Campaign Finance ......................... 30 Key Findings and Recommendations ......... 7 Participation of Women, Minorities, and Marginalized Groups ....................... 30 The Carter Center in Madagascar ............. 11 The Media ................................ 31 Deployment of Observers for the Civil Society ............................... 32 Dec. 20 Elections .......................... 11 Election Day ................................. 34 Historical and Political Background........... 14 Opening and Polling ....................... 34 Overview ................................. 14 Voting Process ............................ 34 Single-Party Dominance and a Close Relationship With France (1960–1975) ....... 14 Postelection Developments .................. 38 Single-Party Dominance and the Transfer of Results to District Transmission Red Admiral’s Break With France ........... -

Rapport De Synthese Des Recommandations Relatives Aux Composantes Mine Et Pipeline
Ⴒၳ۾ޏ10ȅ۪ RAPPORT DE SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX COMPOSANTES MINE ET PIPELINE -------------------- AUDIENCE PUBLIQUE A MORAMANGA ---------------- Par Narisoa RAMANITRA 㧙 157 㧙 SOMMAIRE I. CONTEXTE ET GENERALITE I.1. INTRODUCTION I.2. NOTION ET FINALITE DE LA DEMOCRATIE DIRECTE I.2. IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC I.3. COMMISSION I.4. OBJECTIFS DU MANDAT ,/(60(0%5(6'(/¶(48,3( Moramanga Tamatave I.6. METHODOLOGIE ,0pWKRGHGHPLVHjQLYHDXHWGHPDvWULVHGXFRQWHQXGHO¶(,(6 I.6.2. Méthode utilisée lors de la phase de préparation sur le terrain I.6.3. Méthodes de travail avec le cahier de registre I.6.4. Mode de réalisatiRQGHO¶DXGLHQFHSXEOLTXH Phase de discours 3KDVHG¶LQIRUPDWLRQV 3KDVHGHUHFXHLOG¶RSLQLRQ Phase de clôture I.7. ORGANISATION ET RESPONSABILI6$7,21 '(6 (148(7(856 (7 '(6 AUDITEURS I.7.1. OUTILS (de synthèse et de restitution) ,3DUWLFLSDWLRQGHO¶pTXLSHDX[GLIIpUHQWHVDXGLHQFHVFRPPXQDOHV I.7.3. Par rapport à la participation GXSXEOLFjO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH du projet I.7.4. Pour la production des procès veUEDX[ UDSSRUW HW FRQFOXVLRQV VXU OD SDUWLFLSDWLRQGXSXEOLF 㧙 158 㧙 ,,'(528/(0(17'(/¶$8',(1&(38%/,48($025$0$1*$ II.1. Première partie : ouverture officielle II.2. Deuxième partie : phase informative ,,7URLVLqPHSDUWLHTXHVWLRQV±UpSRQVHV ,,4XDWULqPHSDUWLHSKDVHGHUHFXHLOG¶DYLV II.5.Cinquième partie : clôture ,,&DWpJRULVDWLRQGHVTXHVWLRQVORUVGHO¶DXGLHQFH ,,([SUHVVLRQGHVDYLVGXSXEOLFDXFRXUVGHO¶DXGLHQFHRXpFULWVGDQVOHFDKLHUGH UHJLVWUH ,,/HVSURSRVLWLRQVGXSXEOLFHWH[SUHVVLRQVG¶DYLV II.9.CONCLUSION ,,, 6<17+(6( '(6 5(&200$1'$7,216 &21&(51$17 /$ &20326$17( MINE ,,,3285&(17$*(6'¶(;35(66,21'(6$9,69,//$*(2,6 ,,,3285&(17$*(6'¶(;35(66,21'(6$9,6&20081$8; ,,,6<17+(6(6&20081(6 ,9 6<17+(6( '(6 5(&200$1'$7,216 (1 5(/$7,21 $9(& /$ &20326$17(3,3(/,1( CONCLUSION GENERALE 㧙 159 㧙 I . -

Andry Rajoelina
Andry Rajoelina Andry Rajoelina ([ˈandʐʲ radzˈwelna]), né le 30 mai 1974 à Antsirabe, est un homme d'État malgache, Andry Rajoelina président de la République de Madagascar depuis le 18 janvier 2019. Chef d’entreprise, il est élu maire d'Antananarivo en 2007. Il mène le mouvement de contestation aboutissant à la crise politique de 2009 et au renversement du président Marc Ravalomanana. À la suite de ces événements, considérés comme une arrivée au pouvoir anti-constitutionnelle par plusieurs pays, il devient président de la Haute autorité de la transition et chef de l'État de facto. Il quitte le pouvoir en 2014, après avoir accepté de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord politique. Il se présente à l'élection présidentielle de 2018, qu’il remporte au second tour face à Marc Ravalomanana. Sommaire Andry Rajoelina en 2013. Biographie Fonctions Origines et vie familiale Président de la République de Carrière professionnelle (avant 2007) Madagascar Maire d'Antananarivo (2007-2009) En fonction depuis le 18 janvier 2019 Président de la Haute Autorité de transition (2 ans, 1 mois et 9 jours) (2009-2014) Élection 19 décembre 2018 Élection présidentielle de 2018 Premier ministre Christian Ntsay Président de la République (depuis 2019) Prédécesseur Rivo Rakotovao Publication (intérim) Prix et récompenses Hery Rajaonarimampianina Notes et références Président de la Haute Autorité de Voir aussi transition de Madagascar Articles connexes (chef de l'État) Liens externes 17 mars 2009 – 25 janvier 2014 (4 ans, 10 mois et 8 jours) Premier ministre Roindefo Monja Biographie Eugène Mangalaza Cécile Manorohanta (intérim) Origines et vie familiale Albert-Camille Vital Jean-Omer Beriziky Prédécesseur Hyppolite Ramaroson (intérim, de facto) Andry Nirina Rajoelina est né au sein de l'ethnie merina des Marc Ravalomanana Hauts-Plateaux de Madagascar. -

The Executive Survey General Information and Guidelines
The Executive Survey General Information and Guidelines Dear Country Expert, In this section, we distinguish between the head of state (HOS) and the head of government (HOG). • The Head of State (HOS) is an individual or collective body that serves as the chief public representative of the country; his or her function could be purely ceremonial. • The Head of Government (HOG) is the chief officer(s) of the executive branch of government; the HOG may also be HOS, in which case the executive survey only pertains to the HOS. • The executive survey applies to the person who effectively holds these positions in practice. • The HOS/HOG pair will always include the effective ruler of the country, even if for a period this is the commander of foreign occupying forces. • The HOS and/or HOG must rule over a significant part of the country’s territory. • The HOS and/or HOG must be a resident of the country — governments in exile are not listed. • By implication, if you are considering a semi-sovereign territory, such as a colony or an annexed territory, the HOS and/or HOG will be a person located in the territory in question, not in the capital of the colonizing/annexing country. • Only HOSs and/or HOGs who stay in power for 100 consecutive days or more will be included in the surveys. • A country may go without a HOG but there will be no period listed with only a HOG and no HOS. • If a HOG also becomes HOS (interim or full), s/he is moved to the HOS list and removed from the HOG list for the duration of their tenure. -

Madagascar's 2009 Political Crisis
Madagascar’s 2009 Political Crisis Lauren Ploch Analyst in African Affairs October 7, 2009 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R40448 CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress Madagascar’s 2009 Political Crisis Summary Political tensions on the Indian Ocean island of Madagascar between President Marc Ravalomanana and Andry Rajoelina, the former mayor of the capital city, escalated in early 2009, culminating in the President’s forced removal from office. In preceding weeks, over 135 people had been killed in riots and demonstrations. Under intensifying pressure from mutinous soldiers and large crowds of protestors, Ravalomanana handed power to the military on March 17, 2009. The military then transferred authority to Rajoelina, who has declared a transitional government. Rajoelina’s “inauguration” as president of the transitional authority was followed by days of protests by thousands of supporters of Ravalomanana. Several subsequent demonstrations have led to violent clashes with security forces. Negotiations in August between the parties led to the signing of an agreement in Mozambique to establish an inclusive, transitional government, but Rajoelina subsequently appointed a new government seen to be primarily composed of his own supporters. Southern African leaders and Madagascar’s opposition parties rejected the proposed government, and negotiations in Mozambique resumed. On October 6, the parties announced that they had reached agreement on posts in the new government, which will be led by Andry Rajoelina until new elections are held. Ravalomanana reportedly agreed to the arrangement on the condition that Rajoelina would not vie for the presidency in those elections. The agreement must now be implemented, and some observers question whether members of Rajoelina’s former administration will adhere to the new arrangement. -

Martinica Para Além Dos Clichés Os Mercados Bolseiros ACP Contra
PORT_Courier_cover_n7.qxp:Layout 1 3-10-2008 16:12 Pagina 2 CO rreioN. 7 N.E. – AGOSTO SETEMBRO 2008 A revista das relações e cooperação entre África-Caraíbas-Pacífico e a União Europeia REPORTAGEMREPORTAGEM MADAGASCARMADAGASCAR UmUm roteiroroteiro parapara oo crescimentocrescimento DOSSIERDOSSIER OsOs mercadosmercados bolseirosbolseiros ACPACP ContraContra ventosventos ee marésmarés DESCOBERTADESCOBERTA DADA EUROPAEUROPA MartinicaMartinica ParaPara alémalém dosdos clichésclichés Venda proibida ISSN 1784-6862 PORT_Courier_cover_n7.qxp:Layout 1 3-10-2008 16:12 Pagina 4 O Países de África – Caraíbas – Pacífico C rreio e União Europeia A revista das relações e cooperação entre África-Caraíbas-Pacífico e a União Europeia Comité Editorial Co-presidentes John Kaputin, Secretário-Geral Secretariado do Grupo dos países de Africa, Caraíbas e Pacífico www.acp.int Stefano Manservisi, Director Geral da DG Desenvolvimento Comissão Europeia ec.europa.eu/development/ Equipa editorial Director e Editor-chefe Hegel Goutier Jornalistas Marie-Martine Buckens (Editor-chefe adjunto) Debra Percival Editor assistente e produção Joshua Massarenti CARAÍBAS PACÍFICO Antígua e Barbuda Baamas Barbados Belize Cuba Domínica Granada Guiana Haiti Cook (Ilhas) Fiji Marshall (Ilhas) Micronésia (Estados Federados da) Nauru Niue Palau Colaboraram nesta edição Jamaica República Dominicana São Cristóvão e Nevis Santa Lúcia São Vicente e Papuásia-Nova Guiné Quiribáti Salomão (Ilhas) Samoa Timor Leste Tonga Tuvalu Bernard Babb, Elisabetta Degli Esposti Merli, Sandra Federici, -

Madagascar, D'une Crise À L'autre : Ruptures Et Continuités
Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger (dir.) Madagascar, d'une crise l'autre: ruptures et continuité KARTHALA - IRD MADAGASCAR, D'UNE CRISE L'AUTRE: RUPTURES ET CONTINUITÉ KARTHALA sur internet: www.karthala.com (paiement sécurisé) Couverture: Alakamisy Ambohimaha, 2007, © Pierrot Men. Éditions Kartha/a, 2018 ISBN Karthala: 978-2-8111-1988-1 ISBN IRD: 978-2-7099-2640-9 DIRECfEURS SCIENTIFIQUES Mireille Razafindrakoto, François Roubaud etJean-~icheIVVachsberger Madagascar, d'une crise l'autre: ruptures et continuité Édition Karthala IRD 22-24, boulevard Arago 44, bd de Dunkerque 75013 Paris 13572 Marseille À tous ceux qui ont contribué à la formation et au partage des connaissances pour le développement de Madagascar. À Philippe Hugon. INTRODUCfION GÉNÉRALE La trajectoire de Madagascar au prisme de ses crises Mireille RAzAFiNDRAKOTO, François RouBAuD et Jean-Michel WACHSBERGER Deux représentations de Madagascar sont aujourd'hui concurrentes. La première, héritée d'une longue histoire, est celle d'un quasi-eldorado. Dès le xvu" siècle, la description apologétique, par Étienne de Hacourt (1661), des richesses du pays, des savoir-faire des populations et de leur malléabilité avait abondamment nourri l'imaginaire colonial. Plus tard, dans les années 1930, c'est la propagande du gouverneur Cayla qui avait contribué à propager l'idée d'une «Île heureuse» (Fremigacci, 2014). Aujourd'hui, de nombreux récits de voyage et livres de photos présentent le pays comme un Éden à préserver: beauté époustouflante des paysages, gentillesse et douceur des habitants, diversité de la faune et de la flore. La banque de photographie Shutterstock sur Madagascar, où la Banque mondiale a puisé en 2016 les illustrations d'une publication sur la pauvreté (Banque mondiale, 2016), traduit à merveille ce capital imaginaire. -
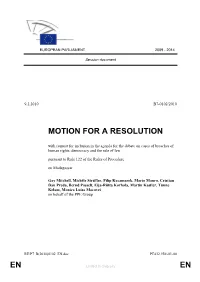
En En Motion for a Resolution
EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014 Session document 9.2.2010 B7-0102/2010 MOTION FOR A RESOLUTION with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law pursuant to Rule 122 of the Rules of Procedure on Madagascar Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei on behalf of the PPE Group RE\P7_B(2010)0102_EN.doc PE432.956v01-00 EN United in diversityEN B7-0102/2010 European Parliament resolution on Madagascar The European Parliament, – having regard to its previous resolutions on the Malagasy situation, in particular, the resolution adopted on 7 May 2009, – having regard to the ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000 and currently under second review, – having regard to the work by the International Contact Group on Madagascar, and in particular the Maputo and Addis Ababa agreements concluded on 9 August 2009 and 6 November 2009 respectively, – having regard to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly resolution adopted in Luanda (Angola) on 3 December 2009, – having regard to the Communique of the SADC Summit held in Maputo- Mozambique on 14 January 2010, – having regard to the 14th African Union Summit held in Addis Ababa- Ethiopia, 31 January to 2 February 2010, – having regard to Rule 122(5) of its Rules of Procedure, A. whereas Mr Andry Rajoelina, the mayor of the capital Antananarivo, became the head of the High Transitional Authority on 17 March 2009, when the military handed over the executive power that it had seized from former President Marc Ravalomanana, who was forced to resign and go into exile, B. -

Essai D'analyse De La Crise De 2009-2011 À Mada
Université d’Antananarivo Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie Département de Sociologie LABORATOIRE III Recherche Interdisciplinaire en Politique, Gouvernance et Développement Mémoire de Maitrise ESSAI D’ANALYSE DE LA CRISE DE 2009- 2011 A MADAGASCAR Présenté par : RALAINONY Stéphane Richard Membres du jury Président : Mr ETIENNE Stefano Raherimalala, Maître de conférences Juge : Mr ANDRIAMAMPANDRY Todisoa, Maître de conférences Directeur de mémoire : Mr RASOLO André, Maître de conférences Date de soutenance : 11 Juillet 2012 Année Universitaire : 2010- 2011 1 “““ Ny olona mahay mihaino sady tsy miteny firy dia manmananganaangana hery lehibe sy afaka mamoaka hevihevi----dalinadalina »»» The person who listen carefully and who speak rarely that person build a great force and can expose an analysis ininin-in ---depthdepth Une personne qui sait écouter et qui parle rarement est une personne qui érige une grande force et capable d’exposer une analyse approfondie ... 2 Essai d’analyse de la crise de 2009-2011 à Madagascar 3 Remerciement Nous remercions les personnalités suivantes pour leurs partages d’expériences et de savoirs. Mr. Serge ZAFIMAHOVA Mr. Fetison RAKOTO ANDRIANIRINA Mr. Joseph RANDRIAMIARISOA Mr. Willy RAZAFINJATOVO Aux autres informateurs qui ont voulu gardé l’anonymat. Je tiens également à adresser ma profonde gratitude envers les membres du jury à savoir : Dr. Stefano Raherimalala ETIENNE, le président du jury Dr. Todisoa ANDRIAMAMPANDRY, le juge Dr. André RASOLO, notre directeur de mémoire Mes -

Madagascar's 2009 Political Crisis
Madagascar’s 2009 Political Crisis Lauren Ploch Analyst in African Affairs May 18, 2009 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R40448 CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress Madagascar’s 2009 Political Crisis Summary Political tensions on the Indian Ocean island of Madagascar between President Marc Ravalomanana and Andry Rajoelina, the former mayor of the capital city, escalated in early 2009, culminating in the President’s forced removal from office. In preceding weeks, over 135 people had been killed in riots and demonstrations. Under intensifying pressure from mutinous soldiers and large crowds of protestors, Ravalomanana handed power to the military on March 17, 2009. The military then transferred authority to Rajoelina, who has declared a transitional government. Days prior to President Ravalomanana’s resignation, the U.S. Ambassador to Madagascar had expressed concern that the country could face civil war; some believe that may still be a possibility. Rajoelina’s “inauguration” as president of the transitional authority was followed by days of protests by thousands of supporters of Ravalomanana. Several more recent demonstrations have led to violent clashes with security forces. The political uncertainty has strained relations between international donors and Madagascar, which was the first country to sign a U.S. Millennium Challenge Account compact, worth an estimated $110 million. Following coups in Mauritania and Guinea in 2008, the African Union, the United States, and the European Union, among others, warned against an unconstitutional transfer of power on the island nation and have threatened sanctions and a suspension of foreign aid. The African Union and the Southern African Development Community have suspended Madagascar until constitutional order is restored.