Etude D'impact Et De Capitalisation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mli0006 Ref Region De Kayes A3 15092013
MALI - Région de Kayes: Carte de référence (Septembre 2013) Limite d'Etat Limite de Région MAURITANIE Gogui Sahel Limite de Cercle Diarrah Kremis Nioro Diaye Tougoune Yerere Kirane Coura Ranga Baniere Gory Kaniaga Limite de Commune Troungoumbe Koro GUIDIME Gavinane ! Karakoro Koussane NIORO Toya Guadiaba Diafounou Guedebine Diabigue .! Chef-lieu de Région Kadiel Diongaga ! Guetema Fanga Youri Marekhaffo YELIMANE Korera Kore ! Chef-lieu de Cercle Djelebou Konsiga Bema Diafounou Fassoudebe Soumpou Gory Simby CERCLES Sero Groumera Diamanou Sandare BAFOULABE Guidimakan Tafasirga Bangassi Marintoumania Tringa Dioumara Gory Koussata DIEMA Sony Gopela Lakamane Fegui Diangounte Goumera KAYES Somankidi Marena Camara DIEMA Kouniakary Diombougou ! Khouloum KENIEBA Kemene Dianguirde KOULIKORO Faleme KAYES Diakon Gomitradougou Tambo Same .!! Sansankide Colombine Dieoura Madiga Diomgoma Lambidou KITA Hawa Segala Sacko Dembaya Fatao NIORO Logo Sidibela Tomora Sefeto YELIMANE Diallan Nord Guemoukouraba Djougoun Cette carte a été réalisée selon le découpage Diamou Sadiola Kontela administratif du Mali à partir des données de la Dindenko Sefeto Direction Nationale des Collectivités Territoriales Ouest (DNCT) BAFOULABE Kourounnikoto CERCLE COMMUNE NOM CERCLE COMMUNE NOM ! BAFOULABE KITA BAFOULABE Bafoulabé BADIA Dafela Nom de la carte: Madina BAMAFELE Diokeli BENDOUGOUBA Bendougouba DIAKON Diakon BENKADI FOUNIA Founia Moriba MLI0006 REF REGION DE KAYES A3 15092013 DIALLAN Dialan BOUDOFO Boudofo Namala DIOKELI Diokeli BOUGARIBAYA Bougarybaya Date de création: -

Smallholder Agriculture's Contribution to Better Nutrition
Smallholder agriculture’s contribution to better nutrition Steve Wiggins & Sharada Keats Overseas Development Institute [email protected] 20 March 2013 Report commissioned by the Hunger Alliance Acknowledgements We’d like to thank members of the Hunger Alliance who gave us such useful feedback on a presentation of the main ideas in the report on 25 November 2012, and commented on an earlier draft report. Also thanks to Helen Hynes from ODI’s Agricultural Development and Policy team for valuable assistance. This research was commissioned and funded by the Hunger Alliance, a joint DFID-NGO consortium which addresses food insecurity and undernutrition and promotes predictable long term responses to food insecurity. Members include: ActionAid, Action Against Hunger UK, British Red Cross, CARE International UK, Christian Aid, Concern Worldwide, Oxfam, Save the Children, Tearfund, World Vision UK; Department for International Development. HA publications and events are not funded by and do not represent the opinion of DFID. Overseas Development Institute Disclaimer: The views presented in this paper 203 Blackfriars Road, London, SE1 8NJ are those of the authors and do not necessarily represent the views of ODI or organisations Tel: +44 (0)20 7922 0300 that have sponsored and supported the work; Fax: +44 (0)20 7922 0399 they, including any errors and omissions, are www.odi.org.uk the responsibility of the authors alone. Smallholder agriculture’s contribution to better nutrition Contents Contents i Tables, figures & boxes ii Abbreviations -

Évaluation Finale Du Projet «Intensifier La Résilience Aux Changements
Série évaluation de projet Évaluation finale du projet «Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion agricole et pastorale intégrée dans la zone sahélienne dans le cadre de l’approche de gestion durable des terres au Mali» Symbole du projet: GCP/MLI/038/LDF FEM ID: 4822 Annexe 4. Liste des CEAP mis en œuvre et leur situation d’accessibilité pour la visite terrain ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE Rome, 2020 Liste des CEAP du cercle de Kita Distance par rapport chef- N° Région Cercle Commune Village CEAP Observations lieu de cercle (Km) 1 Kayes Kita Kobiri Kobiri 80 Accessible 2 Kayes Kita Benkadi-founia Faraba 10 Accessible 3 Kayes Kita Bendougouba Béréla 14 Accessible 4 Kayes Kita Bendougouba Kouroula 23 Accessible 5 Kayes Kita Kassaro Balandougou-morola 80 Accessible 6 Kayes Kita Benkadi-founia Kodogoni 28 Accessible 7 Kayes Kita Bendougouba Karaya-toumoumba I 18 Accessible 8 Kayes Kita Bendougouba Karaya-toumoumba II 18 Accessible 9 Kayes Kita Bendougouba Dialaya 8 Accessible 10 Kayes Kita Sirakoro Mourgoula 62 Accessible 11 Kayes Kita Souransa-tomoto Kodala 40 Accessible 12 Kayes Kita Souransa-tomoto Kassan 20 Accessible 13 Kayes Kita Kassaro Kodialan 75 Accessible 14 Kayes Kita Djidian Kofè 23 Inaccessible 15 Kayes Kita Kita-nord Sibilikily 30 Inaccessible 16 Kayes Kita Badia Makana-bamanan 30 Inaccessible 17 Kayes Kita Badia Daféla 24 Inaccessible 18 Kayes Kita Benkadi-founia Founia-moribougou 12 Accessible 19 Kayes Kita Sirakoro Faraba II 62 Inaccessible 20 Kayes -

G a F a S E Republique Du Mali
G A F A S E REPUBLIQUE DU MALI Groupe pour les Actions de Formation Un Peuple- Un But -Une Foi d’Animation et de Suivi-Evaluation Tél. 21 57 41 12 Kita, Farabala Face Hôtel OASIS la Créole Mail : gafakit 07 @ yahoo.fr INTITULE DU PROJET Appui au Développement Intégré de Quatorze (14 groupements Féminins) dans le cercle de Kita FINANCEMENT Fonds Ingrid Renard <<FIR>> (Belgique) RAPPORT DES ACTIVITES DES PLANS D’ACTION 2011- 2012 et 2012-2013 Août 2013 SOMMAIRE I Introduction II Objectifs visés par le Programme III Présentation de la zone du projet IV Rappel des activités programmées pour le programme V Situation de l’exécution du programme VI Difficultés rencontrées VII Remarques et suggestions VIII Conclusion Annexes 1 Rapport d’étude géophysique 2 Rapport de formation en techniques de maraîchage no 1 et 2 3 Rapport de formation en G I P D no 1 et2 4 Rapport de formation en alphabétisation 5 Rapport de formation sur la vie associative. 6 Rapport de formation sur la saponification. 7 Rapport de formation sur le VIH/SIDA no 1 et 2. 8 Rapport de suivi des actions de lutte contre le VIH à l’école. 9 Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’AGFSS I Introduction Le GAFASE (Groupe pour les Actions de Formation d’Animation et de Suivi-Evaluation) est une ONG nationale malienne reconnu par l’état sous le numéro d’accord cadre 1169 / MAT CL du 09 juillet 2010. Le GAFASE exécute un programme de deux ans (2011-2012 ; 2012-2013) dans le cercle de Kita. -

LA Moyenne VALLEE Du Fleuve SENEGAL
LA MOYENNE VallEE DATLASU Fleuve SENEGAL CENTRES ET PERIPHERIES MALI - MAURITANIE - SENEGAL Graphisme By Reg’ - www.designbyreg.dphoto.com Crédits photos ©JB Russell (http://www.jbrussellimages.com) sauf mention contraire Auteur Grdr (www.grdr.org), décembre 2014. Imprimé à Dakar (Sénégal) en mai 2015 sur papier certifié FSC et PEFC LA MOYENNE VallEE DU Fleuve SENEGAL ATLASCENTRES ET PERIPHERIES MALI - MAURITANIE - SENEGAL 2 LALA MOYENNE VAVALLELLEEE DU FLEUVE SENEGASENEGALL CENTRES ET PERIPHERIEPERIPHERIES Remerciements Cet ouvrage a été élaboré dans le cadre du Programme d’Appui aux Initiatives de Développement Local et de Coopérations Territoriales, une action mise en œuvre par le Grdr et soutenue par l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement, le CCFD-Terre solidaire, la région Ile-de-France, la région Centre, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), la Fondation de France, la Fondation Lord Michelham et le Comité Français pour la Solidarité Internationale. Il s’inscrit dans la continuité des travaux entrepris depuis les années 2000 et des deux forums sous-régionaux tenus à Saint-Louis en 2006 et 2014 en partenariat avec l’Université Gaston Berger (Sénégal). Il vient compléter les références méthodologiques publiées sur le site web « Développement local au Sahel » ainsi que l’Atlas du sud-est Mauritanien (Grdr, 2012). Le Grdr remercie ceux qui ont bien voulu cofinancer ce travail ainsi que les structures partenaires : collectivités locales (conseils régionaux de Kayes, Matam et Tambacounda, associations -
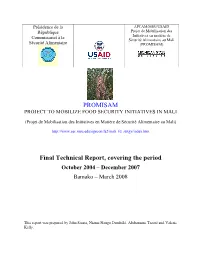
PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period
Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ............................................................................................... -

ACF International's Response to the West African Sahel Food Crisis
EXTERNAL EVALUATION JANUARY 2013 ACF International’s Response to the West African Sahel Food Crisis 2012 Funded by ACF By John Wiater and Jean le Bloas This report was commissioned by Action Against Hunger | ACF International. The comments contained herein reflect the opinions of the Evaluators only. Table of Contents Acronyms ........................................................................................................................................3 Acknowledgements ........................................................................................................................4 Executive Summary .......................................................................................................................5 Background ....................................................................................................................................8 Evaluation Methodology ...............................................................................................................9 Findings ...........................................................................................................................................9 Overall Emergency Response ......................................................................................................9 Timeliness ............................................................................................................................9 Appropriateness of the Strategy .........................................................................................10 -

Recueil Des Arrêts, Avis Et Autres Décisions De La Cour Constitutionnelle Du Mali
Recueil des arrêts, avis et autres décisions de la Cour Constitutionnelle du Mali Vol. 3 (2002 – 2005) Ce recueil de six volumes contient les arrêts, avis et autres décisions de la Cour constitutionnelle de la République du Mali de 1995 jusqu’à 2017 inclus. Financé par le Ministère des AFFaires étranGères de la République Fédérale d’AllemaGne Le présent recueil comprend l’ensemble des arrêts, avis et décisions de la Cour Constitutionnelle du Mali de 1995 à 2017. Cette compilation exhaustive de la jurisprudence constitutionnelle malienne est la première de ce type. Elle a été assemblée et mise en Forme par la Fondation Max Planck pour la Paix Internationale et l’État de Droit (www.mpfpr.de) grâce au Financement du Ministère des afFaires étranGères allemand. Les statistiques qui se trouvent dans ce recueil ne sont pas des statistiques ofFicielles mais ont été élaborées par et sous la seule responsabilité de la Fondation Max Planck. Table des matières Statistiques 2002 – 2005 . 1 VOLUME 3 : 2002 – 2005 Année 2002 . 3 Liste des décisions (arrêts, avis et autres décisions) . 3 Arrêts . 6 Avis . 382 Autres decisions . 387 Statistiques . 397 Année 2003 . 399 Liste des décisions (arrêts, avis et autres décisions) . 399 Arrêts . 400 Statistiques . 411 Année 2004 . 413 Liste des décisions (arrêts, avis et autres décisions) . 413 Arrêts . 414 Statistiques . 440 Année 2005 . 442 Liste des décisions (arrêts, avis et autres décisions) . 442 Arrêts . 443 Autres décisions . 471 Statistiques . 473 Index alphabétique . 475 Statistiques 2002 - 20051 1 Seulement les arrêts sont pris en considération pour l’élaboration de ces statistiques. I. Saisine du juge constitutionnel par type d’actes / contrôle Types d’actes / contrôle 2002 2003 2004 2005 Total Actes et normes Lois ordinaires 1 1 Lois orGaniques 2 2 4 1 9 Lois constitutionnelles RèGlement des institutions 4 2 1 7 Traités et conventions Nature léGislative Total 7 2 6 2 17 II. -

Prospection Des Mils Pénicillaires, Sorghos Et Graminées
LB.P.G.R. O.R.S.T.O.M. Prospeclion des Mils pênicillaires, Sorghos et Gralninées Inineures en J-t\frique de 1"Ouest Campagne 1978 1 REPUBLIQUE DU MALI O.R.S.T.O.M. PARIS 1980 REPUBLIQUE DU MALI PROSPECTION 1978 Prospecteurs J.C. CLEMENT J.M. LEBLANC Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 24 rue Bayard 75 008 PARIS 3 Nous adressons tous nos remerciements aux autorités Maliennes ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et au bon déroulement de la mission. MM. Fatogoma lraoré Directeur Général de I.E.R. Moussa Traoré Chef de la Division de la Recherche Agronomique. Madame Bâ Chef du S.R.C.V.O. MM. Moriba Konaté Ingénieur Agronome Fanfan Délégué Général du PNUD. FAO à Bamako. Nous remercions également MM. les commandants de cercle ainsi que les responsables des différents services agronomiques pour l'aide précieuse et efficace qu'ils nous ont apporté en toutes cir constances. 5 AVANT-PROPOS Cette mission se situe dans le cadre d'un vaste programme initié par la F.A.O. dont l'objectif poursuivi depuis sa mise en route en 1975 consiste en la collecte systématique des formes les plus va riées possibles des deux plus importantes céréales du Sahel que sont les "Mils Penicillaires" et les "Sorghos". En 1977, la collecte devait s'étendre aux graminées mineures utilisées comme céréales alimentaires. C'est la disparition progressive ou brutale d'un certain nombre de variétés traditionnelles cultivées en Afrique de l'Ouest, consécutive soit à l'extension du front de la sécheresse, soit à la vulgarisation de lignées sélectionnées, soit dans certains cas due à l'implantation de cultures industrielles plus rentables, qui a mis en évidence l'urgence de telles prospections. -

Nutrition in Local Mali Food Security Plans We Searched 685 Rural
Nutrition in local Mali Food Security Plans We searched 685 rural commune food security plans for communes which see nutrition training as an integral part of food security planning. 302 (44 %) of the 685 communes include some sort of nutrition training in their food security planning. 221 Communes (32%) also mentioned nutrition planning in the discussion of the communes current situation. A much smaller number (10 or 1%) mentioned existing nutrition training programs. However, the actual number of communes where some sort of nutrition training exists could be much larger as recording those assets was not part of the planning process. In particular, many CSCOM (centres de santé communautaires) offer nutrition training. Table 1 – Summary of nutrition training in the Mali Food Security Plans % of 685 Rural Category Count communes # communes where nutrition training needed 211 31% # communes with nutrition training 10 1% Total # of communes mentioning nutrition training 221 32% # of communes where nutrition is part of the Food Security 302 44% Plan Of special note are the similarities among food security plans from the same Cercle. This could indicate either a Cercle very concerned with central planning, or a Cercle with a special commitment to nutrition training. In total, 41 of the 49 rural Cercles (i.e, those not in Bamako) have at least one commune where nutrition is part of the local food security plan. 13 (27% of Cercles) have a nutrition plan in more than 75% of their respective Communes. Please see the tab “By Cercle” in the attached spread sheet for details. Table 2 – Cercles with a high percentage of Commune nutrition plans Region Cercle % of Communes w/ Plan Kayes Bafoulabé 100.0% Kayes Kita 97.0% Koulikoro Nara 100.0% Ségou Bla 94.1% Ségou Niono 75.0% Mopti Bankass 83.3% Mopti Djenné 100.0% Tombouctou Diré 92.3% Gao Ansongo 100.0% Gao Bourem 100.0% Gao Gao 100.0% Gao Ménaka 100.0% Kidal Abeibara 100.0% The attached spread sheet lists all the plans which mention nutrition training in either the description of the commune or the Food Security Plan itself. -

BT2 N83 Une Expérience Lycéenne Au Mali Document.Pdf
BT2 N83 Novembre 1985 Une expérience lycéenne au Coopération durable et développement décentralisé Des lycéens s’engagent : entre 2000 et 2003, ils partent vivre une aventure au Mali, avec les habitants de Gabou, un petit village. Ils découvrent un pays, et un milieu complètement différent du leur. Sur place, ils prennent conscience de la difficulté de certaines populations à vivre, des problèmes qu’engendre le développement de la planète. Avec les Maliens, ils se mobilisent et élaborent un projet d’entraide. Cette BT2 retrace les étapes de cette collaboration lycéenne au Mali, et montre comment il est possible de contribuer à l’édification d’un monde plus juste et plus agréable à vivre. Mots clés Coopération, développement, humanitaire, Mali, désertification, migration 1 Sommaire Introduction Fiches sur le Mali La géographie L'histoire Désertification ou changement climatique ? Le choc de l'arrivée au Mali: la chaleur et la soif sont constantes Second choc visuel : le bleu et l'ocre dominent Troisième choc rétrospectif : cette situation peut-elle s'aggraver ? Ultime choc complémentaire: le rôle du bois Culture, ethnies et langues : tradition et évolution Gabou, petit village du bout du monde À Gabou, une perceptible variété de peuples Un étonnant foisonnement de cultures dans le pays Les migrants maliens, une arithmétique complexe Les maladies rencontrées et le centre de santé Les maladies et leurs répercussions Le centre de santé communautaire La santé passe par l'éducation La croissance démographique La transition démographique La situation démographique malienne Les mentalités évoluent de plus en plus L'agriculture peut-elle évoluer ? Une volonté existe: l'exemple de Bada À Kouloun et Gabou, la situation est semblable La coopérative multifonctionnelle de Somankidi L'épisode des acridiens L'expérience du « hangar » Pensées en blanc et noir Qu'apporte l'immigration au pays ? L'organisation des migrants africains Le rôle des migrants au pays L'avenir n'est pas serein, mais. -
1 Compte Rendu De La Rencontre Des
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES INTERVENANTS EN NUTRITION L’an deux mille douze et le vingt un septembre s’est tenue dans la salle de réunion de la mission catholique de Kita la rencontre des intervenants en nutrition dans le cercle de Kita. Etaient présents : (cf. liste de présence en annexe) - Le médecin chef du district sanitaire de Kita, - Le chef de service du développement social et de l’économie solidaire - Le président de la coordination locale des ONG de Kita, - Les représentants des ONG : Save the children à travers le Maternal and Child Health Integrated Program (M-CHIP), Association pour le Développement Rural (ADR), Stop sahel, Association pour la Promotion et le Développement (APDEV), Association Malienne pour la Promotion des Entreprises Féminines (AMAPEF), Association pour la Coordination et le Développement Rurale (ACORD), Equipe de Recherche et d’Appui pour le Développement (ERAD) et Action Contre la Faim Espagne (ACF-E). La rencontre a été présidée par le médecin chef qui, dans son intervention d’ouverture, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné l’importance de cette rencontre qui fait partie intégrante de la bonne coordination des activités sur le terrain. Ensuite ont suivi la présentation des participants, l’adoption de l’agenda et la présentation des TDR, et enfin celle de chacune des structures représentées. ACF-E : Action Contre la Faim Espagne Organisation Non Gouvernementale humanitaire, œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la nutrition-santé et de l’eau, hygiène et assainissement. Présente dans le cercle de Kita depuis 2007 d’abord dans les communes de Gadougou I et II, de Kokofata et de Koulou, et depuis Août 2012 dans tout le district sanitaire à travers deux programmes : le Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, et le Projet de renforcement des capacités locales de prise en charge de la malnutrition aiguë et d’accès à l’alimentation.