LA Moyenne VALLEE Du Fleuve SENEGAL
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Bank Document
Public Disclosure Authorized Rapport initial du projet Public Disclosure Authorized Amélioration de la Résilience des Communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique en Mauritanie Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ID Projet 200609 Date de démarrage 15/08/2014 Public Disclosure Authorized Date de fin 14/08/2018 Budget total 7 803 605 USD (Fonds pour l’Adaptation) Modalité de mise en œuvre Entité Multilatérale (PAM) Public Disclosure Authorized Septembre 2014 Rapport initial du projet Table des matières Liste des figures ........................................................................................................................................... 2 Liste des tableaux ........................................................................................................................................ 2 Liste des acronymes ................................................................................................................................... 3 Résumé exécutif ........................................................................................................................................... 4 1. Introduction .......................................................................................................................................... 5 1.1. Historique du projet ......................................................................................................................... 6 1.2. Concept du montage du projet .................................................................................................. -

Mauritania Country Portfolio
Mauritania Country Portfolio Overview: Country program established in 2008. USADF currently U.S. African Development Foundation Partner Organization: IDSEPE manages a portfolio of 16 projects. Total commitment is $1.6 million. Country Program Coordinator: Mr. Sadio Diarra Abdoul Dakel Ly, Project Coordinator BMCI/AFARCO building, 6th floor Tel: +222 44 70 27 27 & +222 22 30 35 04 Country Strategy: The program focuses on working with Avenue Gamal Abder Nassar Email: [email protected] agricultural groups and women’s collectives. P.O Box 1980, Nouakchott, Mauritania Tel: +222 525 29 36 Email: [email protected] Grantee Duration Value Summary Lithi Had El Amme / Iguini El Oula 2014-2017 $94,243 Sector: Agriculture (Vegetables) 3023-MRT Town/City: Wilaya Hodhs -El- Gharbi Summary: The project funds will be used to ensure a reliable water supply to the garden by setting up a borehole extraction system. Funds will allow the Union to expand their cultivation plot to 2 hectares by installing a new irrigation system and building a fence around it to protect it from roaming animals.. Coopérative El Emen Berbâré 2014-2017 $85,527 Sector: Agriculture (Vegetables) 3163-MRT Town/City: Wilaya Hodhs -El- Gharbi Summary: The project funds will be used to install a new irrigation system and fence it to protect it from roaming animals. The Cooperative will set up a borehole extraction system to provide a reliable and constant source of water to the production perimeter. These activities will enable Cooperative members to dramatically increase the volume of vegetables sold and the profit earned by group members. -

Centre De Diboli
MEN LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU D.E.F. SESSION DE JUIN 2017 ------ PAR ORDRE ALPHABETIQUE ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KAYES. 01- CENTRE DE DIBOLI N° ANNEE STATUT PRENOMS NOM SEXE LIEU/NAIS ECOLE MENTION PLACE NAISS ELEVE 13 Ahamada Ag AMAR M 1999 Gossi CL Diboli ASSEZ-BIEN 56 Hawo BA F 2002 Nayé Peulh REG Diboli PASSABLE 219 Mahamadou B BAH M 2001 Diboli REG Diboli ASSEZ-BIEN 233 Mamadou A BAH M 2001 Diboli REG Diboli PASSABLE 288 Assétou BÄH F 2002 Diboli REG Diboli PASSABLE 292 Coumba B BAKHAYOGO F 1999 Bamako REG Diboli PASSABLE 307 Issa BALDE M 2001 Kayes REG Diboli ASSEZ-BIEN 343Sira BANE F 2001 Nayé Peulh REG Diboli PASSABLE 388 Mamadou M BARRO M 2003 Kidira REG Diboli ASSEZ-BIEN 426 Soulemane BARRY M 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 509 Mamadou BATHILY M 2001 Toubaboukané REG Diboli PASSABLE 999 Tidiane CAMARA M 1999 Dakassenou CL Dakassénou PASSABLE 1039Ami CISSE F 2003 Kayes REG Diboli ASSEZ-BIEN 1299 Assitan COULIBALY F 2001 Diboli REG Diboli PASSABLE 1423 Fatoumata COULIBALY F 2002 Dakassenou REG Dakassénou PASSABLE 1510 Kadiatou COULIBALY F 2001 Ségou REG Diboli PASSABLE 1542 Lassana COULIBALY M 2002 Dakassenou REG Dakassénou PASSABLE 1592 Mamadou COULIBALY M 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 1642 Moussa COULIBALY M 1999 Dakassenou REG Dakassénou PASSABLE 1663 Niéné M COULIBALY M 2002 Diboli REG Diboli PASSABLE 2460 Daouda DIABATE M 1999 Nayé Peulh REG Diboli PASSABLE 2561 Mamadou B DIABY M 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 3012 Aissé DIALLO F 2000 Diboli REG Diboli PASSABLE 3100 Cheick S DIALLO M 2002 Gakoura REG Diboli PASSABLE -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Mauritania 20°0'0"N Mali 20°0'0"N Akjoujt ! U479 ATLANTIC OCEAN U Uu435
! ! 20°0'0"W 15°0'0"W 10°0'0"W 5°0'0"W Laayoune / El Aaiun .! !(Smara ! ! Cabo Bu Craa Bojador!( Western Sahara 25°0'0"N ! 25°0'0"N Guelta Zemmur Distances shown in the table and the map are indicative. They have been calculated following the shortest route on main roads. Tracks have not been considered as a main road. Ad Dakhla (! Tiris Zemmour Algeria !( Zouerate ! Bir Gandus Nouadhibou Adrar !( Dakhlet Nouadhibou Uad Guenifa (! ! Atar Chinguetti Inchiri Mauritania 20°0'0"N Mali 20°0'0"N Akjoujt ! u479 ATLANTIC OCEAN u uu435 Tagant Tidjikja ! Nouakchott uu9 Hodh Ech Chargui (! Nbeika Nouakchott Trarza ! uu157 Boutilimit Magta` Lahjar uu202 ! ! uu346 uu101 Aleg ! Mal (! ! u165 Brakna u !Guerou Bourem uu6 Bogue Kiffa 'Ayoun el 'Atrous Nema Tombouctou! uu66 Rosso ! (! Assaba (! 210 (! (! uu 276 (!!( Tekane ! uu Goundam ! Richard-Toll !uu107 Lekseiba Timbedgha Gao Bababe ! Tintane ! !( ! Hodh El Gharbi ( uu116 !Mbout !( Kaedi uu188 Bassikounou Saint-Louis uu183 Bou Gadoum !( Gorgol (! Guidimaka !Hamoud !(Louga uu107 Bousteile! !( Kersani 'Adel Bagrou Tanal ! ! Niminiama (! Nioro Nara 15°0'0"N Thies Touba Gouraye Diadji ! 15°0'0"N Senegal ! Selibabi du Sahel Sandigui Burkina (! !( Douentza !( ! Sandare !( Mbake Khabou Guidimaka Salmossi Dakar .!Rufisque Faso 20°0'0"W Diourbel 15°0'0"W 10°0'0"W 5°0'0"W !( !( !( Mopti Bandiagara ! Sikire Gorom-Gorom Mbour Kayes Niono! !( Linking Roads Road Network Date Created: ! 05 - DEC -2012 ! (! Reference Town National Boundar!y Map Num: LogCluster-MRT-007-A2 ! Primary Road ! Coord.System/Datum: Geographic/WGS84 -

Mauritania 20°0'0"N Mali 20°0'0"N
!ho o Õ o !ho !h h !o ! o! o 20°0'0"W 15°0'0"W 10°0'0"W 5°0'0"W 0°0'0" Laayoune / El Aaiun HASSAN I LAAYOUNE !h.!(!o SMARAÕ !(Smara !o ! Cabo Bu Craa Algeria Bojador!( o Western Sahara BIR MOGHREIN 25°0'0"N ! 25°0'0"N Guelta Zemmur Ad Dakhla h (!o DAKHLA Tiris Zemmour DAJLA !(! ZOUERAT o o!( FDERIK AIRPORT Zouerate ! Bir Gandus o Nouadhibou NOUADHIBOU (!!o Adrar ! ( Dakhlet Nouadhibou Uad Guenifa !h NOUADHIBOU ! Atar (!o ! ATAR Chinguetti Inchiri Mauritania 20°0'0"N Mali 20°0'0"N AKJOUJT o ! ATLANTIC OCEAN Akjoujt Tagant TIDJIKJA ! o o o Tidjikja TICHITT Nouakchott Nouakchott Hodh Ech Chargui (!o NOUAKCHOTT Nbeika !h.! Trarza ! ! NOUAKCHOTT MOUDJERIA o Moudjeria o !Boutilimit BOUTILIMIT ! Magta` Lahjar o Mal ! TAMCHAKETT Aleg! ! Brakna AIOUN EL ATROUSS !Guerou Bourem PODOR AIRPORTo NEMA Tombouctou! o ABBAYE 'Ayoun el 'Atrous TOMBOUCTOU Kiffa o! (!o o Rosso ! !( !( ! !( o Assaba o KIFFA Nema !( Tekane Bogue Bababe o ! o Goundam! ! Timbedgha Gao Richard-Toll RICHARD TOLL KAEDI o ! Tintane ! DAHARA GOUNDAM !( SAINT LOUIS o!( Lekseiba Hodh El Gharbi TIMBEDRA (!o Mbout o !( Gorgol ! NIAFUNKE o Kaedi ! Kankossa Bassikounou KOROGOUSSOU Saint-Louis o Bou Gadoum !( ! o Guidimaka !( !Hamoud BASSIKOUNOU ! Bousteile! Louga OURO SOGUI AIRPORT o ! DODJI o Maghama Ould !( Kersani ! Yenje ! o 'Adel Bagrou Tanal o !o NIORO DU SAHEL SELIBABY YELIMANE ! NARA Niminiama! o! o ! Nioro 15°0'0"N Nara ! 15°0'0"N Selibabi Diadji ! DOUTENZA LEOPOLD SEDAR SENGHOR INTL Thies Touba Senegal Gouraye! du Sahel Sandigui (! Douentza Burkina (! !( o ! (!o !( Mbake Sandare! -
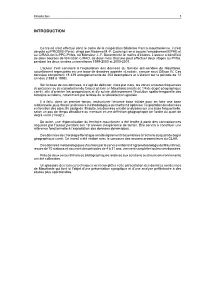
Introduction 1
Introduction 1 INTRODUCTION Ce travail s'est effectué dans le cadre de la coopération bilatérale franco-mauritanienne, il s'est déroulé au PRODIG (Paris), dirigé par Madame M.-F. Courel qui en a assure l’encadrement EPHE et au CIRAD-Amis-PPC-Prifas, où Monsieur J.-F. Duranton fut le maître d’études. L’auteur a bénéficié de deux bourses de formation CIRAD, de deux mois chacune pour effectuer deux stages au Prifas, pendant les deux années universitaires 1999-2000 et 2000-2001. L’auteur s'est consacré à l’exploitation des données du Service anti-acridien de Mauritanie, actuellement regroupées en une base de données appelée «Locdat», conçue sous DBase IV. Ces données comportent 18 429 enregistrements de 253 descripteurs et s’étalent sur la période de 12 années (1988 à 1999). Sur la base de ces données, il s’agit de délimiter, mois par mois, les zones à hautes fréquences de présence ou de reproduction du Criquet pèlerin en Mauritanie (maille de 1/4 de degré géographique carré), afin d’orienter les prospections et d'y suivre ultérieurement l'évolution spatio-temporelle des biotopes acridiens, notamment par le biais de la télédétection spatiale. Il a fallu, dans un premier temps, restructurer l’énorme base initiale pour en faire une base relationnelle, puis choisir un itinéraire méthodologique permettant d’optimiser l’exploitation des données en fonction des objectifs assignés. Ensuite, les données ont été analysées sur une base fréquentielle, selon un pas de temps décadaire ou mensuel et une définition géographique de l’ordre du quart de degré carré (1/4dg²). -

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

Production Et Consommation D'eau Potable Période D'audit Du 01/07/2010 Au 31/12/2010
Production et consommation d'eau potable Période d'audit du 01/07/2010 au 31/12/2010 Cercle de BAFOULABE Centre PopulationProduction m3 Consom. m3 Perte m3 Perte % Consom l/h/j BAFOULABE 3 70013 653 10 355 3 298 24% 15,5 DIAKABA 3 001400 352 48 12% 0,7 OUSSOUBIDIAGNA 4 5736 336 5 516 820 13% 6,7 SIBINDI 7 0865 528 4 948 580 10% 3,9 Total BAFOULABE 18 360 25 917 21 171 4 746 18% Moyenne par centre 4 590 6 479 5 293 1 187 18% 6,7 Cercle de DIEMA Centre PopulationProduction m3 Consom. m3 Perte m3 Perte % Consom l/h/j BEMA 5 4221 759 1 643 116 7% 1,7 DIANGOUNTE CAMARA 11 05110 365 9 083 1 282 12% 4,6 DIEMA 8 35034 072 32 642 1 430 4% 21,7 FASSOUDEBE 5 0501 958 1 921 37 2% 2,1 FATAO 6 3848 215 7 390 825 10% 6,4 KAINERA 2 6262 681 2 309 372 14% 4,9 LAKAMANE 1 5142 697 2 560 137 5% 9,4 LAMBIDOU 8 53915 156 9 728 5 428 36% 6,3 MADIGA SACKO 7 8418 780 8 850 -70 -1% 6,3 MOUNTAN-SONINKE 1 3022 640 2 153 487 18% 9,2 Total DIEMA 58 079 88 323 78 279 10 044 11% Moyenne par centre 5 808 8 832 7 828 1 004 11% 7,3 Cercle de KAYES Centre PopulationProduction m3 Consom. m3 Perte m3 Perte % Consom l/h/j AOUROU 3 2505 332 4 798 534 10% 8,2 BATAMA 8 46912 274 13 065 -791 -6% 8,6 DARSALAM OULOUMA 723348 303 45 13% 2,3 DIABADJI 2 4361 691 1 691 0 0% 3,9 DIALANE 4 94812 616 12 694 -78 -1% 14,3 DIAMOU 4 48010 829 8 576 2 253 21% 10,6 DIATAYA 3 38014 293 14 992 -699 -5% 24,6 FEGUI 3 38413 719 11 930 1 789 13% 19,6 GAGNY 4 0706 158 5 120 1 038 17% 7,0 GAKOURA RIVE DROITE 1 888990 863 127 13% 2,5 GORY GOPELA 4 0177 526 7 033 493 7% 9,7 GOUSSELA 4 7366 664 6 625 39 1% 7,8 KABATE 4 5305 312 7 283 -1 971 -37% 8,9 KONIAKARY 14 32042 827 33 782 9 045 21% 13,1 KOUSSANE 11 6167 755 7 284 471 6% 3,5 KROUKETO 2 60011 476 11 476 0 0% 24,5 MARENA DJOMBOUGOU 4 46427 127 22 955 4 172 15% 28,6 NAYELA 4 3997 378 6 180 1 198 16% 7,8 SEGALA 3 25017 789 17 432 357 2% 29,8 SELIFELY 5 65411 337 8 308 3 029 27% 8,2 DNH - KfW - AfD 2AEP Opérateur STEFI : [email protected] Tél. -

Mli0006 Ref Region De Kayes A3 15092013
MALI - Région de Kayes: Carte de référence (Septembre 2013) Limite d'Etat Limite de Région MAURITANIE Gogui Sahel Limite de Cercle Diarrah Kremis Nioro Diaye Tougoune Yerere Kirane Coura Ranga Baniere Gory Kaniaga Limite de Commune Troungoumbe Koro GUIDIME Gavinane ! Karakoro Koussane NIORO Toya Guadiaba Diafounou Guedebine Diabigue .! Chef-lieu de Région Kadiel Diongaga ! Guetema Fanga Youri Marekhaffo YELIMANE Korera Kore ! Chef-lieu de Cercle Djelebou Konsiga Bema Diafounou Fassoudebe Soumpou Gory Simby CERCLES Sero Groumera Diamanou Sandare BAFOULABE Guidimakan Tafasirga Bangassi Marintoumania Tringa Dioumara Gory Koussata DIEMA Sony Gopela Lakamane Fegui Diangounte Goumera KAYES Somankidi Marena Camara DIEMA Kouniakary Diombougou ! Khouloum KENIEBA Kemene Dianguirde KOULIKORO Faleme KAYES Diakon Gomitradougou Tambo Same .!! Sansankide Colombine Dieoura Madiga Diomgoma Lambidou KITA Hawa Segala Sacko Dembaya Fatao NIORO Logo Sidibela Tomora Sefeto YELIMANE Diallan Nord Guemoukouraba Djougoun Cette carte a été réalisée selon le découpage Diamou Sadiola Kontela administratif du Mali à partir des données de la Dindenko Sefeto Direction Nationale des Collectivités Territoriales Ouest (DNCT) BAFOULABE Kourounnikoto CERCLE COMMUNE NOM CERCLE COMMUNE NOM ! BAFOULABE KITA BAFOULABE Bafoulabé BADIA Dafela Nom de la carte: Madina BAMAFELE Diokeli BENDOUGOUBA Bendougouba DIAKON Diakon BENKADI FOUNIA Founia Moriba MLI0006 REF REGION DE KAYES A3 15092013 DIALLAN Dialan BOUDOFO Boudofo Namala DIOKELI Diokeli BOUGARIBAYA Bougarybaya Date de création: -

Latitudes Longitudes Villages Communes Cercles Regions
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’ASSAINISSEMENT ET UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI DEVELOPEMENT DURABLE DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 MARS 2015 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 13,7590000000 -11,1200000000 GALOUGO NIAMBIA BAFOULABE KAYES 13,3720000000 -11,1300000000 BOULOUMBA GOUNFAN BAFOULABE KAYES 13,3630000000 -11,1380000000 KENIEDING GOUNFAN BAFOULABE KAYES 13,2690000000 -10,7690000000 LAHANDY DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,2680000000 -10,7550000000 BANGAYA DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,1800000000 -10,6990000000 KABADA KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,8550000000 -10,2300000000 DIBA BAMAFELE BAFOULABE KAYES 13,5880000000 -10,4320000000 TAMBAFETO OUALIA BAFOULABE KAYES 13,6200000000 -11,0330000000 DJIMEKOURO MAHINA BAFOULABE KAYES 13,6180000000 -11,0430000000 NEGUETABAL MAHINA BAFOULABE KAYES 14,4590000000 -10,1500000000 TRANTINOU DIAKON BAFOULABE KAYES 13,2600000000 -10,4720000000 SOBELA BAMAFELE BAFOULABE KAYES 13,0910000000 -10,7880000000 NANIFARA KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,8830000000 -6,5380000000 M^BEDOUGOU SANANDO BARAOUELI SEGOU 12,1340000000 -7,2900000000 TYEMALA MERIDIELA BOUGOUNI SIKASSO 11,8240000000 -7,3790000000 BOROMBILA DOGO BOUGOUNI SIKASSO 11,7890000000 -7,5170000000 FARABA DOGO BOUGOUNI SIKASSO 11,5640000000 -7,3600000000 SABOUDIEBO ZANTIEBOUGOU BOUGOUNI SIKASSO 11,3640000000 -6,8730000000 KOUMANTOU KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,4000000000 -7,6240000000 FOULOLA -

Commission Nationale Des Concours Concours D'entrée Aux ENI(S) 2012-2013 Liste Des Admissibles Par Ordre Alphabétique Ecole Annexe
Commission Nationale des Concours Concours d'Entrée aux ENI(s) 2012-2013 Liste des Admissibles par ordre Alphabétique Ecole Annexe Option : Instituteurs Francisants N° Ins Nom Complet Année Naiss Lieu Naiss 0027 Ababacar Abdel Aziz Diop 1984 Sebkha 0005 Abdarrahmane Boubou Niang 1981 Boghe 0142 Abdoul Oumar Ba 1985 Niabina 0063 Abdoulaye Sidi Diop 1986 Teyarett 0060 Aboubacar Moussa Mbaye 1976 Tevragh Zeina 0015 Adam Dioum Diallo 1985 Rosso 0125 adama abdoulaye Sow 1982 Rosso 0025 Adama Cheikhou Traore 1981 Selibaby 0197 Ahmed Abdel kader Ba 1981 Tevragh Zeina 0096 Ahmed Tidjane Yero Sarr 1985 Kiffa 0061 Al Diouma Cheikhna Ndaw 1986 Selibaby 0095 Aly Baila Sall 1984 Nouadhibou 0139 Amadou Ibrahima Sow 1985 Rosso 0159 Amadou Oumar Ba 1984 Sebkha 0045 Aminetou Amadou Dieh 1880 Djeol 0128 Aminetou Mamadou Diallo 1987 Zoueratt 0003 Aminetou Mamadou Seck 1987 Sebkha 0135 Aminetou Med EL Moustapha Limam 1988 Diawnaba 0085 Binta Ghassoum Ba 1987 Bababe 0164 Biry Med Camara 1985 Dafor 0155 Bocar lam Toro Camara 1982 Bababe 0069 Boubacar Billa Yero Sy 1986 Zoueratt 0089 Boudé Gaye Yatera 1981 Boully 0117 Cheikh Oumar Mamadou Anne 1985 Niabina 0175 Cheikh Tidjane Khalidou Ba 1977 Sebkha 0156 Daouda Ousmane Diop 1986 El Mina 0140 Dieynaba Abou Dia 1988 Boghe 0182 Dieynaba Ibrahima Dia 1986 Bababe 0137 Dieynaba Mamadou Ly 1986 Tevragh Zeina 0007 Fatimata Abdoullahi Ba 1985 Bababe 0032 Fatimata Alyou thiam 1987 Nouadhibou 0018 Fatimata Mamadou Sall 1988 Zoueratt 0047 Habsatou Amadou Sy 1985 Aere Mbar 0166 Hacen Ibrahima Lam 1984 Boghe 0078 Hacen Mbaye