A-Cr-Ccp-803/Pf-002 17-370-1/2 Chapitre 17 Oren 370
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
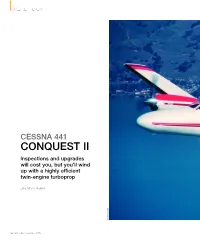
CONQUEST II Inspections and Upgrades Will Cost You, but You’Ll Wind up with a Highly Efficient Twin-Engine Turboprop
USED JET REVIEW CESSNA 441 CONQUEST II inspections and upgrades will cost you, but you’ll wind up with a highly efficient twin-engine turboprop _by Mark Huber T F A R C R I A A N S S E C 44 I BJT october_november 2008 USED JET REVIEW economics HOURLY DIRECT OPERATING COSTS – Fuel ($5.92 per gal): $526.88 – Maintenance labor (at $81 per hour): $192.88 – Parts, airframe, engine, avionics: $146.52 – Inspections, component overhauls, engine restoration: $138.44 – Misc. expenses Landing and parking fees: $8.13 Crew expenses: $30 Supplies & catering: $24 TOTAL VARIABLE FLIGHT COSTS PER HOUR: $1,111.31 Average speed: 270 knots THE CESSNA 441’S CABIN N O – Cost per nautical mile: $4.12 I T A HAS EXECUTIVE SEATING FOR I V A ANNUAL FIXED OPERATING COSTS SEVEN, THOUGH YOU CAN R A T S CRAM IN 11 PASSENGERS. – Crew salaries (estimates) T S E Captain: $79,300 W Copilot: $41,200 Benefits: $36,150 AIRPLANES COME APART IN MIDAIR for a variety of 404 and the 421–into turboprops. The 441 is the larg- – Hangar rental (typical): $20,900 reasons. An errant pilot loses control or flies a model er of the two; the other is the Model 425 Conquest I. – Insurance (insured hull value = $1.735 million) past its design limit, or unrepaired cracks and corro- The 441 has executive seating for seven, although you Hull (1.02% of value): $17,697 sion cause structure to fail. Fortunately, rigorous pilot can cram in nine passengers; it also has a top speed Admitted liability: $4,000 training and aircraft maintenance standards make of 295 knots–higher with a popular engine modifica- Legal liability: $12,250 such events few and far between. -

2011 Washoe County Emissions Inventory Page I
WASHOE COUNTY, NEVADA 2011 PERIODIC EMISSIONS INVENTORY November 2012 Prepared by: Ms. Yann Ling-Barnes, P.E. Mr. Craig A. Petersen Mr. Brendan Schnieder Washoe County Health District Air Quality Management Division P.O. Box 11130 Reno, Nevada 89520 This page intentionally left blank ACKNOWLEDGEMENTS The Air Quality Management Division of the Washoe County Health District wishes to extend its appreciation to the following organizations and local agencies for their assistance in completing this emission inventory: Amtrak City of Reno Fire Department City of Reno, Reno/Stead Water Reclamation Facility City of Sparks Fire Department City of Reno Public Works Department City of Sparks Public Works Department Incline Village General Improvement District North Lake Tahoe Fire Protection District NV Energy Regional Transportation Commission of Washoe County Reno-Tahoe Airport Authority Sierra Fire Protection District Southwest Gas Cooperation State of Nevada, Department of Agriculture, Bureau of Petroleum Technology State of Nevada, Department of Conservation and Natural Resources, Division of Environmental Protection State of Nevada, Department of Conservation and Natural Resources, Division of Forestry State of Nevada, Department of Motor Vehicles and Public Safety State of Nevada, Department of Conservation and Natural Resources, Division of State Lands State of Nevada, Department of Transportation The Nature Conservancy Truckee Meadows Water Reclamation Facility Union Pacific Railroad United States Department of the Interior, Bureau of Land Management, Winnemucca District United States Fish & Wildlife Service, Sheldon National Wildlife Refuge United States Forest Service, Humboldt-Toiyabe National Forest Washoe County, Department of Community Development Washoe County, Department of Public Works Washoe County, Department of Water Resources TABLE OF CONTENTS SECTION PAGE NO. -

Hartzell Top Prop Performance Conversions
T O P P R Beech 33, 35 Bonanza and Debonair O With IO-470-C, -J, -K, -N engine P P E R F O R M A N C E Basic Kit: Part Number: L2F00015STP 1 2-Bladed Propeller: BHC-L2YF-1BF/F8468AR 1 Polished Spinner: A-2295-P C 1 STC Document Set: SA818CE O Kit with Continental Oil Plug: (May be required for some IO-470-C, -N w/Beech N Props) Part Number: L2F00015STP*1 V 1 2-Bladed Propeller: BHC-L2YF-1BF/F8468AR 1 Polished Spinner: A-2295-P E 1 Continental Oil Plug: 633189 1 STC Document Set: SA818CE R S I O __________________________________________________________________________________________________ Aircraft Serial and registration numbers required when ordering N All Prices FOB Hartzell Propeller Inc. Prices do not include Ohio State Sales Tax Installation and Dynamic Balancing available at an additional charge S Telephone: (937) 778-5726 Option 2 / (800) 942-7767 Option 2 Fax: (937) 778-4215 Internet: www.hartzellprop.com Email: [email protected] T O P P R O BEECH BONANZA/DEBONAIR w. IO-470 ENGINE P Applicable Models: 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, E33, F33, G33, J35, K35, M35, N35, P35 * Note: A governor change may be required in some cases. P * Note: On earlier model aircraft with the IO-470-C engine an oil transfer tube or an oil plug may be required. The oil transfer E tube is NO LONGER AVAILABLE. R Specifications: 84 inch diameter 2-bladed, aluminum hub propeller 2400 hour / 6 year TBO F 58 pounds (prop & spinner) diameter reduction allowable to 82.5 inches O Replaces: Beech 273 / 278 - 82 inch dia. -

Aircraft Library
Interagency Aviation Training Aircraft Library Disclaimer: The information provided in the Aircraft Library is intended to provide basic information for mission planning purposes and should NOT be used for flight planning. Due to variances in Make and Model, along with aircraft configuration and performance variability, it is necessary acquire the specific technical information for an aircraft from the operator when planning a flight. Revised: June 2021 Interagency Aviation Training—Aircraft Library This document includes information on Fixed-Wing aircraft (small, large, air tankers) and Rotor-Wing aircraft/Helicopters (Type 1, 2, 3) to assist in aviation mission planning. Click on any Make/Model listed in the different categories to view information about that aircraft. Fixed-Wing Aircraft - SMALL Make /Model High Low Single Multi Fleet Vendor Passenger Wing Wing engine engine seats Aero Commander XX XX XX 5 500 / 680 FL Aero Commander XX XX XX 7 680V / 690 American Champion X XX XX 1 8GCBC Scout American Rockwell XX XX 0 OV-10 Bronco Aviat A1 Husky XX XX X XX 1 Beechcraft A36/A36TC XX XX XX 6 B36TC Bonanza Beechcraft C99 XX XX XX 19 Beechcraft XX XX XX 7 90/100 King Air Beechcraft 200 XX XX XX XX 7 Super King Air Britten-Norman X X X 9 BN-2 Islander Cessna 172 XX XX XX 3 Skyhawk Cessna 180 XX XX XX 3 Skywagon Cessna 182 XX XX XX XX 3 Skylane Cessna 185 XX XX XX XX 4 Skywagon Cessna 205/206 XX XX XX XX 5 Stationair Cessna 207 Skywagon/ XX XX XX 6 Stationair Cessna/Texron XX XX XX 7 - 10 208 Caravan Cessna 210 X X x 5 Centurion Fixed-Wing Aircraft - SMALL—cont’d. -

Appendix H – Noise Report
Appendix H – Noise Report H-1 DRAFT Technical Report THE OHIO STATE UNIVERSITY AIRPORT Master Plan Update Noise Contour Development Prepared for November 2018 Woolpert Inc. DRAFT Technical Report THE OHIO STATE UNIVERSITY AIRPORT Master Plan Update Noise Contour Development Prepared for November 2018 Woolpert Inc. 550 West C Street Suite 750 San Diego, CA 92101 619.719.4200 www.esassoc.com Bend Oakland San Francisco Camarillo Orlando Santa Monica Delray Beach Pasadena Sarasota Destin Petaluma Seattle IrvineIrvine Portland Sunrise Los Angeles Sacramento Tampa Miami San Diego D160608.00 OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY | ESA helps a variety of public and private sector clients plan and prepare for climate change and emerging regulations that limit GHG emissions. ESA is a registered assessor with the California Climate Action Registry, a Climate Leader, and founding reporter for the Climate Registry. ESA is also a corporate member of the U.S. Green Building Council and the Business Council on Climate Change (BC3). Internally, ESA has adopted a Sustainability Vision and Policy Statement and a plan to reduce waste and energy within our operations. This document was produced using recycled paper. TABLE OF CONTENTS OSU Master Plan Update Noise Contour Development Page 1.0 - Introduction and Overview ............................................................................................. 1 2.0 - 2037 Forecasted Aircraft Operations ........................................................................... 1 3.0 - Aircraft Fleet Mix ............................................................................................................ -

THE INCOMPLETE GUIDE to AIRFOIL USAGE David Lednicer
THE INCOMPLETE GUIDE TO AIRFOIL USAGE David Lednicer Analytical Methods, Inc. 2133 152nd Ave NE Redmond, WA 98052 [email protected] Conventional Aircraft: Wing Root Airfoil Wing Tip Airfoil 3Xtrim 3X47 Ultra TsAGI R-3 (15.5%) TsAGI R-3 (15.5%) 3Xtrim 3X55 Trener TsAGI R-3 (15.5%) TsAGI R-3 (15.5%) AA 65-2 Canario Clark Y Clark Y AAA Vision NACA 63A415 NACA 63A415 AAI AA-2 Mamba NACA 4412 NACA 4412 AAI RQ-2 Pioneer NACA 4415 NACA 4415 AAI Shadow 200 NACA 4415 NACA 4415 AAI Shadow 400 NACA 4415 ? NACA 4415 ? AAMSA Quail Commander Clark Y Clark Y AAMSA Sparrow Commander Clark Y Clark Y Abaris Golden Arrow NACA 65-215 NACA 65-215 ABC Robin RAF-34 RAF-34 Abe Midget V Goettingen 387 Goettingen 387 Abe Mizet II Goettingen 387 Goettingen 387 Abrams Explorer NACA 23018 NACA 23009 Ace Baby Ace Clark Y mod Clark Y mod Ackland Legend Viken GTO Viken GTO Adam Aircraft A500 NASA LS(1)-0417 NASA LS(1)-0417 Adam Aircraft A700 NASA LS(1)-0417 NASA LS(1)-0417 Addyman S.T.G. Goettingen 436 Goettingen 436 AER Pegaso M 100S NACA 63-618 NACA 63-615 mod AerItalia G222 (C-27) NACA 64A315.2 ? NACA 64A315.2 ? AerItalia/AerMacchi/Embraer AMX ? 12% ? 12% AerMacchi AM-3 NACA 23016 NACA 4412 AerMacchi MB.308 NACA 230?? NACA 230?? AerMacchi MB.314 NACA 230?? NACA 230?? AerMacchi MB.320 NACA 230?? NACA 230?? AerMacchi MB.326 NACA 64A114 NACA 64A212 AerMacchi MB.336 NACA 64A114 NACA 64A212 AerMacchi MB.339 NACA 64A114 NACA 64A212 AerMacchi MC.200 Saetta NACA 23018 NACA 23009 AerMacchi MC.201 NACA 23018 NACA 23009 AerMacchi MC.202 Folgore NACA 23018 NACA 23009 AerMacchi -

Air Yorkshire Aviation Society
Air Yorkshire Aviation Society Volume 42 Issue 5 May 2016 G-POWH Boeing 757-200 Titan Airways/Jet2.com Leeds/Bradford 25 March 2016 Andrew Barker www.airyorkshire.org.uk SOCIETY CONTACTS Air Yorkshire Committee 2016 Chairman David Senior 23 Queens Drive, Carlton, WF3 3RQ 0113 282 1818 [email protected] Secretary Jim Stanfield 8 Westbrook Close, Leeds, LS18 5RQ 0113 258 9968 [email protected] Treasurer David Valentine 8 St Margaret's Avenue, Horsforth, Distribution/Membership Pauline Valentine Leeds, LS18 5RY 0113 228 8143 Managing Editor Alan Sinfield 6 The Stray, Bradford, BD10 8TL Meetings coordinator 01274 619679 [email protected] Photographic Editor David Blaker [email protected] Visits Organiser Mike Storey 0113 252 6913 [email protected] Dinner Organiser John Dale 01943 875315 Publicity Howard Griffin 6 Acre Fold, Addingham, Ilkley LS29 0TH 01943 839126 (M) 07946 506451 [email protected] Plus Reynell Preston (Security), Paul Windsor (Reception/Registration) Geoff Ward & Paula Denby Code of Conduct Members should not commit any act which would bring the Society into disrepute in any way. Disclaimer the views expressed in articles in the magazine are not necessarily those of the editor and the committee. Copyright The photographs and articles in this magazine may not be reproduced in any form without the strict permission of the editor. SOCIETY ANNOUNCMENTS June magazine – Please be aware that next months magazine will be slightly late than usual as I will be away in Florida for 2 weeks prior to the publication date Photos – Please send in your photographs taken at LBA anywhere else in the world to [email protected]. -

Draft Aircraft Emissions Inventory Report
SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT DRAFT AIRCRAFT EMISSIONS INVENTORY for South Coast Air Quality Management District APRIL 2021 TABLE OF CONTENTS 1. Introduction ......................................................................................... 2 2. Emissions Inventory Methodology ....................................................... 2 2.1. List of Airports .......................................................................... 3 2.2. 2018 Aircraft Activity Data ....................................................... 5 2.3. 2023, 2031, and 2037 Activity Data .......................................... 7 3. Emissions Inventory ........................................................................... 11 Appendix A: EPA’s Emission Factors and FAA’s Survey Data ................... 17 Appendix B: Comparison with the Previous Inventory ............................ 18 Appendix C: Operations by Aircraft and Engine Model ........................... 23 1 1. Introduction As part of the development of the 2022 Air Quality Management Plan (AQMP), the aircraft emissions inventory was evaluated and updated. Specifically, an updated aircraft emissions inventory was developed for the 2018 base year and 2023, 2031, and 2037 forecast years based on the latest available activity data and calculation methodologies. The inventory is presented herein for each airport by pollutant, including VOC, CO, NOx, SO2, PM10, and PM2.5. A comparison with aircraft emissions from the 2016 AQMP is presented in Appendix B. 2. Emissions Inventory Methodology -

G:\JPH Section\ADU CODELIST\Codelist.Snp
Codelist Economic Regulation Group Aircraft By Name By CAA Code Airline By Name By CAA Code By Prefix Airport By Name By IATA Code By ICAO Code By CAA Code Codelist - Aircraft by Name Civil Aviation Authority Aircraft Name CAA code End Month AEROSPACELINES B377SUPER GUPPY 658 AEROSPATIALE (NORD)262 64 AEROSPATIALE AS322 SUPER PUMA (NTH SEA) 977 AEROSPATIALE AS332 SUPER PUMA (L1/L2) 976 AEROSPATIALE AS355 ECUREUIL 2 956 AEROSPATIALE CARAVELLE 10B/10R 388 AEROSPATIALE CARAVELLE 12 385 AEROSPATIALE CARAVELLE 6/6R 387 AEROSPATIALE CORVETTE 93 AEROSPATIALE SA315 LAMA 951 AEROSPATIALE SA318 ALOUETTE 908 AEROSPATIALE SA330 PUMA 973 AEROSPATIALE SA341 GAZELLE 943 AEROSPATIALE SA350 ECUREUIL 941 AEROSPATIALE SA365 DAUPHIN 975 AEROSPATIALE SA365 DAUPHIN/AMB 980 AGUSTA A109A / 109E 970 AGUSTA A139 971 AIRBUS A300 ( ALL FREIGHTER ) 684 AIRBUS A300-600 803 AIRBUS A300B1/B2 773 AIRBUS A300B4-100/200 683 AIRBUS A310-202 796 AIRBUS A310-300 775 AIRBUS A318 800 AIRBUS A319 804 AIRBUS A319 CJ (EXEC) 811 AIRBUS A320-100/200 805 AIRBUS A321 732 AIRBUS A330-200 801 AIRBUS A330-300 806 AIRBUS A340-200 808 AIRBUS A340-300 807 AIRBUS A340-500 809 AIRBUS A340-600 810 AIRBUS A380-800 812 AIRBUS A380-800F 813 AIRBUS HELICOPTERS EC175 969 AIRSHIP INDUSTRIES SKYSHIP 500 710 AIRSHIP INDUSTRIES SKYSHIP 600 711 ANTONOV 148/158 822 ANTONOV AN-12 347 ANTONOV AN-124 820 ANTONOV AN-225 MRIYA 821 ANTONOV AN-24 63 ANTONOV AN26B/32 345 ANTONOV AN72 / 74 647 ARMSTRONG WHITWORTH ARGOSY 349 ATR42-300 200 ATR42-500 201 ATR72 200/500/600 726 AUSTER MAJOR 10 AVIONS MUDRY CAP 10B 601 AVROLINER RJ100/115 212 AVROLINER RJ70 210 AVROLINER RJ85/QT 211 AW189 983 BAE (HS) 748 55 BAE 125 ( HS 125 ) 75 BAE 146-100 577 BAE 146-200/QT 578 BAE 146-300 727 BAE ATP 56 BAE JETSTREAM 31/32 340 BAE JETSTREAM 41 580 BAE NIMROD MR. -

TMB 2017 Noise Contours
| TABLE OF CONTENTS TMB 2017 Noise Contours Page Sections 1.0 Introduction and Overview 1 2.0 TMB ANOMS Aircraft Operations 1 3.0 Aircraft Fleet Mix 2 4.0 Stage Lengths 2 5.0 Time of Day 3 6.0 Runway Use 3 7.0 Flight Track and Flight Track Use Percentages 5 8.0 2017 DNL Noise Contours 13 9.0 2009 versus 2017 DNL Noise Contour Comparison 13 Appendices A Operations Information List of Figures Figure 1: Fixed-Wing AEDT Flight Tracks – East Flow Figure 2: Fixed-Wing AEDT Flight Tracks – West Flow Figure 3: Helicopter and Fixed-Wing Touch-and-Go AEDT Flight Tracks Figure 4: 2017 DNL Contours Figure 5: 2017 and 2009 DNL Contour Comparison Figure 6: Differences in Noise Exposure – 2009 versus 2017 DNL Contours List of Tables Table 1: 2017 Daytime and Nighttime Use Percentages 3 Table 2: 2017 Runway Use Percentages – Fixed-Wing Aircraft 4 Table 3: 2017 Runway Use Percentages – Helicopter Touch-and-Go Operations 4 Table 4: 2017 DNL Contour Areas 13 Table 5: DNL Contour Area Comparison 14 Table 6: Aircraft Operations Comparison with Nighttime-Weighted Operations 14 Table 7: Overall Runway Use Comparison 15 Miami Executive Airport i ESA / Project No. 170069.02 2017 Noise Contours December 2018 Table of Contents This Page Intentionally Blank Miami Executive Airport ii ESA / Project No. 170069.02 2017 Noise Contours December 2018 MIAMI EXECUTIVE AIRPORT 2017 Noise Contours 1.0 Introduction and Overview This report provides an analysis and overview of the noise modeling data preparation and resulting contours for the calendar year 2017 at Miami Executive Airport (TMB). -

Only One Aircraft Delivers It All
NO CONTENT HERE PUBLICATIONS Vol.49 | No.1 $9.00 JANUARY 2020 | ainonline.com ADVERTISEMENT ONLY ONE AIRCRAFT DELIVERS IT ALL. CAC1654_Longitude- Let The Revolution Begin_Make_Good_AIN Outside__10.8125x13.875_FA.indd 1 12/16/19 3:48 PM Client: Textron Aviation Ad Title: Longitude: Let The Revolution Begin Make Good AIN Outside Publication: AIN Trim: 10.8125 x 13.875" Bleed: 11.3125 x 14.375" Live: 9.8125 x 12.875" Nearly Up to Up to Proven QUIETER LESS than the closest competition SCHEDULED COST SAVINGS GARMIN AVIONICS MAINTENANCE when cruising at the same speed 60% as competitors6 G5000 There’s only one aircraft that DELIVERS IT ALL. U.S. +1.844.44.TXTAV | INTERNATIONAL +1.316.517.8270 | CESSNA.COM/LONGITUDE © 2020 Textron Aviation Inc. All rights reserved. CESSNA & DESIGN and CITATION LONGITUDE are trademarks or service marks of Textron Aviation or an affiliate and may be registered in the United States or other jurisdictions. GARMIN and G5000 are trademarks or service marks of others. CAC2104_Longitude Interior - Delivers It All_Make_Good_AIN_10.8125x13.875_FA.indd 1 12/16/19 3:46 PM Client: Textron Aviation Ad Title: Longitude Interior - Delivers It All Make Good AIN Publication: AIN Trim: 10.8125 x 13.875" Bleed: 11.3125 x 14.375" Live: 9.8125 x 12.875" PUBLICATIONS Vol.49 | No.1 $9.00 JANUARY 2020 | ainonline.com Air transport Boeing suspends 737 Max production page 50 UAV Volocopter gets EASA DOA nod page 10 Airports NBAA calls for FAA to act on SMO page 14 Safety NBAA program tackles INTOSH c human trafficking page 17 DAVID M DAVID Training Red 6 developers simplify Delta and Wheels Up to unite airborne training page 32 by Curt Epstein Regulations Delta Air Lines announced in mid-December of private aircraft. -
Cessna 441, Conquest II: Covers, Plugs, Sun Shades & More
18850 Adams Ct Phone: 408/738-3959 Morgan Hill, CA 95037 Toll Free (U.S.): 800/777-6405 www.AircraftCovers.com Fax: 408/738-2729 Email: [email protected] manufacturer of the finest custom-made aircraft covers Tech Sheet: Cessna 441, Conquest II (cessna-441.pdf) Cessna 441 Cockpit Cover Cessna 441 Cockpit Cover Section 1: Canopy/Cockpit/Fuselage Covers Canopy Covers help reduce damage to your airplane's upholstery and avionics caused by excessive heat, and they can eliminate problems caused by leaking door and window seals. They keep the windshield and window surfaces clean and help prevent vandalism and theft. The Cessna 441, Conquest II Canopy Cover is custom-designed for each model, as well as your aircraft's specific antenna and temperature probe placements, if applicable. The Canopy Cover is designed to enclose the windshield, side windows and canopy roof. The Canopy Cover attaches using adjustable "belly straps", which run under the belly and connect to the other side of the cover with a quick-release plastic buckle. When requested, it is also sometimes possible to design Canopy covers that can attach to the aircraft fuselage using pop-riveted snap-heads at the rear and snap-head screws on the engine cowl. This cover type is made from Silver Acrylic Sunbrella canvas and is 100% lined with a soft and smooth microfiber. Bruce's Custom Covers developed this material combination especially for aircraft protection. The outer material is medium weight and treated for water resistance, UV resistance and anti-static buildup. The inner lining is a very soft and smooth microfiber to prevent scratching.