Cdvr: Le Rapport Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Côte D'ivoire
CÔTE D’IVOIRE COI Compilation August 2017 United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for West Africa - RSD Unit UNHCR Côte d’Ivoire UNHCR Regional Representation for West Africa - RSD Unit UNHCR Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire COI Compilation August 2017 This report collates country of origin information (COI) on Côte d’Ivoire up to 15 August 2017 on issues of relevance in refugee status determination for Ivorian nationals. The report is based on publicly available information, studies and commentaries. It is illustrative, but is neither exhaustive of information available in the public domain nor intended to be a general report on human-rights conditions. The report is not conclusive as to the merits of any individual refugee claim. All sources are cited and fully referenced. Users should refer to the full text of documents cited and assess the credibility, relevance and timeliness of source material with reference to the specific research concerns arising from individual applications. UNHCR Regional Representation for West Africa Immeuble FAALO Almadies, Route du King Fahd Palace Dakar, Senegal - BP 3125 Phone: +221 33 867 62 07 Kora.unhcr.org - www.unhcr.org Table of Contents List of Abbreviations .............................................................................................................. 4 1 General Information ....................................................................................................... 5 1.1 Historical background ............................................................................................ -

KAS International Reports 09/2015
9|2015 KAS INTERNATIONAL REPORTS 89 ON THE OTHER SIDE OF CRISIS OR BACK ON THE BRINK? OUTLOOK ON THE 2015 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN IVORY COAST Valentin Katzer INTRODUCTION West Africa is currently running a veritable election marathon: Nigeria, Togo, Benin, Guinea, Ivory Coast, Burkina Faso, Niger, Ghana – the cards in the region are being reshuffled in the 2015 and 2016 electoral period.1 Past experience indicates that polls always prove to be a test for security, as well as social and political stability in the electoral democracies between Sahel and the Gulf Dr. Valentin Katzer of Guinea. The presidential and semi-presidential systems of the is a trainee in the Promotion region have repeatedly given rise to tension and conflict in the of Democr acy in past, and even more so where the newly elected head of state the West Africa is endowed with extensive powers. The “Présidentielles” in Ivory program of the Konrad-Adenauer- Coaste fiv years ago resulted in a particularly dramatic escalation. Stiftung. Due to the Civil War (2002/2007), the elections, which had been originally scheduled for 2005, were postponed several times, and were finally held against the backdrop of a deeply divided country. The first ballot of the belated 2010 presidential elections initially put southern incumbent Laurent Gbagbo ahead, but during the run-off, northern challenger Alassane Ouattara was certified to have received the highest number of votes by the Independent Electoral Commission (Commission Électorale Independente de Côte d’Ivoire). The Constitutional Council, however, declared Gbagbo the victor. Both candidates took their oath, resulting in two Ivorian presidents being in office at the same time. -

« Ils Les Ont Tués Comme Si De Rien N'était »
Côte d’Ivoire « Ils les ont tués comme si HUMAN RIGHTS de rien n’était » WATCH Le besoin de justice pour les crimes post-électoraux en Côte d’Ivoire « Ils les ont tués comme si de rien n’était » Le besoin de justice pour les crimes post-électoraux en Côte d’Ivoire Copyright © 2011 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-820-1 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th floor New York, NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300 [email protected] Poststraße 4-5 10178 Berlin, Germany Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629 [email protected] Avenue des Gaulois, 7 1040 Brussels, Belgium Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471 [email protected] 51, Avenue Blanc 1202 Geneva, Switzerland Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791 [email protected] 2-12 Pentonville Road, 2nd Floor London N1 9HF, UK Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800 [email protected] 27 Rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22 [email protected] 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333 [email protected] Web Site Address: http://www.hrw.org OCTOBRE 2011 1-56432-820-1 « Ils les ont tués comme si de rien n’était » Le besoin de justice pour les crimes post-électoraux en Côte d’Ivoire Cartes ............................................................................................................................... -
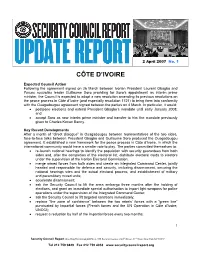
Pdf | 162.29 Kb
2 April 2007 No. 1 CÔTE D’IVOIRE Expected Council Action Following the agreement signed on 26 March between Ivorian President Laurent Gbagbo and Forces nouvelles leader Guillaume Soro providing for Soro’s appointment as interim prime minister, the Council is expected to adopt a new resolution amending its previous resolutions on the peace process in Côte d’Ivoire (and especially resolution 1721) to bring them into conformity with the Ouagadougou agreement signed between the parties on 4 March. In particular, it would: • postpone elections and extend President Gbagbo’s mandate until early January 2008; and • accept Soro as new interim prime minister and transfer to him the mandate previously given to Charles Konan Banny. Key Recent Developments After a month of “direct dialogue” in Ouagadougou between representatives of the two sides, face-to-face talks between President Gbagbo and Guillaume Soro produced the Ouagadougou agreement. It established a new framework for the peace process in Côte d’Ivoire, in which the international community would have a smaller role to play. The parties committed themselves to: • re-launch national hearings to identify the population with security guarantees from both sides and, after the completion of the electoral list, distribute electoral cards to electors under the supervision of the Ivorian Electoral Commission; • merge armed forces from both sides and create an Integrated Command Center, jointly headed and responsible for defence and security, including disarmament, securing the national hearings sites -

193 Cote D-Ivoire
CÔTE D’IVOIRE: DEFUSING TENSIONS Africa Report N°193 – 26 November 2012 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS ................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. INTERNAL TENSION, EXTERNAL THREATS ......................................................... 1 A. A DISORGANISED SECURITY SYSTEM ........................................................................................... 2 1. Too many hunters, too few gendarmes ........................................................................................ 3 2. The challenge of reintegrating ex-combatants ............................................................................. 4 B. MONROVIA, ACCRA, ABIDJAN ..................................................................................................... 6 1. Agitation in the east ..................................................................................................................... 6 2. The west: a devastated region ...................................................................................................... 8 III.A STALLED POLITICAL DIALOGUE ...................................................................... 10 A. MARGINALISATION OF THE FORMER REGIME’S SUPPORTERS ..................................................... 11 B. DANGEROUS POLITICAL POLARISATION ..................................................................................... 12 IV.JUSTICE -

Ivory Coast: “The Fight Against Impunity at a Crossroad”
IVORY COAST: “THE FIGHT AGAINST IMPUNITY AT A CROSSROAD” Article 1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person. Article 4: No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5: No one shall be subjected to torture or to cruel, October 2013/617a - © AFP/SIA KAMBOU 2 / Titre du rapport – FIDH Introduction ------------------------------------------------------------------------------------------------4 I - A political situation still highly polarised ----------------------------------------------------------6 II - The fight against impunity: between political manipulation and genuine efforts ------------9 III - National reconciliation and the Dialogue, Truth and Reconciliation Commission ------- 20 Conclusions ---------------------------------------------------------------------------------------------- -

Rapport Sur L'afrique De L'ouest
NUMÉRO 14 | OCTOBRE 2015 Rapport sur l’Afrique de l’Ouest Côte d’Ivoire 2015 : une élection pour consolider la paix ? Lori-Anne Théroux-Bénoni Résumé Le scrutin présidentiel de 2010 avait plongé la Côte d’Ivoire dans un conflit armé entrainant la mort de plus de 3 000 personnes. Il est peu probable que celui de 2015 déclenche des violences à grande échelle. Cela ne suffira toutefois pas à en faire un succès démocratique et un gage de stabilité pour l’avenir. Alors que toute l’attention est actuellement tournée vers le vote du 25 octobre, il importe de lier les questions électorales immédiates aux enjeux de stabilité à moyen et long terme pour le pays. Si des réponses efficaces ne sont pas apportées aux questions fondamentales, nouvelles et anciennes, de la crise ivoirienne, le risque d’une régression dans la dynamique de normalisation politique et sécuritaire demeurera réel. Introduction Les Ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre 2015 pour l’élection présidentielle. Dix candidats figureront sur le bulletin de vote, dont Alassane Ouattara, le président sortant. Depuis la crise postélectorale de 2010-2011 qui s’est soldée par plus de 3 000 morts, la scène politique de la Côte d’Ivoire a subi de profondes transformations. Elle demeure cependant fortement polarisée. À quelques jours du vote, de nombreux partis d’opposition continuent de remettre en cause les conditions d’organisation du scrutin. Début octobre, deux des candidats de l’opposition suspendaient leur participation au processus, estimant que les conditions d’une élection libre, démocratique et transparente n’étaient pas réunies. -

Ivory Coast OGN V4.0 2 August 2007
Ivory Coast OGN v4.0 2 August 2007 OPERATIONAL GUIDANCE NOTE IVORY COAST CONTENTS 1. Introduction 1.1 – 1.4 2. Country assessment 2.1 – 2.9 3. Main categories of claims 3.1 – 3.5 Members of the Rassemblement des Republicans (RDR) 3.6 Members of the Forces Nouvelles (FN) 3.7 Non-Ivorians and/or Muslims from the north 3.8 Female Genital Mutilation (FGM) 3.9 Prison conditions 3.10 4. Discretionary Leave 4.1 – 4.2 Minors claiming in their own right 4.3 Medical treatment 4.4 5. Returns 5.1 – 5.4 6. List of source documents 1. Introduction 1.1 This document evaluates the general, political and human rights situation in Ivory Coast and provides guidance on the nature and handling of the most common types of claims received from nationals/residents of that country, including whether claims are or are not likely to justify the granting of asylum, Humanitarian Protection or Discretionary Leave. Caseowners must refer to the relevant Asylum Instructions for further details of the policy on these areas. 1.2 This guidance must also be read in conjunction with any COI Service Ivory Coast Country of Origin Information at: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/country_reports.html 1.3 Claims should be considered on an individual basis, but taking full account of the guidance contained in this document. In considering claims where the main applicant has dependent family members who are a part of his/her claim, account must be taken of the situation of all the dependent family members included in the claim in accordance with the Asylum Instructions on Article 8 ECHR. -
Côte D'ivoire: Can the 2015 Elections Consolidate Peace?
ISSUE 14 | OCTOBER 2015 West Africa Report Côte d’Ivoire: Can the 2015 elections consolidate peace? Lori-Anne Théroux-Bénoni Summary The 2010 presidential election plunged Côte d’Ivoire into an armed conflict that resulted in the deaths of more than 3 000 people. It is unlikely that the 2015 election will trigger such large-scale violence but this alone should not be seen either as a sign of democratic success or a guarantee of stability for the future. While all the attention is turned to the 25 October ballot, immediate electoral concerns must be seen in the context of medium- and long-term stability issues. If responses to the new and old core issues are not effective the risk of a setback in the political and security dynamics to normalise the country will remain real. Introduction Ivorians will cast their votes on 25 October 2015 for the presidential election. Ten candidates, including the incumbent President Alassane Ouattara, will appear on the ballot. Since the 2010–2011 post-election violence, which left more than 3 000 dead, the political scene in the country has undergone considerable transformation. However, it remains highly polarised and, in the lead-up to the election, many opposition parties continue to contest the way the polls are organised. In early October two opposition candidates suspended their participation in the process, maintaining that the conditions for free, democratic and transparent elections had not been met. The violent protests that erupted on 10 September, after the validation of the candidacy of President Ouattara by the Constitutional Council, illustrate persistent divisions over issues that are significant for the future of the country.1 The protests revolved around Article 35 of the Constitution, which deals with the criteria for eligibility of candidates for the presidential election. -
The UN Operation in Côte D'ivoire
JUNE 2018 The Many Lives of a Peacekeeping Mission: The UN Operation in Côte d’Ivoire ALEXANDRA NOVOSSELOFF Cover Photo: Peacekeepers of the UN ABOUT THE AUTHOR Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI) provide security as legislative by- ALEXANDRA NOVOSSELOFF is a Senior Visiting Fellow at elections take place in Grand Laho, the International Peace Institute’s Brian Urquhart Center for February 26, 2012. UN Photo/Hien Peace Operations. Macline. Disclaimer: The views expressed in this paper represent those of the author ACKNOWLEDGEMENTS and not necessarily those of the International Peace Institute. IPI The author is particularly grateful to the colleagues and welcomes consideration of a wide friends who provided input and feedback on various drafts range of perspectives in the pursuit of of this report: Caroline Allibert, Arthur Boutellis, Bruno a well-informed debate on critical policies and issues in international Charbonneau, Alan Doss, Fahiraman Rodrigue Koné, Lea affairs. Koudjou, Herbert Loret, and Jake Sherman. IPI Publications This report has been written in memory of the late Adam Lupel, Vice President permanent representative of Côte d’Ivoire to the United Albert Trithart, Editor Nations, Bernard Tanoh-Boutchoué. May he rest in peace. Madeline Brennan, Associate Editor Suggested Citation: Alexandra Novosseloff, “The Many Lives of a Peacekeeping Mission: The UN Operation in Côte d’Ivoire,” New York: International Peace Institute, June 2018. © by International Peace Institute, 2018 All Rights Reserved www.ipinst.org CONTENTS Abbreviations . iii Executive Summary . 1 Introduction . 2 The Origins of the Ivorian Crisis. 3 A Historical Account (2002–2017) . 4 EARLY DAYS OF THE CIVIL WAR FROM THE LINAS-MARCOUSSIS AGREEMENT TO THE EVENTS OF NOVEMBER 2004 THE PRETORIA AGREEMENT AND UNOCI’S MANDATE FROM THE OUAGADOUGOU PEACE AGREEMENT TO THE ELECTIONS FROM THE POST-ELECTION CRISIS TO A NEW PHASE FOR CÔTE D’IVOIRE AND UNOCI DOWNSIZING OF UNOCI AND THE TRANSITION TO THE UN COUNTRY TEAM UNOCI’s Achievements and Limitations in the Implementation of Its Mandate . -
Armed Conflicts Report - Cote D'ivoire
Armed Conflicts Report - Cote d'Ivoire Armed Conflicts Report Côte d'Ivoire (2002 - first combat deaths) Update: January 2009 Summary Type of Conflict Parties to the Conflict Status of Fighting Number of Deaths Political Developments Background Arms Sources Economic Factors Because there have been few reported conflict deaths over the past two years (less than 25 per year), this armed conflict is now deemed to have ended. Summary: 2008 The 2007 peace accord continued to hold throughout 2008. Election preparations continued, with the date changing numerous times and finally being delayed until 2009. Citizenship identification processes took place throughout 2008 as well as the development and implementation of laws to address land ownership, both of which are seen as root causes to the conflict. Demobilization of militia groups did not proceed according to plan and was criticized for being delayed. Conflict was minimal throughout 2008, with between 10 and 15 deaths, reflecting the positive changes that are going on within the country. The peace agreement, although shaky, represents the country's best chance at lasting peace. The elections in 2009 could bring renewed violence if they are perceived as unfair by groups within the country, especially from the New Forces rebels who remain armed. 2007 The signing of the Ouagadougou peace accords in March 2007 have led to increasingly positive changes in Côte d’Ivoire. The agreement saw the end of a long-time rivalry between President Laurent Gbagbo and New Forces rebel leader Guillaume Soro who Gbagbo appointed to be his Prime Minister. Working together the men have created a new interim government, demilitarized a buffer zone that had separated the north and south for five years, and have begun a voter identification process to ensure citizens a vote in the upcoming elections (tentatively scheduled for October 2008). -

176 a Critical Period for Ensuring Stability in Cote Divoire
A CRITICAL PERIOD FOR ENSURING STABILITY IN CÔTE D’IVOIRE Africa Report N°176 – 1 August 2011 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS ................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. THE SECURITY CHALLENGE .................................................................................... 3 A. FRAGMENTED FORCES ................................................................................................................. 3 B. MULTIPLE THREATS .................................................................................................................... 5 C. FILL THE SECURITY VACUUM ...................................................................................................... 6 III. RECONCILIATION AND JUSTICE ............................................................................. 8 A. A BLOODY CONFLICT .................................................................................................................. 8 B. AN END TO IMPUNITY ................................................................................................................ 10 IV. CREATE THE CONDITIONS FOR POLITICAL NORMALISATION ................. 12 V. AN ECONOMIC EMERGENCY .................................................................................. 14 VI. CONCLUSION ................................................................................................................ 16 APPENDICES